Méningite à Pneumocoques : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
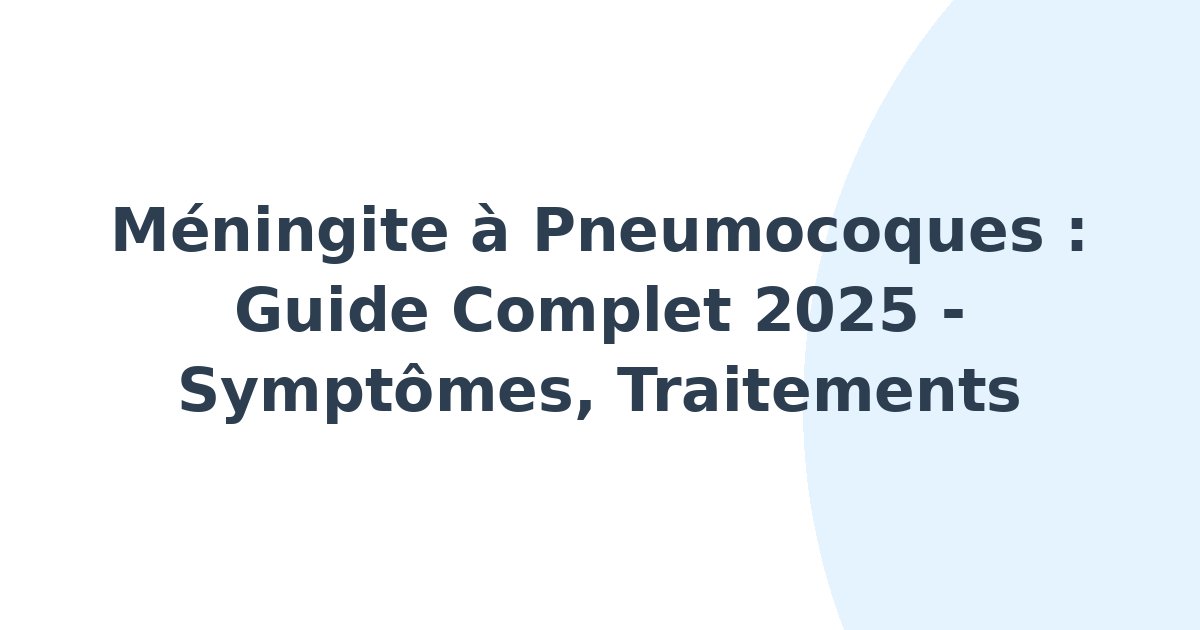
La méningite à pneumocoques représente une urgence médicale absolue qui touche environ 400 personnes chaque année en France [2]. Cette infection grave des méninges, causée par la bactérie Streptococcus pneumoniae, nécessite une prise en charge immédiate. Heureusement, les innovations thérapeutiques 2024-2025 offrent de nouveaux espoirs [1,3]. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette pathologie.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Méningite à Pneumocoques : Définition et Vue d'Ensemble
La méningite à pneumocoques est une infection bactérienne grave qui affecte les méninges, ces membranes protectrices qui entourent le cerveau et la moelle épinière [15]. Causée par Streptococcus pneumoniae, cette pathologie représente l'une des formes les plus sévères de méningites bactériennes.
Mais qu'est-ce qui rend cette maladie si particulière ? D'abord, sa rapidité d'évolution. En quelques heures seulement, une personne en bonne santé peut développer des symptômes graves nécessitant une hospitalisation d'urgence [2]. Le pneumocoque est une bactérie encapsulée qui possède une capacité remarquable à franchir la barrière hémato-encéphalique.
Il faut savoir que cette bactérie fait partie de la flore normale du nasopharynx chez 5 à 10% de la population adulte [15]. Cependant, dans certaines circonstances, elle peut devenir pathogène et provoquer des infections invasives. L'important à retenir, c'est que tous les porteurs ne développent pas la maladie.
Concrètement, la méningite à pneumocoques se caractérise par une inflammation aiguë des méninges avec présence de liquide céphalorachidien purulent. Cette inflammation peut s'étendre aux structures cérébrales adjacentes, créant des complications neurologiques graves [12].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, l'incidence de la méningite à pneumocoques a considérablement évolué ces dernières années. Selon les données récentes, on observe environ 400 à 500 cas annuels, soit une incidence de 0,6 à 0,8 pour 100 000 habitants [13]. Cette diminution notable s'explique principalement par l'introduction des vaccins conjugués.
L'analyse du fardeau hospitalier entre 2013 et 2019 révèle des tendances intéressantes [13]. Les adultes représentent désormais la majorité des cas, avec un pic d'incidence chez les personnes âgées de plus de 65 ans. D'ailleurs, cette tranche d'âge concentre près de 60% des cas graves nécessitant une admission en réanimation [10].
Mais les chiffres varient selon les régions françaises. Les départements d'outre-mer présentent des taux d'incidence légèrement supérieurs, probablement liés à des facteurs socio-économiques et climatiques spécifiques. En métropole, certaines régions comme le Nord-Pas-de-Calais affichent des taux plus élevés.
Au niveau mondial, l'Organisation Mondiale de la Santé estime que les infections pneumococciques causent environ 1,6 million de décès annuels [1]. Les pays en développement sont particulièrement touchés, avec des taux de mortalité pouvant atteindre 50% en l'absence de traitement approprié.
L'évolution temporelle montre une tendance encourageante. Depuis l'introduction des nouveaux vaccins obligatoires pour les nourrissons [3], on observe une diminution progressive de l'incidence chez les jeunes enfants. Cette protection indirecte bénéficie également aux adultes non vaccinés grâce à l'immunité de groupe.
Les Causes et Facteurs de Risque
Le Streptococcus pneumoniae ne devient pathogène que dans certaines circonstances bien définies. Plusieurs facteurs de risque augmentent considérablement la probabilité de développer une méningite à pneumocoques [15].
L'âge constitue le premier facteur déterminant. Les nourrissons de moins de 2 ans et les adultes de plus de 65 ans présentent un risque accru. Chez les tout-petits, l'immaturité du système immunitaire explique cette vulnérabilité. Chez les seniors, c'est l'immunosénescence qui joue un rôle clé.
Certaines pathologies prédisposent particulièrement à cette infection. L'asplénie, qu'elle soit anatomique ou fonctionnelle, multiplie le risque par 20 à 50 [15]. Les déficits immunitaires, congénitaux ou acquis, représentent également des facteurs majeurs. D'ailleurs, les patients sous immunosuppresseurs nécessitent une surveillance particulière.
Les traumatismes crâniens avec brèche ostéo-méningée créent une porte d'entrée directe pour les pneumocoques. De même, certaines interventions neurochirurgicales augmentent temporairement le risque infectieux. Il est important de noter que l'alcoolisme chronique et le tabagisme constituent aussi des facteurs de risque significatifs.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la méningite à pneumocoques apparaissent généralement de façon brutale et évoluent rapidement [2]. La triade classique associe fièvre élevée, céphalées intenses et raideur de nuque. Mais attention, cette triade complète n'est présente que dans 60% des cas.
La fièvre, souvent supérieure à 39°C, s'accompagne de frissons et d'une altération rapide de l'état général. Les céphalées se caractérisent par leur intensité exceptionnelle, souvent décrites comme "la pire douleur de ma vie" par les patients. Ces douleurs résistent aux antalgiques habituels.
D'autres signes doivent alerter immédiatement. Les vomissements en jet, sans rapport avec l'alimentation, constituent un symptôme précoce fréquent [2]. La photophobie et la phonophobie traduisent l'irritation méningée. Chez certains patients, on observe des troubles de la conscience allant de la simple confusion au coma profond.
Bon à savoir : chez les personnes âgées, la présentation peut être atypique. L'absence de fièvre ou de raideur de nuque ne doit pas faire écarter le diagnostic. Parfois, seuls des troubles du comportement ou une confusion inexpliquée orientent vers cette pathologie.
Les signes cutanés méritent une attention particulière. Bien que moins fréquents que dans les méningites à méningocoques, des éléments purpuriques peuvent apparaître et témoignent d'une forme particulièrement grave.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de méningite à pneumocoques repose sur un faisceau d'arguments cliniques, biologiques et bactériologiques [2]. Face à une suspicion clinique, chaque minute compte pour confirmer le diagnostic et débuter le traitement.
L'examen clinique recherche systématiquement les signes méningés classiques. Le signe de Kernig et le signe de Brudzinski permettent d'objectiver la raideur méningée. Cependant, leur absence n'élimine pas le diagnostic, particulièrement chez les sujets âgés ou immunodéprimés.
La ponction lombaire constitue l'examen de référence pour confirmer le diagnostic. Elle doit être réalisée en urgence, idéalement avant la première dose d'antibiotiques, mais ne doit jamais retarder le traitement [8]. Le liquide céphalorachidien présente un aspect trouble ou purulent caractéristique.
L'analyse du LCR révèle une pléocytose à prédominance de polynucléaires neutrophiles, généralement supérieure à 1000 éléments/mm³. La protéinorachie est élevée (> 0,5 g/L) tandis que la glycorachie est effondrée (< 0,4 g/L) [2]. Ces anomalies traduisent l'inflammation méningée intense.
L'identification bactériologique s'effectue par examen direct, culture et recherche d'antigènes solubles. Les techniques de biologie moléculaire, comme la PCR, permettent un diagnostic rapide même après début de l'antibiothérapie. D'ailleurs, ces méthodes modernes ont considérablement amélioré la rapidité diagnostique.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de la méningite à pneumocoques constitue une urgence thérapeutique absolue [8]. L'antibiothérapie doit être débutée dans les plus brefs délais, idéalement dans l'heure suivant l'arrivée aux urgences. Chaque heure de retard augmente significativement le risque de complications neurologiques.
Les céphalosporines de troisième génération représentent le traitement de première intention. La ceftriaxone, administrée à la dose de 2g toutes les 12 heures par voie intraveineuse, constitue le standard thérapeutique [8]. En cas d'allergie aux bêta-lactamines, la vancomycine associée au chloramphénicol peut être utilisée.
Mais l'émergence de souches résistantes complique parfois la prise en charge. Face à une suspicion de résistance à la pénicilline, l'association ceftriaxone-vancomycine est recommandée en première intention. Les tests de sensibilité guident ensuite l'adaptation thérapeutique.
La corticothérapie adjuvante fait l'objet de recommandations précises [14]. La dexaméthasone, administrée avant ou simultanément à la première dose d'antibiotiques, réduit significativement le risque de complications neurologiques et auditives. Cette approche est particulièrement bénéfique chez l'adulte.
La durée du traitement varie généralement de 10 à 14 jours, selon l'évolution clinique et biologique. Un contrôle du liquide céphalorachidien n'est pas systématiquement nécessaire si l'évolution est favorable. L'important est de surveiller étroitement l'apparition de complications.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge de la méningite à pneumocoques avec plusieurs innovations prometteuses [7,9]. Les recherches actuelles se concentrent sur l'optimisation des traitements existants et le développement de nouvelles approches thérapeutiques.
L'essai clinique AddaMap représente une avancée majeure dans ce domaine [9]. Cette étude de phase II évalue l'ajout de daptomycine au traitement standard chez l'adulte. Les premiers résultats montrent une amélioration significative de la pénétration antibiotique dans le liquide céphalorachidien, ouvrant de nouvelles perspectives thérapeutiques.
La pharmacocinétique de la daptomycine dans le système nerveux central fait l'objet d'études approfondies [7]. Cette molécule présente des propriétés intéressantes contre les souches résistantes de pneumocoques. Son profil de diffusion méningée pourrait révolutionner la prise en charge des formes compliquées.
Parallèlement, les stratégies vaccinales évoluent rapidement [1,3,4]. L'OMS souligne qu'une meilleure utilisation des vaccins pourrait réduire l'usage d'antibiotiques de 2,5 milliards de doses annuellement [1]. Cette approche préventive s'inscrit dans la lutte contre l'antibiorésistance.
La Semaine européenne de la vaccination 2025 met l'accent sur le renforcement de l'engagement collectif [4]. Les nouveaux vaccins obligatoires pour les nourrissons [3] s'accompagnent d'une extension des recommandations vaccinales pour certaines populations à risque [5].
Vivre au Quotidien avec les Séquelles
Après une méningite à pneumocoques, la vie ne reprend pas toujours son cours normal. Environ 20 à 30% des survivants conservent des séquelles neurologiques plus ou moins importantes [12]. Ces complications peuvent affecter profondément la qualité de vie et nécessitent un accompagnement spécialisé.
Les troubles auditifs représentent les séquelles les plus fréquentes. La surdité, partielle ou complète, touche près de 15% des patients survivants. Cette complication résulte de l'atteinte de l'oreille interne par l'inflammation méningée. Heureusement, les appareils auditifs modernes permettent souvent une compensation efficace.
Les troubles cognitifs constituent une autre préoccupation majeure. Difficultés de concentration, troubles de la mémoire, ralentissement psychomoteur peuvent persister plusieurs mois après la guérison. Ces symptômes nécessitent parfois une rééducation neuropsychologique prolongée.
Certains patients développent des vascularites cérébrales [12], complications rares mais graves qui peuvent provoquer des accidents vasculaires cérébraux. Le suivi neurologique régulier permet de dépister précocement ces complications et d'adapter la prise en charge.
L'important à retenir, c'est que chaque personne réagit différemment. Certains récupèrent complètement en quelques semaines, tandis que d'autres nécessitent un accompagnement prolongé. Le soutien familial et l'aide de professionnels spécialisés jouent un rôle crucial dans ce processus de récupération.
Les Complications Possibles
La méningite à pneumocoques peut entraîner des complications graves, même avec un traitement approprié [10,12]. Ces complications peuvent survenir pendant la phase aiguë ou apparaître secondairement, nécessitant une surveillance prolongée.
L'œdème cérébral représente la complication la plus redoutable en phase aiguë. Il peut provoquer une hypertension intracrânienne avec risque d'engagement cérébral. Cette complication explique pourquoi certains patients nécessitent une admission directe en réanimation [10]. La surveillance neurologique rapprochée permet de détecter précocement les signes d'aggravation.
Les complications vasculaires méritent une attention particulière [12]. Les vascularites cérébrales, bien que rares, peuvent provoquer des accidents vasculaires cérébraux ischémiques ou hémorragiques. Ces complications surviennent généralement dans les premiers jours du traitement et nécessitent une prise en charge neurologique spécialisée.
Certains patients développent des collections intracrâniennes : abcès cérébraux, empyèmes sous-duraux ou épiduraux. Ces complications nécessitent souvent un drainage neurochirurgical en urgence. Le pronostic dépend largement de la rapidité de la prise en charge.
Il faut également mentionner les complications systémiques. Le choc septique peut compliquer l'évolution, particulièrement chez les patients fragiles. L'insuffisance rénale aiguë, les troubles de la coagulation et l'insuffisance surrénalienne représentent d'autres complications possibles nécessitant une prise en charge multidisciplinaire.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la méningite à pneumocoques s'est considérablement amélioré ces dernières décennies grâce aux progrès thérapeutiques [8,10]. Cependant, cette pathologie reste grevée d'une mortalité et d'une morbidité significatives, particulièrement chez certaines populations à risque.
La mortalité globale se situe actuellement entre 15 et 25% selon les séries [10]. Ce taux varie considérablement selon l'âge du patient, ses comorbidités et la rapidité de la prise en charge. Chez les patients de moins de 50 ans sans facteur de risque, la mortalité descend à moins de 10%. En revanche, elle peut dépasser 40% chez les sujets âgés avec comorbidités.
L'admission directe en réanimation, nécessaire dans environ 30% des cas, constitue un facteur pronostique important [10]. Ces patients présentent généralement des formes plus sévères avec complications neurologiques ou hémodynamiques. Paradoxalement, cette prise en charge précoce en soins intensifs améliore significativement le pronostic.
Parmi les survivants, environ 70% récupèrent complètement sans séquelle [8]. Les 30% restants conservent des séquelles de gravité variable : troubles auditifs, déficits neurologiques focaux, troubles cognitifs ou épilepsie post-infectieuse. Ces séquelles peuvent nécessiter une prise en charge prolongée et multidisciplinaire.
L'important à retenir, c'est que le pronostic dépend largement de la précocité du diagnostic et du traitement. Chaque heure compte dans cette course contre la montre. Les innovations thérapeutiques récentes [7,9] laissent espérer une amélioration future de ces résultats.
Peut-on Prévenir la Méningite à Pneumocoques ?
La prévention de la méningite à pneumocoques repose principalement sur la vaccination [1,3,5]. Cette stratégie préventive a révolutionné l'épidémiologie de cette pathologie depuis l'introduction des vaccins conjugués au début des années 2000.
Les nouveaux vaccins obligatoires pour les nourrissons [3] incluent désormais la vaccination antipneumococcique dès l'âge de 2 mois. Le schéma vaccinal comprend deux injections à 2 et 4 mois, suivies d'un rappel à 11 mois. Cette vaccination précoce protège efficacement contre les sérotypes les plus virulents.
Chez l'adulte, les recommandations vaccinales évoluent constamment [5]. Les personnes de plus de 65 ans, les patients immunodéprimés, aspléniques ou porteurs de certaines pathologies chroniques bénéficient d'une vaccination spécifique. Le vaccin polysaccharidique 23-valent est généralement recommandé dans ces situations.
La Semaine européenne de la vaccination 2025 souligne l'importance de renforcer l'engagement collectif [4]. L'immunité de groupe obtenue par une couverture vaccinale élevée protège indirectement les personnes non vaccinées. Cette protection communautaire s'avère particulièrement importante pour les populations vulnérables.
D'autres mesures préventives complètent la vaccination. L'éviction du tabagisme, la limitation de la consommation d'alcool et le traitement optimal des pathologies prédisposantes réduisent le risque infectieux. Chez les patients à très haut risque, une antibioprophylaxie peut être discutée au cas par cas.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises et internationales ont établi des recommandations précises pour la prise en charge de la méningite à pneumocoques [1,3,8]. Ces guidelines, régulièrement mises à jour, intègrent les dernières avancées scientifiques et thérapeutiques.
La Haute Autorité de Santé (HAS) insiste sur la nécessité d'une prise en charge hospitalière immédiate dès la suspicion diagnostique. Le délai entre l'arrivée aux urgences et la première dose d'antibiotiques ne doit pas excéder une heure [8]. Cette recommandation s'appuie sur des données probantes montrant l'impact pronostique de la précocité thérapeutique.
Concernant l'antibiothérapie, les recommandations privilégient les céphalosporines de troisième génération en première intention [8]. L'adaptation selon l'antibiogramme reste indispensable face à l'émergence de résistances. Les sociétés savantes recommandent également l'usage systématique de corticostéroïdes en adjuvant.
L'Organisation Mondiale de la Santé met l'accent sur la prévention vaccinale [1]. Ses recommandations soulignent qu'une meilleure utilisation des vaccins pourrait considérablement réduire l'incidence des infections pneumococciques. Cette approche s'inscrit dans une stratégie globale de lutte contre l'antibiorésistance.
Les nouvelles recommandations 2024-2025 intègrent les innovations thérapeutiques récentes [7,9]. L'utilisation de la daptomycine en complément du traitement standard fait l'objet d'évaluations en cours. Ces évolutions témoignent de la dynamique de recherche dans ce domaine.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs organismes et associations accompagnent les patients et leurs familles confrontés à la méningite à pneumocoques. Ces structures offrent un soutien précieux tant sur le plan médical qu'humain.
L'Association Audition Solidarité propose un accompagnement spécialisé pour les patients présentant des séquelles auditives. Cette association met en relation les familles avec des professionnels de l'audition et organise des groupes de parole. Son expertise dans l'appareillage auditif s'avère particulièrement utile.
La Fondation pour la Recherche Médicale finance de nombreux projets de recherche sur les méningites bactériennes. Elle informe également le grand public sur les avancées scientifiques et les mesures préventives. Ses publications vulgarisées permettent de mieux comprendre cette pathologie complexe.
Au niveau local, les Centres Hospitaliers Universitaires proposent souvent des consultations de suivi spécialisées. Ces consultations multidisciplinaires réunissent neurologues, infectiologues et rééducateurs. Elles permettent un suivi personnalisé et une prise en charge globale des séquelles.
Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) jouent un rôle crucial pour les patients conservant des séquelles importantes. Elles évaluent les besoins et orientent vers les aides appropriées : allocation adulte handicapé, reconnaissance de travailleur handicapé, aménagements du poste de travail.
N'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin traitant pour obtenir les coordonnées de ces structures. Le soutien social et psychologique fait partie intégrante de la prise en charge de cette pathologie.
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec les conséquences d'une méningite à pneumocoques ou accompagner un proche dans cette épreuve nécessite des adaptations concrètes au quotidien. Voici nos conseils pratiques basés sur l'expérience des patients et des professionnels de santé.
Pour les troubles auditifs, n'attendez pas pour consulter un audioprothésiste. L'appareillage précoce améliore significativement la qualité de vie et limite l'isolement social. Pensez également aux aides techniques : amplificateurs téléphoniques, systèmes d'alerte vibrante, sous-titrage automatique sur les appareils numériques.
En cas de troubles cognitifs persistants, organisez votre quotidien avec des outils simples. Utilisez des agendas, des rappels sur smartphone, des listes de tâches. La rééducation neuropsychologique peut considérablement améliorer ces fonctions. N'hésitez pas à en parler avec votre neurologue.
Sur le plan professionnel, le dialogue avec votre employeur s'avère essentiel. Le médecin du travail peut proposer des aménagements : horaires adaptés, poste de travail ergonomique, temps partiel thérapeutique. Ces mesures facilitent la réinsertion professionnelle.
Pour les proches, l'accompagnement psychologique peut s'avérer nécessaire. Cette épreuve génère souvent anxiété et stress post-traumatique. Les groupes de parole permettent de partager l'expérience avec d'autres familles ayant vécu la même situation.
Enfin, maintenez un suivi médical régulier même après la guérison apparente. Certaines complications peuvent survenir à distance. Votre médecin traitant coordonne ce suivi avec les spécialistes concernés.
Quand Consulter un Médecin ?
Reconnaître les signes d'alarme de la méningite à pneumocoques peut sauver des vies [2]. Cette pathologie constitue une urgence médicale absolue qui ne tolère aucun retard diagnostique. Voici les situations qui doivent vous amener à consulter immédiatement.
Consultez en urgence si vous présentez l'association de fièvre élevée, maux de tête intenses et vomissements. Cette triade, même incomplète, doit faire suspecter une méningite. N'attendez pas que tous les symptômes soient présents : chaque heure compte dans cette pathologie.
Chez l'enfant, soyez particulièrement vigilant aux signes suivants : pleurs inconsolables, refus de s'alimenter, somnolence anormale ou au contraire agitation. La fontanelle bombée chez le nourrisson constitue un signe d'alarme majeur. Les convulsions nécessitent un appel immédiat au SAMU.
Certaines situations augmentent le niveau d'alerte. Si vous présentez des facteurs de risque (immunodépression, asplénie, antécédent de traumatisme crânien), ne minimisez aucun symptôme évocateur. De même, si vous revenez d'un voyage en zone d'endémie méningococcique.
Pour les patients ayant survécu à une méningite, consultez rapidement en cas de : nouveaux troubles neurologiques, aggravation de séquelles existantes, convulsions, troubles de l'équilibre persistants. Ces signes peuvent témoigner de complications tardives nécessitant une prise en charge spécialisée.
En cas de doute, n'hésitez jamais à appeler le 15 (SAMU) ou à vous rendre directement aux urgences. Il vaut mieux consulter pour rien que de passer à côté d'une méningite débutante.
Questions Fréquentes
La méningite à pneumocoques est-elle contagieuse ?Non, contrairement à la méningite à méningocoques, la méningite à pneumocoques n'est pas contagieuse. Il n'y a pas de risque de transmission directe entre personnes. Aucune mesure d'isolement n'est nécessaire.
Peut-on avoir plusieurs fois une méningite à pneumocoques ?
C'est possible mais rare. Les récidives surviennent généralement chez des patients présentant des facteurs de risque persistants : brèche ostéo-méningée, déficit immunitaire, asplénie. Un bilan étiologique approfondi est alors nécessaire.
La vaccination protège-t-elle à 100% ?
Non, aucun vaccin n'offre une protection absolue. Les vaccins antipneumococciques protègent contre les sérotypes les plus fréquents et virulents, mais d'autres sérotypes peuvent causer la maladie. Cependant, la vaccination réduit considérablement le risque [3,5].
Combien de temps durent les séquelles ?
Cela varie énormément d'un patient à l'autre. Certaines séquelles, comme la surdité, sont définitives. D'autres, comme les troubles cognitifs, peuvent s'améliorer progressivement sur plusieurs mois ou années avec une rééducation appropriée.
Faut-il éviter certaines activités après une méningite ?
Les restrictions dépendent des séquelles présentes. En cas de troubles de l'équilibre, certaines activités sportives peuvent être déconseillées. Votre médecin vous guidera selon votre situation personnelle. La plupart des patients reprennent une vie normale.
Questions Fréquentes
La méningite à pneumocoques est-elle contagieuse ?
Non, contrairement à la méningite à méningocoques, la méningite à pneumocoques n'est pas contagieuse. Il n'y a pas de risque de transmission directe entre personnes.
Peut-on avoir plusieurs fois une méningite à pneumocoques ?
C'est possible mais rare. Les récidives surviennent généralement chez des patients présentant des facteurs de risque persistants comme une brèche ostéo-méningée ou un déficit immunitaire.
La vaccination protège-t-elle à 100% ?
Non, aucun vaccin n'offre une protection absolue. Les vaccins antipneumococciques protègent contre les sérotypes les plus fréquents mais d'autres peuvent causer la maladie.
Combien de temps durent les séquelles ?
Cela varie énormément. Certaines séquelles comme la surdité sont définitives, d'autres comme les troubles cognitifs peuvent s'améliorer avec une rééducation appropriée.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Une meilleure utilisation des vaccins pourrait réduire l'usage d'antibiotiques de 2,5 milliards de doses annuellementLien
- [2] Méningite : symptômes, diagnostic et évolutionLien
- [3] De nouveaux vaccins obligatoires pour les nourrissonsLien
- [4] Semaine européenne de la vaccination 2025 : renforcer l'engagement collectifLien
- [5] Pneumococcal vaccinesLien
- [7] Pharmacocinétique de la daptomycine dans le plasma et le liquide céphalorachidien au cours de la méningite à pneumocoqueLien
- [8] Antibiothérapie des méningites bactériennesLien
- [9] Ajout de daptomycine dans le traitement de la méningite à pneumocoques : premiers résultats de l'essai AddaMapLien
- [10] Impact de l'admission directe en réanimation des méningites à pneumocoques en FranceLien
- [12] Prévalence et facteurs associés aux vascularites cérébrales dans les méningites à Streptococcus pneumoniaeLien
- [13] Fardeau hospitalier des infections invasives à pneumocoque chez les adultes en France entre 2013 et 2019Lien
- [14] L'utilisation de la corticothérapie dans la prévention des complications neurologiques auditivesLien
- [15] Infections pneumococciquesLien
Publications scientifiques
- Pharmacocinétique de la daptomycine dans le plasma et le liquide céphalorachidien au cours de la méningite à pneumocoque (2025)
- Antibiothérapie des méningites bactériennes (2024)3 citations[PDF]
- Ajout de daptomycine dans le traitement de la méningite à pneumocoques (MaP) de l'adulte: 1er résultats de l'essai de phase II AddaMap (2025)
- Impact de l'admission directe en réanimation des méningites à pneumocoques en France: analyse rétrospective d'une base de données médico-administrative … (2023)
- Réactivation du virus de l'herpès simplex de type 1 (HSV-1) après une méningite à Streptococcus pneumoniae: observation d'un cas (2025)
Ressources web
- Infections pneumococciques (msdmanuals.com)
Le diagnostic de méningite à pneumocoque nécessite de faire une ponction lombaire (rachicentèse) pour prélever un échantillon du liquide entourant le cerveau ...
- Méningite à pneumocoques (doctissimo.fr)
14 déc. 2016 — Les symptômes et le diagnostic de la méningite à pneumocoque · Fièvre (> 38,5°C) avec une sensation de malaise et des frissons ; · Violents maux ...
- Méningite : symptômes, diagnostic et évolution (ameli.fr)
26 févr. 2025 — Les méningites se manifestent par un syndrome méningé (maux de tête, photophobie, vomissements, raideur de la nuque, fièvre). Après avoir ...
- Méningites à méningocoques :symptômes, traitement, ... (pasteur.fr)
La méningite associe un syndrome infectieux (fièvre, maux de tête violents, vomissements) et un syndrome méningé (raideur de la nuque, léthargie, troubles de ...
- Méningites à pneumocoque : actualités, perspectives (srlf.org)
de M Auburtin · 2001 · Cité 12 fois — Les foyers associés aux méningites à pneumocoque sont ORL (15 % des cas : sinusite, otite, mastoïdite), pleuro-pulmonaire (5–10 %) et plus rarement endo- ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
