Méningite à Méningocoques : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitement
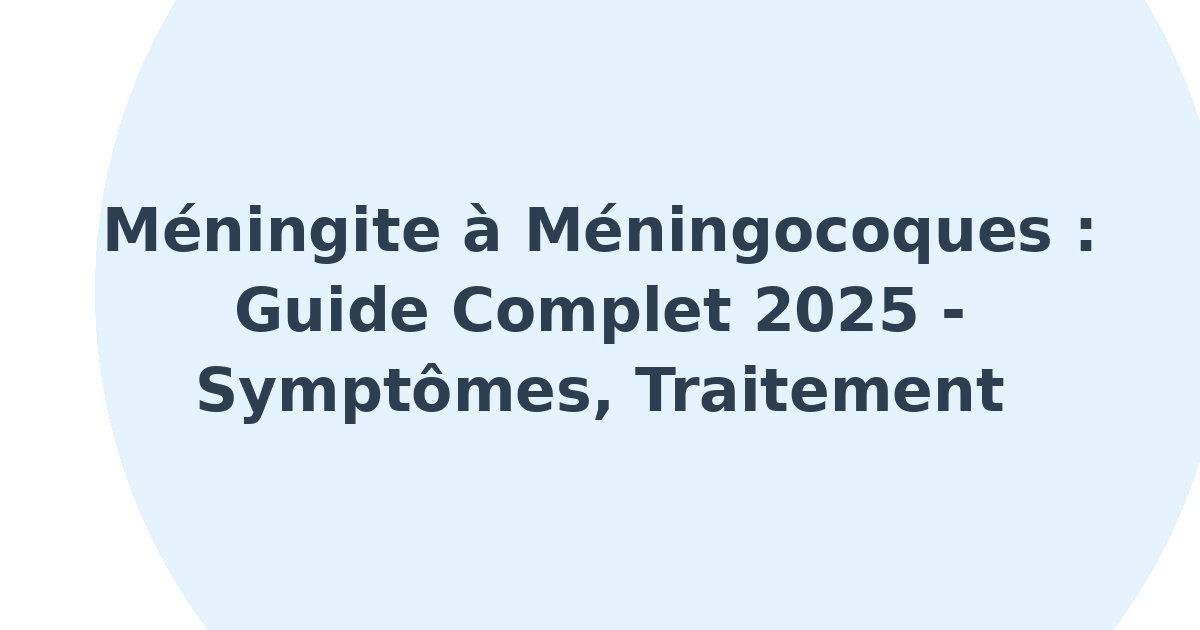
La méningite à méningocoques représente une urgence médicale absolue qui peut bouleverser une vie en quelques heures. Cette infection bactérienne grave touche les méninges, ces membranes protectrices qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Chaque année en France, environ 500 à 600 cas sont recensés, avec une mortalité qui reste préoccupante malgré les progrès thérapeutiques [1,15]. Comprendre cette pathologie, c'est pouvoir agir rapidement face aux premiers signes.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Méningite à Méningocoques : Définition et Vue d'Ensemble
La méningite à méningocoques est une infection bactérienne causée par Neisseria meningitidis, une bactérie qui s'attaque aux méninges. Ces fines membranes protègent votre cerveau et votre moelle épinière comme un cocon protecteur.
Mais cette bactérie ne s'arrête pas là. Elle peut également provoquer une septicémie méningococcique, une infection généralisée du sang qui met la vie en danger. D'ailleurs, c'est souvent cette forme qui cause le plus de décès [15,16].
Il existe plusieurs sérogroupes de méningocoques, désignés par des lettres : A, B, C, W, X et Y. En France, les sérogroupes B et C sont les plus fréquents, représentant environ 70% des cas selon les données de Santé publique France [1]. Le sérotype B touche particulièrement les nourrissons et les jeunes enfants.
L'important à retenir : cette pathologie évolue très rapidement. Entre les premiers symptômes et les complications graves, il peut s'écouler seulement quelques heures. C'est pourquoi on parle d'urgence médicale absolue.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, l'incidence de la méningite à méningocoques s'établit autour de 1 cas pour 100 000 habitants par an, soit environ 500 à 600 cas annuels [1]. Cette incidence a considérablement diminué depuis l'introduction des vaccins conjugués, notamment contre le sérogroupe C.
Les données de surveillance montrent une répartition particulière selon l'âge. Les nourrissons de moins d'un an présentent le taux d'incidence le plus élevé, avec environ 10 cas pour 100 000. Un second pic survient chez les adolescents et jeunes adultes de 15 à 24 ans [1,15].
Géographiquement, certaines régions françaises connaissent des variations notables. La région Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France rapportent traditionnellement des incidences légèrement supérieures à la moyenne nationale [9,10].
Au niveau mondial, l'Afrique subsaharienne reste la zone la plus touchée, particulièrement la "ceinture de la méningite" qui s'étend du Sénégal à l'Éthiopie. Les épidémies y surviennent cycliquement, principalement causées par le sérogroupe A [8,11]. Heureusement, l'introduction du vaccin conjugué A a considérablement réduit l'incidence dans cette région depuis 2010.
Concrètement, la mortalité reste préoccupante : elle varie entre 8 et 15% selon les sérogroupes et l'âge des patients. Chez les survivants, 10 à 20% gardent des séquelles neurologiques permanentes [1,16].
Les Causes et Facteurs de Risque
Le méningocoque se transmet exclusivement d'humain à humain par les gouttelettes respiratoires. Tousser, éternuer, embrasser ou simplement parler à proximité peut suffire à la transmission. Mais rassurez-vous : la bactérie est fragile et ne survit pas longtemps dans l'environnement [15].
Certaines personnes portent la bactérie dans leur gorge sans développer la maladie. On les appelle "porteurs sains". Environ 10 à 15% de la population générale sont porteurs asymptomatiques, ce pourcentage pouvant atteindre 25% chez les adolescents et jeunes adultes [1,15].
Plusieurs facteurs augmentent le risque de développer une méningite à méningocoques. L'âge constitue le premier facteur : les nourrissons de moins de 2 ans et les adolescents de 15 à 19 ans sont particulièrement vulnérables. Leur système immunitaire est soit immature, soit en pleine maturation [16].
D'autres facteurs de risque incluent les déficits immunitaires, qu'ils soient congénitaux ou acquis. Les personnes sans rate (asplénie) ou avec une rate non fonctionnelle présentent un risque multiplié par 50 à 100. Les déficits en complément, ces protéines qui aident à combattre les infections, augmentent également considérablement le risque [12,16].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la méningite à méningocoques peuvent être trompeurs au début. Ils ressemblent souvent à ceux d'une grippe banale, ce qui retarde parfois le diagnostic. Mais attention : l'évolution peut être foudroyante [1,15].
Les signes classiques de méningite incluent des maux de tête intenses et inhabituels, souvent décrits comme "le pire mal de tête de ma vie". La raideur de nuque est également caractéristique : impossible de toucher le menton avec la poitrine. La fièvre élevée, souvent supérieure à 39°C, s'accompagne de frissons [1,16].
Chez les nourrissons, les symptômes sont plus subtils et donc plus difficiles à repérer. Ils peuvent présenter une fièvre, des vomissements, une somnolence inhabituelle ou au contraire une irritabilité extrême. La fontanelle (partie molle du crâne) peut être bombée et tendue [15].
Le signe le plus redoutable reste l'éruption cutanée de la septicémie méningococcique. Ces taches rouges ou violacées (purpura) ne disparaissent pas quand on appuie dessus avec un verre transparent. Elles peuvent apparaître n'importe où sur le corps et s'étendent rapidement [1,15,16].
D'autres symptômes peuvent survenir : vomissements en jet, photophobie (gêne à la lumière), troubles de la conscience, convulsions. Chez l'adolescent, des douleurs dans les jambes sont parfois le premier signe [12].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Face à une suspicion de méningite à méningocoques, chaque minute compte. Le diagnostic repose sur un faisceau d'arguments cliniques et biologiques que votre médecin va analyser rapidement [16].
L'examen clinique recherche d'abord les signes méningés classiques. Le médecin teste la raideur de nuque par des manœuvres spécifiques comme le signe de Kernig ou de Brudzinski. Il examine minutieusement votre peau à la recherche du moindre purpura [1,12].
La ponction lombaire reste l'examen de référence pour confirmer le diagnostic. Cette procédure consiste à prélever du liquide céphalorachidien (LCR) au niveau du bas du dos. Rassurez-vous : elle est réalisée sous anesthésie locale et les complications sont rares [12,16].
L'analyse du LCR révèle des anomalies caractéristiques : augmentation des globules blancs (principalement des polynucléaires neutrophiles), diminution du glucose et augmentation des protéines. La recherche directe de la bactérie par examen microscopique et culture permet d'identifier le sérogroupe [12].
Parallèlement, des examens sanguins sont réalisés : numération formule sanguine, CRP, procalcitonine, hémocultures. Un scanner cérébral peut être nécessaire avant la ponction lombaire si des signes d'hypertension intracrânienne sont présents [16].
Les techniques de biologie moléculaire, comme la PCR, permettent un diagnostic plus rapide, en quelques heures seulement. C'est particulièrement utile quand un traitement antibiotique a déjà été commencé [12].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de la méningite à méningocoques constitue une urgence thérapeutique absolue. Dès la suspicion diagnostique, un traitement antibiotique doit être débuté, même avant les résultats des examens [16].
L'antibiotique de première intention est la ceftriaxone, administrée par voie intraveineuse à forte dose. Chez l'adulte, la posologie habituelle est de 2 grammes toutes les 12 heures. Cette molécule traverse efficacement la barrière hémato-encéphalique et atteint des concentrations thérapeutiques dans le LCR [1,16].
En cas d'allergie aux bêta-lactamines, le chloramphénicol reste une alternative efficace. La durée du traitement varie généralement de 7 à 10 jours, selon l'évolution clinique et biologique du patient [16].
Le traitement ne se limite pas aux antibiotiques. La prise en charge en réanimation est souvent nécessaire, particulièrement en cas de septicémie méningococcique. Les patients peuvent nécessiter une ventilation assistée, des drogues vasoactives pour maintenir la tension artérielle, et une surveillance neurologique étroite [1].
La corticothérapie par dexaméthasone peut être prescrite dans certains cas pour réduire l'inflammation méningée et limiter les séquelles neurologiques. Elle doit être administrée avant ou en même temps que la première dose d'antibiotique [16].
Bon à savoir : un traitement préventif (chimioprophylaxie) est systématiquement proposé aux contacts proches du patient. Il s'agit généralement de rifampicine, ciprofloxacine ou ceftriaxone selon les cas [15].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque une avancée majeure dans la prévention de la méningite à méningocoques avec l'approbation par la FDA du Penmenvy, le nouveau vaccin 5-en-1 de GSK. Ce vaccin révolutionnaire protège contre les sérogroupes A, B, C, W et Y en une seule injection [6].
Cette innovation représente un tournant dans la stratégie vaccinale. Jusqu'à présent, il fallait plusieurs vaccins différents pour couvrir tous les sérogroupes. Le Penmenvy simplifie considérablement les schémas de vaccination, particulièrement pour les populations à risque [6].
En parallèle, les recherches en immunoscience transforment notre approche thérapeutique. Les travaux de Sanofi sur l'immunomodulation ouvrent de nouvelles perspectives pour traiter les formes sévères de septicémie méningococcique [4]. Ces approches visent à moduler la réponse inflammatoire excessive qui cause souvent les complications les plus graves.
L'INSERM développe également de nouvelles stratégies pour comprendre les mécanismes du polyhandicap consécutif aux méningites sévères. Ces recherches pourraient déboucher sur des traitements préventifs des séquelles neurologiques [3].
Du côté de la recherche fondamentale, les avancées sur la synthèse d'oligosaccharides ouvrent la voie à de nouveaux vaccins plus efficaces. Ces molécules complexes pourraient améliorer la réponse immunitaire, particulièrement chez les populations les plus vulnérables [5].
Concrètement, ces innovations devraient être disponibles en Europe d'ici 2025-2026, révolutionnant la prise en charge préventive et curative de cette pathologie redoutable.
Vivre au Quotidien avec les Séquelles de Méningite à Méningocoques
Survivre à une méningite à méningocoques peut laisser des traces durables. Environ 10 à 20% des patients gardent des séquelles, allant de troubles légers à des handicaps sévères [1,16].
Les séquelles neurologiques sont les plus fréquentes. Elles incluent des troubles de l'audition (surdité partielle ou totale), des difficultés de concentration, des troubles de la mémoire ou des changements de personnalité. Certains patients développent une épilepsie secondaire [16].
Les amputations représentent une réalité douloureuse pour certains survivants. La septicémie méningococcique peut provoquer une nécrose des extrémités, nécessitant parfois l'amputation de doigts, orteils, voire de membres entiers. Ces situations nécessitent un accompagnement psychologique et une rééducation intensive [1].
Heureusement, de nombreuses ressources existent pour accompagner les patients et leurs familles. Les centres de rééducation spécialisés proposent des programmes adaptés. L'ergothérapie aide à réapprendre les gestes du quotidien, tandis que l'orthophonie prend en charge les troubles du langage [16].
L'important à retenir : chaque parcours de récupération est unique. Certains patients récupèrent complètement en quelques mois, d'autres apprennent à vivre avec leurs séquelles. Le soutien familial et professionnel joue un rôle crucial dans cette adaptation.
Les Complications Possibles
La méningite à méningocoques peut entraîner des complications redoutables, parfois irréversibles. La rapidité de prise en charge influence directement le pronostic [1,16].
Le choc septique représente la complication la plus grave. Il survient quand la bactérie se multiplie dans le sang, provoquant une chute brutale de la tension artérielle. Les organes vitaux ne sont plus correctement irrigués, pouvant conduire à une défaillance multiviscérale [16].
L'œdème cérébral constitue une autre complication majeure. L'inflammation des méninges peut provoquer un gonflement du cerveau, augmentant dangereusement la pression intracrânienne. Cette situation nécessite parfois une intervention neurochirurgicale d'urgence [1].
Les complications vasculaires incluent la coagulation intravasculaire disséminée (CIVD). Cette pathologie perturbe la coagulation sanguine, provoquant simultanément des hémorragies et des thromboses. Elle peut conduire à la nécrose des extrémités et nécessiter des amputations [16].
Certaines complications surviennent à distance : hydrocéphalie, abcès cérébraux, troubles cognitifs permanents. Les arthrites septiques méningococciques, bien que rares, peuvent également survenir et nécessitent un traitement spécifique [14].
Chez l'enfant, les convulsions sont fréquentes et peuvent laisser des séquelles neurologiques. Un suivi neurologique prolongé est donc indispensable pour dépister d'éventuels troubles du développement [1].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la méningite à méningocoques dépend essentiellement de la rapidité de prise en charge et de la forme clinique. Globalement, la mortalité varie entre 8 et 15% selon les études [1,16].
La forme méningée pure présente un meilleur pronostic que la septicémie méningococcique. Quand la méningite est diagnostiquée et traitée précocement, la guérison sans séquelles est possible dans 70 à 80% des cas [16].
En revanche, la septicémie méningococcique fulminante (purpura fulminans) reste redoutable avec une mortalité pouvant atteindre 20 à 30%. Cette forme évolue en quelques heures et nécessite une prise en charge en réanimation [1].
L'âge influence significativement le pronostic. Les nourrissons de moins de 2 ans et les personnes âgées de plus de 60 ans présentent un risque de complications plus élevé. Leur système immunitaire, soit immature soit affaibli, répond moins bien au traitement [16].
Parmi les survivants, environ 10 à 20% gardent des séquelles. Les plus fréquentes sont la surdité (5 à 10% des cas), les troubles neurologiques (difficultés de concentration, troubles de la mémoire) et les amputations en cas de nécrose périphérique [1,16].
Bon à savoir : un suivi médical régulier est indispensable après une méningite à méningocoques. Des bilans auditifs, neurologiques et psychologiques permettent de dépister précocement d'éventuelles séquelles et de les prendre en charge rapidement.
Peut-on Prévenir la Méningite à Méningocoques ?
La prévention de la méningite à méningocoques repose principalement sur la vaccination. Plusieurs vaccins sont disponibles selon les sérogroupes à couvrir [15,16].
Le vaccin conjugué contre le méningocoque C est obligatoire en France depuis 2018 pour tous les nourrissons. Il est administré à 5 mois avec un rappel à 12 mois. Cette vaccination a considérablement réduit l'incidence du sérogroupe C [1,15].
Le vaccin contre le méningocoque B (Bexsero) est recommandé chez les nourrissons depuis 2022. Il nécessite plusieurs injections : à 3, 5 et 12 mois. Ce vaccin protège contre le sérogroupe le plus fréquent en France [15].
Pour les sérogroupes A, C, W et Y, un vaccin tétravalent conjugué est disponible. Il est particulièrement recommandé pour les voyageurs se rendant dans des zones à risque, comme l'Afrique subsaharienne pendant la saison sèche [16].
L'innovation majeure de 2024 est l'approbation du Penmenvy, vaccin 5-en-1 couvrant tous les sérogroupes principaux. Cette avancée simplifiera considérablement les schémas vaccinaux dans les années à venir [6].
D'autres mesures préventives existent : éviter les rassemblements en milieu confiné pendant les épidémies, maintenir une bonne hygiène respiratoire (se couvrir la bouche en toussant), et consulter rapidement en cas de symptômes évocateurs [15].
Pour les contacts proches d'un cas confirmé, une chimioprophylaxie antibiotique est systématiquement proposée. Elle doit être prise dans les 48 heures suivant le dernier contact pour être efficace [1,15].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi des recommandations précises concernant la méningite à méningocoques. La Haute Autorité de Santé (HAS) actualise régulièrement ses préconisations en fonction des données épidémiologiques [16].
Concernant la vaccination, le calendrier vaccinal 2024 recommande la vaccination contre le méningocoque C pour tous les nourrissons à 5 mois, avec un rappel à 12 mois. Un rattrapage est proposé jusqu'à 24 ans pour les personnes non vaccinées [15,16].
La vaccination contre le méningocoque B est désormais recommandée chez tous les nourrissons depuis avril 2022. Le schéma comprend deux doses à 3 et 5 mois, suivies d'un rappel à 12 mois. Cette recommandation fait suite à l'analyse du rapport bénéfice-risque favorable [15].
Pour les populations à risque élevé (déficit immunitaire, asplénie), la HAS recommande une vaccination élargie incluant les vaccins tétravalents ACWY. Ces personnes doivent également recevoir des rappels réguliers selon des modalités spécifiques [16].
Santé publique France assure la surveillance épidémiologique nationale. Tout cas de méningite à méningocoques doit être déclaré obligatoirement aux autorités sanitaires dans les 24 heures. Cette surveillance permet d'adapter les stratégies de prévention [1].
Les recommandations pour les voyageurs sont également précises : vaccination ACWY obligatoire pour le pèlerinage à La Mecque, fortement recommandée pour l'Afrique subsaharienne pendant la saison sèche (décembre à juin) [15,16].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations accompagnent les patients et familles touchés par la méningite à méningocoques. Ces structures offrent soutien, information et entraide face à cette épreuve difficile.
L'Association Petit Ange propose un accompagnement spécialisé pour les familles d'enfants victimes de méningite. Elle organise des groupes de parole, des weekends de rencontre et diffuse des informations médicales actualisées. Son site internet constitue une ressource précieuse pour comprendre la maladie.
La Fondation pour la Recherche Médicale finance des projets de recherche sur les méningites bactériennes. Elle sensibilise également le grand public aux enjeux de la prévention et du diagnostic précoce. Ses campagnes d'information contribuent à améliorer la reconnaissance des symptômes.
Au niveau européen, la Confederation of Meningitis Organisations (CoMO) fédère les associations nationales. Elle coordonne les actions de sensibilisation et facilite les échanges d'expériences entre pays. Ses ressources multilingues sont particulièrement utiles.
Les centres de référence des méningites, répartis sur le territoire français, offrent une expertise médicale spécialisée. Ils assurent le diagnostic, le traitement et le suivi des formes complexes. Ces centres participent également à la formation des professionnels de santé.
Concrètement, n'hésitez pas à contacter ces structures si vous ou un proche êtes concernés. Leur expérience et leur soutien peuvent faire une réelle différence dans votre parcours de soins et de récupération.
Nos Conseils Pratiques
Face à la méningite à méningocoques, quelques conseils pratiques peuvent faire la différence. La rapidité de réaction reste votre meilleur atout pour un bon pronostic.
Apprenez à reconnaître les signes d'alarme : fièvre élevée associée à des maux de tête intenses, raideur de nuque, vomissements. Chez le nourrisson, soyez attentifs à l'irritabilité, aux pleurs inconsolables et à la fontanelle bombée. N'attendez jamais "de voir comment ça évolue" [1,15].
Le test du verre transparent peut sauver une vie. Si des taches rouges ou violacées apparaissent sur la peau, appuyez dessus avec un verre. Si elles ne disparaissent pas, appelez immédiatement le 15. Ce purpura signe une urgence vitale [15].
Respectez scrupuleusement le calendrier vaccinal. Les vaccins contre les méningocoques sont sûrs et efficaces. N'hésitez pas à discuter avec votre médecin des vaccinations recommandées selon votre situation personnelle [16].
Si vous êtes contact d'un cas confirmé, prenez la chimioprophylaxie prescrite même si vous vous sentez bien. Cette précaution peut vous éviter de développer la maladie. Surveillez votre température pendant 10 jours et consultez au moindre symptôme [1,15].
Maintenez une bonne hygiène respiratoire : lavez-vous régulièrement les mains, évitez de partager verres et couverts, couvrez-vous la bouche en toussant. Ces gestes simples limitent la transmission [15].
En cas de voyage dans une zone à risque, consultez un centre de vaccinations internationales au moins 4 semaines avant le départ. Certaines vaccinations sont obligatoires ou fortement recommandées selon la destination [16].
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous amener à consulter en urgence pour suspicion de méningite à méningocoques. Cette pathologie ne pardonne pas les retards de prise en charge [1,16].
Consultez immédiatement aux urgences si vous présentez : fièvre élevée (>38,5°C) associée à des maux de tête intenses et inhabituels, raideur de nuque (impossibilité de toucher le menton avec la poitrine), vomissements en jet, troubles de la conscience [1,15].
L'apparition de taches rouges ou violacées sur la peau constitue une urgence vitale absolue. Ces lésions purpuriques ne disparaissent pas à la pression et peuvent s'étendre rapidement. Appelez le 15 sans attendre [15,16].
Chez le nourrisson et l'enfant, soyez particulièrement vigilants devant : fièvre avec irritabilité extrême ou au contraire somnolence inhabituelle, refus de s'alimenter, pleurs aigus inconsolables, fontanelle bombée et tendue [1].
N'hésitez pas à consulter même si vous avez un doute. Les médecins préfèrent examiner dix patients inquiets pour rien plutôt que de passer à côté d'une méningite. Votre instinct de parent ou de proche peut sauver une vie [15].
Si vous êtes contact proche d'un cas confirmé, surveillez votre température deux fois par jour pendant 10 jours. Consultez immédiatement en cas de fièvre, même légère, ou de tout symptôme inhabituel [1,16].
En cas de doute, appelez le 15 (SAMU) qui pourra vous orienter et, si nécessaire, organiser un transport médicalisé. Face à la méningite à méningocoques, il vaut mieux pécher par excès de prudence.
Questions Fréquentes
La méningite à méningocoques est-elle contagieuse ?Oui, mais la transmission nécessite un contact proche et prolongé. La bactérie se transmet par les gouttelettes respiratoires lors de toux, éternuements ou baisers. Elle ne survit pas dans l'environnement [15].
Peut-on avoir plusieurs fois une méningite à méningocoques ?
C'est extrêmement rare chez les personnes immunocompétentes. Une première infection confère généralement une immunité durable contre le sérogroupe responsable. Cependant, il existe plusieurs sérogroupes différents [16].
Les vaccins sont-ils vraiment efficaces ?
Oui, les vaccins conjugués contre les méningocoques sont très efficaces, avec une protection supérieure à 90%. Ils ont considérablement réduit l'incidence de la maladie dans les pays où ils sont utilisés [1,15].
Combien de temps dure l'immunité vaccinale ?
L'immunité varie selon le vaccin et l'âge de vaccination. Pour le méningocoque C, elle dure au moins 10 ans. Des rappels peuvent être nécessaires pour certaines populations à risque [16].
Que faire si mon enfant a été en contact avec un cas ?
Contactez immédiatement votre médecin ou l'ARS. Une chimioprophylaxie antibiotique sera probablement prescrite. Surveillez la température de votre enfant pendant 10 jours et consultez au moindre symptôme [1,15].
Les séquelles sont-elles toujours définitives ?
Pas nécessairement. Certaines séquelles peuvent s'améliorer avec le temps et la rééducation. Un suivi médical régulier permet d'optimiser la récupération et d'adapter les prises en charge [16].
Questions Fréquentes
La méningite à méningocoques est-elle contagieuse ?
Oui, mais la transmission nécessite un contact proche et prolongé. La bactérie se transmet par les gouttelettes respiratoires lors de toux, éternuements ou baisers.
Peut-on avoir plusieurs fois une méningite à méningocoques ?
C'est extrêmement rare chez les personnes immunocompétentes. Une première infection confère généralement une immunité durable contre le sérogroupe responsable.
Les vaccins sont-ils vraiment efficaces ?
Oui, les vaccins conjugués contre les méningocoques sont très efficaces, avec une protection supérieure à 90%.
Que faire si mon enfant a été en contact avec un cas ?
Contactez immédiatement votre médecin ou l'ARS. Une chimioprophylaxie antibiotique sera probablement prescrite.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Méningite : symptômes, diagnostic et évolutionLien
- [3] Qu'est-ce que le polyhandicap ? L'Inserm lève le voileLien
- [4] Comment l'immunoscience transforme le traitementLien
- [5] Recent advances on the syntheses of oligosaccharidesLien
- [6] FDA Approves Penmenvy, GSK's 5-in-1 Meningococcal VaccineLien
- [8] La Méningite à Méningocoque C dans la Zone d'Orpaillage Artisanale de N'tahakaLien
- [9] Facteurs associés aux méningites bactériennes aiguës avant et après l'introduction du vaccin conjugué A au MaliLien
- [10] Facteurs associés aux méningites bactériennes aiguës avant et après l'introduction du vaccin conjugué A en 2017 au MaliLien
- [11] Evaluation du système de surveillance de la méningite dans la région de Niamey, Niger en 2021Lien
- [12] Méningites et encéphalites infectieuses: diagnostic, analyses complémentaires et approche syndromiqueLien
- [14] Arthrites au cours des infections à méningocoques à propos de 3 casLien
- [15] Méningites à méningocoques : symptômes, traitementLien
- [16] Recommandations Méningite aiguë de l'adulteLien
Publications scientifiques
- [PDF][PDF] Méningites à méningocoque à l'hôpital mère-enfant du CHU Mohammed VI de Marrakech [PDF]
- La Méningite à Méningocoque C dans la Zone d'Orpaillage Artisanale de N'tahaka, Région de Gao: Meningococcal C Meningitis in the Artisanal Gold-Panning Zone … (2024)
- [HTML][HTML] Facteurs associés aux méningites bactériennes aiguës avant et après l'introduction du vaccin conjugué A au Mali, 2017 (2024)
- Facteurs associés aux méningites bactériennes aiguës avant et après l'introduction du vaccin conjugué A en 2017 au Mali (2023)
- [HTML][HTML] Evaluation du système de surveillance de la méningite dans la région de Niamey, Niger en 2021 (2025)
Ressources web
- Méningites à méningocoques :symptômes, traitement, ... (pasteur.fr)
Comment diagnostiquer l'infection ? ... Après un examen clinique, une ponction lombaire (prélèvement de liquide céphalo-rachidien) est réalisée. Elle est ...
- Méningite : symptômes, diagnostic et évolution (ameli.fr)
26 févr. 2025 — Les méningites se manifestent par un syndrome méningé (maux de tête, photophobie, vomissements, raideur de la nuque, fièvre). Après avoir ...
- Recommandations Méningite aiguë de l'adulte (vidal.fr)
23 avr. 2024 — Le traitement initial de référence de la méningite à méningocoque est une céphalosporine de 3e génération : céfotaxime (200 mg/kg par jour en 4 ...
- Infections à méningocoque (msdmanuals.com)
La méningite provoque souvent fièvre, céphalées, éruption cutanée rouge et raideur de la nuque. Elle peut également provoquer des nausées, des vomissements et ...
- Méningite à méningocoques - Santé sur le Net (sante-sur-le-net.com)
30 avr. 2024 — Le plus souvent, le traitement antibiotique est rapidement efficace, les symptômes disparaissent et la méningite guérit. Chez les enfants, une ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
