Loase : Guide Complet 2025 - Symptômes, Diagnostic et Traitements
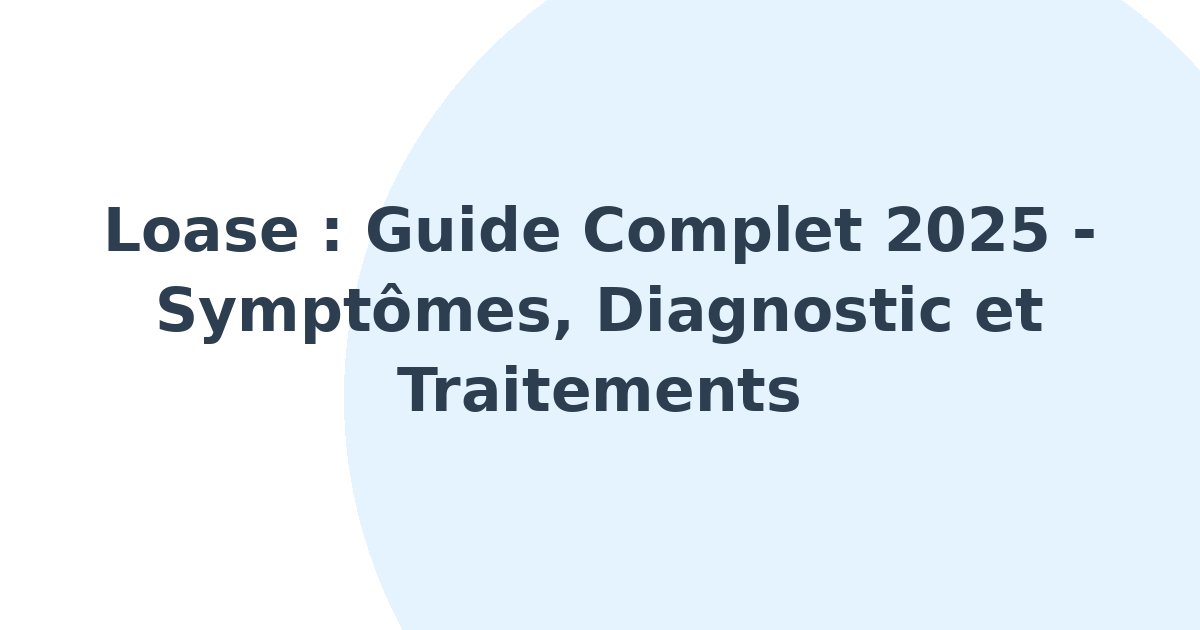
La loase, aussi appelée filariose à Loa loa, est une maladie parasitaire tropicale qui touche principalement les voyageurs et résidents d'Afrique centrale. Cette pathologie, causée par un ver nématode, peut provoquer des symptômes variés allant de simples démangeaisons à des complications oculaires spectaculaires. Bien que rare en France métropolitaine, elle nécessite une prise en charge spécialisée et bénéficie aujourd'hui d'innovations thérapeutiques prometteuses.
Téléconsultation et Loase
Téléconsultation non recommandéeLa loase est une filariose tropicale nécessitant un diagnostic parasitologique spécialisé par identification du microfilaire ou du ver adulte. Cette pathologie complexe requiert des examens complémentaires spécifiques (sérologie, recherche de microfilaires, parfois biopsie) et une prise en charge spécialisée en médecine tropicale qui ne peuvent être réalisés à distance.
Ce qui peut être évalué à distance
Description des symptômes oculaires et cutanés caractéristiques, évaluation de l'historique de voyage en zone d'endémie (Afrique centrale et occidentale), analyse des antécédents de piqûres de taons, orientation diagnostique initiale basée sur l'anamnèse, suivi de l'évolution des symptômes sous traitement.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen ophtalmologique spécialisé pour visualiser le ver adulte sous la conjonctive, examens parasitologiques (recherche de microfilaires dans le sang, biopsie cutanée), sérologie spécialisée, évaluation de la charge parasitaire avant traitement antiparasitaire.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion de passage du ver adulte dans l'œil nécessitant un examen ophtalmologique urgent, nécessité d'examens parasitologiques spécialisés pour confirmer le diagnostic, évaluation de la charge parasitaire avant traitement, surveillance des effets secondaires du traitement antiparasitaire.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Atteinte oculaire avec baisse d'acuité visuelle ou douleur intense, signes de réaction allergique sévère au traitement, complications neurologiques (encéphalopathie post-thérapeutique), œdème de Calabar extensif avec gêne fonctionnelle importante.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Baisse brutale de l'acuité visuelle ou douleur oculaire intense
- Œdème facial ou des membres massif et rapidement extensif
- Signes neurologiques (confusion, convulsions, troubles de la conscience)
- Réaction allergique sévère avec difficultés respiratoires ou œdème de Quincke
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Médecin spécialisé en médecine tropicale et maladies infectieuses — consultation en présentiel indispensable
La loase nécessite impérativement une expertise en médecine tropicale pour le diagnostic parasitologique spécialisé et la gestion du traitement antiparasitaire complexe. Une consultation en présentiel est obligatoire pour réaliser les examens complémentaires indispensables au diagnostic et à la prise en charge.
Loase : Définition et Vue d'Ensemble
La loase est une maladie parasitaire causée par le nématode Loa loa, communément appelé "ver de l'œil africain". Ce parasite filaire se transmet exclusivement par la piqûre de mouches du genre Chrysops, présentes uniquement dans les forêts tropicales d'Afrique centrale et occidentale [12,13].
Contrairement à d'autres filarioses, la loase présente une particularité fascinante : le ver adulte peut migrer sous la peau et traverser l'œil, créant un spectacle saisissant mais généralement bénin. Cette caractéristique lui a valu son surnom évocateur [14].
Le cycle de vie du parasite est complexe. Les mouches Chrysops ingèrent les microfilaires lors d'un repas sanguin sur une personne infectée. Après maturation dans l'insecte, les larves infectieuses sont transmises lors d'une nouvelle piqûre. Chez l'humain, le développement jusqu'au stade adulte prend environ un an [13].
Bon à savoir : la loase ne se transmet jamais directement d'humain à humain. Seule la piqûre de mouches infectées peut propager la maladie. Cette spécificité géographique explique pourquoi les cas en France concernent quasi exclusivement des voyageurs ou des personnes originaires des zones d'endémie [1].
Épidémiologie en France et dans le Monde
L'épidémiologie de la loase révèle des contrastes saisissants entre les zones d'endémie et les pays non tropicaux. En Afrique centrale, particulièrement au Cameroun, en République centrafricaine et au Gabon, la prévalence peut atteindre 20 à 40% de la population dans certaines régions forestières [1].
En France métropolitaine, les données du ministère de la Santé indiquent environ 50 à 80 cas diagnostiqués annuellement, principalement chez des voyageurs de retour d'Afrique centrale ou des résidents de ces régions [1]. Cette incidence reste stable depuis 2020, mais les experts notent une légère augmentation liée à l'intensification des échanges commerciaux et touristiques.
L'analyse des données françaises révèle des caractéristiques démographiques intéressantes. Les hommes représentent 60% des cas, avec un âge moyen de 35 ans. Cette répartition s'explique par les profils professionnels à risque : militaires, coopérants, travailleurs du secteur pétrolier ou forestier [10].
D'ailleurs, les régions françaises les plus touchées correspondent aux zones de forte immigration africaine : Île-de-France (40% des cas), Provence-Alpes-Côte d'Azur (15%) et Rhône-Alpes (12%). Ces chiffres reflètent les liens historiques et les flux migratoires entre la France et l'Afrique francophone [1].
Concrètement, le délai moyen entre l'exposition et le diagnostic en France est de 18 mois, variant de 6 mois à 5 ans selon les études récentes [10]. Cette latence explique pourquoi de nombreux patients ne font plus le lien avec leur séjour tropical au moment de l'apparition des symptômes.
Les Causes et Facteurs de Risque
La loase résulte exclusivement de l'infection par le nématode Loa loa, mais plusieurs facteurs influencent le risque de contamination. Le vecteur, la mouche Chrysops, présente des habitudes très spécifiques qui déterminent les situations à risque [13].
Ces mouches piquent principalement en journée, entre 10h et 16h, avec un pic d'activité vers midi. Elles sont attirées par les mouvements, la fumée et certaines odeurs corporelles. Contrairement aux moustiques, elles ne pénètrent pas dans les habitations et restent cantonnées aux zones forestières [1,13].
Les facteurs de risque individuels sont bien identifiés. La durée d'exposition constitue le paramètre le plus déterminant : un séjour de moins d'un mois présente un risque quasi nul, tandis qu'une exposition de plusieurs années peut atteindre des taux d'infection de 50% [1]. Les activités professionnelles en forêt (exploitation forestière, recherche scientifique, missions militaires) multiplient considérablement les risques.
Mais attention, même les séjours touristiques courts ne sont pas exempts de risque. Des cas ont été rapportés après des safaris de deux semaines ou des treks en forêt équatoriale [14]. L'important à retenir : toute exposition, même brève, dans les zones d'endémie justifie une surveillance médicale au retour.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la loase évoluent en plusieurs phases, rendant parfois le diagnostic complexe. La période d'incubation, généralement asymptomatique, dure de 6 mois à plusieurs années après l'infection initiale [12,14].
Le signe le plus spectaculaire, mais paradoxalement le moins fréquent, est le passage du ver adulte sous la conjonctive oculaire. Cette migration, visible à l'œil nu, provoque une sensation de corps étranger, des larmoiements et parfois une douleur modérée. Rassurez-vous, ce phénomène, bien qu'impressionnant, ne cause généralement aucun dommage permanent à l'œil [5,7,8].
Plus fréquemment, la maladie se manifeste par des œdèmes de Calabar, gonflements fugaces et migrateurs qui apparaissent principalement aux poignets, chevilles et paupières. Ces œdèmes, d'apparition brutale, peuvent mesurer plusieurs centimètres et disparaissent spontanément en 24 à 72 heures [5,9]. Ils s'accompagnent souvent de démangeaisons intenses et d'une sensation de chaleur locale.
D'autres symptômes moins spécifiques peuvent révéler la maladie : urticaire chronique, douleurs articulaires migratrices, fatigue inexpliquée ou fièvre intermittente [9]. Ces manifestations, souvent négligées, peuvent persister des mois avant qu'un diagnostic correct ne soit posé.
Il faut savoir que certains patients restent totalement asymptomatiques malgré une infection avérée. Cette forme asymptomatique, découverte fortuitement lors d'un bilan sanguin, représente environ 30% des cas diagnostiqués en France [10].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de loase repose sur une démarche méthodique combinant anamnèse, examen clinique et examens complémentaires spécialisés. La première étape consiste à rechercher systématiquement un antécédent de séjour en zone d'endémie, même ancien [11,14].
L'examen parasitologique direct constitue la méthode diagnostique de référence. La recherche de microfilaires dans le sang périphérique s'effectue idéalement entre 10h et 14h, période de pic de circulation des parasites. Cette particularité, appelée périodicité diurne, différencie Loa loa des autres filaires [11,13].
Cependant, la sensibilité de cet examen reste limitée. Environ 40% des patients infectés présentent une microfilarémie indétectable, nécessitant le recours à des techniques de concentration comme la filtration sur membrane ou la technique de Knott [10,11].
Les examens sérologiques, bien qu'utiles, manquent de spécificité. Les anticorps dirigés contre Loa loa peuvent persister des années après guérison et présentent des réactions croisées avec d'autres filaires. Néanmoins, une sérologie négative chez un patient n'ayant jamais vécu en zone tropicale permet d'exclure le diagnostic [14].
L'imagerie moderne apporte parfois des éléments diagnostiques inattendus. L'échographie peut visualiser les vers adultes sous forme de structures échogènes mobiles, particulièrement au niveau des paupières ou des membres [7,8]. Cette technique, non invasive, gagne en popularité pour le suivi thérapeutique.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de la loase a considérablement évolué ces dernières années, avec l'émergence de protocoles plus sûrs et plus efficaces. La diéthylcarbamazine (DEC) reste le traitement de première intention, mais son utilisation nécessite des précautions particulières [2,10].
Le protocole standard débute par des doses progressives : 1 mg/kg le premier jour, 2 mg/kg le deuxième jour, puis 6 mg/kg/jour pendant 21 jours. Cette montée progressive vise à réduire le risque d'encéphalopathie, complication redoutable liée à la destruction massive des microfilaires [10,14].
Chez les patients présentant une forte charge parasitaire (>8000 microfilaires/ml), l'ivermectine est désormais privilégiée en première intention. Ce médicament, administré à doses répétées et croissantes, permet une réduction progressive de la microfilarémie avec un risque neurologique moindre [2,10].
La surveillance thérapeutique est cruciale. Les patients hospitalisés bénéficient d'un monitoring neurologique rapproché pendant les premiers jours de traitement. Tout signe d'altération de la conscience, de céphalées intenses ou de troubles visuels impose l'arrêt immédiat du traitement [10].
Concrètement, le taux de guérison parasitologique atteint 85 à 95% avec les protocoles actuels. Les échecs thérapeutiques, rares, nécessitent souvent une adaptation posologique ou un changement de molécule [2,14].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la prise en charge de la loase avec l'émergence de nouvelles approches thérapeutiques prometteuses. Les recherches récentes se concentrent sur l'optimisation des protocoles existants et le développement de molécules innovantes [2,3,4].
Une étude clinique majeure publiée en 2024 évalue l'efficacité d'une dose unique d'ivermectine à 2 mg/kg chez les patients faiblement microfilarémiques. Les résultats préliminaires montrent une efficacité comparable aux protocoles prolongés, avec une tolérance remarquable et une observance optimale [4].
Parallèlement, les chercheurs explorent de nouvelles cibles thérapeutiques. L'approche anti-Wolbachia, ciblant les bactéries symbiotiques des filaires, ouvre des perspectives révolutionnaires. La doxycycline, administrée pendant 4 à 6 semaines, pourrait stériliser définitivement les vers adultes généralement bien toléré d'encéphalopathie [3].
Les innovations diagnostiques accompagnent ces avancées thérapeutiques. Les tests de détection d'antigènes circulants, plus sensibles que la microscopie traditionnelle, permettent un diagnostic précoce même en l'absence de microfilarémie détectable [2,3].
D'ailleurs, l'intelligence artificielle fait son entrée dans le diagnostic de la loase. Des algorithmes d'apprentissage automatique analysent désormais les images microscopiques, améliorant la précision diagnostique et réduisant les délais de prise en charge [3].
Vivre au Quotidien avec Loase
Vivre avec une loase diagnostiquée nécessite certains ajustements, mais la plupart des patients mènent une vie parfaitement normale. La compréhension de la maladie constitue le premier pas vers une gestion sereine de cette pathologie [9,14].
Les œdèmes de Calabar, bien qu'impressionnants, ne nécessitent généralement aucun traitement spécifique. L'application de froid local et la prise d'antihistaminiques peuvent soulager les démangeaisons. Il est important de rassurer l'entourage : ces gonflements ne sont ni contagieux ni dangereux [5,9].
Certains patients développent des stratégies personnelles pour gérer les symptômes. Le port de vêtements amples lors des poussées œdémateuses, l'évitement des situations stressantes qui peuvent déclencher les crises, ou encore la tenue d'un journal des symptômes pour identifier les facteurs déclenchants [9].
La dimension psychologique ne doit pas être négligée. L'anxiété liée à l'imprévisibilité des symptômes peut impacter significativement la qualité de vie. Un accompagnement psychologique, parfois nécessaire, aide les patients à développer des mécanismes d'adaptation efficaces [14].
Heureusement, la plupart des patients traités retrouvent une qualité de vie normale dans les mois suivant la guérison parasitologique. Les symptômes résiduels, s'ils persistent, s'estompent progressivement sur plusieurs mois [10].
Les Complications Possibles
Bien que généralement bénigne, la loase peut occasionnellement présenter des complications graves nécessitant une prise en charge urgente. L'encéphalopathie post-thérapeutique représente la complication la plus redoutable, survenant paradoxalement lors du traitement [6,10].
Cette encéphalopathie résulte de la destruction massive des microfilaires par les antiparasitaires, provoquant une réaction inflammatoire cérébrale intense. Elle se manifeste par des troubles de la conscience, des convulsions, voire un coma. Son incidence, heureusement rare (moins de 1% des cas traités), est directement corrélée à la charge parasitaire initiale [10].
Les complications oculaires, bien que spectaculaires, restent généralement bénignes. Le passage du ver sous la conjonctive peut exceptionnellement s'accompagner d'une inflammation sévère ou d'une surinfection bactérienne. Dans de très rares cas, une extraction chirurgicale du parasite peut s'avérer nécessaire [7,8].
Certains patients développent des manifestations neurologiques atypiques. Des cas de neuromyélite ont été rapportés, associant des troubles moteurs et sensitifs à une atteinte médullaire inflammatoire. Ces formes, exceptionnelles, nécessitent une prise en charge neurologique spécialisée [6].
Les complications rénales, bien que rares, méritent d'être mentionnées. Une protéinurie transitoire peut accompagner les phases aiguës de la maladie, généralement réversible après traitement antiparasitaire [14].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la loase est globalement excellent lorsque la maladie est correctement diagnostiquée et traitée. La mortalité, exceptionnelle, concerne uniquement les formes compliquées d'encéphalopathie sévère non prises en charge [10,14].
Avec les protocoles thérapeutiques actuels, le taux de guérison parasitologique dépasse 90% après un cycle de traitement complet. Les échecs thérapeutiques, rares, répondent généralement à un second cycle avec adaptation posologique [2,10].
La récupération clinique suit généralement la guérison parasitologique. Les œdèmes de Calabar disparaissent progressivement sur plusieurs mois, tandis que les symptômes généraux (fatigue, douleurs articulaires) s'amendent plus rapidement [9,14].
Cependant, certains patients conservent des séquelles mineures. Une hypersensibilité cutanée persistante, des épisodes d'urticaire occasionnels ou une fatigue résiduelle peuvent persister plusieurs mois après la guérison parasitologique. Ces manifestations, bénignes, s'estompent généralement spontanément [9].
L'important à retenir : un diagnostic précoce et un traitement adapté attendussent un pronostic favorable dans l'immense majorité des cas. Les patients traités retrouvent une qualité de vie normale et peuvent reprendre toutes leurs activités habituelles [14].
Peut-on Prévenir Loase ?
La prévention de la loase repose essentiellement sur la protection contre les piqûres de mouches Chrysops lors des séjours en zone d'endémie. Contrairement aux moustiques, ces vecteurs présentent des habitudes spécifiques nécessitant des mesures préventives adaptées [1,13].
Les répulsifs cutanés constituent la première ligne de défense. Les produits contenant du DEET à concentration élevée (30-50%) offrent une protection efficace pendant 6 à 8 heures. L'application doit être renouvelée régulièrement, particulièrement en cas de transpiration importante [1].
Les vêtements longs, de couleur claire et imprégnés de perméthrine, réduisent significativement le risque de piqûre. Cette protection vestimentaire s'avère particulièrement importante lors des activités en forêt entre 10h et 16h, période de pic d'activité des Chrysops [1,13].
Mais attention, aucune chimioprophylaxie n'est recommandée pour la loase. Contrairement au paludisme, il n'existe pas de traitement préventif efficace et sûr. Cette absence de prophylaxie médicamenteuse renforce l'importance des mesures de protection physique [1].
Pour les expatriés et travailleurs en zone d'endémie, des consultations de médecine tropicale régulières permettent un dépistage précoce. Un bilan parasitologique annuel, incluant la recherche de microfilaires, peut identifier une infection asymptomatique avant l'apparition des complications [14].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont actualisé leurs recommandations concernant la loase dans le cadre des conseils aux voyageurs 2024-2025. Ces directives, élaborées par Santé publique France en collaboration avec les sociétés savantes, précisent les conduites à tenir [1].
Pour les voyageurs se rendant en Afrique centrale, les recommandations insistent sur l'information préalable au départ. Tout séjour, même bref, dans les zones forestières d'endémie doit faire l'objet d'une consultation de médecine des voyages. Cette consultation permet d'évaluer les risques individuels et d'adapter les mesures préventives [1].
Au retour de zone d'endémie, un suivi médical est recommandé pendant au moins deux ans. Cette surveillance, idéalement assurée par un service de parasitologie, permet un diagnostic précoce avant l'apparition des complications. Un bilan parasitologique systématique est préconisé 6 mois après le retour [1].
Les professionnels de santé bénéficient de formations spécifiques pour améliorer le diagnostic de cette pathologie rare. Des référentiels de prise en charge, régulièrement mis à jour, sont diffusés dans les services d'urgence et de médecine interne [10].
D'ailleurs, la Haute Autorité de Santé travaille actuellement sur des recommandations de bonnes pratiques spécifiquement dédiées à la loase. Ces guidelines, attendues pour 2025, devraient standardiser les protocoles diagnostiques et thérapeutiques sur l'ensemble du territoire [1].
Ressources et Associations de Patients
Bien que la loase soit une maladie rare en France, plusieurs ressources peuvent accompagner les patients dans leur parcours de soins. Les centres de référence en parasitologie-mycologie constituent les interlocuteurs privilégiés pour cette pathologie spécialisée.
L'Institut Pasteur, à travers son centre médical, propose des consultations spécialisées en médecine tropicale. Cette structure, reconnue pour son expertise en parasitologie, assure le diagnostic et le suivi des patients atteints de loase. Des consultations de suivi post-thérapeutique y sont également organisées.
Les hôpitaux universitaires disposent généralement de services de maladies infectieuses et tropicales compétents dans la prise en charge de la loase. Ces services, souvent associés à des laboratoires de parasitologie spécialisés, attendussent une expertise diagnostique et thérapeutique optimale.
Pour l'information et le soutien, plusieurs associations de patients atteints de maladies rares peuvent apporter une aide précieuse. Bien qu'aucune association ne soit spécifiquement dédiée à la loase, les réseaux de maladies tropicales offrent un soutien adapté.
Les plateformes d'information médicale fiables, comme celles des CHU ou de l'Institut Pasteur, proposent des ressources documentaires actualisées. Ces supports, validés par des experts, permettent aux patients de mieux comprendre leur maladie et son traitement.
Nos Conseils Pratiques
Gérer une loase au quotidien nécessite quelques adaptations simples mais efficaces. Ces conseils pratiques, issus de l'expérience clinique et des retours de patients, peuvent considérablement améliorer votre qualité de vie.
Lors des poussées d'œdèmes de Calabar, l'application de compresses froides pendant 15-20 minutes soulage efficacement les démangeaisons et réduit l'inflammation. Évitez les compresses chaudes qui peuvent aggraver le gonflement. Les antihistaminiques en vente libre peuvent également apporter un soulagement [5,9].
Tenez un journal de vos symptômes. Notez la date, l'heure, la localisation et l'intensité des œdèmes, ainsi que les facteurs déclenchants potentiels (stress, fatigue, exposition solaire). Ces informations précieuses aideront votre médecin à adapter votre prise en charge [9].
Informez systématiquement tous vos professionnels de santé de votre antécédent de loase. Cette information, cruciale en cas d'urgence, doit figurer dans votre dossier médical. Portez toujours sur vous une carte mentionnant votre pathologie et vos traitements en cours.
Maintenez une activité physique régulière adaptée à votre état. L'exercice modéré améliore la circulation lymphatique et peut réduire la fréquence des œdèmes. Évitez cependant les efforts intenses pendant les phases symptomatiques [14].
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous alerter et motiver une consultation médicale urgente. La reconnaissance précoce de ces symptômes peut prévenir des complications graves et optimiser votre prise en charge [6,10].
Consultez immédiatement en cas de troubles neurologiques : maux de tête intenses, troubles visuels, confusion, somnolence anormale ou convulsions. Ces symptômes peuvent signaler une encéphalopathie nécessitant une prise en charge hospitalière urgente [6,10].
Tout œdème facial massif, particulièrement s'il s'accompagne de difficultés respiratoires ou de déglutition, constitue une urgence médicale. Bien que rare, un œdème laryngé peut compromettre les voies aériennes [5].
Une fièvre élevée (>38,5°C) persistante plus de 48 heures, surtout si elle s'accompagne de frissons, de sueurs ou d'altération de l'état général, doit motiver une consultation rapide. Ces signes peuvent révéler une complication infectieuse [14].
Pour les patients sous traitement, tout effet secondaire inhabituel ou inquiétant justifie un contact avec l'équipe médicale. N'hésitez pas à appeler votre médecin en cas de doute : il vaut mieux une consultation de précaution qu'une complication négligée [10].
Enfin, planifiez des consultations de suivi régulières même en l'absence de symptômes. Cette surveillance permet d'évaluer l'efficacité du traitement et de dépister d'éventuelles récidives [14].
Questions Fréquentes
La loase est-elle contagieuse ?
Non, la loase ne se transmet jamais directement d'une personne à l'autre. Seule la piqûre de mouches Chrysops infectées peut transmettre la maladie.
Peut-on guérir définitivement de la loase ?
Oui, avec un traitement approprié, la guérison parasitologique est obtenue dans plus de 90% des cas. Une fois guéri, vous ne pouvez pas développer à nouveau la maladie sauf en cas de nouvelle exposition.
Les œdèmes de Calabar sont-ils dangereux ?
Généralement non. Ces gonflements, bien qu'impressionnants, sont bénins et disparaissent spontanément. Seuls les œdèmes faciaux massifs peuvent exceptionnellement poser problème.
Combien de temps dure le traitement ?
Le traitement standard dure 21 jours avec la diéthylcarbamazine. Certains protocoles plus récents proposent des durées plus courtes, mais cela dépend de votre situation individuelle.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] RECOMMANDATIONS SANITAIRES AUX VOYAGEURS. sante.gouv.fr. 2024-2025.Lien
- [2] Treatment of loiasis: a review of clinical management. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [3] The long and winding road towards new treatments against. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] Safety and Short-term Efficacy of a Single Dose of 2 mg. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] V Reynaud, AC Garreau. Angiœdèmes récidivants révélateurs d'une loase. 2023.Lien
- [6] JPM OUMAROU. Loase révélée par une neuromyélite chez un jeune militaire.Lien
- [7] NO Bouamama, J Bouleau. Loase sous-cutanée palpébrale supérieure à bascule: à propos d'un cas. 2023.Lien
- [8] N Ould Bouamama, J Bouleau. Loase sous-cutanée palpébrale supérieure à bascule: à propos d'un cas. 2023.Lien
- [9] V Reynaud, AC Garreau. La loase considérée à tort comme une urticaire chronique spontanée. 2022.Lien
- [10] C Declerck, S Kravetz. Panorama du traitement et de l'évolution des loases microfilarémiques en France (2000–2022). 2025.Lien
- [12] X JANNOT, V GERBER. PARASITOLOGIE CA267.Lien
- [13] Loase - Infections - Manuels MSD pour le grand public.Lien
- [14] Loase. medecinetropicale.free.fr.Lien
- [15] Loase : symptômes fréquents, diagnostic et traitement. sante.lefigaro.fr.Lien
Publications scientifiques
- Angiœdèmes récidivants révélateurs d'une loase (2023)
- [PDF][PDF] Loase révélée par une neuromyélite chez un jeune militaire. [PDF]
- Loase sous-cutanée palpébrale supérieure à bascule: à propos d'un cas (2023)
- Loase sous-cutanée palpébrale supérieure à bascule: à propos d'un cas (2023)
- La loase considérée à tort comme une urticaire chronique spontanée (2022)
Ressources web
- Loase - Infections - Manuels MSD pour le grand public (msdmanuals.com)
La loase est une infection des tissus sous-cutanés ou de la membrane externe transparente qui recouvre l'œil (conjonctive) par le ver rond Loa loa.
- Loase (medecinetropicale.free.fr)
La Loase est cause de prurit, d'éruptions cutanées de type urticariennes, d'oedèmes de Calabar et lors de la migration des FA, de reptation du ver sous la peau ...
- Loase : symptômes fréquents, diagnostic et traitement (sante.lefigaro.fr)
* reptation du ver adulte sous la peau, sensation désagréable de fourmillement, prurit, le ver apparaissant sous forme d'un cordon palpable mobile. * œdème ...
- Loase (orpha.net)
Un prurit généralisé, une urticaire, des myalgies, des arthralgies, une fatigue et la migration visible de vers adultes sous la surface de la peau peuvent être ...
- Loase | Guides médicaux MSF (medicalguidelines.msf.org)
Passage d'une macrofilaire sous la peau : cordon rouge, palpable, sinueux, prurigineux, mobile (1 cm/heure), disparaissant rapidement sans laisser de tracea ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
