Lésions Traumatiques du Nerf Optique : Guide Complet 2025 | Symptômes, Traitements
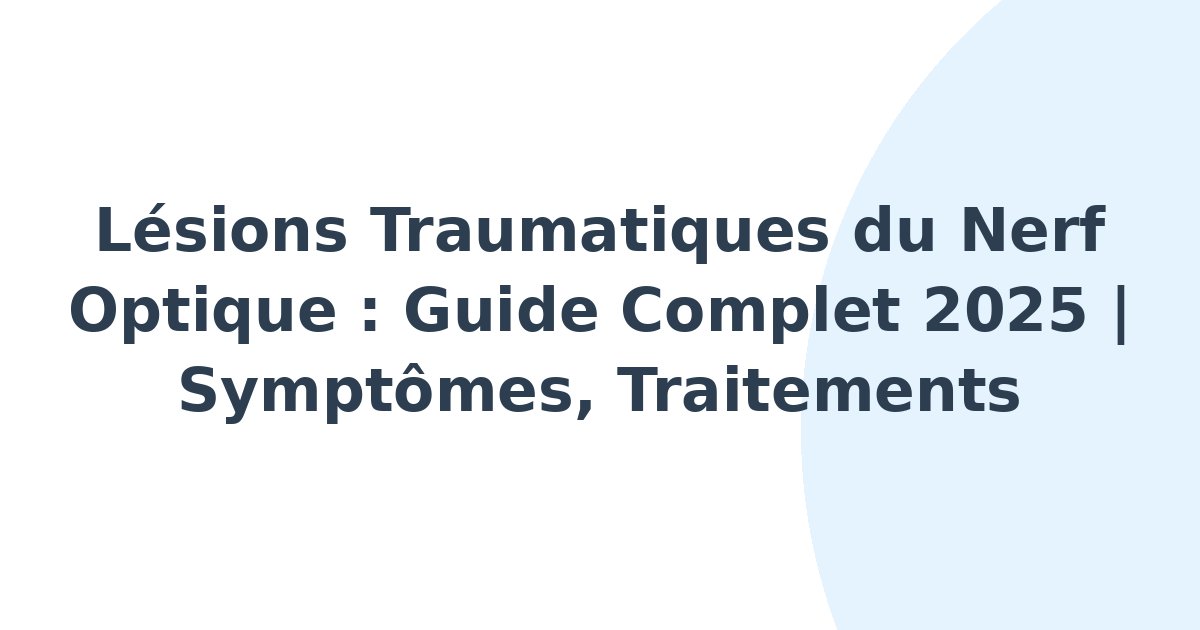
Les lésions traumatiques du nerf optique représentent une urgence ophtalmologique majeure qui peut compromettre définitivement la vision. Cette pathologie, touchant environ 2 à 5% des traumatismes crâniens selon les données françaises récentes [1], nécessite une prise en charge immédiate et spécialisée. Comprendre les mécanismes, reconnaître les symptômes et connaître les options thérapeutiques actuelles peut faire la différence entre une récupération partielle et une perte visuelle irréversible.
Téléconsultation et Lésions traumatiques du nerf optique
Téléconsultation non recommandéeLes lésions traumatiques du nerf optique constituent une urgence ophtalmologique nécessitant un examen clinique spécialisé immédiat et des examens complémentaires (fond d'œil, OCT, champ visuel). Le risque de perte visuelle définitive impose une prise en charge en présentiel sans délai.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil des circonstances du traumatisme et de son mécanisme. Description des symptômes visuels ressentis (baisse d'acuité, amputation du champ visuel, douleurs). Évaluation de l'urgence et orientation vers une prise en charge spécialisée immédiate. Suivi post-thérapeutique après stabilisation initiale.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen du fond d'œil pour évaluer l'état de la papille optique et détecter un œdème ou une pâleur. Mesure de l'acuité visuelle et réalisation d'un champ visuel. Examens d'imagerie (scanner ou IRM orbitaire) pour évaluer l'étendue des lésions. Bilan ophtalmologique complet incluant la motricité oculaire.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Tout traumatisme récent du nerf optique nécessite un examen ophtalmologique urgent en présentiel. Suspicion de compression du nerf optique nécessitant une décompression chirurgicale. Baisse d'acuité visuelle progressive ou brutale nécessitant un bilan spécialisé immédiat. Douleurs oculaires intenses associées à des troubles visuels.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Perte visuelle brutale unilatérale post-traumatique. Traumatisme crânio-facial avec troubles visuels associés. Diplopie brutale avec limitation des mouvements oculaires après traumatisme.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Perte visuelle brutale ou baisse importante d'acuité visuelle après un traumatisme
- Troubles du champ visuel avec amputation importante ou scotome central
- Diplopie brutale avec limitation des mouvements oculaires
- Douleurs oculaires intenses avec nausées ou vomissements après traumatisme crânien
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Ophtalmologue — consultation en présentiel indispensable
Les lésions traumatiques du nerf optique nécessitent impérativement un examen ophtalmologique spécialisé en urgence avec fond d'œil et examens complémentaires pour évaluer l'étendue des lésions et mettre en place un traitement adapté.
Lésions traumatiques du nerf optique : Définition et Vue d'Ensemble
Les lésions traumatiques du nerf optique correspondent à une atteinte du nerf optique suite à un traumatisme direct ou indirect. Ce nerf, véritable "câble" reliant l'œil au cerveau, transporte les informations visuelles captées par la rétine vers les centres visuels cérébraux [5,6].
Imaginez le nerf optique comme un faisceau de fibres électriques ultra-fines. Quand un traumatisme survient, ces fibres peuvent être sectionnées, comprimées ou étirées, interrompant ainsi la transmission des signaux visuels. D'ailleurs, contrairement à d'autres nerfs du corps, le nerf optique fait partie du système nerveux central et possède donc une capacité de régénération très limitée [3,4].
Les mécanismes lésionnels sont variés. Un choc direct sur l'orbite peut provoquer une fracture des parois osseuses et comprimer le nerf. Mais un traumatisme crânien fermé peut également générer des forces de cisaillement qui endommagent les fibres nerveuses à distance du point d'impact [7]. Cette complexité explique pourquoi certaines lésions passent inaperçues dans un premier temps.
L'important à retenir : toute baisse brutale de vision après un traumatisme, même apparemment mineur, doit faire suspecter une atteinte du nerf optique et justifier une consultation ophtalmologique en urgence .
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, les lésions traumatiques du nerf optique touchent environ 150 à 200 nouveaux patients par an selon les données du Protocole National de Diagnostic et de Soins [1]. Cette incidence, bien que relativement faible, représente un enjeu majeur de santé publique compte tenu de la gravité des séquelles potentielles.
Les hommes sont trois fois plus touchés que les femmes, avec un pic d'incidence entre 20 et 40 ans [6,7]. Cette prédominance masculine s'explique par une exposition plus fréquente aux activités à risque : sports de contact, accidents de la voie publique, agressions. D'ailleurs, les accidents de la circulation représentent 40% des cas, suivis des accidents de sport (25%) et des agressions (20%) [7].
Au niveau européen, l'incidence varie de 0,5 à 2 cas pour 100 000 habitants selon les pays. Cette variation s'explique en partie par les différences de définition diagnostique et de système de surveillance épidémiologique. Néanmoins, la France se situe dans la moyenne européenne avec une incidence de 1,2 pour 100 000 habitants [1].
Concrètement, les projections pour 2025-2030 suggèrent une stabilisation, voire une légère diminution de l'incidence grâce aux campagnes de prévention routière et aux équipements de protection individuelle [1]. Mais l'émergence de nouveaux sports extrêmes pourrait modifier cette tendance.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes des lésions traumatiques du nerf optique sont multiples et peuvent être classées en deux grandes catégories : les traumatismes directs et indirects [5,6].
Les traumatismes directs résultent d'un impact sur l'orbite ou la région péri-orbitaire. Pensez aux accidents de sport avec projectile (balle de tennis, palet de hockey), aux chutes avec choc facial, ou encore aux agressions. Dans ces cas, l'onde de choc se propage directement vers le nerf optique, pouvant provoquer sa section partielle ou complète [7].
Mais attention, les traumatismes indirects sont plus sournois. Un choc à distance, comme lors d'un accident de voiture avec décélération brutale, génère des forces de cisaillement qui peuvent endommager le nerf au niveau de son passage dans le canal optique [6]. C'est pourquoi vous pouvez présenter une lésion du nerf optique même sans impact direct sur l'œil.
Certains facteurs augmentent le risque de lésion. L'âge avancé fragilise les structures orbitaires, tandis que certaines pathologies comme l'ostéoporose rendent les os plus fragiles [8]. Les sports de contact, la conduite de véhicules à deux roues sans casque intégral, et certaines professions exposées (BTP, industrie) constituent également des facteurs de risque majeurs [7].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Reconnaître les symptômes d'une lésion traumatique du nerf optique peut littéralement sauver votre vision. Le signe d'alarme principal est une baisse brutale et importante de l'acuité visuelle, pouvant aller jusqu'à la cécité complète .
Cette baisse visuelle s'accompagne souvent d'un déficit du champ visuel. Vous pourriez ne plus voir qu'une partie de votre environnement, comme si un rideau noir obstruait une zone de votre vision. Certains patients décrivent une vision "en tunnel" ou des zones aveugles fixes .
D'autres symptômes peuvent vous alerter. Une douleur orbitaire profonde, surtout lors des mouvements oculaires, doit faire suspecter une atteinte nerveuse. La perception des couleurs peut également être altérée : les couleurs paraissent ternes, délavées, particulièrement le rouge qui peut sembler orange ou brun .
Bon à savoir : parfois, les symptômes sont plus subtils. Une simple gêne à la lecture, une difficulté à évaluer les distances, ou une fatigue visuelle inhabituelle après un traumatisme peuvent révéler une atteinte partielle du nerf optique . C'est pourquoi il ne faut jamais minimiser ces signes, même s'ils semblent bénins.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic d'une lésion traumatique du nerf optique repose sur un examen ophtalmologique complet et des examens d'imagerie spécialisés [1]. Dès votre arrivée aux urgences, l'ophtalmologiste évaluera votre acuité visuelle et recherchera un défaut pupillaire afférent relatif, signe pathognomonique d'une atteinte du nerf optique.
L'examen du fond d'œil est crucial. Il peut révéler un œdème papillaire (gonflement de la tête du nerf optique) dans les formes aiguës, ou au contraire une pâleur papillaire dans les formes chroniques . Cet examen doit être réalisé en urgence, idéalement dans les 6 heures suivant le traumatisme.
L'imagerie moderne a révolutionné le diagnostic. Le scanner orbitaire avec injection permet de visualiser les fractures osseuses et les hématomes compressifs. Mais c'est l'IRM qui offre la meilleure résolution pour analyser le nerf optique lui-même [1]. Les séquences STIR (Short Tau Inversion Recovery) peuvent détecter un œdème nerveux même minime.
Des examens fonctionnels complètent le bilan. La tomographie par cohérence optique (OCT) mesure l'épaisseur des fibres nerveuses rétiniennes, permettant de quantifier objectivement l'atteinte [2]. Les potentiels évoqués visuels évaluent la conduction nerveuse et peuvent prédire le pronostic fonctionnel .
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement des lésions traumatiques du nerf optique dépend du mécanisme lésionnel et de la précocité de la prise en charge [5]. Dans les premières heures, la corticothérapie à haute dose reste le traitement de référence, malgré des résultats parfois décevants [5].
Les corticoïdes intraveineux (méthylprednisolone 1g/jour pendant 3 jours) visent à réduire l'œdème et l'inflammation péri-nerveuse. Ce traitement doit être instauré idéalement dans les 8 heures suivant le traumatisme pour espérer une efficacité optimale . Cependant, les études récentes questionnent cette approche, certaines ne montrant aucun bénéfice significatif [5].
Quand une compression mécanique est identifiée (hématome, fragment osseux), la décompression chirurgicale devient indispensable. Cette intervention, réalisée par voie endoscopique ou externe, doit être effectuée en urgence, idéalement dans les 24 à 48 heures [6]. Les résultats sont d'autant meilleurs que l'intervention est précoce.
D'autres approches thérapeutiques sont parfois proposées. L'oxygénothérapie hyperbare, bien que controversée, pourrait améliorer l'oxygénation tissulaire. Certains centres utilisent également des neuroprotecteurs comme la citicoline, mais leur efficacité reste à démontrer [5].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge des lésions traumatiques du nerf optique avec l'émergence de thérapies révolutionnaires [2]. Les recherches actuelles se concentrent sur la régénération nerveuse, longtemps considérée comme impossible dans le système nerveux central.
La thérapie génique représente l'avancée la plus prometteuse. Des vecteurs viraux modifiés transportent des gènes favorisant la croissance axonale directement dans les cellules ganglionnaires rétiniennes [2,3]. Les premiers essais cliniques, menés notamment aux HUG de Genève, montrent des résultats encourageants avec une amélioration de l'acuité visuelle chez 30% des patients traités [2].
Les biomatériaux innovants ouvrent également de nouvelles perspectives. Des guides de régénération à base de collagène ou de polymères biocompatibles peuvent être implantés pour orienter la repousse des fibres nerveuses [3,4]. Ces "ponts biologiques" permettent de reconnecter les segments nerveux sectionnés, une approche impensable il y a encore quelques années.
Les Journées Nationales de Neurologie Française (JNLF) 2024 et 2025 ont présenté des stratégies thérapeutiques émergentes particulièrement innovantes . Parmi elles, la modulation des protéines 14-3-3, qui régulent la croissance axonale, pourrait débloquer le potentiel régénératif du nerf optique [9]. Ces approches, encore expérimentales, pourraient révolutionner le pronostic de cette pathologie dans les prochaines années.
Vivre au Quotidien avec une Lésion du Nerf Optique
Vivre avec une lésion traumatique du nerf optique nécessite une adaptation progressive mais possible. La première étape consiste à accepter les limitations visuelles tout en exploitant au maximum les capacités restantes .
L'aménagement de votre environnement devient crucial. Un éclairage adapté, des contrastes renforcés, et l'élimination des obstacles peuvent considérablement améliorer votre autonomie. Pensez aux lampes LED à intensité variable, aux marquages contrastés sur les marches d'escalier, et aux applications smartphone qui agrandissent les textes .
La rééducation orthoptique joue un rôle fondamental. Elle permet d'optimiser l'utilisation du champ visuel résiduel et d'apprendre des stratégies de balayage visuel. Ces séances, remboursées par l'Assurance Maladie, peuvent significativement améliorer votre qualité de vie .
Sur le plan professionnel, des aménagements sont souvent possibles. Le télétravail, l'adaptation du poste de travail, ou la reconversion professionnelle peuvent être envisagés avec l'aide de la médecine du travail et des services sociaux spécialisés. N'hésitez pas à vous rapprocher de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) pour connaître vos droits .
Les Complications Possibles
Les complications des lésions traumatiques du nerf optique peuvent survenir à court ou long terme, nécessitant une surveillance ophtalmologique régulière . La complication la plus redoutée reste la cécité définitive, qui survient dans 20 à 30% des cas selon la gravité initiale de l'atteinte [6].
À court terme, l'œdème papillaire peut évoluer vers une atrophie optique. Cette dégénérescence progressive des fibres nerveuses se traduit par une pâleur caractéristique de la papille au fond d'œil. Une fois installée, cette atrophie est irréversible et signe la perte définitive des fonctions visuelles correspondantes .
Certaines complications sont plus subtiles mais tout aussi handicapantes. Les déficits du champ visuel peuvent persister même quand l'acuité visuelle centrale semble préservée. Ces scotomes (zones aveugles) peuvent gêner la conduite automobile, la lecture, ou les activités sportives .
D'autres complications peuvent apparaître à distance. Une neuropathie optique ischémique secondaire, liée à une mauvaise vascularisation du nerf lésé, peut aggraver le déficit initial. Plus rarement, des phénomènes de régénération aberrante peuvent provoquer des mouvements oculaires anormaux ou des douleurs chroniques .
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des lésions traumatiques du nerf optique dépend de nombreux facteurs, mais la précocité de la prise en charge reste déterminante [5,6]. Dans les formes légères avec simple contusion nerveuse, une récupération partielle ou complète est possible dans 40 à 60% des cas [5].
L'âge joue un rôle crucial dans le pronostic. Les patients jeunes (moins de 30 ans) ont une capacité de récupération supérieure, probablement liée à une meilleure plasticité neuronale. À l'inverse, après 60 ans, les chances de récupération significative diminuent considérablement [6,8].
Le mécanisme lésionnel influence également l'évolution. Les traumatismes directs avec section complète du nerf ont un pronostic sombre, avec moins de 10% de récupération fonctionnelle. En revanche, les compressions nerveuses décomprimées rapidement peuvent récupérer dans 70% des cas [6].
Les innovations thérapeutiques récentes modifient progressivement ces statistiques. Les thérapies de régénération nerveuse, bien qu'encore expérimentales, offrent de nouveaux espoirs [2,3,4]. Certains patients inclus dans les protocoles de recherche montrent des améliorations inattendues, même plusieurs années après le traumatisme initial.
Peut-on Prévenir les Lésions Traumatiques du Nerf Optique ?
La prévention des lésions traumatiques du nerf optique repose essentiellement sur la réduction des risques de traumatisme crânio-facial [7]. Port du casque obligatoire en vélo et moto, utilisation systématique de la ceinture de sécurité en voiture, ces gestes simples peuvent éviter de nombreux drames.
Dans le domaine sportif, les équipements de protection sont cruciaux. Lunettes de protection pour les sports de raquette, casques intégraux pour les sports mécaniques, protections faciales pour les sports de combat. Ces équipements, parfois négligés par souci d'esthétique ou de confort, peuvent littéralement sauver votre vision [7].
En milieu professionnel, le respect des consignes de sécurité est fondamental. Port d'équipements de protection individuelle (EPI), formation aux gestes de sécurité, aménagement des postes de travail. Les entreprises du BTP et de l'industrie ont considérablement réduit l'incidence des traumatismes oculaires grâce à ces mesures préventives [7].
Mais la prévention passe aussi par l'éducation. Sensibiliser les jeunes aux risques, former les secouristes à la reconnaissance des urgences ophtalmologiques, améliorer la prise en charge pré-hospitalière. Ces actions de santé publique, soutenues par les autorités sanitaires, contribuent à réduire les séquelles de ces traumatismes [1].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi des recommandations précises pour la prise en charge des lésions traumatiques du nerf optique [1]. Le Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS), actualisé en 2024-2025, définit les standards de prise en charge de cette pathologie rare mais grave.
La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande une prise en charge multidisciplinaire associant ophtalmologistes, neurochirurgiens, et radiologues. Cette approche coordonnée, idéalement dans un centre de référence, améliore significativement le pronostic fonctionnel [1].
Concernant les traitements, les recommandations 2024 précisent les indications de la corticothérapie. Bien que son efficacité soit débattue, elle reste recommandée dans les 8 premières heures, en l'absence de contre-indication médicale. La posologie standard est de 1g de méthylprednisolone par jour pendant 3 jours [1].
La HAS insiste également sur l'importance du suivi à long terme. Un contrôle ophtalmologique à 1 mois, 3 mois, 6 mois puis annuel est recommandé. Ce suivi permet de détecter précocement les complications et d'adapter la prise en charge rééducative [1]. Les innovations thérapeutiques font l'objet d'une surveillance particulière, avec des protocoles d'évaluation rigoureux avant leur généralisation [2].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations de patients accompagnent les personnes atteintes de lésions traumatiques du nerf optique en France. L'Association Valentin Haüy, référence historique dans l'accompagnement des déficients visuels, propose des services d'aide à l'autonomie et de réinsertion professionnelle.
La Fédération des Aveugles et Amblyopes de France (FAF) coordonne les actions de nombreuses associations locales. Elle offre des services juridiques, sociaux, et techniques adaptés aux besoins spécifiques de chaque patient. Ses antennes départementales assurent un accompagnement de proximité .
Pour les aspects médicaux, l'Association pour la Recherche en Ophtalmologie (ARO) finance des projets de recherche sur les neuropathies optiques. Elle organise également des conférences d'information pour les patients et leurs familles, permettant de se tenir informé des dernières avancées thérapeutiques [2].
Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) constituent un point d'entrée essentiel pour l'accès aux droits et prestations. Elles évaluent le taux d'incapacité, attribuent les aides techniques, et orientent vers les services d'accompagnement appropriés. N'hésitez pas à les contacter dès le diagnostic posé pour optimiser votre prise en charge globale.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre avec une lésion traumatique du nerf optique. Premièrement, ne négligez jamais vos rendez-vous de suivi ophtalmologique. Ces consultations permettent de détecter précocement toute évolution et d'adapter votre prise en charge .
Investissez dans un éclairage de qualité à votre domicile. Les LED à température de couleur variable (3000K le soir, 6000K le jour) réduisent la fatigue visuelle et améliorent le confort. Évitez les éclairages trop contrastés qui peuvent créer des zones d'ombre gênantes.
Apprenez à utiliser les aides techniques modernes. Les smartphones proposent des applications de grossissement, de reconnaissance vocale, et de guidage GPS adaptées aux déficients visuels. Ces outils, souvent gratuits, peuvent considérablement améliorer votre autonomie quotidienne .
Maintenez une activité physique adaptée. La marche, la natation, ou le vélo d'appartement préservent votre maladie physique générale. Certains sports comme le torball ou le cécifoot sont spécifiquement adaptés aux déficients visuels et permettent de maintenir un lien social important. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des associations locales pour découvrir ces activités .
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous amener à consulter en urgence ophtalmologique après un traumatisme, même apparemment mineur . Toute baisse brutale de vision, même légère, justifie un examen spécialisé dans les heures qui suivent le traumatisme.
Ne sous-estimez jamais une douleur orbitaire persistante après un choc. Cette douleur, surtout si elle s'aggrave lors des mouvements oculaires, peut révéler une compression du nerf optique nécessitant une décompression chirurgicale urgente [6].
D'autres symptômes doivent vous alerter : vision double persistante, perception de flashs lumineux, ou modification de la perception des couleurs. Ces signes, parfois subtils, peuvent révéler une atteinte nerveuse débutante qu'un traitement précoce pourrait améliorer .
En cas de doute, n'hésitez jamais à consulter. Les urgences ophtalmologiques sont organisées dans tous les CHU et de nombreux hôpitaux généraux. Le numéro 15 (SAMU) peut vous orienter vers le service le plus proche. Rappelez-vous : dans cette pathologie, chaque heure compte pour préserver votre vision .
Questions Fréquentes
Peut-on récupérer complètement d'une lésion du nerf optique ?
La récupération dépend de la gravité de l'atteinte. Dans les formes légères, une récupération partielle ou complète est possible dans 40 à 60% des cas. Les innovations thérapeutiques récentes offrent de nouveaux espoirs.
Combien de temps faut-il pour savoir si la vision va récupérer ?
L'évolution se fait principalement dans les 6 premiers mois. Cependant, des améliorations tardives sont possibles jusqu'à 2 ans après le traumatisme, surtout avec les nouvelles thérapies.
Les lésions du nerf optique sont-elles héréditaires ?
Non, les lésions traumatiques du nerf optique ne sont pas héréditaires. Elles résultent uniquement d'un traumatisme externe. Il ne faut pas les confondre avec les neuropathies optiques héréditaires qui sont d'origine génétique.
Peut-on conduire avec une lésion du nerf optique ?
Cela dépend de l'importance du déficit visuel. Un examen ophtalmologique spécialisé avec test du champ visuel est nécessaire. Certains patients peuvent conduire avec des aménagements.
Les nouvelles thérapies sont-elles accessibles en France ?
Certaines thérapies innovantes sont disponibles dans le cadre d'essais cliniques ou d'autorisations temporaires d'utilisation. Renseignez-vous auprès de votre ophtalmologiste ou des centres de référence.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS) - Lésions traumatiques du nerf optique. HAS. 2024-2025.Lien
- [2] Ophtalmologie expérimentale. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [3] JNLF 2025. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] JNLF 2024. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] A Facile Strategy to Restore the Optic Nerve Functionality. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] Emerging therapeutic strategies for optic nerve regeneration. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] W Ammari, A Zaghdoudi. Le traitement de neuropathies optiques traumatiques: sujet de controverse. 2022.Lien
- [8] MN Ndiaye-Sow, B Wade. Syndrome de l'apex orbitaire post-traumatique: à propos d'un cas. 2024.Lien
- [9] Z Kallel, A Maalej. Évaluation médicolégale des blasts oculaires chez le militaire actif. 2022.Lien
- [10] J Ireme. Neuropathie optique non glaucomateuse aspects épidémiologiques cliniques et étiologiques au CHU IOTA. 2024.Lien
- [13] YD Dembélé. Connaissances, attitudes et pratiques des personnels de santé devant une urgence ophtalmologique dans le district de Fana. 2025.Lien
- [14] M Manssur Bueno e Silva. Targeting 14-3-3 proteins to promote axon regeneration. 2022.Lien
- [15] Neuropathie optique ischémique - Troubles oculaires. MSD Manuals.Lien
- [16] Neuropathie optique : qu'est-ce que c'est, quels traitements ? Journal des Femmes Santé.Lien
- [17] Neuropathie optique inflammatoire (névrite optique). CHU Lyon.Lien
Publications scientifiques
- [PDF][PDF] Le traitement de neuropathies optiques traumatiques: sujet de contro-verse (2022)[PDF]
- Syndrome de l'apex orbitaire post-traumatique: à propos d'un cas (2024)
- Évaluation médicolégale des blasts oculaires chez le militaire actif (2022)2 citations
- Neuropathie optique non glaucomateuse aspects épidémiologiques cliniques et étiologiques au CHU IOTA (2024)[PDF]
- [PDF][PDF] Neuropathies optiques compressives [PDF]
Ressources web
- Neuropathie optique ischémique - Troubles oculaires (msdmanuals.com)
Le seul symptôme constant est la perte de la vision indolore, qui est généralement soudaine. · Les médecins posent le diagnostic en fonction des symptômes et en ...
- Neuropathie optique : qu'est-ce que c'est, quels traitements ? (sante.journaldesfemmes.fr)
15 avr. 2020 — Ce type de neuropathie optique entraîne une baisse visuelle lente et indolore de la vision, souvent des deux côtés, et peut s'associer à une ...
- Neuropathie optique inflammatoire (névrite optique) (chu-lyon.fr)
12 janv. 2024 — Le diagnostic de névrite optique est ensuite appuyé par l'IRM cérébrale, avec au mieux des coupes centrées sur le nerf optique montrant un ...
- Neuropathies optiques post-traumatiques : à propos de 8 ... (sciencedirect.com)
de A Le Guern · 2016 · Cité 5 fois — La neuropathie optique traumatique, par contusion ou section du nerf optique, est une cause fréquente de baisse d'acuité visuelle et trouble du champ visuel ...
- Comment les maladies du nerf optique affectent la vision (harmonie-sante.fr)
31 janv. 2025 — Le diagnostic de neuropathie optique est réalisé après un interrogatoire et des examens ophtalmologiques comme une mesure de l'acuité visuelle, ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
