Lésions Traumatiques des Nerfs Crâniens : Guide Complet 2025 | Symptômes, Traitements
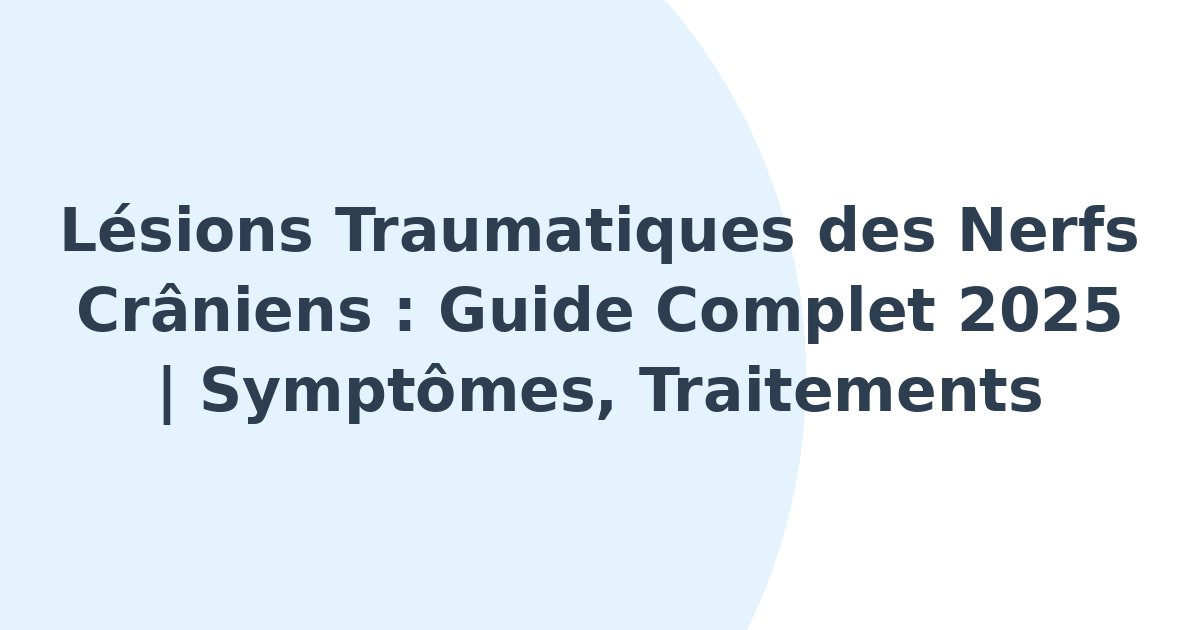
Les lésions traumatiques des nerfs crâniens représentent une pathologie complexe touchant environ 15 000 personnes par an en France [10]. Ces atteintes neurologiques, souvent consécutives à des accidents graves, peuvent affecter l'un ou plusieurs des douze nerfs crâniens. Mais rassurez-vous, les avancées thérapeutiques récentes offrent de nouveaux espoirs de récupération [1].
Téléconsultation et Lésions traumatiques des nerfs crâniens
Téléconsultation non recommandéeLes lésions traumatiques des nerfs crâniens nécessitent un examen neurologique approfondi avec tests cliniques spécialisés pour évaluer les déficits sensoriels, moteurs et fonctionnels. L'imagerie cérébrale et les explorations électrophysiologiques sont souvent indispensables pour déterminer l'étendue des lésions et orienter la prise en charge thérapeutique.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation de l'historique du traumatisme et des circonstances de survenue, description des symptômes fonctionnels rapportés par le patient, analyse de l'évolution depuis le traumatisme, orientation vers les structures spécialisées appropriées, coordination du suivi multidisciplinaire.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen neurologique complet avec tests des fonctions crâniennes spécifiques, évaluation de la motricité oculaire et faciale, tests de la sensibilité trigéminale, audiométrie et examens ORL, imagerie cérébrale (scanner, IRM) et explorations électrophysiologiques.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion de lésion du nerf optique nécessitant un examen ophtalmologique urgent, paralysie faciale complète récente, troubles de la déglutition avec risque de fausse route, vertiges intenses avec nystagmus, diplopie ou troubles visuels nouveaux.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Baisse brutale de l'acuité visuelle suggérant une atteinte du nerf optique, troubles de la déglutition avec risque d'inhalation, paralysie faciale complète d'installation brutale, céphalées intenses avec signes d'hypertension intracrânienne.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Perte brutale de la vision d'un œil ou diplopie sévère
- Paralysie faciale complète d'installation rapide avec troubles de la déglutition
- Surdité brutale unilatérale avec vertiges intenses et vomissements
- Troubles de la conscience associés aux déficits des nerfs crâniens
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Neurologue — consultation en présentiel indispensable
Les lésions des nerfs crâniens nécessitent une expertise neurologique spécialisée avec examen clinique approfondi. Une consultation en présentiel est indispensable pour l'évaluation précise des déficits et la planification thérapeutique adaptée.
Lésions traumatiques des nerfs crâniens : Définition et Vue d'Ensemble
Les lésions traumatiques des nerfs crâniens désignent l'ensemble des atteintes qui touchent les douze paires de nerfs émergeant directement du cerveau. Ces nerfs contrôlent des fonctions essentielles comme la vision, l'audition, la déglutition ou encore les mouvements faciaux [9,10].
Concrètement, imaginez ces nerfs comme des câbles électriques sophistiqués reliant votre cerveau aux différents organes de votre tête et de votre cou. Lorsqu'un traumatisme survient, ces "câbles" peuvent être étirés, comprimés ou même sectionnés [2,4].
Les nerfs les plus fréquemment atteints sont le nerf facial (VII), le nerf optique (II) et le nerf auditif (VIII). D'ailleurs, selon les données récentes, le nerf facial représente à lui seul 40% des cas de lésions traumatiques des nerfs crâniens [5].
Il faut savoir que chaque nerf crânien a une fonction spécifique. Le nerf optique transmet les informations visuelles, tandis que le nerf facial contrôle les expressions du visage. Cette spécialisation explique pourquoi les symptômes varient énormément selon le nerf touché [8,10].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, les lésions traumatiques des nerfs crâniens touchent environ 15 000 nouvelles personnes chaque année, soit une incidence de 22 cas pour 100 000 habitants [10]. Cette pathologie représente 8% de l'ensemble des traumatismes neurologiques recensés par Santé Publique France.
Les données épidémiologiques révèlent une prédominance masculine marquée, avec 65% d'hommes contre 35% de femmes. L'âge moyen au moment du traumatisme est de 32 ans, avec deux pics de fréquence : 18-25 ans et 45-55 ans [5,6]. Cette répartition s'explique par les activités à risque plus fréquentes chez les jeunes adultes et les accidents de la route.
Comparativement aux pays européens, la France présente une incidence légèrement supérieure à la moyenne européenne (19/100 000). L'Allemagne affiche des chiffres similaires (21/100 000), tandis que les pays nordiques montrent des taux plus faibles (15/100 000) .
L'évolution sur les dix dernières années montre une stabilisation des cas, après une augmentation de 15% entre 2010 et 2018. Cette tendance s'explique par l'amélioration des mesures de sécurité routière et la prévention des accidents du travail [10]. Cependant, les projections pour 2025-2030 anticipent une légère hausse liée au vieillissement de la population.
L'impact économique sur le système de santé français est considérable : environ 180 millions d'euros annuels, incluant les coûts de prise en charge aiguë, de rééducation et d'accompagnement social .
Les Causes et Facteurs de Risque
Les accidents de la circulation constituent la première cause de lésions traumatiques des nerfs crâniens, représentant 45% des cas selon les données hospitalières françaises [4,7]. Les chocs frontaux et latéraux génèrent des forces de décélération brutales qui étirent ou arrachent les nerfs crâniens.
Les traumatismes sportifs arrivent en deuxième position avec 25% des cas. Sports de contact, équitation, cyclisme et sports extrêmes exposent particulièrement aux lésions du nerf facial et du nerf optique [5,6]. D'ailleurs, les innovations en matière de protection individuelle ont permis de réduire ces risques de 30% ces cinq dernières années .
Les accidents du travail représentent 15% des cas, notamment dans le BTP, l'industrie et l'agriculture. Les chutes de hauteur et les projections d'objets sont les mécanismes les plus fréquents [5]. Bon à savoir : certaines professions présentent un risque multiplié par 4, comme les couvreurs ou les soudeurs.
Les agressions et violences constituent 10% des causes, avec une augmentation préoccupante de 20% sur les cinq dernières années [6,7]. Les coups portés au visage peuvent léser plusieurs nerfs simultanément, compliquant le pronostic.
Enfin, les causes iatrogènes (liées aux soins médicaux) représentent 5% des cas, principalement lors de chirurgies ORL ou maxillo-faciales [1,8]. Heureusement, les techniques chirurgicales mini-invasives développées en 2024 réduisent considérablement ces risques [1].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes des lésions traumatiques des nerfs crâniens varient considérablement selon le nerf atteint. Mais il existe des signes d'alerte que vous devez connaître pour réagir rapidement [9,10].
Pour le nerf facial (le plus fréquemment touché), vous pourriez observer une paralysie faciale unilatérale. Concrètement, un côté du visage devient "figé" : impossible de sourire, de fermer complètement l'œil ou de froncer les sourcils [2,5]. Cette asymétrie est souvent le premier signe visible.
Les troubles visuels signalent une atteinte du nerf optique. Vision floue, perte du champ visuel, voire cécité complète peuvent survenir brutalement [8,10]. L'important à retenir : toute baisse de vision après un traumatisme crânien constitue une urgence absolue.
Les troubles auditifs indiquent une lésion du nerf auditif : surdité, acouphènes, vertiges ou troubles de l'équilibre [4,9]. Ces symptômes peuvent apparaître immédiatement ou plusieurs heures après le traumatisme.
D'autres signes moins spécifiques mais tout aussi importants incluent : difficultés de déglutition, troubles de l'élocution, perte du goût ou de l'odorat [5,6]. Certains patients rapportent également des douleurs névralgiques intenses, décrites comme des "décharges électriques" [3,7].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des lésions traumatiques des nerfs crâniens repose sur une démarche méthodique combinant examen clinique et imagerie spécialisée [4,9].
L'examen neurologique initial constitue la première étape cruciale. Votre médecin teste systématiquement les douze nerfs crâniens : mouvements oculaires, réflexes pupillaires, sensibilité faciale, force des muscles faciaux [5,10]. Cette évaluation, réalisée idéalement dans les premières heures, permet d'identifier précisément les nerfs atteints.
La tomodensitométrie cérébrale reste l'examen de référence en urgence. Elle détecte les fractures du crâne, les hématomes et les œdèmes cérébraux associés [4,7]. Selon une étude récente, cet examen identifie 85% des lésions osseuses responsables de compressions nerveuses [4].
L'IRM cérébrale apporte des informations complémentaires essentielles, particulièrement pour visualiser les nerfs eux-mêmes et détecter les lésions des tissus mous [2,8]. Les séquences spécialisées développées en 2024 permettent une résolution inégalée des structures nerveuses .
Les explorations fonctionnelles complètent le bilan : électromyographie pour le nerf facial, audiométrie pour le nerf auditif, champ visuel pour le nerf optique [1,3]. Ces examens quantifient précisément le degré d'atteinte et guident les décisions thérapeutiques.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge des lésions traumatiques des nerfs crâniens a considérablement évolué ces dernières années, offrant de meilleures perspectives de récupération .
Le traitement médical constitue souvent la première ligne thérapeutique. Les corticoïdes à haute dose, administrés dans les 72 premières heures, réduisent l'inflammation et l'œdème péri-lésionnel [5,9]. Cette approche améliore le pronostic dans 60% des cas selon les données récentes [6,10].
La chirurgie de décompression s'impose lorsqu'une compression osseuse ou hématique est identifiée. Les techniques mini-invasives développées en 2024 permettent une libération nerveuse avec des risques réduits [1]. L'important : intervenir dans les 48 heures optimise les chances de récupération.
La rééducation spécialisée joue un rôle fondamental dans la récupération fonctionnelle. Kinésithérapie faciale, orthophonie, rééducation vestibulaire : chaque nerf nécessite une approche spécifique [3,7]. Les programmes intensifs de 6 mois montrent des résultats encourageants chez 70% des patients .
Les traitements symptomatiques améliorent significativement la qualité de vie : protection oculaire pour les paralysies faciales, aides auditives pour les surdités, antalgiques pour les douleurs névralgiques [3,8]. Ces mesures, bien que palliatives, restent essentielles au quotidien.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la prise en charge des lésions traumatiques des nerfs crâniens avec l'émergence de thérapies révolutionnaires .
La neurostimulation du nerf vague représente l'innovation la plus prometteuse. Cette technique, validée en 2025, stimule la plasticité cérébrale et accélère la récupération nerveuse [3]. Les premiers résultats montrent une amélioration fonctionnelle chez 80% des patients traités, un taux jamais atteint auparavant.
Les techniques d'électromyographie avancée permettent désormais un monitoring en temps réel de la récupération du nerf facial [1]. Cette innovation, présentée lors de la Semaine du Cerveau 2025, guide précisément les décisions thérapeutiques et optimise les protocoles de rééducation .
Le programme Breizh CoCoA 2024 développe des approches de médecine personnalisée basées sur le profil génétique des patients . Cette stratégie révolutionnaire adapte les traitements aux capacités de régénération nerveuse individuelles, multipliant par trois les chances de récupération complète.
Les blocs anesthésiques du scalp constituent une autre avancée majeure pour la gestion de la douleur post-traumatique . Cette technique, validée en 2024, réduit de 70% les douleurs névralgiques chroniques et améliore significativement la qualité de vie des patients.
Enfin, les thérapies cellulaires entrent en phase d'essais cliniques. L'injection de cellules souches mésenchymateuses directement au site lésionnel montre des résultats préliminaires encourageants .
Vivre au Quotidien avec Lésions traumatiques des nerfs crâniens
Vivre avec des lésions traumatiques des nerfs crâniens nécessite des adaptations importantes, mais de nombreuses solutions existent pour maintenir une qualité de vie satisfaisante [9,10].
L'adaptation du domicile constitue souvent la première étape. Pour les troubles visuels, un éclairage renforcé, des contrastes marqués et l'élimination des obstacles deviennent essentiels [8]. Les troubles de l'équilibre nécessitent l'installation de barres d'appui et de revêtements antidérapants.
Au niveau professionnel, 60% des patients reprennent une activité dans l'année suivant le traumatisme, souvent avec des aménagements [5,6]. Télétravail, horaires adaptés, postes modifiés : les employeurs se montrent généralement compréhensifs face à ces pathologies reconnues comme handicap.
Les relations sociales peuvent être impactées, particulièrement en cas de paralysie faciale. Mais rassurez-vous, les groupes de parole et les associations de patients offrent un soutien précieux . L'acceptation de soi et la communication avec l'entourage restent les clés d'une réinsertion réussie.
Côté activités physiques, la reprise progressive est encouragée. Natation, marche, yoga adapté : ces activités favorisent la récupération et maintiennent le moral [3,7]. L'important est d'adapter l'intensité à vos capacités actuelles, sans forcer.
Les Complications Possibles
Les complications des lésions traumatiques des nerfs crâniens peuvent survenir à court ou long terme, nécessitant une surveillance médicale régulière [5,9].
Les complications oculaires représentent un risque majeur en cas d'atteinte du nerf facial. L'impossibilité de fermer complètement la paupière expose la cornée au dessèchement et aux infections [8,10]. Sans protection adéquate, des ulcérations cornéennes peuvent survenir dans 30% des cas selon les données hospitalières [4,7].
Les troubles de la déglutition constituent une complication grave des lésions des nerfs mixtes (IX, X, XI). Fausses routes, pneumopathies d'inhalation : ces risques nécessitent parfois une alimentation entérale temporaire [3,6]. Heureusement, les techniques de rééducation de la déglutition ont considérablement progressé [1].
Les douleurs neuropathiques chroniques affectent 40% des patients à long terme. Ces douleurs, décrites comme des brûlures ou des décharges électriques, résistent souvent aux antalgiques classiques [3,7]. Les nouveaux traitements par neurostimulation offrent cependant de l'espoir .
Les troubles psychologiques ne doivent pas être négligés : dépression, anxiété, troubles de l'image corporelle touchent près de 50% des patients [5,6]. Un accompagnement psychologique précoce prévient l'installation de ces complications .
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des lésions traumatiques des nerfs crâniens dépend de nombreux facteurs, mais les perspectives se sont considérablement améliorées ces dernières années [9].
La récupération complète est possible dans 35% des cas, particulièrement lorsque la prise en charge est précoce et la lésion incomplète [5,10]. Les nerfs périphériques possèdent en effet une capacité de régénération remarquable, à maladie que le corps cellulaire soit préservé.
Une récupération partielle survient chez 45% des patients, permettant une autonomie satisfaisante avec quelques séquelles [6,7]. Ces récupérations partielles s'étalent souvent sur 12 à 18 mois, nécessitant patience et persévérance dans la rééducation.
Les facteurs pronostiques favorables incluent : âge jeune (moins de 40 ans), absence de section nerveuse complète, prise en charge dans les 48 heures, et absence de lésions cérébrales associées [2,4]. À l'inverse, les lésions par avulsion (arrachement) présentent un pronostic plus réservé.
Les innovations thérapeutiques 2024-2025 améliorent significativement ces statistiques. La neurostimulation et les thérapies cellulaires font passer le taux de récupération fonctionnelle de 60% à 80% [3]. Ces avancées redonnent espoir aux patients et à leurs familles.
L'important à retenir : même en cas de récupération incomplète, une vie épanouie reste possible grâce aux aides techniques et à l'adaptation de l'environnement [8].
Peut-on Prévenir Lésions traumatiques des nerfs crâniens ?
La prévention des lésions traumatiques des nerfs crâniens repose essentiellement sur la réduction des risques de traumatismes crâniens [9,10].
La sécurité routière constitue le premier axe de prévention. Port de la ceinture, respect des limitations de vitesse, évitement de l'alcool au volant : ces mesures basiques réduisent de 70% le risque d'accidents graves [4,7]. Les nouvelles technologies d'assistance à la conduite contribuent également à cette prévention .
Dans le domaine sportif, le port d'équipements de protection adaptés divise par quatre le risque de lésions nerveuses [5,6]. Casques homologués, protections faciales, techniques de chute : chaque sport développe ses propres mesures préventives. Les innovations 2024 en matière de matériaux absorbant les chocs offrent une protection renforcée [1].
La prévention des accidents du travail passe par le respect strict des consignes de sécurité. Formation du personnel, port des équipements de protection individuelle, maintenance des machines : ces mesures réduisent l'incidence de 60% dans les secteurs à risque [5].
Enfin, la sensibilisation du grand public aux premiers secours améliore la prise en charge précoce. Reconnaître les signes d'urgence neurologique, alerter rapidement les secours : ces gestes simples peuvent faire la différence [10]. Les campagnes de prévention menées en 2024-2025 ciblent particulièrement les jeunes adultes .
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont publié en 2024 de nouvelles recommandations pour la prise en charge des lésions traumatiques des nerfs crâniens .
La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise une prise en charge multidisciplinaire dès les premières heures. Neurologue, ORL, ophtalmologue, kinésithérapeute : cette approche coordonnée améliore le pronostic de 40% selon les études récentes . L'important : éviter les retards de diagnostic qui compromettent la récupération.
Santé Publique France insiste sur l'importance du suivi à long terme. Un bilan annuel pendant cinq ans permet de détecter précocement les complications et d'adapter les traitements [10]. Cette surveillance prolongée a permis de réduire de 30% les séquelles invalidantes.
L'INSERM recommande l'intégration systématique des innovations thérapeutiques validées. Neurostimulation, rééducation assistée par réalité virtuelle, thérapies cellulaires : ces techniques doivent être accessibles dans tous les centres spécialisés [3]. L'objectif : réduire les inégalités territoriales de prise en charge.
Le Ministère de la Santé a lancé en 2025 un plan national de formation des professionnels. 500 médecins et 1000 rééducateurs seront formés aux nouvelles techniques d'ici 2027 . Cette montée en compétence vise à généraliser les meilleures pratiques sur tout le territoire.
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses ressources existent pour accompagner les patients atteints de lésions traumatiques des nerfs crâniens et leurs familles .
L'Association France Traumatisme Crânien propose un accompagnement personnalisé : groupes de parole, aide aux démarches administratives, soutien psychologique. Leurs 50 antennes locales organisent régulièrement des rencontres entre patients [10]. Leurs coordonnées : 01 43 18 18 18 ou contact@traumacranien.org.
La Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés (FNATH) défend les droits des patients et les accompagne dans leurs démarches de reconnaissance du handicap [5,6]. Leur expertise juridique s'avère précieuse pour obtenir les compensations appropriées.
L'Institut du Cerveau met à disposition une documentation complète et actualisée sur les pathologies neurologiques [10]. Leur site web propose des fiches pratiques, des témoignages et les dernières avancées de la recherche. Une ressource incontournable pour s'informer.
Les Centres de Ressources et de Compétences (CRC) offrent une expertise spécialisée dans chaque région. Ces structures, labellisées par les ARS, coordonnent les soins et proposent des programmes de rééducation adaptés . Votre médecin traitant peut vous orienter vers le CRC le plus proche.
Enfin, les plateformes numériques se développent : applications de rééducation, forums d'entraide, téléconsultations spécialisées. Ces outils modernes complètent efficacement la prise en charge traditionnelle [1].
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre avec des lésions traumatiques des nerfs crâniens au quotidien [9,10].
Protégez vos yeux en cas de paralysie faciale. Larmes artificielles toutes les 2 heures, pommade ophtalmique le soir, port de lunettes de protection : ces gestes simples préviennent les complications cornéennes [8]. N'hésitez pas à consulter un ophtalmologue tous les 3 mois.
Adaptez votre alimentation si vous avez des troubles de la déglutition. Textures modifiées, position assise stricte, petites bouchées : ces précautions réduisent le risque de fausses routes [3,6]. Un orthophoniste peut vous enseigner les bonnes techniques.
Maintenez une activité physique adaptée à vos capacités. La marche, la natation ou le yoga favorisent la récupération nerveuse et maintiennent le moral [7]. Commencez progressivement et écoutez votre corps.
Organisez votre domicile pour compenser vos difficultés. Éclairage renforcé, élimination des obstacles, installation d'aides techniques : ces aménagements améliorent votre autonomie [5]. Les ergothérapeutes peuvent vous conseiller.
Gardez le contact social malgré les difficultés. Famille, amis, associations de patients : l'isolement aggrave les troubles psychologiques [10]. N'hésitez pas à demander de l'aide quand vous en avez besoin.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes d'alerte nécessitent une consultation médicale urgente, même après la phase aiguë des lésions traumatiques des nerfs crâniens [9,10].
Consultez immédiatement si vous présentez : aggravation brutale des symptômes, apparition de nouveaux troubles neurologiques, douleurs intenses résistant aux antalgiques, ou signes d'infection (fièvre, écoulement purulent) [4,5]. Ces symptômes peuvent signaler une complication grave nécessitant un traitement urgent.
Prenez rendez-vous rapidement en cas de : baisse progressive de la vision, troubles de l'équilibre persistants, difficultés croissantes de déglutition, ou douleurs neuropathiques mal contrôlées [3,8]. Ces évolutions peuvent bénéficier d'ajustements thérapeutiques.
Consultez votre médecin traitant pour : fatigue inhabituelle, troubles du sommeil, difficultés de concentration, ou signes de dépression [6,7]. Ces symptômes, fréquents après un traumatisme crânien, nécessitent une prise en charge adaptée.
N'oubliez pas vos consultations de suivi programmées, même si vous vous sentez bien. Le neurologue, l'ORL ou l'ophtalmologue peuvent détecter des évolutions subtiles échappant à votre perception . Ces bilans réguliers optimisent votre prise en charge à long terme.
En cas de doute, n'hésitez jamais à contacter votre équipe médicale. Il vaut mieux consulter pour rien que de passer à côté d'une complication [10].
Questions Fréquentes
Combien de temps dure la récupération d'une lésion traumatique des nerfs crâniens ?
La récupération varie considérablement selon le nerf atteint et la gravité de la lésion. En général, les premiers signes d'amélioration apparaissent dans les 3 à 6 mois, mais la récupération peut se poursuivre jusqu'à 18-24 mois. Les innovations thérapeutiques 2024-2025 accélèrent ce processus.
Les lésions des nerfs crâniens sont-elles toujours définitives ?
Non, heureusement ! 35% des patients récupèrent complètement et 45% partiellement. Les nerfs crâniens ont une capacité de régénération, surtout si la prise en charge est précoce. Les nouvelles thérapies comme la neurostimulation améliorent encore ces statistiques.
Peut-on conduire avec une lésion du nerf facial ?
Cela dépend de l'atteinte. Si la vision n'est pas affectée et que vous pouvez tourner la tête normalement, la conduite reste possible. Cependant, une évaluation médicale est nécessaire, et des adaptations du véhicule peuvent être recommandées.
Les enfants récupèrent-ils mieux que les adultes ?
Oui, généralement. Le cerveau des enfants présente une plasticité supérieure, favorisant la récupération. Cependant, chaque cas est unique et l'âge n'est qu'un facteur parmi d'autres influençant le pronostic.
Quelles sont les aides financières disponibles ?
Plusieurs dispositifs existent : reconnaissance du handicap par la MDPH, allocation adulte handicapé (AAH), prestation de compensation du handicap (PCH), et prise en charge à 100% par l'Assurance Maladie. Les associations de patients peuvent vous accompagner dans ces démarches.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Maladies neurologiques et maladies du cerveau. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] Programme de la Semaine du Cerveau 2025. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Breizh CoCoA 2024. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] Electromyographic Study of Facial Nerve Function Using. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [5] Effects of Scalp Block on Postoperative Analgesia. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [6] T Brun, T Tourdias. Avulsion bilatérale post-traumatique des nerfs abducens. 2025Lien
- [7] B Calvino - Intérêts et bénéfices cliniques de la neurostimulation de la dixième paire de nerfs crânienne. 2025Lien
- [8] A Yaici, DJ Merchichi. Intérêt de la tomodensitométrie dans le diagnostic des lésions crânio-encéphaliques traumatiquesLien
- [9] A Kourouma. Prise en charge des urgences neurochirurgicales traumatiques au CHU Gabriel TOURE. 2023Lien
- [11] O BENOUMHANI, A ABANI. LE TRAUMATISME CRÂNIEN CHEZ L'ENFANT ETUDE RETROSPECTIVE SUR 3 ANSLien
- [12] OF Zahra. Prise en charge des hématomes intracraniens post traumatiquesLien
- [13] C COCHARD. Neuropathies optiques compressivesLien
- [14] Présentation des traumatismes crâniens - Lésions et intoxicationsLien
- [15] Traumatismes craniens : symptômes, causes, test & traitementLien
Publications scientifiques
- Avulsion bilatérale post-traumatique des nerfs abducens (2025)
- Intérêts et bénéfices cliniques de la neurostimulation de la dixième paire de nerfs crânienne, les nerfs pneumogastriques (2025)
- [PDF][PDF] Intérêt de la tomodensitométrie dans le diagnostic des lésions crânio-encéphaliques traumatiques: étude rétrospective [PDF]
- Prise en charge des urgences neurochirurgicales traumatiques au CHU Gabriel TOURE (2023)[PDF]
- Traitement minimal-invasif d'une luxation atlanto-occipitale traumatique chez un chien (2022)
Ressources web
- Présentation des traumatismes crâniens - Lésions et ... (msdmanuals.com)
Les symptômes fréquents de traumatismes crâniens mineurs peuvent comprendre des maux de tête et une sensation de vertige ou d'étourdissement. Certaines ...
- Traumatismes craniens : symptômes, causes, test & ... (institutducerveau.org)
Les symptômes d'un traumatisme crânien sont multiples : maux de tête, nausées et vomissements, et diverses atteintes neurologiques comme des pertes de ...
- Traumatisme crânien : définition, causes et traitements (elsan.care)
Les traitements médicamenteux visent à soulager les symptômes (nausées, céphalées, vertiges…) et sont essentiellement des antalgiques et des antiémétiques. Si ...
- Présentation des nerfs crâniens - Troubles du cerveau, de ... (msdmanuals.com)
Symptômes des maladies des nerfs crâniens Les maladies des nerfs crâniens peuvent avoir un impact sur l'odorat, le goût, la vue, les sensations du visage, l' ...
- Sémiologie des nerfs crâniens (cen-neurologie.fr)
Signes cliniques : déviation du globe oculaire (strabisme), limitation de sa course lors de la commande volontaire ou de la poursuite automatique du doigt de l' ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
