Lésion Pulmonaire Aigüe : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
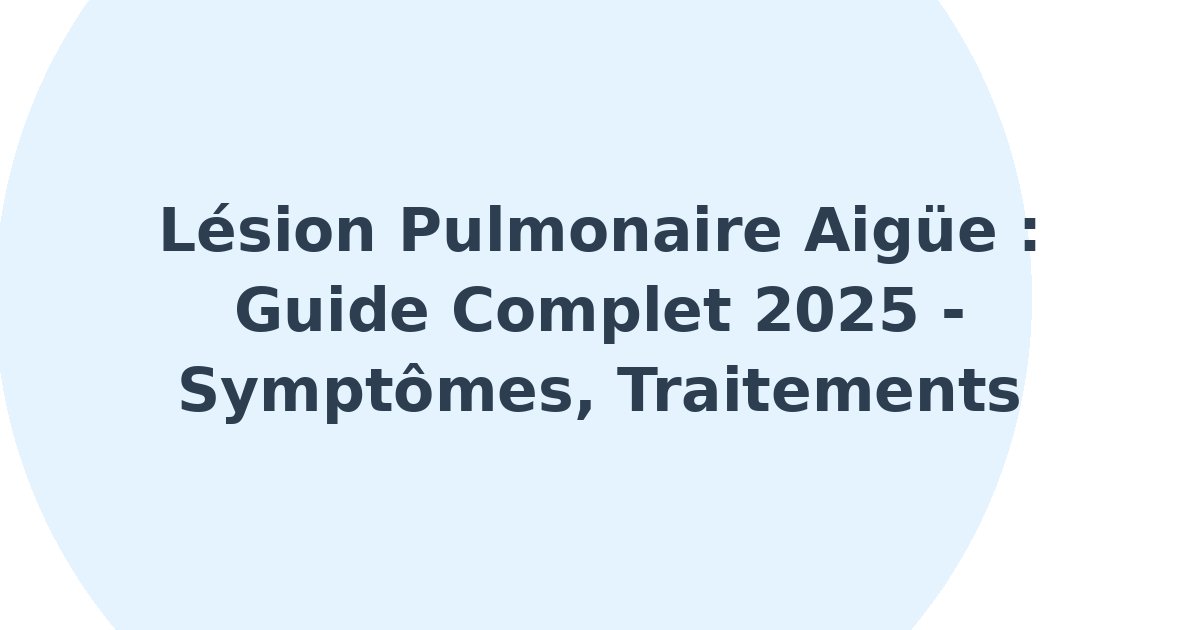
La lésion pulmonaire aigüe représente une urgence médicale qui touche environ 15 000 personnes chaque année en France [1,15]. Cette pathologie grave, souvent méconnue du grand public, peut rapidement évoluer vers un syndrome de détresse respiratoire aigüe. Comprendre ses mécanismes, reconnaître ses symptômes et connaître les traitements disponibles peut littéralement sauver des vies.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Lésion Pulmonaire Aigüe : Définition et Vue d'Ensemble
La lésion pulmonaire aigüe (LPA) correspond à une inflammation sévère des poumons qui survient brutalement. Contrairement à une pneumonie classique, cette pathologie affecte les alvéoles pulmonaires de manière diffuse [15]. Les poumons se remplissent de liquide inflammatoire, compromettant gravement les échanges gazeux.
Mais qu'est-ce qui distingue vraiment cette maladie ? En fait, la LPA se caractérise par une perméabilité anormale de la barrière alvéolo-capillaire [7,8]. Cette membrane, normalement étanche, devient poreuse et laisse passer des protéines et du liquide dans les alvéoles. Imaginez une passoire qui remplacerait un filtre à café : l'eau passerait partout !
D'ailleurs, les médecins utilisent des critères précis pour diagnostiquer cette pathologie. L'important à retenir, c'est que la LPA peut évoluer vers un syndrome de détresse respiratoire aigüe (SDRA) dans 60% des cas selon les données françaises récentes [11,15]. Cette évolution survient généralement dans les 24 à 48 heures suivant l'apparition des premiers symptômes.
Concrètement, vos poumons perdent leur capacité à oxygéner correctement votre sang. Cette situation nécessite une prise en charge immédiate en réanimation, avec souvent un recours à la ventilation mécanique [7,9].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, la lésion pulmonaire aigüe touche environ 15 000 personnes chaque année, soit une incidence de 22 cas pour 100 000 habitants [1,15]. Ces chiffres, issus des données de Santé Publique France, montrent une stabilité relative depuis 2020, après une augmentation notable liée à la pandémie de COVID-19.
L'âge moyen des patients atteints se situe autour de 65 ans, avec une légère prédominance masculine (55% d'hommes contre 45% de femmes) [11,15]. Mais attention, cette pathologie peut survenir à tout âge, y compris chez des adultes jeunes en parfaite santé apparente.
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne avec des taux similaires à l'Allemagne et au Royaume-Uni [4,5]. Cependant, les pays nordiques affichent des taux légèrement inférieurs, probablement liés à des différences dans les facteurs de risque environnementaux et les habitudes de vie.
D'un point de vue économique, le coût moyen d'une hospitalisation pour LPA s'élève à 35 000 euros par patient [6]. Cette somme inclut le séjour en réanimation, les examens diagnostiques et les traitements spécialisés. L'impact sur le système de santé français représente ainsi plus de 500 millions d'euros annuels.
Les projections pour 2025-2030 suggèrent une augmentation de 15% des cas, principalement due au vieillissement de la population et à l'augmentation des comorbidités [4,6]. Cette tendance inquiète les autorités sanitaires qui renforcent les programmes de prévention.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes de lésion pulmonaire aigüe sont multiples et parfois surprenantes. La pneumonie bactérienne reste la cause la plus fréquente, représentant 40% des cas selon les données françaises [1,15]. Mais d'autres facteurs peuvent déclencher cette pathologie grave.
Parmi les causes directes, on retrouve l'inhalation de substances toxiques, les traumatismes thoraciques et certaines infections virales [13,15]. La leptospirose, par exemple, peut provoquer des lésions pulmonaires sévères, comme le rapporte une étude malienne récente [13]. Cette maladie tropicale, transmise par les rongeurs, illustre bien la diversité des agents pathogènes impliqués.
Les causes indirectes sont tout aussi importantes. Le sepsis (infection généralisée) représente 35% des cas de LPA [15]. D'autres situations comme les transfusions sanguines massives, les pancréatites aiguës ou certains médicaments peuvent également déclencher cette pathologie.
Concernant les médicaments, une étude française récente a mis en évidence la toxicité pulmonaire du triméthoprime-sulfaméthoxazole [12]. Cet antibiotique, couramment prescrit, peut dans de rares cas provoquer des lésions pulmonaires aigües. L'important à retenir, c'est que cette complication reste exceptionnelle mais nécessite une surveillance.
Certains facteurs augmentent votre risque de développer une LPA : l'âge avancé, le tabagisme, l'alcoolisme chronique, et les maladies chroniques comme le diabète ou l'insuffisance cardiaque [11,15]. Si vous présentez plusieurs de ces facteurs, une vigilance particulière s'impose.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la lésion pulmonaire aigüe apparaissent généralement de manière brutale, en quelques heures seulement. Le premier signe d'alarme est souvent une dyspnée (difficulté à respirer) qui s'aggrave rapidement [15,16]. Vous pourriez avoir l'impression de manquer d'air même au repos.
La tachypnée (respiration rapide) accompagne presque toujours cette gêne respiratoire. Votre fréquence respiratoire peut dépasser 30 respirations par minute, contre 12 à 16 normalement [15]. Cette accélération témoigne de l'effort de vos poumons pour compenser le manque d'oxygène.
D'autres symptômes peuvent vous alerter : une toux sèche persistante, parfois accompagnée de crachats mousseux ou rosés [16]. Ces expectorations particulières résultent de l'œdème pulmonaire qui caractérise cette pathologie. Une fatigue extrême et des douleurs thoraciques complètent souvent le tableau clinique.
Mais attention, certains signes nécessitent un appel immédiat au 15 : une cyanose (coloration bleutée des lèvres ou des ongles), des sueurs froides, ou une altération de la conscience [15]. Ces symptômes témoignent d'un manque d'oxygène sévère qui met votre vie en danger.
Il est important de noter que les symptômes peuvent varier selon la cause sous-jacente. En cas de sepsis, vous pourriez également présenter de la fièvre et des frissons [15]. L'évolution est généralement rapide, d'où l'importance de consulter sans délai.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de lésion pulmonaire aigüe repose sur une combinaison d'éléments cliniques, biologiques et radiologiques. Dès votre arrivée aux urgences, l'équipe médicale évalue votre détresse respiratoire et mesure votre saturation en oxygène [15].
La radiographie thoracique constitue l'examen de première intention. Elle révèle des opacités bilatérales diffuses, caractéristiques de l'œdème pulmonaire lésionnel [8,15]. Contrairement à l'œdème cardiaque, ces opacités sont réparties de manière homogène dans les deux poumons.
Mais l'examen le plus précis reste le scanner thoracique. Une étude française récente a développé des techniques de quantification de l'aération pulmonaire sur les images CT [8]. Cette approche permet d'évaluer avec précision l'étendue des lésions et de guider le traitement. Le scanner peut révéler des zones de condensation, d'atélectasie et d'emphysème sous-cutané.
Les examens biologiques complètent le bilan diagnostique. L'analyse des gaz du sang artériel montre une hypoxémie sévère avec un rapport PaO2/FiO2 inférieur à 300 mmHg [15]. Cette mesure objective la gravité de l'atteinte respiratoire et guide les décisions thérapeutiques.
D'autres examens peuvent être nécessaires selon le contexte : hémocultures en cas de suspicion d'infection, échocardiographie pour éliminer une cause cardiaque, ou prélèvements respiratoires pour identifier un agent pathogène [1,15]. L'important, c'est d'identifier rapidement la cause pour adapter le traitement.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de la lésion pulmonaire aigüe nécessite une prise en charge multidisciplinaire en réanimation. L'objectif principal consiste à maintenir une oxygénation correcte tout en traitant la cause sous-jacente [7,9,15].
L'oxygénothérapie à haut débit nasal représente souvent la première étape thérapeutique. Cette technique, étudiée dans une publication française de 2022, permet de délivrer un mélange air-oxygène réchauffé et humidifié à des débits élevés [9]. Elle améliore l'oxygénation tout en réduisant le travail respiratoire.
Cependant, si cette approche s'avère insuffisante, la ventilation mécanique devient nécessaire. Les protocoles français recommandent une ventilation protectrice avec des volumes courants réduits (6 ml/kg de poids idéal) et une pression positive en fin d'expiration (PEEP) adaptée [7]. Cette stratégie vise à limiter les lésions induites par la ventilation elle-même.
Le traitement de la cause sous-jacente reste fondamental. En cas de pneumonie bactérienne, une antibiothérapie adaptée doit être débutée dans les premières heures [1]. Pour les infections virales, des antiviraux spécifiques peuvent être prescrits selon l'agent pathogène identifié.
D'autres mesures de support complètent la prise en charge : maintien de l'équilibre hydro-électrolytique, nutrition adaptée, et prévention des complications de décubitus [15]. La kinésithérapie respiratoire, dès que possible, aide à mobiliser les sécrétions et à prévenir les surinfections.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
La recherche sur les lésions pulmonaires aigües connaît des avancées prometteuses en 2024-2025. Le bulletin de recherche de l'European Respiratory Society (ERS) 2024 met en lumière plusieurs innovations thérapeutiques révolutionnaires [4].
Une approche particulièrement innovante concerne l'utilisation de thérapies cellulaires. Le CHU de Lyon a récemment traité un premier patient atteint de cancer pulmonaire par thérapie cellulaire de type CNET [3]. Bien que cette technique soit initialement développée pour le cancer, les chercheurs explorent son potentiel dans les lésions pulmonaires aigües.
Les antagonistes des récepteurs de l'IL-1 et de l'IL-6 représentent une autre piste prometteuse. Une étude canadienne récente a démontré leur efficacité pour la résolution des paramètres du SDRA dans un modèle murin [14]. Ces molécules ciblent l'inflammation excessive qui caractérise cette pathologie.
D'ailleurs, le marché mondial du traitement du SDRA devrait passer de 1,23 milliard de dollars en 2023 à 2,36 milliards en 2032 [6]. Cette croissance témoigne de l'investissement massif dans la recherche et le développement de nouvelles thérapies.
Les techniques d'imagerie évoluent également. La quantification automatisée de l'aération pulmonaire sur scanner permet désormais un suivi précis de l'évolution des lésions [8]. Cette approche aide les médecins à adapter le traitement en temps réel selon la réponse du patient.
Vivre au Quotidien avec une Lésion Pulmonaire Aigüe
Après une lésion pulmonaire aigüe, la récupération nécessite du temps et de la patience. La plupart des patients gardent des séquelles respiratoires pendant plusieurs mois, voire années [15]. Il est normal de ressentir une fatigue importante et une diminution de votre capacité d'effort.
La réhabilitation respiratoire joue un rôle crucial dans votre rétablissement. Ces programmes, généralement proposés en hôpital de jour, combinent exercices physiques adaptés, kinésithérapie respiratoire et éducation thérapeutique. L'objectif consiste à retrouver progressivement vos capacités fonctionnelles.
Concrètement, vous devrez probablement adapter votre rythme de vie. Les activités physiques intenses peuvent rester difficiles pendant plusieurs mois. Mais rassurez-vous, une amélioration progressive est généralement observée avec un accompagnement adapté.
Le soutien psychologique ne doit pas être négligé. Vivre une expérience de réanimation peut laisser des traces psychologiques importantes. N'hésitez pas à en parler avec votre médecin ou à consulter un psychologue spécialisé. De nombreux patients développent un syndrome de stress post-traumatique qui nécessite une prise en charge spécifique.
L'entourage familial joue également un rôle essentiel. Vos proches peuvent vous aider dans les gestes du quotidien et vous encourager dans votre rééducation. Leur compréhension et leur patience constituent un atout précieux pour votre récupération.
Les Complications Possibles
Les complications de la lésion pulmonaire aigüe peuvent être précoces ou tardives. Pendant la phase aigüe, le risque principal reste l'évolution vers un syndrome de détresse respiratoire aigüe (SDRA) complet [15]. Cette aggravation survient dans 60% des cas et nécessite une ventilation mécanique prolongée.
Les lésions laryngées représentent une complication spécifique liée à l'intubation et à la ventilation mécanique. Une étude française récente a identifié les facteurs de risque de ces lésions chez les patients adultes [11]. L'âge avancé, la durée de ventilation et certaines comorbidités augmentent ce risque.
À plus long terme, la fibrose pulmonaire constitue la complication la plus redoutée. Elle se développe chez 20 à 30% des survivants et peut considérablement limiter la qualité de vie [15]. Cette cicatrisation excessive du tissu pulmonaire réduit définitivement les capacités respiratoires.
D'autres complications peuvent survenir : infections nosocomiales, embolies pulmonaires, ou dysfonctionnements d'autres organes liés à l'hypoxémie prolongée [15]. Le système cardiovasculaire est particulièrement vulnérable, avec un risque accru d'arythmies et d'insuffisance cardiaque.
Heureusement, les techniques de ventilation protectrice et les protocoles de soins actuels ont considérablement réduit l'incidence de ces complications. La surveillance étroite en réanimation permet une détection précoce et une prise en charge adaptée.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la lésion pulmonaire aigüe dépend de nombreux facteurs : l'âge du patient, la cause sous-jacente, la rapidité de prise en charge et la présence de comorbidités [15]. Globalement, la mortalité hospitalière se situe entre 25 et 40% selon les séries françaises récentes.
L'âge constitue un facteur pronostique majeur. Les patients de moins de 50 ans ont un taux de survie supérieur à 80%, tandis que ce taux chute à 60% après 70 ans [15]. Cette différence s'explique par la capacité de récupération pulmonaire qui diminue avec l'âge.
La cause initiale influence également le pronostic. Les LPA d'origine infectieuse ont généralement un meilleur pronostic que celles liées à un sepsis ou à un traumatisme [15]. Le délai de prise en charge joue aussi un rôle crucial : plus le traitement est précoce, meilleures sont les chances de récupération.
Pour les survivants, la récupération fonctionnelle s'étale sur 6 à 12 mois. Environ 70% des patients retrouvent une fonction respiratoire satisfaisante, permettant une reprise d'activité normale [15]. Cependant, 30% gardent des séquelles permanentes nécessitant une adaptation de leur mode de vie.
Les innovations thérapeutiques récentes laissent espérer une amélioration de ces chiffres. Les nouvelles approches anti-inflammatoires et les techniques de ventilation optimisées contribuent à réduire la mortalité et les séquelles [4,5].
Peut-on Prévenir la Lésion Pulmonaire Aigüe ?
La prévention de la lésion pulmonaire aigüe passe avant tout par la prise en charge précoce des facteurs de risque. Vaccinez-vous contre la grippe et le pneumocoque, surtout si vous avez plus de 65 ans ou des maladies chroniques [1]. Ces vaccinations réduisent significativement le risque de pneumonies sévères.
L'arrêt du tabac constitue une mesure préventive fondamentale. Le tabagisme altère les défenses pulmonaires et favorise les infections respiratoires [15]. Si vous fumez, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre médecin pour arrêter. Les bénéfices se font sentir dès les premières semaines.
La limitation de la consommation d'alcool joue également un rôle protecteur. L'alcoolisme chronique affaiblit le système immunitaire et augmente le risque de pneumonies d'inhalation [15]. Une consommation modérée (maximum 2 verres par jour pour les hommes, 1 pour les femmes) est recommandée.
En milieu hospitalier, des protocoles de prévention spécifiques existent. La prévention des infections nosocomiales, l'optimisation des transfusions sanguines et la surveillance des patients à risque permettent de réduire l'incidence des LPA [15].
Concrètement, consultez rapidement en cas de symptômes respiratoires qui s'aggravent. Une prise en charge précoce d'une pneumonie peut éviter son évolution vers une lésion pulmonaire aigüe. N'attendez pas que la situation se dégrade pour demander de l'aide médicale.
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié des recommandations spécifiques pour la prise en charge des lésions pulmonaires aigües. Ces guidelines, mises à jour en 2024, insistent sur l'importance du diagnostic précoce et de la prise en charge multidisciplinaire [7,15].
Les recommandations françaises privilégient une approche graduée de l'oxygénothérapie. L'oxygénothérapie à haut débit nasal doit être tentée en première intention avant le recours à la ventilation mécanique [9]. Cette stratégie permet de réduire les complications liées à l'intubation.
Concernant la ventilation mécanique, les protocoles français s'alignent sur les recommandations internationales : volumes courants de 6 ml/kg, PEEP optimisée et limitation des pressions [7]. Ces mesures visent à protéger les poumons des lésions induites par la ventilation.
La Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF) recommande également un suivi à long terme des patients survivants [2]. Ce suivi inclut des explorations fonctionnelles respiratoires régulières et une évaluation de la qualité de vie. L'objectif consiste à détecter précocement les séquelles et à proposer une réhabilitation adaptée.
D'ailleurs, les autorités sanitaires insistent sur l'importance de la formation des équipes soignantes. La reconnaissance précoce des signes de gravité et la mise en œuvre rapide des traitements appropriés constituent des enjeux majeurs de santé publique [4,15].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations peuvent vous accompagner si vous ou un proche êtes confrontés à une lésion pulmonaire aigüe. La Fédération Française contre les Maladies Respiratoires propose des groupes de parole et des programmes d'éducation thérapeutique.
L'association "Respire" organise régulièrement des rencontres entre patients et familles. Ces échanges permettent de partager expériences et conseils pratiques. Vous pouvez également y trouver des informations sur les dernières avancées thérapeutiques et les essais cliniques en cours.
Au niveau local, de nombreux hôpitaux proposent des programmes de réhabilitation respiratoire. Ces programmes, remboursés par l'Assurance Maladie, combinent activité physique adaptée, éducation thérapeutique et soutien psychologique. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre pneumologue.
Les réseaux sociaux peuvent également constituer une source de soutien. Des groupes Facebook dédiés aux maladies respiratoires permettent d'échanger avec d'autres patients. Attention cependant à vérifier la fiabilité des informations partagées et à toujours consulter votre médecin.
Enfin, votre médecin traitant reste votre interlocuteur privilégié. Il peut vous orienter vers les ressources locales appropriées et coordonner votre prise en charge avec les spécialistes. N'hésitez pas à lui faire part de vos préoccupations et de vos besoins.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre avec les séquelles d'une lésion pulmonaire aigüe. Tout d'abord, respectez scrupuleusement vos traitements et vos rendez-vous de suivi. La régularité des soins constitue la clé d'une récupération optimale.
Adaptez votre activité physique progressivement. Commencez par de courtes marches et augmentez la durée selon votre tolérance. L'exercice physique, même modéré, améliore votre capacité respiratoire et votre qualité de vie. Écoutez votre corps et n'hésitez pas à faire des pauses.
Maintenez une alimentation équilibrée riche en protéines pour favoriser la cicatrisation pulmonaire. Les fruits et légumes apportent des antioxydants bénéfiques pour vos poumons. Évitez les aliments trop salés qui peuvent favoriser la rétention d'eau.
Protégez-vous des infections respiratoires en évitant les lieux confinés pendant les épidémies. Lavez-vous régulièrement les mains et portez un masque si nécessaire. Une nouvelle infection pourrait compromettre votre récupération.
Enfin, n'hésitez pas à demander de l'aide pour les tâches quotidiennes. Votre entourage comprendra vos difficultés et sera heureux de vous soutenir. L'important, c'est de préserver votre énergie pour les activités essentielles et votre rééducation.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes d'alarme nécessitent une consultation médicale immédiate. Si vous ressentez une gêne respiratoire qui s'aggrave rapidement, n'attendez pas : appelez le 15 ou rendez-vous aux urgences [15]. Cette règle s'applique particulièrement si vous avez des antécédents de lésion pulmonaire aigüe.
La fièvre associée à une toux ou à un essoufflement doit également vous alerter. Ces symptômes peuvent signaler une surinfection pulmonaire qui nécessite un traitement antibiotique rapide [1]. Plus la prise en charge est précoce, meilleures sont vos chances d'éviter les complications.
D'autres situations justifient une consultation urgente : crachats sanglants, douleurs thoraciques intenses, ou sensation de malaise général [15,16]. Ces symptômes peuvent témoigner d'une complication grave nécessitant une hospitalisation.
Pour le suivi à long terme, consultez votre pneumologue au moins deux fois par an. Ces consultations permettent d'évaluer l'évolution de votre fonction respiratoire et d'adapter vos traitements si nécessaire. N'hésitez pas à signaler toute dégradation de votre état, même minime.
Enfin, si vous développez des symptômes d'anxiété ou de dépression liés à votre maladie, parlez-en à votre médecin. Un soutien psychologique peut considérablement améliorer votre qualité de vie et faciliter votre récupération.
Questions Fréquentes
Peut-on guérir complètement d'une lésion pulmonaire aigüe ?Oui, environ 70% des patients récupèrent une fonction respiratoire normale dans l'année qui suit [15]. Cependant, cette récupération nécessite du temps et un suivi médical régulier.
Combien de temps dure l'hospitalisation ?
La durée moyenne d'hospitalisation est de 2 à 3 semaines, dont 7 à 10 jours en réanimation [15]. Cette durée varie selon la gravité et la réponse au traitement.
Peut-on reprendre le travail après une LPA ?
La plupart des patients peuvent reprendre une activité professionnelle, parfois avec des aménagements. Le délai moyen de reprise du travail est de 3 à 6 mois selon la profession [15].
Y a-t-il un risque de récidive ?
Le risque de récidive existe mais reste faible (moins de 5%). Il est plus élevé chez les patients avec des facteurs de risque persistants [15].
Les enfants peuvent-ils développer une LPA ?
Oui, mais c'est plus rare. Les causes et la prise en charge diffèrent de celles de l'adulte. La récupération est généralement meilleure chez l'enfant.
Faut-il éviter certains médicaments après une LPA ?
Certains médicaments peuvent être contre-indiqués. Signalez toujours vos antécédents de LPA à tout médecin qui vous prescrit un nouveau traitement [12].
Questions Fréquentes
Peut-on guérir complètement d'une lésion pulmonaire aigüe ?
Oui, environ 70% des patients récupèrent une fonction respiratoire normale dans l'année qui suit. Cependant, cette récupération nécessite du temps et un suivi médical régulier.
Combien de temps dure l'hospitalisation ?
La durée moyenne d'hospitalisation est de 2 à 3 semaines, dont 7 à 10 jours en réanimation. Cette durée varie selon la gravité et la réponse au traitement.
Peut-on reprendre le travail après une LPA ?
La plupart des patients peuvent reprendre une activité professionnelle, parfois avec des aménagements. Le délai moyen de reprise du travail est de 3 à 6 mois selon la profession.
Y a-t-il un risque de récidive ?
Le risque de récidive existe mais reste faible (moins de 5%). Il est plus élevé chez les patients avec des facteurs de risque persistants.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Pneumonie ou pneumopathie bactérienne : symptômes, diagnostic, évolutionLien
- [2] Nodules pulmonaires - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Cancer du poumon : un premier patient traité par thérapie cellulaire de type CNETLien
- [4] Bulletin de recherche ERS 2024Lien
- [5] Advances in acute respiratory distress syndromeLien
- [6] Acute Respiratory Distress Syndrome Analysis Report 2024Lien
- [7] Prise en charge ventilatoire de l'insuffisance respiratoire aiguë à SARS-CoV-2Lien
- [8] Quantification de l'aération pulmonaire sur des images CT de patients atteints du syndrome de détresse respiratoire aiguëLien
- [9] Oxygénothérapie à haut débit nasal dans l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémiqueLien
- [11] Facteurs de risques de lésions laryngées dans le syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'adulteLien
- [12] Toxicité pulmonaire du TRIMETHOPRIME-SULFAMETHOXAZOLELien
- [13] Cas rare de Leptospirose ictéro-hémorragique avec atteinte pulmonaireLien
- [14] Antagonistes des récepteurs de l'IL-1 et de l'IL-6 pour la résolution des paramètres du SDRALien
- [15] Syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA)Lien
- [16] Œdème pulmonaire : Définitions, symptômes, diagnosticLien
Publications scientifiques
- Prise en charge ventilatoire de l'insuffisance respiratoire aiguë à SARS-CoV-2 (2023)
- Quantification de l'aération pulmonaire sur des images CT de patients atteints du syndrome de détresse respiratoire aiguë (2022)1 citations
- Oxygénothérapie à haut débit nasal dans l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique (2022)2 citations
- Ce que cache la chicha. Une cause inconnue de pneumonie fibrineuse organisée aiguë? (2025)
- Facteurs de risques de lésions laryngées dans le syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'adulte: une étude cas-témoins française selon les directives STROBE (2024)
Ressources web
- Syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) (msdmanuals.com)
La personne atteinte présente une dyspnée, généralement accompagnée d'une respiration accélérée et superficielle, la peau peut paraître grisâtre ou gris cendré ...
- Œdème pulmonaire : Définitions, symptômes, diagnostic et ... (sante-sur-le-net.com)
21 janv. 2021 — Le diagnostic de l'œdème du poumon est essentiellement clinique, puisque les symptômes principaux (gêne respiratoire extrême et râles ...
- Pneumonie ou pneumopathie bactérienne : symptômes, ... (ameli.fr)
Pneumonie à pneumocoque · une fièvre d'emblée importante (39 - 40° C) avec des frissons ; · une toux sèche ; · un essoufflement ; · une douleur thoracique, qui peut ...
- Lésion pulmonaire aiguë (mypathologyreport.ca)
Les symptômes de la pneumonie organisée peuvent inclure une toux sèche, des difficultés respiratoires, de la fièvre et une perte de poids. Qu'est-ce qui cause ...
- Contusion pulmonaire - Lésions et intoxications (msdmanuals.com)
Les médecins réalisent une radiographie du thorax pour poser le diagnostic. Le traitement consiste à administrer de l'oxygène et parfois un respirateur pour ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
