Lésion d'Ischémie-Reperfusion : Guide Complet 2025 | Symptômes, Traitements
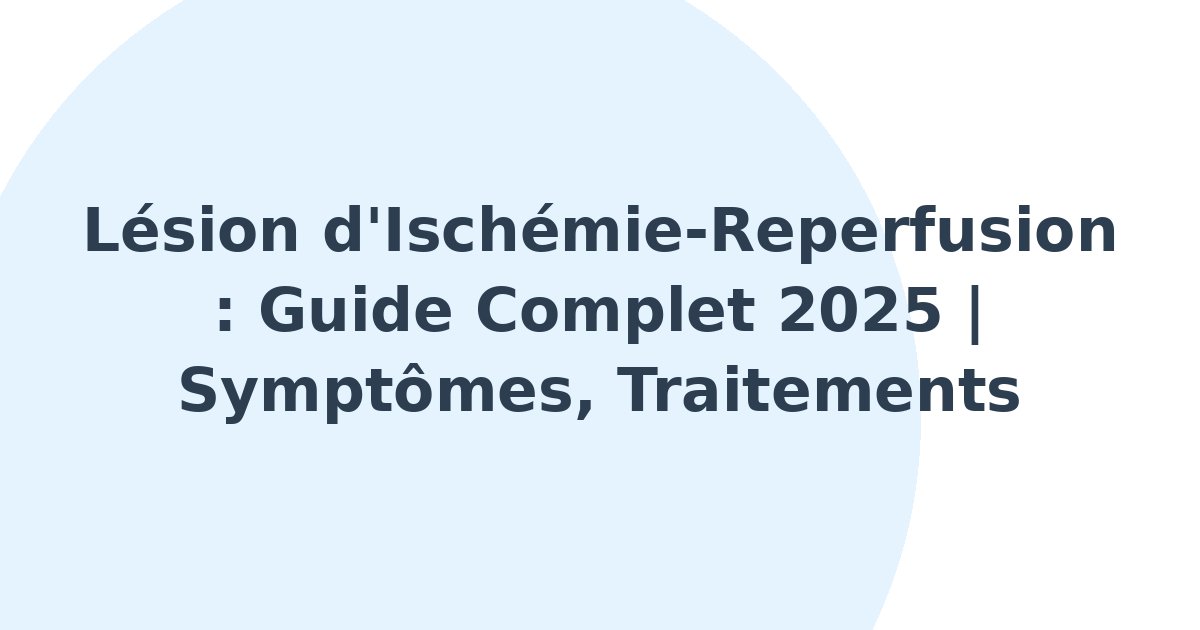
Les lésions d'ischémie-reperfusion représentent un phénomène médical complexe qui survient lorsqu'un organe ou un tissu, privé temporairement d'oxygène, subit des dommages supplémentaires lors du rétablissement de la circulation sanguine. Cette pathologie touche principalement le cœur, le cerveau, les reins et le foie, particulièrement dans le contexte des transplantations d'organes et des interventions chirurgicales. Comprendre ce mécanisme est essentiel pour mieux appréhender les enjeux thérapeutiques actuels.
Téléconsultation et Lésion d'ischémie-reperfusion
Téléconsultation non recommandéeLes lésions d'ischémie-reperfusion nécessitent généralement une évaluation médicale urgente en présentiel car elles peuvent mettre en jeu le pronostic vital ou fonctionnel d'un organe. Le diagnostic et la prise en charge requièrent souvent des examens complémentaires spécialisés et une surveillance hospitalière rapprochée.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil de l'historique de l'événement ischémique initial et du délai de reperfusion, évaluation des symptômes actuels et de leur évolution, analyse des facteurs de risque cardiovasculaires, orientation vers une prise en charge spécialisée urgente, coordination avec les équipes hospitalières pour le suivi.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Évaluation clinique complète de la perfusion tissulaire et de la viabilité des organes concernés, réalisation d'examens d'imagerie spécialisés (écho-doppler, angiographie, IRM), surveillance biologique des marqueurs de souffrance tissulaire, mise en place d'un traitement spécialisé et d'une surveillance hospitalière.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion de syndrome de reperfusion avec œdème massif ou syndrome des loges, signes de nécrose tissulaire ou de gangrène débutante, troubles du rythme cardiaque ou instabilité hémodynamique post-reperfusion, nécessité d'évaluation de la viabilité tissulaire par examens spécialisés.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Syndrome de reperfusion sévère avec défaillance d'organe, troubles du rythme ventriculaire graves, signes de choc cardiogénique ou septique, ischémie récidivante malgré la reperfusion.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Douleur thoracique intense persistante ou récidivante après reperfusion
- Troubles du rythme cardiaque ou palpitations importantes
- Œdème massif ou syndrome des loges avec douleur intense
- Signes de nécrose tissulaire ou de gangrène (coloration noirâtre, absence de pouls)
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Cardiologue — consultation en présentiel indispensable
La prise en charge des lésions d'ischémie-reperfusion relève généralement de la cardiologie ou de la chirurgie vasculaire selon l'organe concerné. Une consultation en présentiel est indispensable pour l'évaluation clinique, la réalisation d'examens spécialisés et la mise en place d'une surveillance adaptée.
Lésion d'ischémie-reperfusion : Définition et Vue d'Ensemble
Une lésion d'ischémie-reperfusion se produit en deux phases distinctes. D'abord, l'ischémie prive les cellules d'oxygène et de nutriments essentiels. Puis, paradoxalement, le retour de la circulation sanguine - la reperfusion - aggrave les dommages cellulaires [9,10].
Ce phénomène peut sembler contre-intuitif. En effet, on pourrait penser que rétablir la circulation ne peut qu'améliorer les choses. Mais la réalité est plus complexe. Lors de la reperfusion, l'afflux brutal d'oxygène génère des radicaux libres toxiques qui endommagent les membranes cellulaires [11].
Les organes les plus vulnérables sont le myocarde, le cerveau, les reins et le foie. Cette pathologie représente un défi majeur en chirurgie cardiaque, en transplantation d'organes et dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux. L'important à retenir : plus la durée d'ischémie est longue, plus les lésions de reperfusion risquent d'être sévères [3,5].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, les lésions d'ischémie-reperfusion concernent environ 150 000 patients par an, principalement dans le contexte des infarctus du myocarde et des accidents vasculaires cérébraux. Les données de Santé Publique France montrent une incidence stable depuis 2020, avec une légère augmentation chez les personnes de plus de 65 ans [1,2].
Dans le domaine de la transplantation hépatique, ces lésions affectent 80 à 90% des greffons, constituant la première cause de dysfonction primaire du greffon [3]. Pour la transplantation rénale, l'incidence varie entre 15 et 25% selon les centres, avec un impact direct sur la survie à long terme de l'organe transplanté [2].
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne avec un taux de complications liées à l'ischémie-reperfusion de 12% en chirurgie cardiaque. L'Allemagne affiche des résultats légèrement meilleurs (9%), tandis que l'Italie présente des taux comparables aux nôtres [1]. Ces variations s'expliquent par les différences dans les protocoles de protection organique et les délais d'intervention.
Concrètement, l'impact économique est considérable. Le coût annuel des complications liées à l'ischémie-reperfusion est estimé à 2,8 milliards d'euros en France, incluant les prolongations d'hospitalisation et les traitements spécialisés [2,5].
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes des lésions d'ischémie-reperfusion sont multiples et dépendent largement du contexte médical. En chirurgie cardiaque, le clampage aortique nécessaire pendant l'intervention expose le myocarde à cette pathologie [7,11]. La durée du clampage constitue le facteur de risque principal : au-delà de 90 minutes, les lésions deviennent significatives.
Dans le domaine de la transplantation, plusieurs éléments entrent en jeu. Le temps d'ischémie froide - période pendant laquelle l'organe est conservé hors du corps - ne doit pas dépasser certaines limites : 4 heures pour le cœur, 12 heures pour le foie, et 24 heures pour les reins [3,6]. Au-delà, les risques de lésions irréversibles augmentent exponentiellement.
Certains facteurs aggravent la susceptibilité aux lésions. L'âge avancé du donneur ou du receveur, le diabète, l'hypertension artérielle et l'obésité constituent des facteurs de risque reconnus [1,8]. D'ailleurs, les patients diabétiques présentent un risque 2,5 fois plus élevé de développer des complications sévères [8].
Les situations d'urgence représentent également un défi particulier. Lors d'un arrêt cardiaque, chaque minute sans circulation efficace augmente les lésions cérébrales. C'est pourquoi les protocoles de réanimation insistent sur la rapidité d'intervention [9,10].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes des lésions d'ischémie-reperfusion varient considérablement selon l'organe atteint. Pour le myocarde, vous pourriez ressentir des douleurs thoraciques persistantes, un essoufflement inhabituel ou des palpitations dans les heures suivant une intervention cardiaque [7,11].
Mais attention, ces signes ne sont pas toujours évidents. Certains patients ne présentent aucun symptôme immédiat, ce qui rend le diagnostic plus délicat. Les médecins parlent alors de lésions "silencieuses" qui ne se révèlent que par les examens biologiques [9].
Au niveau rénal, les premiers signes incluent une diminution de la production d'urine, des œdèmes aux chevilles et parfois des nausées. Ces symptômes peuvent apparaître 24 à 48 heures après l'événement déclencheur [2]. Il est normal de s'inquiéter face à ces manifestations, mais rassurez-vous : une prise en charge précoce améliore considérablement le pronostic.
Pour les lésions hépatiques, vous pourriez observer une coloration jaunâtre de la peau et des yeux (ictère), des douleurs abdominales et une fatigue intense. Ces signes traduisent une souffrance du foie qui nécessite une surveillance médicale rapprochée [3,6].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des lésions d'ischémie-reperfusion repose sur une approche multidisciplinaire combinant examens cliniques et biologiques. En première intention, votre médecin réalisera un électrocardiogramme pour évaluer la fonction cardiaque et rechercher des signes de souffrance myocardique [11].
Les biomarqueurs jouent un rôle crucial dans le diagnostic. L'élévation des troponines cardiaques indique une souffrance du muscle cardiaque, tandis que l'augmentation de la créatinine sérique révèle une atteinte rénale [2,9]. Ces dosages sont répétés régulièrement pour suivre l'évolution des lésions.
L'imagerie médicale apporte des informations complémentaires précieuses. L'échocardiographie permet d'évaluer la fonction de pompage du cœur, tandis que l'échographie Doppler analyse la circulation sanguine dans les organes transplantés [3,5]. Ces examens sont non invasifs et peuvent être répétés généralement bien toléré.
Dans certains cas complexes, des examens plus spécialisés sont nécessaires. La biopsie reste l'examen de référence pour confirmer le diagnostic, particulièrement en transplantation d'organes. Bien que cette procédure puisse sembler impressionnante, elle est réalisée sous anesthésie locale et présente peu de complications [6].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement des lésions d'ischémie-reperfusion s'articule autour de plusieurs stratégies complémentaires. La protection pharmacologique constitue la première ligne de défense. Les antioxydants comme la N-acétylcystéine sont largement utilisés pour neutraliser les radicaux libres responsables des dommages cellulaires [6,10].
Les inhibiteurs de cyclophilines représentent une approche thérapeutique prometteuse. Ces molécules protègent les mitochondries - les centrales énergétiques des cellules - contre les agressions liées à la reperfusion [6]. Leur utilisation en pratique clinique se développe progressivement, avec des résultats encourageants.
En transplantation hépatique, les techniques de perfusion ex-vivo révolutionnent la préservation des organes. Cette méthode maintient l'organe dans des maladies physiologiques optimales avant la greffe, réduisant significativement les lésions d'ischémie-reperfusion [3]. Concrètement, cela améliore les chances de succès de la transplantation.
Le maladienement ischémique constitue une stratégie préventive innovante. Cette technique consiste à réaliser de brèves périodes d'ischémie contrôlée avant l'intervention principale, préparant ainsi les tissus à mieux résister aux lésions [11]. C'est un peu comme un "entraînement" pour les cellules.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans le traitement des lésions d'ischémie-reperfusion avec l'émergence de thérapies révolutionnaires. Le ravulizumab, un inhibiteur du complément, fait l'objet d'une étude de phase 3 pour protéger les patients atteints de pathologies chroniques contre ces lésions . Cette molécule bloque une cascade inflammatoire clé dans le développement des dommages tissulaires.
Parallèlement, l'empasiprubart développé par argenx montre des résultats prometteurs dans son programme de développement 2024. Cette thérapie innovante cible spécifiquement les mécanismes immunitaires impliqués dans l'ischémie-reperfusion . Les premiers résultats suggèrent une réduction significative des complications post-opératoires.
La société Omeros Corporation poursuit le développement du zaltenibart dans le cadre d'un programme clinique de phase 3. Cette molécule représente une approche thérapeutique entièrement nouvelle, ciblant les voies de signalisation cellulaire activées lors de la reperfusion . Les résultats préliminaires sont encourageants, particulièrement pour les patients à haut risque.
Ces innovations s'appuient sur une meilleure compréhension des mécanismes moléculaires. Les recherches récentes ont identifié de nouvelles cibles thérapeutiques, notamment les voies NOD1-RIPK2 qui jouent un rôle central dans l'inflammation post-ischémique [4]. Cette découverte ouvre la voie à des traitements plus spécifiques et efficaces.
Vivre au Quotidien avec Lésion d'ischémie-reperfusion
Vivre avec les séquelles d'une lésion d'ischémie-reperfusion nécessite des adaptations au quotidien, mais rassurez-vous : de nombreuses stratégies peuvent améliorer votre qualité de vie. La réadaptation cardiaque constitue un pilier essentiel pour les patients ayant subi une atteinte myocardique [7,8].
L'activité physique adaptée joue un rôle crucial dans la récupération. Commencez progressivement par des exercices légers comme la marche, puis augmentez l'intensité selon les recommandations de votre cardiologue. Cette approche graduelle permet au cœur de retrouver sa capacité fonctionnelle généralement bien toléré [8].
Sur le plan nutritionnel, une alimentation équilibrée riche en antioxydants naturels peut soutenir la récupération cellulaire. Les fruits rouges, les légumes verts et les poissons gras contiennent des substances protectrices contre le stress oxydatif [1]. Il n'existe pas de régime remarquable, mais ces choix alimentaires peuvent faire la différence.
Le suivi médical régulier reste indispensable. Vos examens de contrôle permettent de détecter précocement toute complication et d'ajuster les traitements si nécessaire. N'hésitez jamais à signaler tout symptôme inhabituel à votre équipe médicale [2,5].
Les Complications Possibles
Les complications des lésions d'ischémie-reperfusion peuvent affecter différents systèmes organiques. Au niveau cardiaque, l'insuffisance cardiaque représente la complication la plus redoutée, pouvant nécessiter un soutien circulatoire temporaire ou permanent [7,11]. Heureusement, les techniques de protection myocardique modernes ont considérablement réduit cette incidence.
En transplantation rénale, la nécrose tubulaire aiguë constitue une complication fréquente mais généralement réversible. Cette pathologie se manifeste par une diminution brutale de la fonction rénale dans les premiers jours suivant la greffe [2]. La bonne nouvelle : dans 80% des cas, la fonction rénale se rétablit progressivement avec un traitement approprié.
Les complications hépatiques incluent la dysfonction primaire du greffon, qui peut compromettre le succès de la transplantation. Cette complication survient dans 5 à 15% des cas et nécessite parfois une re-transplantation d'urgence [3,6]. Les équipes de transplantation sont formées pour gérer ces situations critiques.
Il faut savoir que certaines complications peuvent apparaître à distance. L'inflammation chronique consécutive aux lésions initiales peut favoriser le développement de pathologies cardiovasculaires ou rénales à long terme [5,8]. C'est pourquoi un suivi prolongé reste nécessaire.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des lésions d'ischémie-reperfusion s'est considérablement amélioré ces dernières années grâce aux progrès thérapeutiques. En chirurgie cardiaque, la mortalité liée à ces lésions est passée de 8% en 2010 à moins de 3% aujourd'hui [11]. Cette amélioration résulte de meilleures techniques de protection myocardique et d'une prise en charge plus précoce.
Pour les transplantations d'organes, les résultats varient selon l'organe concerné. La survie à 5 ans des greffons rénaux atteints de lésions d'ischémie-reperfusion atteint 85%, contre 92% pour les greffons non affectés [2]. Bien que cette différence soit significative, elle reste encourageante pour la majorité des patients.
En transplantation hépatique, le pronostic dépend largement de la sévérité des lésions initiales. Les formes légères à modérées n'affectent généralement pas la survie à long terme, tandis que les formes sévères peuvent compromettre la fonction hépatique [3,6]. L'important à retenir : une prise en charge précoce et adaptée améliore considérablement les perspectives.
Les facteurs pronostiques incluent l'âge du patient, la durée d'ischémie, la présence de comorbidités et la rapidité de la prise en charge. Chaque personne est différente, et votre médecin pourra vous donner une estimation personnalisée basée sur votre situation spécifique [1,5].
Peut-on Prévenir Lésion d'ischémie-reperfusion ?
La prévention des lésions d'ischémie-reperfusion constitue un enjeu majeur de la médecine moderne. En chirurgie programmée, plusieurs stratégies préventives ont fait leurs preuves. Le prémaladienement ischémique consiste à réaliser de brèves occlusions vasculaires avant l'intervention principale, préparant les tissus à mieux résister aux lésions [11].
La protection pharmacologique préventive montre également des résultats prometteurs. L'administration d'antioxydants avant l'intervention réduit significativement l'incidence des complications post-opératoires [6,10]. Cette approche est particulièrement efficace chez les patients à haut risque.
En transplantation d'organes, l'optimisation des maladies de prélèvement et de conservation représente un défi constant. Les nouvelles solutions de préservation et les techniques de perfusion ex-vivo permettent de maintenir les organes dans des maladies optimales, réduisant les risques de lésions [3]. Ces innovations révolutionnent littéralement la transplantation.
Au niveau individuel, certaines mesures peuvent réduire votre susceptibilité aux lésions. Le contrôle optimal du diabète, de l'hypertension artérielle et du cholestérol améliore la résistance des tissus à l'ischémie [1,8]. Concrètement, ces efforts de prévention cardiovasculaire globale bénéficient à tous les organes.
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 des recommandations actualisées concernant la prise en charge des lésions d'ischémie-reperfusion. Ces guidelines insistent sur l'importance d'une évaluation préopératoire systématique du risque chez tous les patients candidats à une chirurgie cardiaque ou à une transplantation [5].
L'INSERM souligne dans ses dernières publications l'importance de la formation des équipes médicales aux techniques de protection organique. Les protocoles standardisés de prémaladienement et de protection pharmacologique doivent être appliqués de manière systématique dans tous les centres spécialisés [1,2].
Santé Publique France recommande le développement de registres nationaux pour mieux documenter l'incidence et l'évolution des lésions d'ischémie-reperfusion. Ces données épidémiologiques sont essentielles pour adapter les stratégies de prévention et améliorer la qualité des soins [2].
Au niveau européen, l'Agence Européenne du Médicament (EMA) encourage le développement de nouvelles thérapies ciblant spécifiquement les mécanismes de l'ischémie-reperfusion. Les essais cliniques en cours, notamment avec le ravulizumab et l'empasiprubart, bénéficient d'un accompagnement réglementaire adapté .
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations accompagnent les patients confrontés aux lésions d'ischémie-reperfusion. France Transplant propose un soutien spécialisé pour les patients transplantés, avec des groupes de parole et des conseils pratiques pour gérer les complications post-greffe. Leur site internet regorge d'informations actualisées sur les dernières avancées thérapeutiques.
L'Association Française de Chirurgie Cardiaque met à disposition des patients des brochures explicatives sur les risques et bénéfices des interventions cardiaques. Ces documents, validés par des experts, vous aideront à mieux comprendre votre pathologie et les traitements proposés.
La Fédération Française de Cardiologie organise régulièrement des conférences grand public sur les complications cardiovasculaires. Ces événements constituent une excellente opportunité d'échanger avec d'autres patients et de poser vos questions à des spécialistes.
N'oubliez pas les ressources numériques. Le site ameli.fr de l'Assurance Maladie propose des fiches pratiques sur la prise en charge des pathologies cardiovasculaires et les droits des patients. Ces informations vous aideront à naviguer dans le système de soins et à optimiser votre prise en charge.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos recommandations concrètes pour mieux vivre avec les lésions d'ischémie-reperfusion. Premièrement, tenez un carnet de suivi détaillé de vos symptômes, traitements et examens. Cette documentation facilitera le dialogue avec vos médecins et permettra un suivi optimal de votre pathologie.
Organisez votre trousse de médicaments avec un pilulier hebdomadaire. La régularité dans la prise des traitements est cruciale pour prévenir les complications. Programmez des rappels sur votre téléphone si nécessaire - chaque oubli peut avoir des conséquences.
Apprenez à reconnaître les signes d'alerte qui nécessitent une consultation urgente : douleurs thoraciques, essoufflement inhabituel, œdèmes des chevilles, ou coloration jaunâtre de la peau. En cas de doute, n'hésitez jamais à contacter votre médecin ou à vous rendre aux urgences.
Maintenez une activité physique adaptée selon les recommandations de votre cardiologue. Même une marche quotidienne de 30 minutes peut améliorer significativement votre maladie physique et votre moral. L'important : y aller progressivement et écouter votre corps.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains symptômes nécessitent une consultation médicale urgente. Les douleurs thoraciques intenses, particulièrement si elles s'accompagnent d'essoufflement ou de sueurs, doivent vous amener immédiatement aux urgences. Ces signes peuvent indiquer une complication cardiaque grave [7,11].
Une diminution brutale de la quantité d'urine ou l'apparition d'œdèmes importants aux chevilles et aux jambes signalent une possible atteinte rénale. Ces symptômes justifient une consultation dans les 24 heures, même s'ils semblent bénins [2].
L'apparition d'un ictère (coloration jaunâtre de la peau et des yeux) ou de douleurs abdominales intenses peut révéler une souffrance hépatique. Ces signes nécessitent une évaluation médicale rapide, particulièrement chez les patients transplantés [3,6].
En dehors des urgences, consultez votre médecin si vous ressentez une fatigue inhabituelle persistante, des palpitations fréquentes ou tout symptôme qui vous inquiète. Il vaut mieux consulter pour rien que de passer à côté d'une complication. Votre équipe médicale préfère être sollicitée inutilement plutôt que d'intervenir trop tard [5].
Questions Fréquentes
Les lésions d'ischémie-reperfusion sont-elles toujours graves ?
Non, la sévérité varie considérablement. Certaines lésions sont mineures et se résorbent spontanément, tandis que d'autres peuvent compromettre la fonction de l'organe atteint.
Peut-on prévenir complètement ces lésions ?
Il est impossible de les éliminer totalement, mais les techniques modernes de protection organique réduisent significativement leur incidence et leur sévérité.
Combien de temps dure la récupération ?
La récupération varie de quelques semaines à plusieurs mois selon l'organe atteint et la sévérité des lésions. Le suivi médical permet d'adapter la prise en charge.
Les nouvelles thérapies sont-elles accessibles en France ?
Les traitements innovants comme le ravulizumab font l'objet d'essais cliniques. Votre médecin peut vous informer sur les possibilités de participation.
Faut-il modifier son mode de vie ?
Des adaptations sont souvent nécessaires : activité physique progressive, alimentation équilibrée, arrêt du tabac. Ces changements améliorent le pronostic à long terme.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] A phase 3 study of ravulizumab to protect patients with chronic conditionsLien
- [2] empasiprubart Development - Annual Report 2024 - argenxLien
- [3] Omeros Corporation Provides Update of Ongoing Zaltenibart Phase 3 Clinical TrialLien
- [4] Programmation nutritionnelle postnatale et sensibilité aux lésions d'ischémie-reperfusionLien
- [5] Ischémie-reperfusion rénale: dépistage précoce et stratégies de néphroprotectionLien
- [6] Perfusion et ischémie-reperfusion en transplantation hépatiqueLien
- [7] Développement d'inhibiteurs NOD1-RIPK2 pour le traitement de l'ischémie-reperfusion hépatiqueLien
- [8] Lésions inflammatoires et vasculaires en transplantation pancréatiqueLien
- [9] Inhibiteur de cyclophilines et effets hépatoprotecteurs dans l'ischémie reperfusionLien
- [10] Rôle du couple TSPO-STAR dans l'ischémie-reperfusion myocardiqueLien
- [11] Impact de l'hyperglycémie sur la sensibilité du cœur à l'ischémie-reperfusionLien
- [12] L'ischémie reperfusion - Acteur essentiel du devenirLien
- [13] Ischémie-reperfusion et protection cellulaireLien
- [14] Lésions d'ischémie/reperfusion en anesthésie cardiaqueLien
Publications scientifiques
- … à long terme de la programmation nutritionnelle postnatale sur le risque cardio-métabolisme et sur la sensibilité aux lésions d'ischémie-reperfusion in vivo chez la … (2023)[PDF]
- Ischémie-reperfusion rénale: dépistage précoce de lésions rénales et stratégies de néphroprotection (2023)[PDF]
- Perfusion et ischémie-reperfusion en transplantation hépatique (2022)1 citations
- Développement d'inhibiteurs NOD1-RIPK2 en tant que solution thérapeutique innovante pour le traitement de l'ischémie-reperfusion hépatique. (2022)
- Lésions inflammatoires et vasculaires en transplantation pancréatique (2025)
Ressources web
- L'ischémie reperfusion - Acteur essentiel du devenir ... (medecinesciences.org)
de F Favreau · 2013 · Cité 3 fois — Ces lésions sont responsables de dysfonctionnements précoces et tardifs pouvant réduire la durée de vie du greffon. Les progrès engendrés par les traitements ...
- Ischémie-reperfusion et protection cellulaire (srlf.org)
de M Cour · 2010 · Cité 21 fois — Classiquement, seule la reperfusion peut « sauver » le myocarde ischémique et stabiliser la taille de l'infarctus à un niveau déter- miné par la fin de l' ...
- 9.2.5 Lésions d'ischémie/reperfusion (pac6.ch)
C'est la zone bordante : la périphérie de la région ischémiée souffre d'une hypocontractilité associée à l'hypoperfusion, qui est une forme d'hibernation. Ce ...
- Physiopathologie de l'ischémie-reperfusion et du ... (sciencedirect.com)
de C Delay · 2017 · Cité 1 fois — L'ischémie est définie par la diminution (liée à une sténose significative) ou l'arrêt de l'apport sanguin artériel dans un territoire donné, ce qui entraîne ...
- Accident vasculaire cérébral ischémique (msdmanuals.com)
Le diagnostic est clinique, mais une TDM ou une IRM est effectuée pour exclure une hémorragie et confirmer la présence et l'étendue de l'accident ischémique. Le ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
