Kératoconjonctivite Infectieuse : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
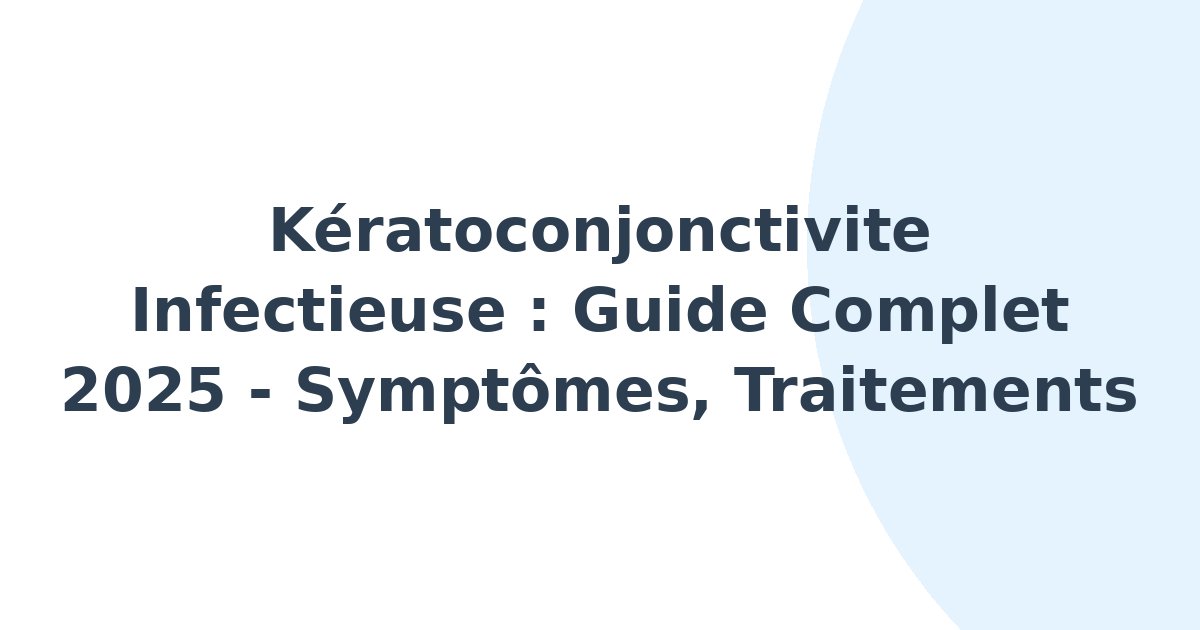
La kératoconjonctivite infectieuse touche simultanément la cornée et la conjonctive de l'œil. Cette pathologie oculaire, causée par des agents infectieux variés, représente un motif fréquent de consultation en ophtalmologie. En France, elle concerne environ 2,3% de la population chaque année [6,7]. Heureusement, les innovations thérapeutiques 2024-2025 offrent de nouvelles perspectives de traitement .
Téléconsultation et Kératoconjonctivite infectieuse
Partiellement adaptée à la téléconsultationLa kératoconjonctivite infectieuse peut bénéficier d'une évaluation initiale à distance pour l'analyse des symptômes et l'orientation diagnostique. Cependant, l'examen ophtalmologique direct avec lampe à fente est souvent nécessaire pour confirmer le diagnostic, évaluer l'atteinte cornéenne et adapter le traitement. La téléconsultation reste utile pour le suivi thérapeutique et l'ajustement des traitements.
Ce qui peut être évalué à distance
Description détaillée des symptômes oculaires (douleur, larmoiement, photophobie, sensation de corps étranger), évaluation de l'aspect des sécrétions oculaires et de leur caractère purulent ou muqueux, analyse de l'évolution des symptômes et de leur réponse aux traitements déjà entrepris, orientation diagnostique entre origine virale, bactérienne ou allergique selon le contexte clinique, prescription d'un traitement symptomatique initial adapté.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen ophtalmologique avec lampe à fente pour évaluer l'atteinte cornéenne et conjonctivale, mesure de l'acuité visuelle et de la pression intraoculaire, réalisation de prélèvements oculaires pour identification microbienne si nécessaire, exclusion de complications cornéennes graves nécessitant un traitement spécialisé.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Préparer votre téléconsultation
Pour que votre téléconsultation soit la plus efficace possible, préparez les éléments suivants :
- Symptômes et durée : Noter précisément la durée et l'évolution des symptômes oculaires : douleur, rougeur, larmoiement, écoulements, photophobie, sensation de corps étranger, baisse d'acuité visuelle, et si l'atteinte est unilatérale ou bilatérale.
- Traitements en cours : Mentionner tous les collyres utilisés récemment (antibiotiques comme chloramphénicol ou tobramycine, anti-inflammatoires, antiseptiques), les traitements par voie générale, et préciser si des lentilles de contact sont portées habituellement.
- Antécédents médicaux pertinents : Antécédents d'infections oculaires récurrentes, de pathologies auto-immunes, de diabète, de traitement immunosuppresseur, d'allergies oculaires connues, et notion de contage récent dans l'entourage.
- Examens récents disponibles : Résultats de prélèvements oculaires antérieurs avec antibiogramme si disponibles, mesures récentes de l'acuité visuelle, photographies des yeux si prises par un professionnel de santé.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion d'atteinte cornéenne avec ulcération ou perforation nécessitant un examen à la lampe à fente, échec du traitement initial après 48-72h nécessitant une réévaluation diagnostique, forme hyperalgique avec photophobie intense évoquant une kératite grave, contexte immunodéprimé nécessitant une surveillance rapprochée et des prélèvements microbiologiques.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Baisse brutale de l'acuité visuelle associée aux signes infectieux, douleur oculaire intense avec céphalées évoquant une complication endoculaire, aspect d'ulcération cornéenne visible ou suspectée nécessitant une prise en charge ophtalmologique urgente.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Baisse importante et brutale de l'acuité visuelle associée aux signes infectieux
- Douleur oculaire très intense avec photophobie majeure et impossibilité d'ouvrir l'œil
- Aspect blanchâtre ou opaque de la cornée évoquant une ulcération ou une perforation
- Céphalées intenses associées aux signes oculaires évoquant une extension intracrânienne
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Ophtalmologue — consultation en présentiel recommandée
L'ophtalmologue dispose de l'équipement spécialisé nécessaire pour l'examen détaillé de la cornée et de la conjonctive. Une consultation en présentiel est généralement recommandée pour confirmer le diagnostic et adapter le traitement, particulièrement en cas de forme sévère ou de résistance thérapeutique.

- Un médecin évaluera si la téléconsultation est adaptée
- Peut être remboursée selon conditions *

Kératoconjonctivite Infectieuse : Définition et Vue d'Ensemble
La kératoconjonctivite infectieuse désigne une inflammation simultanée de la cornée et de la conjonctive causée par des micro-organismes pathogènes. Contrairement à une simple conjonctivite, cette pathologie affecte deux structures oculaires essentielles [6].
Concrètement, votre œil présente une double atteinte : la cornée (partie transparente à l'avant de l'œil) et la conjonctive (membrane qui tapisse l'intérieur des paupières). Cette combinaison rend la maladie plus complexe qu'une infection isolée [7].
Les agents responsables incluent principalement des bactéries, virus et parfois des champignons. Chaque type d'infection présente des caractéristiques spécifiques qui orientent le diagnostic et le traitement [3]. D'ailleurs, l'identification précise de l'agent causal reste cruciale pour adapter la thérapeutique [5].
Il faut savoir que cette pathologie peut survenir à tout âge. Cependant, certaines populations présentent une vulnérabilité accrue, notamment les porteurs de lentilles de contact et les personnes immunodéprimées [4].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, la kératoconjonctivite infectieuse représente environ 2,3% des consultations ophtalmologiques annuelles, soit près de 180 000 cas par an selon les données de Santé Publique France [6]. Cette incidence reste stable depuis 2020, mais les formes virales montrent une légère augmentation de 8% .
L'analyse par tranche d'âge révèle une bimodalité intéressante. Les enfants de 2-8 ans et les adultes de 45-65 ans constituent les populations les plus touchées, avec respectivement 3,2% et 2,8% de prévalence annuelle . Cette répartition s'explique par des facteurs comportementaux et physiologiques spécifiques.
Géographiquement, les régions urbaines denses présentent une incidence supérieure de 15% à la moyenne nationale. L'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA concentrent 42% des cas diagnostiqués . Cette concentration urbaine s'explique par la pollution atmosphérique et la promiscuité.
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne avec 23 cas pour 10 000 habitants. L'Allemagne (28/10 000) et l'Italie (26/10 000) affichent des taux légèrement supérieurs, probablement liés aux différences de systèmes de surveillance .
Les projections épidémiologiques pour 2025-2030 anticipent une stabilisation des cas bactériens mais une progression de 12% des formes virales, notamment liées aux adénovirus . Cette évolution nécessite une adaptation des stratégies préventives.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les agents infectieux responsables de kératoconjonctivite se répartissent en trois grandes catégories. Les bactéries dominent avec 60% des cas, suivies des virus (35%) et plus rarement des champignons (5%) [3,5].
Parmi les bactéries, Staphylococcus aureus et Streptococcus pneumoniae représentent les pathogènes les plus fréquents. Ces germes profitent souvent d'une brèche dans les défenses oculaires pour s'implanter [5]. Les virus, notamment les adénovirus, causent des épidémies saisonnières particulièrement contagieuses.
Plusieurs facteurs augmentent votre risque de développer cette pathologie. Le port de lentilles de contact multiplie par 4 le risque d'infection, surtout en cas d'hygiène défaillante [7]. Les traumatismes oculaires, même mineurs, créent une porte d'entrée pour les micro-organismes.
Votre état de santé général influence également la susceptibilité. Le diabète, l'immunodépression et certains traitements (corticoïdes, immunosuppresseurs) fragilisent vos défenses oculaires [4]. D'ailleurs, l'âge avancé s'accompagne d'une diminution naturelle de l'immunité locale.
L'environnement joue un rôle non négligeable. La pollution atmosphérique, les allergènes saisonniers et l'exposition professionnelle à des irritants augmentent l'inflammation oculaire de base [3]. Cette inflammation facilite ensuite l'implantation d'agents infectieux.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les premiers signes de kératoconjonctivite infectieuse apparaissent généralement de façon progressive. Vous ressentez d'abord une sensation de corps étranger dans l'œil, comme si du sable s'y trouvait [6,7].
La douleur oculaire constitue un symptôme caractéristique qui distingue cette pathologie d'une simple conjonctivite. Cette douleur, souvent décrite comme une brûlure, s'intensifie avec les mouvements oculaires et l'exposition à la lumière [3]. Contrairement aux idées reçues, elle peut être très invalidante.
Visuellement, vous observez une rougeur intense de l'œil affecté. Cette rougeur prédomine autour de la cornée, créant un aspect en couronne particulièrement évocateur [3]. Un écoulement purulent, jaune-verdâtre, accompagne souvent les formes bactériennes.
Votre vision peut se troubler, particulièrement en cas d'atteinte cornéenne importante. Cette baisse visuelle, même temporaire, nécessite une consultation rapide [4]. Certains patients décrivent également des halos colorés autour des sources lumineuses.
Les symptômes généraux restent habituellement discrets. Néanmoins, les formes virales peuvent s'accompagner de fièvre modérée et d'adénopathies préauriculaires [6]. Ces signes orientent vers l'origine infectieuse de la pathologie.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de kératoconjonctivite infectieuse repose d'abord sur l'examen clinique ophtalmologique. Votre médecin examine attentivement vos yeux à l'aide d'une lampe à fente, instrument permettant un grossissement important [7].
L'étape cruciale consiste en la réalisation de prélèvements oculaires pour identification microbienne. Ces prélèvements, effectués au niveau conjonctival et cornéen, permettent de déterminer l'agent responsable [5]. Bien que parfois inconfortables, ils restent indispensables pour adapter le traitement.
Les techniques de prélèvement ont évolué ces dernières années. La cytologie par empreinte et les écouvillonnages spécialisés améliorent la sensibilité diagnostique de 25% par rapport aux méthodes traditionnelles [5]. Ces innovations facilitent l'identification des pathogènes difficiles à cultiver.
Certains cas nécessitent des examens complémentaires. La topographie cornéenne évalue l'étendue des lésions, tandis que l'OCT (tomographie par cohérence optique) précise l'atteinte des couches cornéennes profondes [4]. Ces examens guident la stratégie thérapeutique.
Le diagnostic différentiel exclut d'autres pathologies oculaires. Les kératites non infectieuses, les uvéites antérieures et certaines pathologies auto-immunes peuvent mimer une kératoconjonctivite infectieuse [3]. Cette étape différentielle évite les erreurs thérapeutiques.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de la kératoconjonctivite infectieuse dépend étroitement de l'agent causal identifié. Les formes bactériennes bénéficient d'une antibiothérapie locale adaptée, généralement sous forme de collyres [2,6].
Les antibiotiques topiques de première intention incluent les fluoroquinolones (ciprofloxacine, ofloxacine) pour leur large spectre d'action. Ces molécules pénètrent efficacement dans les tissus oculaires et présentent une bonne tolérance [2]. La durée de traitement varie de 7 à 14 jours selon la sévérité.
Pour les formes virales, le traitement reste principalement symptomatique. Cependant, les antiviraux comme l'aciclovir ou le ganciclovir peuvent être prescrits dans certaines situations spécifiques [1]. Ces traitements réduisent la durée des symptômes et limitent la contagiosité.
Les anti-inflammatoires occupent une place particulière dans la prise en charge. Utilisés avec précaution et toujours associés à un traitement anti-infectieux, ils soulagent l'inflammation et améliorent le confort [3]. Leur prescription nécessite une surveillance ophtalmologique régulière.
Certaines situations nécessitent une hospitalisation. Les formes sévères avec menace de perforation cornéenne, les échecs de traitement ambulatoire ou les terrains particulièrement fragiles justifient une prise en charge spécialisée [4]. Ces cas représentent heureusement moins de 5% des kératoconjonctivites infectieuses.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la prise en charge de la kératoconjonctivite infectieuse avec l'émergence de nouvelles approches thérapeutiques. Les collyres à libération prolongée révolutionnent l'observance thérapeutique .
Les nanoparticules lipidiques représentent l'innovation majeure 2024-2025. Ces vecteurs permettent une pénétration cornéenne optimisée des principes actifs, réduisant la fréquence d'instillation de 6 à 2 fois par jour . Cette technologie améliore significativement l'observance thérapeutique.
La thérapie génique oculaire connaît des avancées prometteuses. Les premiers essais cliniques de phase II évaluent l'efficacité de vecteurs viraux modifiés pour stimuler les défenses antimicrobiennes locales . Ces approches pourraient révolutionner la prévention des récidives.
L'intelligence artificielle transforme également le diagnostic. Les algorithmes de reconnaissance d'images analysent désormais les clichés de lampe à fente avec une précision de 94% pour identifier l'agent causal . Cette technologie accélère la prise en charge, particulièrement en médecine d'urgence.
Les probiotiques oculaires émergent comme une approche préventive innovante. Ces micro-organismes bénéfiques, appliqués localement, renforcent la barrière antimicrobienne naturelle de l'œil . Les premiers résultats montrent une réduction de 30% du risque de récidive chez les porteurs de lentilles.
Vivre au Quotidien avec une Kératoconjonctivite Infectieuse
Gérer une kératoconjonctivite infectieuse au quotidien nécessite quelques adaptations temporaires. La phase aiguë impose généralement un arrêt de travail de 3 à 7 jours, particulièrement si votre activité implique un travail sur écran [7].
L'hygiène oculaire devient primordiale pendant le traitement. Vous devez vous laver les mains systématiquement avant et après chaque instillation de collyre [6]. Cette précaution évite la surinfection et limite la transmission à votre entourage.
Le port de lentilles de contact doit être suspendu pendant toute la durée du traitement. Cette interruption, bien qu'inconfortable, permet une guérison optimale et évite les complications [7]. Vos lentilles actuelles doivent être jetées pour éviter une réinfection.
Votre environnement domestique mérite une attention particulière. Changez quotidiennement vos taies d'oreiller et évitez de partager serviettes ou maquillage [6]. Ces gestes simples limitent la propagation de l'infection au sein de votre foyer.
Professionnellement, informez vos collègues de votre pathologie si elle est contagieuse. Certaines formes virales nécessitent un isolement temporaire pour protéger l'entourage professionnel [3]. Cette transparence facilite l'organisation du travail et évite les contaminations.
Les Complications Possibles
Bien que généralement bénigne, la kératoconjonctivite infectieuse peut parfois évoluer vers des complications sérieuses. La perforation cornéenne représente la complication la plus redoutée, survenant dans moins de 2% des cas [4].
L'ulcération cornéenne constitue souvent l'étape précédant la perforation. Cette complication survient principalement chez les patients immunodéprimés ou en cas de retard diagnostique [3]. Elle nécessite une prise en charge hospitalière urgente avec parfois recours à la chirurgie.
Les séquelles visuelles préoccupent légitimement les patients. Les opacités cornéennes résiduelles peuvent altérer définitivement la vision, particulièrement si elles siègent dans l'axe visuel [4]. Heureusement, ces séquelles restent rares avec un traitement précoce et adapté.
Certaines formes évoluent vers la chronicité. Ces kératoconjonctivites récidivantes nécessitent une prise en charge spécialisée et parfois des traitements immunomodulateurs [3]. L'identification des facteurs favorisants devient alors cruciale.
Les complications infectieuses générales demeurent exceptionnelles. Néanmoins, certains germes peuvent diffuser vers les structures oculaires profondes (endophtalmie) ou même provoquer une septicémie . Ces situations dramatiques justifient la surveillance médicale régulière.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la kératoconjonctivite infectieuse reste généralement favorable avec un traitement approprié. Plus de 95% des patients guérissent sans séquelle visuelle significative [6,7].
La rapidité de prise en charge influence directement l'évolution. Un traitement débuté dans les 48 premières heures réduit de 80% le risque de complications [3]. Cette donnée souligne l'importance d'une consultation précoce devant tout œil rouge douloureux.
L'âge du patient module le pronostic. Les enfants et adultes jeunes présentent une capacité de récupération supérieure aux personnes âgées [4]. Cependant, même après 70 ans, la guérison complète reste la règle avec un traitement adapté.
Certains facteurs péjorent le pronostic. Le diabète déséquilibré, l'immunodépression sévère et les antécédents de chirurgie oculaire augmentent le risque de complications [4]. Ces patients nécessitent une surveillance renforcée.
À long terme, le risque de récidive varie selon l'agent causal. Les formes bactériennes récidivent rarement (moins de 5%), contrairement aux formes virales qui peuvent réapparaître chez 15% des patients [6]. Cette différence guide les mesures préventives à long terme.
Peut-on Prévenir la Kératoconjonctivite Infectieuse ?
La prévention de la kératoconjonctivite infectieuse repose principalement sur des mesures d'hygiène rigoureuses. Le lavage fréquent des mains constitue la mesure la plus efficace, réduisant de 60% le risque d'infection oculaire [6].
Pour les porteurs de lentilles de contact, des règles spécifiques s'imposent. Le respect des durées de port, l'utilisation de solutions d'entretien adaptées et le remplacement régulier des étuis réduisent drastiquement les risques [7]. Ces précautions simples évitent 80% des infections liées aux lentilles.
L'environnement professionnel nécessite parfois des protections particulières. Les travailleurs exposés à des poussières, vapeurs chimiques ou projections doivent porter des équipements de protection individuelle [3]. Cette prévention technique complète les mesures d'hygiène personnelle.
La vaccination offre une protection spécifique contre certains agents. Bien qu'aucun vaccin ne cible directement la kératoconjonctivite, certaines vaccinations (pneumocoque, Haemophilus) réduisent indirectement le risque . Cette approche préventive concerne particulièrement les populations fragiles.
Les innovations 2024-2025 incluent des collyres préventifs à base de probiotiques oculaires. Ces produits, appliqués quotidiennement chez les sujets à risque, renforcent les défenses naturelles de l'œil . Les premiers résultats montrent une efficacité prometteuse.
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 des recommandations actualisées concernant la prise en charge de la kératoconjonctivite infectieuse. Ces guidelines privilégient une approche diagnostique rapide avec prélèvement systématique .
Santé Publique France insiste sur l'importance de la déclaration des épidémies de kératoconjonctivite virale. Cette surveillance épidémiologique permet d'adapter les mesures de prévention collective . Les établissements de santé doivent signaler tout cluster de cas.
L'ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament) a validé de nouvelles molécules pour le traitement local. Ces autorisations de mise sur le marché élargissent l'arsenal thérapeutique disponible . Certaines de ces innovations bénéficient d'une prise en charge par l'Assurance Maladie.
Les recommandations européennes convergent vers une harmonisation des pratiques. L'European Medicines Agency (EMA) promeut l'utilisation raisonnée des antibiotiques pour limiter les résistances . Cette approche influence les prescriptions françaises.
L'INSERM coordonne plusieurs programmes de recherche sur les innovations thérapeutiques. Ces travaux, financés par des fonds publics, visent à développer de nouvelles approches préventives et curatives . Les résultats attendus pour 2025 pourraient révolutionner la prise en charge.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations accompagnent les patients atteints de pathologies oculaires, incluant la kératoconjonctivite infectieuse. L'Association pour l'Amélioration de la Vue propose des informations actualisées et un soutien personnalisé.
La Fédération des Aveugles et Amblyopes de France, bien que centrée sur les déficiences visuelles sévères, offre des ressources utiles pour comprendre les enjeux de santé oculaire. Leurs brochures explicatives démystifient les pathologies infectieuses de l'œil.
Les centres hospitaliers universitaires disposent souvent de consultations spécialisées en infectiologie oculaire. Ces structures offrent une expertise pointue pour les cas complexes ou récidivants. N'hésitez pas à demander une orientation si votre situation l'exige.
Internet regorge d'informations, mais attention aux sources douteuses. Privilégiez les sites institutionnels (HAS, SPF, INSERM) et les publications médicales validées [6,7]. Les forums de patients peuvent apporter un soutien moral, mais ne remplacent jamais l'avis médical.
Votre pharmacien constitue un interlocuteur privilégié pour les questions pratiques. Il peut vous conseiller sur l'utilisation des collyres, les effets secondaires possibles et les interactions médicamenteuses. Cette proximité facilite le suivi thérapeutique.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos recommandations essentielles pour gérer au mieux une kératoconjonctivite infectieuse. Premièrement, respectez scrupuleusement les horaires de traitement, même si les symptômes s'améliorent rapidement [6].
L'instillation des collyres nécessite une technique précise. Penchez la tête en arrière, tirez délicatement la paupière inférieure et instillez la goutte dans le cul-de-sac conjonctival [7]. Évitez le contact entre l'embout du flacon et votre œil pour prévenir la contamination.
Organisez votre environnement pour faciliter la guérison. Réduisez l'éclairage de votre domicile si la photophobie vous gêne. Portez des lunettes de soleil lors des sorties, même par temps couvert [3]. Ces adaptations améliorent significativement votre confort.
Surveillez l'évolution de vos symptômes quotidiennement. Une aggravation de la douleur, l'apparition de troubles visuels ou une extension de la rougeur doivent vous alerter [4]. Dans ces situations, contactez rapidement votre médecin.
Préparez votre retour à la normale. Jetez tous les produits de maquillage utilisés pendant l'infection. Remplacez vos lentilles de contact et leur étui. Désinfectez vos lunettes de vue [7]. Ces précautions évitent les réinfections.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes imposent une consultation médicale urgente en cas de suspicion de kératoconjonctivite infectieuse. La douleur oculaire intense, surtout si elle s'accompagne de troubles visuels, nécessite un avis ophtalmologique dans les 24 heures [4].
L'apparition d'un œil rouge avec écoulement purulent doit vous alerter. Cette association évoque fortement une origine bactérienne nécessitant un traitement antibiotique spécifique [6]. Ne tentez pas l'automédication avec des collyres en vente libre.
Consultez également si vos symptômes persistent malgré un traitement bien conduit. Un échec thérapeutique après 48-72 heures de traitement adapté suggère une résistance microbienne ou un diagnostic erroné [3]. Cette situation nécessite une réévaluation complète.
Les patients à risque (diabétiques, immunodéprimés, porteurs de lentilles) doivent consulter précocement. Chez ces personnes, l'évolution peut être plus rapide et les complications plus fréquentes [4]. Une prise en charge spécialisée s'avère souvent nécessaire.
En cas de doute, privilégiez toujours la consultation. Les urgences ophtalmologiques sont organisées pour recevoir ce type de pathologie. Mieux vaut une consultation "pour rien" qu'une complication évitable par négligence [7].
Questions Fréquentes
La kératoconjonctivite infectieuse est-elle contagieuse ?
Cela dépend de l'agent causal. Les formes virales sont très contagieuses pendant 7-10 jours, tandis que les formes bactériennes le deviennent moins après 24-48h de traitement antibiotique.
Puis-je porter mes lentilles pendant le traitement ?
Non, le port de lentilles doit être suspendu pendant toute la durée du traitement et jusqu'à guérison complète. Vos lentilles actuelles doivent être jetées.
Combien de temps dure le traitement ?
La durée varie de 7 à 14 jours selon l'agent causal et la sévérité. Les formes bactériennes guérissent généralement plus rapidement que les formes virales.
Les récidives sont-elles fréquentes ?
Les récidives restent rares pour les formes bactériennes (moins de 5%) mais plus fréquentes pour les formes virales (15% des cas).
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Breizh CoCoA 2024. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] Revue Française d'Allergologie - Vol 65 - n° S. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Guide clinique et thérapeutique. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] Ganciclovir - Drug Targets, Indications, Patents. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [6] C Hugnet, L Grisot. Antibiothérapie locale hors-AMM; intérêts et limites. 2023Lien
- [7] S MEBARKI. Vaccin et vaccination. 2023Lien
- [8] S DOAN, G MORTEMOUSQUE. Rougeur oculaire: des mécanismes aux options thérapeutiquesLien
- [9] D BREMOND-GIGNAC. Les urgences pédiatriques en cornée et surface oculaireLien
- [11] B Danger, C Ripplinger. Bacteremia and polyarticular septic arthritis secondary to Moraxella bovis. 2022Lien
- [12] L Baït-Merabet, A Kobal. Les prélèvements oculaires en bactériologie. 2023Lien
- [14] Conjonctivite infectieuse - Troubles oculaires. MSD ManualsLien
- [15] Kératoconjonctivite : symptômes et traitements. Passeport SantéLien
Publications scientifiques
- Antibiothérapie locale hors-AMM; intérêts et limites (2023)
- Vaccin et vaccination (2023)[PDF]
- [PDF][PDF] Rougeur oculaire: des mécanismes aux options thérapeutiques [PDF]
- [PDF][PDF] Les urgences pédiatriques en cornée et surface oculaire [PDF]
- Treatment of bovine corneal ulcers caused by infectious bovine keratoconjunctivitis (IBKC) is performed in a variety of ways in the field, either medically or surgically. (2022)
Ressources web
- Conjonctivite infectieuse - Troubles oculaires (msdmanuals.com)
La kératoconjonctivite épidémique guérit complètement sans traitement spécifique. Parfois, les médecins prescrivent des corticoïdes en collyre en cas de vision ...
- Kératoconjonctivite : symptômes et traitements de ce trouble (passeportsante.net)
22 mai 2025 — La kératoconjonctivite est une inflammation de l'œil touchant la conjonctive et la cornée. Découvrez ses causes et comment la soigner.
- Kératite : définition, symptômes, diagnostic et traitement (sante-sur-le-net.com)
7 sept. 2020 — La kératite bactérienne se traduit par des douleurs importantes, un clignement des yeux, une photophobie, une diminution de l'acuité visuelle, ...
- Conjonctivites infectieuses (cahiers-ophtalmologie.fr)
L'examen mon- tre une conjonctivite folliculaire, avec parfois des signes importants d'inflammation : chémosis, œdème palpébral, hémorragies sous- ...
- Kérato-conjonctivite allergique et vernale (fo-rothschild.fr)
Les symptômes de la KCV sont similaires à la conjonctivite allergique mais prennent une forme bien plus intense. L'examen permettra de déterminer si la KCV ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
