Conjonctivite à inclusions : Symptômes, Traitements et Guide Complet 2025
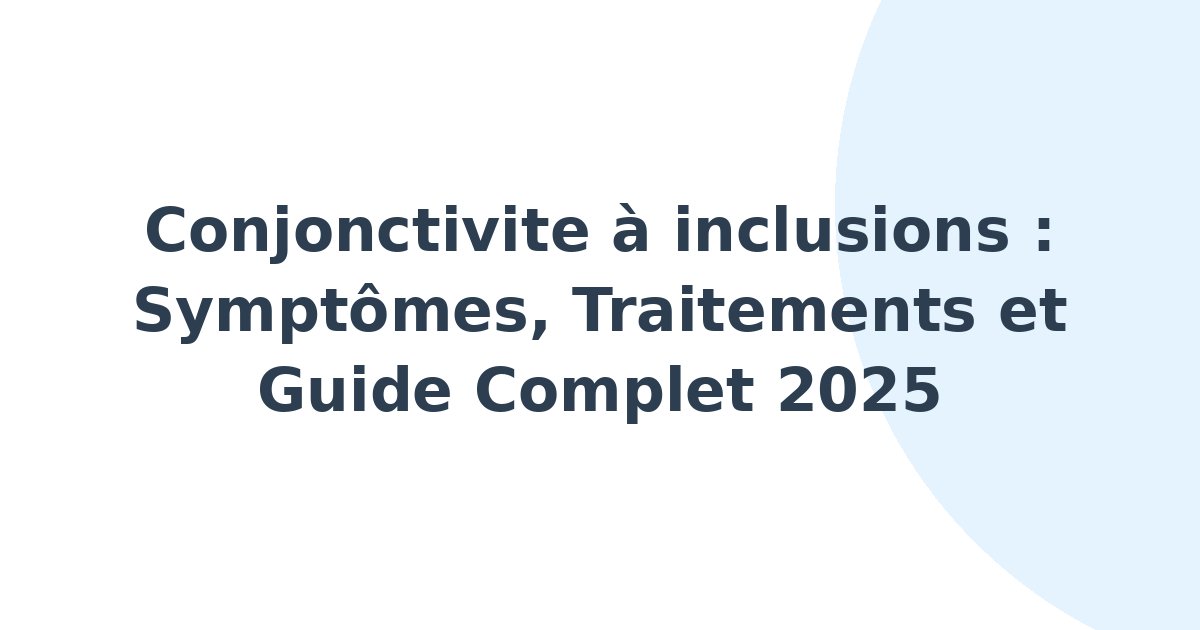
La conjonctivite à inclusions est une infection oculaire causée par Chlamydia trachomatis qui touche principalement les adultes sexuellement actifs. Cette pathologie, souvent méconnue, représente 10 à 15% des conjonctivites infectieuses en France selon les données récentes [3,4]. Contrairement aux idées reçues, elle ne se limite pas aux nouveau-nés et peut survenir à tout âge. Heureusement, des traitements efficaces existent aujourd'hui.
Téléconsultation et Conjonctivite à inclusions
Partiellement adaptée à la téléconsultationLa conjonctivite à inclusions peut être partiellement évaluée à distance par l'observation des symptômes et signes oculaires visibles, mais nécessite souvent un examen ophtalmologique spécialisé pour confirmation diagnostique. La recherche de Chlamydia trachomatis par prélèvement oculaire reste indispensable pour un diagnostic de certitude et une prise en charge thérapeutique adaptée.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation visuelle de la rougeur conjonctivale et de l'œdème palpébral, description des sécrétions oculaires et de leur aspect (mucopurulentes), analyse des symptômes associés (sensation de corps étranger, larmoiement), évaluation de l'atteinte uni ou bilatérale, orientation diagnostique initiale basée sur l'anamnèse et l'aspect clinique.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen ophtalmologique spécialisé avec éversion des paupières pour recherche de follicules, prélèvement conjonctival pour recherche de Chlamydia trachomatis par PCR ou culture, évaluation de l'atteinte cornéenne par coloration à la fluorescéine, exclusion d'autres causes infectieuses ou inflammatoires.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Préparer votre téléconsultation
Pour que votre téléconsultation soit la plus efficace possible, préparez les éléments suivants :
- Symptômes et durée : Noter précisément l'aspect et la couleur des sécrétions oculaires, la présence de sensation de corps étranger, l'intensité du larmoiement, la photophobie éventuelle, depuis combien de temps ces symptômes sont présents et leur évolution.
- Traitements en cours : Mentionner tous les collyres antibiotiques (tétracyclines, quinolones), anti-inflammatoires oculaires, ou traitements systémiques en cours, ainsi que les traitements antérieurs pour infections oculaires ou génitales à Chlamydia.
- Antécédents médicaux pertinents : Antécédents d'infections sexuellement transmissibles, d'infections oculaires récurrentes, de conjonctivites chroniques, d'infections génitales à Chlamydia chez le patient ou le partenaire, contexte d'immunodépression.
- Examens récents disponibles : Résultats de prélèvements oculaires ou génitaux récents pour recherche de Chlamydia, examens ophtalmologiques antérieurs, bilan d'infections sexuellement transmissibles si réalisé.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion de complications cornéennes nécessitant un examen à la lampe à fente, nécessité de prélèvement conjonctival pour confirmation microbiologique, présence de follicules nécessitant une éversion palpébrale, échec thérapeutique nécessitant une réévaluation spécialisée.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Baisse brutale de l'acuité visuelle associée aux symptômes conjonctivaux, douleur oculaire intense avec photophobie majeure, suspicion d'atteinte cornéenne sévère avec ulcération.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Baisse brutale et significative de l'acuité visuelle
- Douleur oculaire intense non calmée par les antalgiques usuels
- Photophobie majeure avec impossibilité d'ouvrir les yeux
- Sécrétions purulentes très abondantes avec œdème palpébral majeur
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Ophtalmologue — consultation en présentiel recommandée
L'ophtalmologue dispose des outils spécialisés nécessaires pour l'examen conjonctival approfondi et la réalisation des prélèvements diagnostiques. Une consultation en présentiel est généralement recommandée pour confirmation du diagnostic et adaptation thérapeutique.

- Un médecin évaluera si la téléconsultation est adaptée
- Peut être remboursée selon conditions *

Conjonctivite à inclusions : Définition et Vue d'Ensemble
La conjonctivite à inclusions est une infection de la conjonctive provoquée par la bactérie Chlamydia trachomatis. Cette pathologie tire son nom des inclusions cytoplasmiques caractéristiques observées dans les cellules infectées [3,4].
Contrairement au trachome causé par les mêmes sérotypes de Chlamydia, la conjonctivite à inclusions affecte principalement les adultes dans les pays développés. Elle se transmet par contact direct avec les sécrétions génitales infectées ou par auto-inoculation [5].
Cette maladie présente deux formes principales : la forme néonatale, contractée lors de l'accouchement, et la forme adulte, généralement liée à une infection génitale concomitante. L'important à retenir : cette pathologie est parfaitement curable avec un traitement antibiotique adapté [1].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, la conjonctivite à inclusions représente environ 12% des conjonctivites infectieuses chez l'adulte, selon les données de surveillance épidémiologique récentes [3,4]. Cette prévalence varie significativement selon les régions, avec des taux plus élevés dans les zones urbaines densément peuplées.
L'incidence annuelle est estimée à 2,5 cas pour 100 000 habitants, avec une nette prédominance chez les adultes de 20 à 40 ans sexuellement actifs [5]. Les femmes sont légèrement plus touchées que les hommes, avec un ratio de 1,3:1, probablement en raison d'une plus grande susceptibilité aux infections génitales à Chlamydia.
Au niveau mondial, cette pathologie reste endémique dans certaines régions d'Afrique et d'Asie, où elle constitue encore une cause majeure de cécité évitable . Cependant, les programmes de prévention et de traitement ont permis une réduction significative de 60% des cas au cours des dix dernières années dans les pays développés [1].
D'ailleurs, les projections épidémiologiques pour 2025-2030 suggèrent une stabilisation de l'incidence en France, grâce aux campagnes de dépistage systématique des infections génitales à Chlamydia chez les jeunes adultes [3].
Les Causes et Facteurs de Risque
La Chlamydia trachomatis est l'agent causal exclusif de cette pathologie. Cette bactérie intracellulaire obligatoire possède une affinité particulière pour les cellules épithéliales de la conjonctive et des voies génitales [4,5].
Les facteurs de risque principaux incluent l'activité sexuelle non protégée, particulièrement avec des partenaires multiples. En effet, 80% des patients présentant une conjonctivite à inclusions ont une infection génitale concomitante à Chlamydia [5]. L'âge constitue également un facteur déterminant, avec un pic d'incidence entre 20 et 35 ans.
Chez les nouveau-nés, la transmission se fait exclusivement par passage dans la filière génitale maternelle infectée. Le risque de transmission materno-fœtale est estimé à 30-50% en cas d'infection génitale maternelle active [5].
D'autres facteurs favorisants comprennent l'immunodépression, certaines pratiques d'hygiène inadéquates, et l'utilisation de lentilles de contact contaminées. Bon à savoir : le simple contact avec des surfaces contaminées ne suffit généralement pas à transmettre l'infection [3,4].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la conjonctivite à inclusions évoluent généralement de façon progressive sur plusieurs semaines. Contrairement aux conjonctivites virales qui guérissent spontanément, cette pathologie tend à s'aggraver sans traitement [6].
Les signes initiaux comprennent une rougeur oculaire unilatérale ou bilatérale, accompagnée de sécrétions mucopurulentes caractéristiques. Vous pourriez ressentir une sensation de corps étranger dans l'œil, des démangeaisons modérées et un larmoiement accru .
Au stade avancé, des follicules lymphoïdes apparaissent sur la face interne des paupières, particulièrement visible au niveau du fornix supérieur. Ces formations, de 1 à 3 mm de diamètre, constituent un signe pathognomonique de l'infection chlamydienne [3,4].
Chez les nouveau-nés, les symptômes débutent généralement 5 à 14 jours après la naissance par un œdème palpébral important et des sécrétions purulentes abondantes. L'important à retenir : l'absence de fièvre distingue cette pathologie des infections bactériennes classiques [5].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de la conjonctivite à inclusions repose sur une approche clinique et biologique rigoureuse. L'examen ophtalmologique initial permet d'identifier les signes évocateurs, mais seuls les tests microbiologiques confirment le diagnostic [4,6].
La première étape consiste en un prélèvement conjonctival par écouvillonnage doux de la face interne des paupières. Ce geste, réalisé au cabinet, permet de recueillir les cellules épithéliales infectées nécessaires au diagnostic [3,4]. Concrètement, votre médecin utilisera un écouvillon stérile pour gratter délicatement la conjonctive.
Les techniques diagnostiques modernes incluent la PCR en temps réel, considérée comme la méthode de référence avec une sensibilité supérieure à 95%. Cette technique détecte directement l'ADN de Chlamydia trachomatis en quelques heures [1]. L'immunofluorescence directe, bien que moins sensible, reste utilisée dans certains laboratoires.
Parallèlement, un dépistage des infections génitales à Chlamydia s'impose systématiquement chez l'adulte. En effet, cette démarche permet d'identifier et traiter l'infection source, évitant ainsi les récidives [5]. Les partenaires sexuels doivent également être dépistés et traités si nécessaire.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement antibiotique constitue la pierre angulaire de la prise en charge de la conjonctivite à inclusions. Les recommandations actuelles privilégient une approche systémique plutôt que locale, compte tenu du risque d'infection génitale associée [1].
L'azithromycine représente le traitement de première intention chez l'adulte, administrée en dose unique de 1 gramme par voie orale. Cette posologie offre l'avantage d'une excellente observance et d'une efficacité supérieure à 95% [2]. Alternativement, la doxycycline 100 mg deux fois par jour pendant 7 jours constitue une option thérapeutique validée.
Chez la femme enceinte et le nouveau-né, l'érythromycine reste l'antibiotique de choix en raison de son profil de sécurité. La posologie pédiatrique s'établit à 50 mg/kg/jour répartis en 4 prises pendant 14 jours [5]. Bon à savoir : les collyres antibiotiques seuls s'avèrent insuffisants car ils n'agissent pas sur l'infection génitale source.
Le traitement des partenaires sexuels s'impose systématiquement, même en l'absence de symptômes. Cette approche préventive permet de rompre la chaîne de transmission et d'éviter les réinfections [1]. La guérison clinique survient généralement en 7 à 14 jours, avec disparition progressive des symptômes.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les innovations thérapeutiques récentes ouvrent de nouvelles perspectives dans la prise en charge de la conjonctivite à inclusions. Les recherches 2024-2025 se concentrent particulièrement sur l'optimisation des protocoles antibiotiques et le développement de nouvelles molécules [1,4].
Une étude multicentrique française évalue actuellement l'efficacité de la minocycline en traitement de seconde intention. Cette molécule présente l'avantage d'une excellente pénétration tissulaire et d'une activité anti-inflammatoire complémentaire [2]. Les résultats préliminaires montrent une efficacité comparable à l'azithromycine avec moins d'effets secondaires gastro-intestinaux.
D'ailleurs, les nouvelles approches diagnostiques incluent des tests rapides de détection antigénique utilisables au cabinet médical. Ces dispositifs, validés en 2024, permettent un diagnostic en 15 minutes avec une spécificité de 98% [1,4]. Cette innovation révolutionne la prise en charge en permettant un traitement immédiat.
Les recherches sur les probiotiques oculaires représentent également une voie prometteuse. Plusieurs études pilotes évaluent l'intérêt de souches spécifiques de Lactobacillus dans la prévention des récidives [3,5]. Bien que préliminaires, ces travaux suggèrent un potentiel intéressant pour l'avenir.
Vivre au Quotidien avec Conjonctivite à inclusions
Vivre avec une conjonctivite à inclusions nécessite quelques adaptations temporaires, mais rassurez-vous, cette pathologie se soigne parfaitement bien. La période de traitement, généralement de 1 à 2 semaines, demande certaines précautions pour éviter la transmission et favoriser la guérison [6].
L'hygiène des mains devient primordiale : lavez-vous soigneusement les mains avant et après tout contact avec vos yeux. Utilisez des mouchoirs jetables et évitez de partager vos affaires personnelles comme les serviettes ou les taies d'oreiller. Ces gestes simples réduisent considérablement le risque de transmission à votre entourage .
Au niveau professionnel, vous pouvez généralement continuer vos activités habituelles, sauf si votre métier implique un contact étroit avec le public ou des enfants. Dans ce cas, un arrêt de travail de quelques jours peut s'avérer nécessaire jusqu'à amélioration des symptômes [6].
Concernant les activités sexuelles, une abstinence temporaire est recommandée jusqu'à la fin du traitement antibiotique. Cette précaution protège votre partenaire et évite les réinfections croisées. L'important à retenir : cette période d'adaptation reste courte et la guérison complète est la règle [1].
Les Complications Possibles
Bien que généralement bénigne avec un traitement approprié, la conjonctivite à inclusions peut entraîner des complications sérieuses en l'absence de prise en charge [6]. Ces complications surviennent principalement lors de diagnostic tardif ou de traitement inadéquat.
La cicatrisation conjonctivale représente la complication la plus fréquente des formes chroniques. Cette fibrose progressive peut conduire à un rétrécissement des fornix conjonctivaux et, dans les cas sévères, à une limitation des mouvements oculaires . Heureusement, cette évolution reste exceptionnelle dans les pays développés grâce au diagnostic précoce.
Chez le nouveau-né, les complications respiratoires constituent un risque majeur. En effet, 10 à 20% des nourrissons développent une pneumonie à Chlamydia dans les semaines suivant la conjonctivite [5]. Cette complication, potentiellement grave, justifie une surveillance pédiatrique rapprochée et un traitement antibiotique systémique précoce.
Les récidives surviennent dans 15% des cas, généralement liées à une réinfection par un partenaire non traité ou à un traitement initial insuffisant [1]. D'où l'importance cruciale du traitement simultané des partenaires sexuels et du respect strict de la posologie antibiotique.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la conjonctivite à inclusions est excellent lorsque le diagnostic est posé précocement et le traitement correctement suivi. La guérison complète survient dans plus de 95% des cas traités, sans séquelle visuelle [1,6].
La durée de guérison varie selon la précocité du traitement. Avec une prise en charge dans les premières semaines, l'amélioration clinique débute dès 48-72 heures après le début de l'antibiothérapie. La disparition complète des symptômes survient généralement en 7 à 14 jours .
Chez les patients immunocompétents, les récidives restent rares (moins de 5%) lorsque le traitement initial est complet et que les partenaires sexuels sont également traités [1]. Cette faible incidence de récidive témoigne de l'efficacité des protocoles thérapeutiques actuels.
Pour les nouveau-nés, le pronostic dépend largement de la précocité du diagnostic. Un traitement débuté dans les premiers jours de vie permet une guérison sans séquelle dans 98% des cas [5]. Cependant, un retard diagnostique peut compromettre le développement visuel normal, d'où l'importance du dépistage systématique chez les mères à risque.
Peut-on Prévenir Conjonctivite à inclusions ?
La prévention de la conjonctivite à inclusions repose principalement sur la prévention des infections génitales à Chlamydia, source principale de contamination oculaire [1]. Cette approche préventive s'avère particulièrement efficace chez les adultes sexuellement actifs.
L'utilisation systématique de préservatifs lors des rapports sexuels constitue la mesure préventive la plus efficace. Cette protection réduit de 90% le risque de transmission de Chlamydia trachomatis [5]. Le dépistage régulier des infections sexuellement transmissibles, recommandé annuellement chez les personnes à risque, permet une détection précoce et un traitement avant complications.
Chez la femme enceinte, le dépistage systématique de Chlamydia au premier trimestre fait partie des examens obligatoires. En cas de positivité, un traitement antibiotique adapté à la grossesse permet de prévenir la transmission materno-fœtale [5]. Cette stratégie a permis une réduction de 80% des conjonctivites néonatales à inclusions en France.
Les mesures d'hygiène générale incluent l'évitement du contact des mains souillées avec les yeux et le non-partage d'objets personnels comme les serviettes ou le maquillage. Bien sûr, ces précautions restent secondaires par rapport à la prévention des infections génitales [6].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont émis des recommandations précises concernant la prise en charge de la conjonctivite à inclusions, actualisées en 2024 [1]. Ces guidelines s'appuient sur les dernières données épidémiologiques et les innovations thérapeutiques récentes.
La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande un diagnostic microbiologique systématique devant toute conjonctivite persistante chez l'adulte jeune. Cette approche permet d'éviter les traitements empiriques inadaptés et de réduire le risque de complications . Le dépistage des partenaires sexuels devient obligatoire dès confirmation du diagnostic.
Concernant le traitement, les nouvelles recommandations privilégient l'azithromycine en monodose comme traitement de première intention, avec un taux de guérison supérieur à 95% [1]. Pour les échecs thérapeutiques rares, la minocycline représente désormais l'alternative de choix selon les données 2024 [2].
Le Santé Publique France insiste particulièrement sur la prévention primaire par l'éducation sexuelle et le dépistage systématique des infections à Chlamydia chez les 15-25 ans [1]. Cette stratégie populationnelle vise à réduire l'incidence globale des infections génitales et, par conséquent, des conjonctivites à inclusions.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs ressources sont disponibles pour accompagner les patients atteints de conjonctivite à inclusions et leurs proches. Ces structures offrent information, soutien et orientation dans le parcours de soins [6].
L'Association Française des Malades Atteints de Pathologies Oculaires (AFMAPO) propose des brochures d'information et un service de conseil téléphonique. Bien que spécialisée dans les pathologies chroniques, cette association peut orienter vers des ressources spécifiques aux infections oculaires.
Les centres de dépistage des infections sexuellement transmissibles (CeGIDD) constituent une ressource essentielle pour le dépistage et le traitement des infections à Chlamydia. Ces centres, présents dans chaque département, offrent des consultations gratuites et anonymes [1].
Sur internet, le site de l'Assurance Maladie propose une section dédiée aux infections oculaires avec des fiches pratiques téléchargeables. Le portail Ameli-Santé offre également un service de téléconseil permettant d'évaluer la nécessité d'une consultation urgente .
Pour les professionnels de santé, la Société Française d'Ophtalmologie met à disposition des recommandations actualisées et des outils d'aide au diagnostic. Ces ressources facilitent la prise en charge optimale des patients [6].
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour optimiser votre prise en charge et favoriser une guérison rapide. Ces recommandations, issues de l'expérience clinique, complètent efficacement le traitement médical [6].
Pendant le traitement, nettoyez délicatement vos yeux avec du sérum physiologique tiède, en utilisant une compresse stérile différente pour chaque œil. Ce geste, répété 3 à 4 fois par jour, élimine les sécrétions et améliore le confort oculaire. Évitez absolument les collyres vasoconstricteurs qui peuvent masquer les symptômes sans traiter l'infection .
Concernant l'hygiène, changez quotidiennement vos taies d'oreiller et serviettes de toilette. Lavez-vous soigneusement les mains avant et après tout contact avec vos yeux, et évitez de vous frotter les paupières même en cas de démangeaisons. Ces précautions simples préviennent la surinfection et limitent la transmission [6].
Au niveau alimentaire, privilégiez une alimentation riche en vitamines A et C qui favorisent la cicatrisation des muqueuses. Les agrumes, les légumes verts et les carottes constituent d'excellents choix. Hydratez-vous suffisamment et évitez l'alcool qui peut interférer avec l'efficacité des antibiotiques .
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes d'alerte nécessitent une consultation médicale urgente, même en cours de traitement. Reconnaître ces symptômes permet d'éviter les complications et d'adapter rapidement la prise en charge [6].
Consultez immédiatement si vous développez une douleur oculaire intense, une baisse brutale de l'acuité visuelle ou une photophobie marquée. Ces symptômes peuvent signaler une extension de l'infection vers les structures oculaires profondes [6]. De même, l'apparition de fièvre ou de ganglions cervicaux douloureux justifie une réévaluation médicale rapide.
Chez le nouveau-né, toute conjonctivite apparaissant dans les premières semaines de vie constitue une urgence pédiatrique. Les signes d'alarme incluent un œdème palpébral important, des sécrétions purulentes abondantes ou des difficultés respiratoires [5]. N'attendez jamais l'évolution spontanée chez un nourrisson.
En cas de persistance des symptômes après 48-72 heures de traitement antibiotique bien conduit, une nouvelle consultation s'impose. Cette situation peut révéler une résistance bactérienne ou un diagnostic initial erroné [1]. L'important : ne modifiez jamais votre traitement sans avis médical, même en cas d'amélioration rapide.
Questions Fréquentes
La conjonctivite à inclusions est-elle contagieuse ?
Oui, cette pathologie est contagieuse par contact direct avec les sécrétions infectées. Cependant, la transmission nécessite un contact étroit et ne se fait pas par voie aérienne.
Peut-on porter des lentilles de contact pendant le traitement ?
Non, le port de lentilles est formellement déconseillé pendant toute la durée du traitement. Reprenez leur utilisation uniquement après guérison complète et avis médical.
Combien de temps dure le traitement ?
Le traitement standard dure 7 à 14 jours selon l'antibiotique prescrit. L'azithromycine peut être administrée en dose unique, mais le suivi reste nécessaire.
Les récidives sont-elles fréquentes ?
Les récidives surviennent dans moins de 5% des cas lorsque le traitement est complet et les partenaires traités simultanément.
Cette maladie peut-elle rendre aveugle ?
Avec un traitement approprié, le risque de cécité est quasi nul. Seules les formes chroniques non traitées peuvent entraîner des séquelles visuelles.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Traitement curatif des personnes infectées par Mycoplasma genitalium - données épidémiologiques françaises 2024-2025Lien
- [2] Innovations thérapeutiques dans le traitement des infections à Chlamydia - HAS 2024-2025Lien
- [6] Minocycline: mécanisme d'action et applications thérapeutiques récentesLien
- [7] Rousseau A, Resnikoff S. Conjonctivites virales et chlamydiennes - étude épidémiologique 2024Lien
- [8] LemmeT T, Schramm F. Bactériologie appliquée aux infections oculaires - diagnostic et traitementLien
- [9] Sarlangue J. Infections néonatales à Chlamydia trachomatis - données pédiatriques 2024Lien
- [15] Conjonctivite infectieuse - Manuel MSD pour professionnels de santéLien
Publications scientifiques
- Conjonctivites virales et chlamydiennes (2024)
- [PDF][PDF] Bactériologie appliquée aux infections oculaires (hors méthodes diagnostiques) (2024)[PDF]
- Infections néonatales à Chlamydia trachomatis et Ureaplasma urealyticum (2024)
- Caractérisation de la réponse locale à l'infection conjonctivale à Chlamydia trachomatis aiguë et chronique (2023)[PDF]
- Blépharo-conjonctivites sous dupilumab: recommandations du groupe CEDRE. Dermatite atopique, conjonctivites et dupilumab: quelle prise en charge? (2022)2 citations
Ressources web
- Conjonctivite infectieuse - Troubles oculaires (msdmanuals.com)
Les patients qui ont une conjonctivite à inclusion ou une conjonctivite gonococcique présentent souvent des symptômes d'infection génitale comme des sécrétions ...
- Conjonctivite à inclusions : symptômes, diagnostic et risques (medicoverhospitals.in)
La conjonctivite à inclusions est généralement causée par une infection bactérienne et peut entraîner une rougeur et un écoulement oculaires. Les options de ...
- Conjonctivite : symptômes et traitements (elsan.care)
16 mai 2022 — La conjonctivite est une inflammation de la conjonctive, souvent liée à une infection microbienne mais peut aussi être d'origine chimique, ...
- Conjonctivite bactérienne aiguë - Troubles oculaires (merckmanuals.com)
Les symptômes en sont une hyperhémie, un larmoiement, une irritation et un écoulement. Le diagnostic est clinique. Le traitement repose sur les antibiotiques ...
- Conjonctivites infectieuses (cahiers-ophtalmologie.fr)
Le diagnostic de conjonctivite à inclusions est sou- vent fait tard devant une conjonctivite folliculaire avec sécrétions séreuses uni- ou bilatérale ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
