Insuffisance Intestinale : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
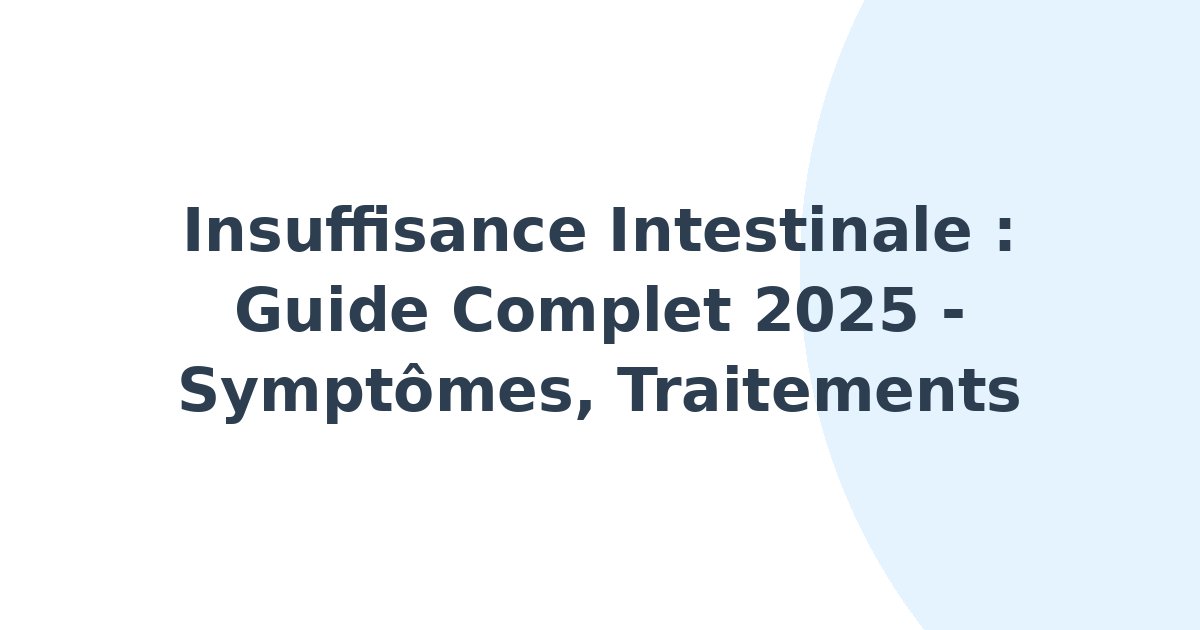
L'insuffisance intestinale représente une pathologie complexe où l'intestin grêle ne parvient plus à absorber suffisamment de nutriments et d'eau pour maintenir un état nutritionnel normal. Cette maladie rare touche environ 2 à 5 personnes par million d'habitants en France selon les dernières données épidémiologiques [1,2]. Bien que méconnue du grand public, elle nécessite une prise en charge spécialisée et peut considérablement impacter la qualité de vie.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Insuffisance intestinale : Définition et Vue d'Ensemble
L'insuffisance intestinale se définit comme l'incapacité de l'intestin grêle à maintenir un équilibre nutritionnel et hydrique normal. Concrètement, votre intestin ne peut plus absorber les nutriments essentiels, les vitamines et les minéraux dont votre corps a besoin pour fonctionner correctement [9,10].
Cette pathologie se caractérise par une malabsorption sévère qui nécessite souvent un support nutritionnel artificiel. D'ailleurs, on distingue deux formes principales : l'insuffisance intestinale aiguë, généralement réversible, et l'insuffisance intestinale chronique, qui persiste au-delà de plusieurs mois [10,16].
Mais attention, il ne faut pas confondre cette maladie avec le syndrome de l'intestin irritable, beaucoup plus fréquent [3]. L'insuffisance intestinale est une pathologie organique grave qui affecte la structure même de l'intestin. En fait, elle peut résulter d'une perte anatomique importante de l'intestin grêle ou d'un dysfonctionnement majeur de sa fonction d'absorption [9].
L'important à retenir : cette maladie nécessite une prise en charge multidisciplinaire dans des centres spécialisés. Heureusement, les innovations thérapeutiques récentes offrent de nouveaux espoirs aux patients [4,5].
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques françaises révèlent que l'insuffisance intestinale chronique touche environ 2 à 5 personnes par million d'habitants [1,2]. Selon le Bulletin épidémiologique hebdomadaire de Santé Publique France, cette prévalence reste stable depuis 2020, mais le diagnostic s'améliore progressivement [1].
En France, on estime qu'environ 150 à 300 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. D'ailleurs, les centres de référence français suivent actuellement près de 800 patients adultes en nutrition parentérale à domicile pour insuffisance intestinale chronique [11,12]. Ces chiffres placent notre pays dans la moyenne européenne.
Mais il existe des disparités régionales importantes. Les régions avec des centres hospitaliers universitaires spécialisés, comme l'Île-de-France ou Rhône-Alpes, diagnostiquent davantage de cas [1]. Cela ne signifie pas forcément une prévalence plus élevée, mais plutôt un meilleur accès au diagnostic spécialisé.
Concernant la répartition par âge, deux pics d'incidence se dessinent : les nouveau-nés avec des malformations congénitales et les adultes de 40-60 ans suite à des complications chirurgicales [9,11]. Les femmes semblent légèrement plus touchées, représentant 55% des cas selon les registres français [12].
Au niveau international, les États-Unis rapportent une prévalence similaire, tandis que les pays nordiques affichent des chiffres légèrement supérieurs, probablement liés à de meilleurs systèmes de surveillance épidémiologique [1,2].
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes de l'insuffisance intestinale sont multiples et varient selon l'âge du patient. Chez l'adulte, les complications post-chirurgicales représentent la première cause, notamment après des résections étendues de l'intestin grêle [9,10].
Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn, constituent un facteur de risque majeur. En effet, les poussées répétées peuvent nécessiter des interventions chirurgicales multiples, réduisant progressivement la longueur intestinale fonctionnelle [16]. D'ailleurs, environ 30% des patients avec insuffisance intestinale ont des antécédents de maladie de Crohn [9].
Mais d'autres causes existent. La pseudo-obstruction intestinale chronique représente une forme particulière où l'intestin, bien que présent, ne fonctionne plus correctement [16]. Cette pathologie de la motricité intestinale peut être congénitale ou acquise.
Chez l'enfant, les malformations congénitales dominent : atrésie intestinale, gastroschisis, ou maladie de Hirschsprung étendue [15]. Ces pathologies nécessitent souvent des interventions chirurgicales précoces qui peuvent compromettre la fonction intestinale à long terme.
Les facteurs de risque incluent également les radiothérapies abdominales, certaines chimiothérapies, et les infections sévères comme l'entérocolite nécrosante chez le prématuré [9,15]. Il faut savoir que le risque augmente avec le nombre d'interventions chirurgicales abdominales.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de l'insuffisance intestinale se développent progressivement et peuvent être trompeurs au début. Le signe le plus caractéristique reste la diarrhée chronique avec des selles très liquides et abondantes, souvent supérieures à 2 litres par jour [9,17].
Vous pourriez également ressentir une fatigue intense et inexpliquée. Cette asthénie résulte de la malnutrition progressive due à la mauvaise absorption des nutriments [11,17]. D'ailleurs, une perte de poids involontaire et rapide constitue souvent le premier motif de consultation.
Les carences nutritionnelles se manifestent de diverses façons : anémie par manque de fer ou de vitamine B12, troubles de la coagulation par déficit en vitamine K, ou encore fragilité osseuse par carence en calcium et vitamine D [12,13]. Ces signes peuvent apparaître avant même que le diagnostic soit posé.
Mais attention aux symptômes plus subtils. Les crampes abdominales, les ballonnements persistants et les nausées fréquentes doivent alerter, surtout s'ils s'accompagnent des autres signes [17]. Certains patients décrivent également une soif intense et des urines fréquentes, témoignant de la déshydratation chronique.
Il est normal de s'inquiéter face à ces symptômes. Cependant, leur présence ne signifie pas automatiquement une insuffisance intestinale, car d'autres pathologies peuvent les provoquer [3,17].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic d'insuffisance intestinale nécessite une approche méthodique dans un centre spécialisé. Votre médecin commencera par un interrogatoire détaillé sur vos antécédents chirurgicaux, vos traitements et l'évolution de vos symptômes [9,17].
Les examens biologiques constituent la première étape. Ils recherchent les signes de malnutrition : albumine basse, carences vitaminiques, déséquilibres électrolytiques [12,13]. D'ailleurs, le dosage de la cystatine C peut être plus fiable que la créatinine classique pour évaluer la fonction rénale chez ces patients dénutris [13].
L'imagerie médicale joue un rôle crucial. Le scanner abdominal avec injection permet d'évaluer la longueur intestinale restante et de détecter d'éventuelles complications [9]. L'IRM peut compléter le bilan, notamment pour étudier la motricité intestinale dans les formes fonctionnelles [16].
Mais le diagnostic repose aussi sur des tests fonctionnels. La mesure des pertes digestives sur 24 heures, l'analyse de la composition des selles et parfois des tests d'absorption spécifiques permettent de quantifier le degré d'insuffisance [10,17].
Concrètement, le diagnostic est confirmé lorsque le patient nécessite un support nutritionnel artificiel depuis plus de 28 jours pour l'insuffisance aiguë, ou plus de 3 mois pour la forme chronique [9,10]. Cette définition temporelle aide les équipes médicales à orienter la prise en charge.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge de l'insuffisance intestinale repose principalement sur le support nutritionnel artificiel. La nutrition parentérale constitue souvent le traitement de première ligne, apportant directement dans le sang tous les nutriments nécessaires [11,14].
Heureusement, la nutrition parentérale à domicile permet aux patients de retrouver une certaine autonomie. Cette technique nécessite la pose d'un cathéter central et une formation spécialisée du patient et de sa famille [14]. D'ailleurs, les études montrent que la qualité de vie s'améliore significativement avec ce traitement à domicile [14].
Mais la nutrition entérale reste privilégiée quand c'est possible. Elle utilise le tube digestif résiduel et présente moins de complications que la voie parentérale [10]. Certains patients bénéficient d'une combinaison des deux approches selon leurs besoins spécifiques.
Les traitements médicamenteux complètent cette prise en charge. Les ralentisseurs du transit comme la lopéramide réduisent les pertes digestives [17]. Les inhibiteurs de la pompe à protons diminuent les sécrétions gastriques, tandis que les analogues de la somatostatine peuvent être utiles dans certains cas [9,10].
Pour les formes les plus sévères, la transplantation intestinale représente l'ultime recours. Bien que complexe, cette intervention offre une chance de guérison définitive [15]. Les résultats s'améliorent progressivement grâce aux progrès des techniques chirurgicales et des traitements immunosuppresseurs.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans le traitement de l'insuffisance intestinale avec l'émergence de nouvelles thérapies prometteuses. L'apraglutide, un analogue du GLP-2 administré une fois par semaine, a montré des résultats encourageants dans l'essai STARS de phase III [7,8].
Cette innovation thérapeutique représente une avancée majeure pour les patients avec syndrome de l'intestin court. En effet, l'apraglutide stimule la croissance et la réparation de la muqueuse intestinale, permettant une meilleure absorption [7]. Les résultats montrent une réduction significative du volume de nutrition parentérale nécessaire [8].
D'ailleurs, les données présentées lors des JFHOD 2025 révèlent de nouveaux protocoles de prise en charge [4]. Ces approches intègrent mieux la réinstillation de chyme, une technique qui consiste à réinjecter les sécrétions digestives dans l'intestin grêle distal [10]. Cette méthode améliore l'absorption et réduit les pertes hydriques.
Mais les innovations ne s'arrêtent pas là. Les recherches actuelles explorent les thérapies cellulaires et la médecine régénérative [5,6]. Certains centres testent l'utilisation de cellules souches pour stimuler la régénération intestinale, ouvrant des perspectives thérapeutiques inédites.
Les biomarqueurs nutritionnels font également l'objet d'études approfondies. Le suivi du statut en zinc et l'utilisation de la cystatine C comme marqueur de fonction rénale permettent un monitoring plus précis des patients [12,13]. Ces avancées diagnostiques améliorent l'adaptation des traitements.
Vivre au Quotidien avec Insuffisance intestinale
Vivre avec une insuffisance intestinale nécessite des adaptations importantes, mais une vie épanouie reste possible. L'organisation du quotidien autour des soins nutritionnels devient rapidement une routine [14]. Bien sûr, cela demande du temps et de la patience au début.
La nutrition parentérale à domicile impose un rythme particulier. La plupart des patients la reçoivent la nuit, pendant 10 à 14 heures, ce qui préserve une certaine liberté en journée [14]. D'ailleurs, beaucoup reprennent une activité professionnelle adaptée après la phase d'apprentissage.
L'alimentation orale reste possible et importante, même si elle ne couvre pas tous les besoins. Il faut privilégier les aliments bien tolérés et fractionner les repas [11,17]. Certains patients développent une véritable expertise dans l'adaptation de leur alimentation à leur pathologie.
Mais attention aux complications potentielles. Les infections sur cathéter central représentent le risque principal [14]. Une hygiène rigoureuse et une surveillance attentive des signes d'alerte sont essentielles. Heureusement, les équipes spécialisées assurent un suivi rapproché et une éducation thérapeutique complète.
Le soutien psychologique ne doit pas être négligé. Cette maladie chronique peut générer de l'anxiété et un sentiment d'isolement [14]. Les associations de patients et les groupes de parole constituent des ressources précieuses pour partager expériences et conseils pratiques.
Les Complications Possibles
L'insuffisance intestinale peut entraîner diverses complications qu'il est important de connaître pour mieux les prévenir. Les complications hépatiques représentent l'une des préoccupations majeures, particulièrement chez les patients sous nutrition parentérale prolongée [9].
La stéatose hépatique et la cholestase peuvent se développer progressivement. Ces atteintes du foie résultent de l'accumulation de lipides et de la perturbation du métabolisme biliaire [9]. Heureusement, un suivi biologique régulier permet de les détecter précocement et d'adapter le traitement.
Les infections sur cathéter central constituent un risque permanent pour les patients sous nutrition parentérale [14]. Ces infections peuvent être graves et nécessiter une hospitalisation. D'ailleurs, elles représentent la première cause de complications chez ces patients. Une hygiène rigoureuse lors des manipulations reste la meilleure prévention.
Mais d'autres complications existent. Les troubles de la fonction rénale peuvent survenir, particulièrement en cas de déshydratation chronique [13]. La surveillance de la cystatine C permet un dépistage plus précoce que les marqueurs traditionnels chez ces patients dénutris.
Les carences nutritionnelles spécifiques nécessitent une attention particulière. Le déficit en zinc, fréquent dans cette pathologie, peut retarder la cicatrisation et altérer l'immunité [12]. Les carences en vitamines liposolubles (A, D, E, K) peuvent également survenir et nécessiter une supplémentation adaptée.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'insuffisance intestinale s'est considérablement amélioré ces dernières années grâce aux progrès de la prise en charge. Pour l'insuffisance intestinale aiguë, la récupération est possible dans 60 à 80% des cas selon les études récentes [10].
Concernant la forme chronique, le pronostic dépend largement de la cause initiale et de la longueur d'intestin grêle restante. Les patients avec plus de 100 centimètres d'intestin grêle ont généralement un meilleur pronostic [9,11]. D'ailleurs, certains parviennent à sevrer progressivement la nutrition parentérale après plusieurs années.
Mais il faut être réaliste : la dénutrition reste fréquente même après le sevrage de la nutrition parentérale [11]. Une surveillance nutritionnelle à long terme est donc indispensable. Heureusement, les nouvelles thérapies comme l'apraglutide offrent des perspectives encourageantes [7,8].
La qualité de vie constitue un enjeu majeur. Les études montrent qu'elle peut être satisfaisante avec une prise en charge adaptée [14]. Les patients apprennent à gérer leur pathologie et beaucoup reprennent une activité professionnelle et sociale normale.
Pour les cas les plus sévères, la transplantation intestinale offre une chance de guérison définitive. Bien que complexe, cette intervention présente des taux de succès croissants [15]. Les équipes spécialisées évaluent soigneusement chaque candidat pour optimiser les résultats.
Peut-on Prévenir Insuffisance intestinale ?
La prévention de l'insuffisance intestinale repose principalement sur la prévention de ses causes. Pour les patients avec maladie de Crohn, un traitement précoce et adapté peut limiter les complications nécessitant des résections intestinales étendues [16].
En chirurgie digestive, les techniques de préservation intestinale se développent. Les chirurgiens privilégient désormais les résections économes et les techniques de reconstruction qui préservent au maximum la longueur intestinale fonctionnelle [9]. Cette approche réduit significativement le risque d'insuffisance intestinale post-opératoire.
Chez les nouveau-nés à risque, la prévention de l'entérocolite nécrosante constitue un enjeu majeur. L'allaitement maternel, quand possible, et les probiotiques spécifiques montrent des résultats prometteurs [15]. D'ailleurs, les unités de néonatologie ont développé des protocoles de prévention de plus en plus efficaces.
Mais la prévention passe aussi par la formation des équipes médicales. Une meilleure connaissance de cette pathologie permet un diagnostic plus précoce et une prise en charge optimisée [4,5]. Les centres de référence jouent un rôle crucial dans cette formation et la diffusion des bonnes pratiques.
Il faut savoir que certains facteurs de risque ne peuvent être évités, comme les malformations congénitales. Cependant, leur prise en charge précoce dans des centres spécialisés améliore considérablement le pronostic [15]. La prévention secondaire devient alors essentielle pour limiter l'évolution vers l'insuffisance intestinale chronique.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi des recommandations spécifiques pour la prise en charge de l'insuffisance intestinale. Santé Publique France souligne l'importance du diagnostic précoce et de l'orientation vers des centres spécialisés [1,2].
La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande une approche multidisciplinaire impliquant gastro-entérologues, chirurgiens, nutritionnistes et pharmaciens spécialisés. Cette coordination est essentielle pour optimiser la prise en charge [1]. D'ailleurs, seuls certains centres sont autorisés à prescrire la nutrition parentérale à domicile.
Concernant le suivi biologique, les recommandations préconisent une surveillance régulière des paramètres nutritionnels, hépatiques et rénaux [12,13]. Le dosage de nouveaux marqueurs comme la cystatine C est désormais recommandé pour un suivi plus précis de la fonction rénale [13].
Les innovations thérapeutiques font l'objet d'évaluations continues. Les données des JFHOD 2025 et des congrès internationaux alimentent régulièrement les recommandations [4,5]. L'apraglutide, par exemple, fait l'objet d'une évaluation approfondie par les autorités européennes [7,8].
Mais les recommandations évoluent aussi vers une approche plus centrée sur le patient. L'éducation thérapeutique, la qualité de vie et le soutien psychosocial sont désormais intégrés dans les parcours de soins [14]. Cette évolution reflète une meilleure compréhension des besoins globaux des patients.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations de patients accompagnent les personnes atteintes d'insuffisance intestinale en France. Ces organisations offrent un soutien précieux, tant sur le plan pratique qu'émotionnel [14].
L'Association François Aupetit (AFA) propose des ressources spécifiques pour les patients avec maladies inflammatoires chroniques pouvant évoluer vers l'insuffisance intestinale. Elle organise régulièrement des rencontres et des formations [16]. D'ailleurs, son site internet regorge d'informations pratiques et de témoignages.
Les centres de référence constituent également des ressources essentielles. Ils proposent des consultations spécialisées, des programmes d'éducation thérapeutique et un suivi multidisciplinaire [1,4]. Ces centres sont répartis sur le territoire français pour faciliter l'accès aux soins.
Mais n'oubliez pas les ressources en ligne. Le site de l'Assurance Maladie propose des informations fiables sur les démarches administratives et les prises en charge [3]. Les forums de patients permettent également d'échanger expériences et conseils pratiques.
Les services sociaux hospitaliers jouent un rôle crucial dans l'accompagnement. Ils aident aux démarches de reconnaissance de handicap, aux aménagements professionnels et aux aides financières [14]. Cette dimension sociale est souvent sous-estimée mais essentielle pour maintenir la qualité de vie.
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec une insuffisance intestinale nécessite quelques adaptations pratiques que nous souhaitons partager avec vous. Tout d'abord, organisez votre domicile pour faciliter les soins : un espace dédié, propre et bien éclairé pour la nutrition parentérale [14].
Concernant l'alimentation, privilégiez les repas fractionnés et les aliments bien tolérés. Tenez un carnet alimentaire pour identifier vos tolérances personnelles [11,17]. Chaque patient développe ses propres stratégies alimentaires avec l'expérience.
Pour les voyages, une préparation minutieuse s'impose. Contactez votre équipe médicale plusieurs semaines à l'avance pour organiser le transport des solutions nutritives et prévoir les contacts médicaux sur place [14]. D'ailleurs, certaines compagnies aériennes ont des procédures spécifiques pour le transport de matériel médical.
Mais n'oubliez pas l'aspect psychologique. Rejoignez des groupes de patients, participez aux activités associatives, n'hésitez pas à consulter un psychologue si nécessaire [14]. Cette maladie chronique peut être isolante, le soutien social est crucial.
Enfin, restez acteur de votre prise en charge. Posez des questions à votre équipe médicale, informez-vous sur les nouveautés thérapeutiques, participez aux décisions vous concernant [4,5]. Votre expertise de patient est précieuse pour optimiser votre traitement.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous amener à consulter rapidement votre médecin ou l'équipe spécialisée. En premier lieu, toute fièvre persistante chez un patient porteur de cathéter central nécessite une consultation urgente [14]. Elle peut signaler une infection grave.
Les modifications importantes du transit intestinal méritent également une attention particulière. Une augmentation brutale des pertes digestives ou l'apparition de sang dans les selles doivent être signalées rapidement [9,17]. Ces changements peuvent révéler une complication ou une évolution de la maladie.
Mais attention aussi aux signes plus subtils. Une fatigue inhabituelle, des œdèmes des membres inférieurs ou des troubles de la concentration peuvent témoigner d'un déséquilibre nutritionnel [11,12]. N'hésitez pas à en parler lors de vos consultations de suivi.
Les problèmes techniques avec le matériel de nutrition parentérale nécessitent parfois une intervention médicale. Obstruction du cathéter, fuite au niveau des raccords ou dysfonctionnement de la pompe doivent être signalés [14]. Votre équipe vous aura formé à gérer ces situations.
En cas de doute, il vaut toujours mieux consulter. Les équipes spécialisées préfèrent être contactées pour rien plutôt que de passer à côté d'une complication [1,14]. D'ailleurs, la plupart des centres proposent une astreinte téléphonique pour leurs patients.
Questions Fréquentes
Quelle est la différence entre insuffisance intestinale aiguë et chronique ?
L'insuffisance intestinale aiguë dure moins de 3 mois et est souvent réversible, tandis que la forme chronique persiste au-delà de 3 mois et nécessite généralement un support nutritionnel à long terme.
Peut-on vivre normalement avec une nutrition parentérale à domicile ?
Oui, beaucoup de patients reprennent une vie quasi-normale. La nutrition parentérale se fait généralement la nuit, préservant l'autonomie en journée. Une formation adaptée et un suivi médical régulier sont essentiels.
Quels sont les nouveaux traitements disponibles en 2024-2025 ?
L'apraglutide, un analogue du GLP-2 administré une fois par semaine, montre des résultats prometteurs dans les essais cliniques. Les techniques de réinstillation de chyme se développent également.
L'insuffisance intestinale est-elle héréditaire ?
Certaines causes peuvent avoir une composante génétique (malformations congénitales, certaines maladies inflammatoires), mais la plupart des cas résultent de complications acquises.
Combien de temps faut-il pour s'adapter à la nutrition parentérale ?
L'adaptation varie selon les patients, généralement 2-6 mois pour maîtriser la technique et s'organiser. L'éducation thérapeutique et le soutien de l'équipe médicale facilitent cette adaptation.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] BEH – Bulletin épidémiologique hebdomadaire. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [2] Virus hivernaux. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [3] Reconnaître le syndrome de l'intestin irritable. www.ameli.fr.Lien
- [4] JFHOD2025-Livre des résumés.pdf. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] POST U. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] Once-Weekly Apraglutide Showed Consistent Treatment Effect. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [8] S2211 Phase 3, Double-Blind, Randomized STARS Trial. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [9] L Sequier, A Bozon. Insuffisance intestinale chronique et atteintes hépatiques. 2025.Lien
- [10] J Fatseas, P Grandval. Insuffisance intestinale aiguë et réinstillation de chyme. 2024.Lien
- [11] L Wauters, S Dermine. La dénutrition est fréquente après le sevrage de nutrition parentérale à domicile pour une insuffisance intestinale chronique. 2023.Lien
- [12] MA Gomez, M Lauverjat. Statut en zinc des patients en nutrition parentérale de longue durée pour insuffisance intestinale chronique. 2023.Lien
- [13] G Kosmadakis, LD Dubourg. Cystatine C comme marqueur de la fonction rénale chez les patients atteints d'insuffisance intestinale chronique sous nutrition parentérale de longue durée. 2023.Lien
- [14] P Chaillan, J Winkler. Évaluation de la qualité de vie des patients sous nutrition parentérale à domicile ayant une insuffisance intestinale chronique. 2022.Lien
- [15] F LACAILLE, C TALBOTEC. Indications et succès de la transplantation intestinale en 2022.Lien
- [16] L Billiauws, M Cohen. Troubles de la motricité de l'intestin grêle: pseudo-obstruction intestinale chronique. 2022.Lien
- [17] Insuffisance intestinale : causes, symptômes et traitement. www.medicoverhospitals.in.Lien
Publications scientifiques
- Insuffisance intestinale chronique et atteintes hépatiques (2025)
- Insuffisance intestinale aiguë et réinstillation de chyme (2024)
- La dénutrition est fréquente après le sevrage de nutrition parentérale à domicile pour une insuffisance intestinale chronique (2023)
- Statut en zinc des patients en nutrition parentérale de longue durée pour insuffisance intestinale chronique (2023)
- Cystatine C comme marqueur de la fonction rénale chez les patients atteints d'insuffisance intestinale chronique sous nutrition parentérale de longue durée (2023)
Ressources web
- Insuffisance intestinale : causes, symptômes et traitement (medicoverhospitals.in)
L'insuffisance intestinale survient lorsque les intestins ne peuvent plus assurer leurs fonctions essentielles de digestion et d'absorption des nutriments.
- Présentation de la malabsorption - Troubles digestifs (msdmanuals.com)
La malabsorption provoque une diarrhée, une perte de poids, ainsi que des selles volumineuses et malodorantes. Le diagnostic repose sur les symptômes typiques ...
- Reconnaître le syndrome de l'intestin irritable (ou ... (ameli.fr)
des douleurs abdominales récurrentes ; · des troubles du transit intestinal (constipation, diarrhée ou alternance des deux).
- Syndrome de l'intestin irritable (SII) - Troubles digestifs (msdmanuals.com)
Les symptômes sont variables, mais incluent fréquemment des douleurs dans le bas du ventre, des ballonnements, des flatulences et une constipation ou une ...
- Le syndrome de grêle court chez l'adulte (medecinesciences.org)
de B de Dreuille · 2021 · Cité 3 fois — Le syndrome de grêle court, conséquence d'une résection étendue de l'intestin, est la principale cause d'insuffisance intestinale, définie comme la réduction de ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
