Infections Fongiques du Système Nerveux Central : Guide Complet 2025
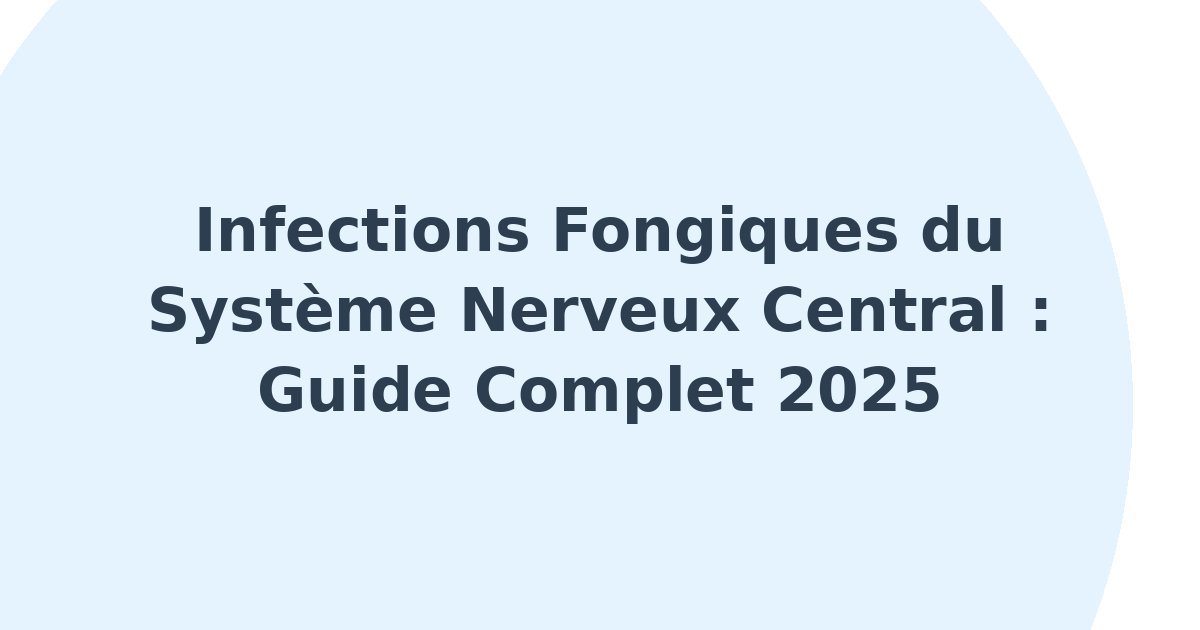
Les infections fongiques du système nerveux central représentent des pathologies rares mais graves qui touchent le cerveau et la moelle épinière. Ces maladies infectieuses, causées par des champignons microscopiques, nécessitent une prise en charge médicale urgente. Bien que peu fréquentes, elles peuvent survenir chez des personnes immunodéprimées ou dans certaines circonstances particulières. Comprendre leurs symptômes et leurs traitements est essentiel pour un diagnostic précoce.
Téléconsultation et Infections fongiques du système nerveux central
Téléconsultation non recommandéeLes infections fongiques du système nerveux central constituent des urgences neurologiques nécessitant un diagnostic rapide par ponction lombaire, imagerie cérébrale et examens microbiologiques spécialisés. L'examen neurologique clinique approfondi et la mise en route urgente d'un traitement antifongique intraveineux en milieu hospitalier sont indispensables.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil de l'historique des symptômes neurologiques et de leur évolution temporelle, évaluation des facteurs de risque immunologiques, analyse des antécédents d'infections fongiques, orientation vers une prise en charge spécialisée urgente, suivi post-hospitalisation des effets secondaires du traitement antifongique.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen neurologique complet avec évaluation de l'état de conscience et des signes méningés, ponction lombaire pour analyse du liquide céphalorachidien, imagerie cérébrale (scanner ou IRM), examens microbiologiques spécialisés avec identification fongique, mise en route d'un traitement antifongique intraveineux en urgence.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Tout patient présentant des symptômes neurologiques évocateurs d'infection du système nerveux central, nécessité d'un examen neurologique avec recherche de signes méningés, évaluation de l'état de conscience et des fonctions cognitives, patients immunodéprimés avec fièvre et céphalées, suspicion de méningoencéphalite fongique.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Altération de l'état de conscience, signes méningés patents, convulsions, déficits neurologiques focaux, syndrome d'hypertension intracrânienne, fièvre élevée chez un patient immunodéprimé avec céphalées.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Altération de la conscience, confusion, somnolence ou coma
- Céphalées intenses avec raideur de nuque et photophobie
- Convulsions ou crises d'épilepsie
- Déficits neurologiques focaux (paralysie, troubles de la parole, troubles visuels)
- Fièvre élevée associée à des troubles neurologiques chez un patient immunodéprimé
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Neurologue ou infectiologue — consultation en présentiel indispensable
Les infections fongiques du système nerveux central nécessitent impérativement une prise en charge spécialisée en neurologie ou infectiologie avec hospitalisation pour diagnostic urgent et traitement antifongique intraveineux. L'examen clinique neurologique et les examens complémentaires sont indispensables.
Infections fongiques du système nerveux central : Définition et Vue d'Ensemble
Les infections fongiques du système nerveux central sont des pathologies causées par des champignons qui envahissent le cerveau, les méninges ou la moelle épinière. Ces micro-organismes, normalement présents dans l'environnement, deviennent pathogènes lorsqu'ils franchissent la barrière hémato-encéphalique [10].
Contrairement aux infections bactériennes ou virales, les infections fongiques du SNC évoluent généralement de manière plus insidieuse. Les champignons les plus fréquemment impliqués incluent Cryptococcus neoformans, Candida albicans, Aspergillus fumigatus et Histoplasma capsulatum [2,11].
Ces pathologies touchent principalement les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Mais attention, elles peuvent aussi survenir chez des individus apparemment en bonne santé, notamment lors d'expositions environnementales spécifiques [6]. L'important à retenir : ces infections nécessitent toujours une prise en charge médicale spécialisée et urgente.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, les infections fongiques du système nerveux central restent heureusement rares. Selon les données de Santé Publique France, l'incidence annuelle est estimée à environ 0,5 à 2 cas pour 100 000 habitants, avec des variations importantes selon les régions .
Les méningites fongiques représentent moins de 5% de l'ensemble des méningites en France métropolitaine. Cependant, leur fréquence augmente progressivement depuis 2020, notamment en raison de l'augmentation du nombre de patients immunodéprimés [1]. Cette tendance s'observe également dans d'autres pays européens.
D'ailleurs, l'Enquête nationale de prévalence 2024 révèle que ces infections touchent davantage les hommes (60% des cas) et surviennent principalement entre 40 et 70 ans . Les régions du Sud de la France enregistrent une incidence légèrement supérieure, probablement liée aux maladies climatiques favorables au développement de certains champignons.
Au niveau mondial, la cryptococcose reste la cause la plus fréquente d'infection fongique du SNC, particulièrement dans les pays en développement où elle est souvent associée au VIH [2]. Les projections pour 2025-2030 suggèrent une stabilisation de l'incidence en France, grâce aux progrès thérapeutiques récents.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les champignons pathogènes responsables de ces infections proviennent généralement de l'environnement. Cryptococcus neoformans, par exemple, se trouve couramment dans les fientes d'oiseaux, tandis qu'Aspergillus prolifère dans les sols humides et les matières organiques en décomposition [2,7].
Plusieurs facteurs augmentent considérablement le risque de développer une infection fongique du SNC. L'immunodépression constitue le principal facteur de risque : patients sous chimiothérapie, greffés d'organes, porteurs du VIH ou traités par corticoïdes au long cours [7,11]. Mais ce n'est pas tout.
Certaines professions exposent également à un risque accru. Les agriculteurs, jardiniers, spéléologues ou travailleurs du bâtiment peuvent inhaler des spores fongiques en grande quantité . De même, les voyages dans certaines régions endémiques (vallée du Mississippi pour l'histoplasmose, Sud-Ouest américain pour la coccidioïdomycose) représentent des facteurs de risque géographiques.
Il faut savoir que même chez les personnes immunocompétentes, certaines circonstances peuvent favoriser l'infection : traumatisme crânien, intervention neurochirurgicale récente, ou exposition massive à des spores [6]. L'âge avancé et le diabète constituent également des facteurs prédisposants non négligeables.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes des infections fongiques du SNC apparaissent généralement de manière progressive, sur plusieurs semaines ou mois. Cette évolution insidieuse rend le diagnostic parfois difficile [10,12].
Les céphalées constituent le symptôme le plus fréquent, présentes chez plus de 80% des patients. Ces maux de tête sont souvent persistants, d'intensité croissante, et résistent aux antalgiques habituels. Ils s'accompagnent fréquemment de nausées et vomissements [1,12].
La fièvre n'est pas systématique, ce qui peut retarder le diagnostic. Quand elle est présente, elle reste souvent modérée (38-39°C) et peut être intermittente. D'autres signes neurologiques peuvent apparaître : troubles de la conscience, confusion, convulsions, ou déficits neurologiques focaux selon la localisation de l'infection [10].
Bon à savoir : certains symptômes sont plus spécifiques selon le type de champignon. La cryptococcose provoque souvent des troubles visuels et une hypertension intracrânienne, tandis que l'aspergillose peut causer des accidents vasculaires cérébraux par thrombose [2,11]. Il est normal de s'inquiéter face à ces symptômes, mais rassurez-vous : un diagnostic précoce améliore considérablement le pronostic.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des infections fongiques du SNC repose sur plusieurs examens complémentaires. La première étape consiste en une évaluation clinique approfondie, incluant l'anamnèse des facteurs de risque et l'examen neurologique [9,10].
La ponction lombaire constitue l'examen clé du diagnostic. Elle permet d'analyser le liquide céphalorachidien (LCR) et de rechercher la présence de champignons par examen direct, culture et tests antigéniques [9,11]. Concrètement, cet examen se déroule sous anesthésie locale et dure environ 15 minutes.
Les techniques de biologie moléculaire révolutionnent aujourd'hui le diagnostic. Le séquençage à haut débit et la PCR multiplex permettent d'identifier rapidement les agents pathogènes, même en faible quantité [8,9]. Ces innovations 2024-2025 réduisent considérablement les délais diagnostiques, passant de plusieurs jours à quelques heures.
L'imagerie cérébrale (IRM ou scanner) complète le bilan diagnostique. Elle peut révéler des lésions caractéristiques : abcès, granulomes, ou signes d'hypertension intracrânienne [4,12]. Certains patients nécessitent parfois une biopsie cérébrale, notamment en cas de lésions focales suspectes.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement des infections fongiques du SNC nécessite une approche multidisciplinaire associant infectiologues, neurologues et parfois neurochirurgiens. Les antifongiques constituent la base du traitement, mais leur choix dépend du champignon identifié [11].
Pour la cryptococcose, le traitement de référence associe l'amphotéricine B et la flucytosine pendant 2 semaines, suivies de fluconazole pendant 8 à 10 semaines [2,11]. Cette approche séquentielle permet d'optimiser l'efficacité tout en limitant la toxicité.
L'aspergillose cérébrale nécessite un traitement plus agressif, généralement par voriconazole ou isavuconazole. Ces molécules de nouvelle génération présentent une meilleure pénétration cérébrale que les antifongiques classiques [5,11]. La durée du traitement varie de 3 à 6 mois selon l'évolution clinique.
Mais attention, ces traitements ne sont pas généralement bien tolérés. Les antifongiques peuvent provoquer des effets indésirables significatifs : toxicité rénale, hépatique, ou troubles électrolytiques [3]. Un suivi biologique régulier est donc indispensable. Heureusement, les nouvelles formulations lipidiques d'amphotéricine B réduisent considérablement ces complications.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
La recherche sur les infections fongiques du SNC connaît des avancées remarquables en 2024-2025. Les nouveaux inhibiteurs antifongiques développés grâce à l'intelligence artificielle montrent des résultats prometteurs dans les essais précliniques [5].
L'innovation majeure concerne les thérapies ciblées post-CAR T-cell. Le golcadomide (BMS-986369) fait l'objet d'essais cliniques pour prévenir les infections fongiques chez les patients immunodéprimés après thérapie cellulaire . Cette approche préventive pourrait révolutionner la prise en charge des patients à haut risque.
Les techniques de diagnostic moléculaire évoluent également rapidement. Les panels multiplex de nouvelle génération permettent désormais d'identifier simultanément plus de 20 agents pathogènes fongiques en moins de 2 heures [4,8]. Cette rapidité diagnostique améliore significativement le pronostic des patients.
D'ailleurs, la recherche fondamentale progresse aussi. Les études sur les mécanismes de neuro-invasion fongique ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques . Comprendre comment les champignons franchissent la barrière hémato-encéphalique pourrait permettre de développer des traitements préventifs ciblés. Ces innovations donnent beaucoup d'espoir pour l'avenir.
Vivre au Quotidien avec une Infection Fongique du SNC
Vivre avec une infection fongique du système nerveux central nécessite des adaptations importantes dans la vie quotidienne. La fatigue constitue souvent le symptôme le plus handicapant, persistant même après la guérison de l'infection [10].
L'organisation du quotidien devient essentielle. Il est important de prévoir des périodes de repos régulières et d'adapter son rythme de vie. Beaucoup de patients trouvent utile de tenir un carnet de symptômes pour identifier les facteurs déclenchants de fatigue ou de maux de tête [12].
Le suivi médical reste crucial pendant plusieurs mois, voire années après le traitement initial. Les consultations régulières permettent de détecter précocement d'éventuelles récidives et d'adapter les traitements préventifs [11]. Certains patients nécessitent un traitement antifongique suppressif au long cours.
Concrètement, il faut aussi adapter son environnement. Éviter les expositions à risque (jardinage sans protection, espaces poussiéreux) devient une priorité, surtout pour les personnes immunodéprimées . La famille et l'entourage professionnel jouent un rôle important dans cette adaptation. Rassurez-vous, avec un suivi approprié, la plupart des patients retrouvent une qualité de vie satisfaisante.
Les Complications Possibles
Les complications des infections fongiques du SNC peuvent être graves et nécessitent une surveillance attentive. L'hypertension intracrânienne constitue la complication la plus fréquente, particulièrement dans la cryptococcose [2,10].
Les séquelles neurologiques persistent malheureusement chez 20 à 30% des patients, même après un traitement approprié. Ces séquelles incluent des troubles cognitifs, des déficits moteurs, ou des troubles de l'équilibre [12]. La précocité du diagnostic et du traitement influence directement le risque de séquelles.
Certaines complications sont liées aux traitements eux-mêmes. La toxicité rénale de l'amphotéricine B peut nécessiter une dialyse temporaire chez 10 à 15% des patients [3,11]. Les troubles électrolytiques, notamment l'hypokaliémie, sont également fréquents et nécessitent une correction régulière.
Les récidives représentent un défi thérapeutique majeur, survenant chez 10 à 20% des patients dans les deux ans suivant le traitement initial [11]. C'est pourquoi un suivi prolongé est indispensable. Heureusement, les nouvelles approches thérapeutiques réduisent progressivement ces risques de complications.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des infections fongiques du SNC s'est considérablement amélioré ces dernières années grâce aux progrès diagnostiques et thérapeutiques. Globalement, le taux de mortalité varie de 10 à 30% selon le type de champignon et l'état immunitaire du patient [2,11].
La cryptococcose présente un pronostic relativement favorable chez les patients immunocompétents, avec un taux de guérison supérieur à 90%. En revanche, chez les patients immunodéprimés, notamment ceux atteints du VIH, le pronostic reste plus réservé [2].
L'aspergillose cérébrale demeure la forme la plus grave, avec un taux de mortalité encore élevé malgré les nouveaux traitements. Cependant, les innovations thérapeutiques 2024-2025 laissent entrevoir des améliorations significatives [5].
Plusieurs facteurs influencent le pronostic : l'âge du patient, son état immunitaire, la précocité du diagnostic, et la réponse au traitement initial [6,12]. Il faut savoir que même après guérison, certains patients conservent des séquelles neurologiques mineures. Mais rassurez-vous, la majorité des patients traités précocement récupèrent complètement. L'important est de maintenir un suivi médical régulier et de respecter scrupuleusement les traitements prescrits.
Peut-on Prévenir les Infections Fongiques du SNC ?
La prévention des infections fongiques du SNC repose principalement sur la réduction des expositions à risque et la prophylaxie chez les patients immunodéprimés [7].
Pour les personnes à risque élevé, certaines mesures préventives sont essentielles. Éviter les environnements poussiéreux, porter un masque lors de travaux de jardinage, et maintenir une hygiène rigoureuse constituent les bases de la prévention . Les patients immunodéprimés doivent être particulièrement vigilants.
La prophylaxie antifongique est recommandée chez certains patients à très haut risque : greffés d'organes, patients sous chimiothérapie intensive, ou porteurs du VIH avec CD4 très bas [2,11]. Le fluconazole est l'antifongique le plus utilisé en prophylaxie.
Les innovations 2024-2025 incluent de nouvelles stratégies préventives. Les thérapies ciblées post-CAR T-cell ouvrent des perspectives prometteuses pour prévenir les infections chez les patients traités par immunothérapie . D'ailleurs, la recherche sur les vaccins antifongiques progresse, même si aucun n'est encore disponible en pratique clinique. Concrètement, la meilleure prévention reste l'identification précoce des patients à risque et l'adaptation de leur environnement.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont émis des recommandations spécifiques pour la prise en charge des infections fongiques du SNC. Santé Publique France insiste sur l'importance du diagnostic précoce et de la déclaration des cas .
La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande une approche multidisciplinaire associant infectiologues, neurologues et biologistes. Le recours aux centres de référence est préconisé pour les cas complexes ou les infections à champignons rares [1].
Concernant le diagnostic biologique, les recommandations 2024 privilégient l'utilisation des techniques de biologie moléculaire en première intention. Les panels multiplex sont désormais recommandés dans tous les centres hospitaliers universitaires [8,9].
Pour le traitement, les guidelines européennes, adoptées par les sociétés savantes françaises, préconisent des protocoles standardisés selon le type de champignon [11]. L'Assurance Maladie a d'ailleurs élargi la prise en charge des nouveaux antifongiques en 2024 [1].
Les recommandations insistent également sur l'importance du suivi post-thérapeutique. Un suivi neurologique et infectiologique est recommandé pendant au moins 2 ans après la fin du traitement [10]. Ces guidelines sont régulièrement mises à jour en fonction des nouvelles données scientifiques.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations accompagnent les patients atteints d'infections fongiques du SNC et leurs familles. La Fédération Française de Neurologie propose des ressources spécialisées et met en relation patients et professionnels [10].
L'association "Ensemble contre les Infections Rares" organise des groupes de parole et des journées d'information. Ces rencontres permettent aux patients de partager leur expérience et de bénéficier de conseils pratiques pour la vie quotidienne.
Les centres de référence des maladies infectieuses rares proposent des consultations spécialisées et des programmes d'éducation thérapeutique. Ces programmes aident les patients à mieux comprendre leur maladie et à optimiser leur prise en charge [11].
Sur internet, plusieurs forums modérés par des professionnels de santé permettent d'échanger des informations fiables. Attention cependant aux informations non vérifiées : privilégiez toujours les sources officielles et l'avis de votre équipe médicale.
Les services sociaux hospitaliers peuvent également vous accompagner dans vos démarches administratives : reconnaissance de handicap, aménagement du poste de travail, ou aide à domicile. N'hésitez pas à solliciter ces services dès le début de votre prise en charge.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre avec une infection fongique du SNC. Tout d'abord, respectez scrupuleusement votre traitement antifongique, même si vous vous sentez mieux. L'arrêt prématuré expose au risque de récidive [11].
Organisez votre quotidien en tenant compte de la fatigue. Planifiez vos activités importantes le matin, quand vous êtes le plus en forme. N'hésitez pas à faire des siestes courtes dans la journée si nécessaire [12].
Côté alimentation, privilégiez une alimentation équilibrée riche en vitamines et minéraux. Évitez l'alcool qui peut interagir avec vos médicaments et affaiblir votre système immunitaire. Hydratez-vous suffisamment, surtout si vous prenez de l'amphotéricine B.
Pour l'environnement, évitez les travaux de jardinage sans protection, les caves humides, et les espaces poussiéreux. Si vous devez vous exposer, portez un masque FFP2 et des gants . Aérez régulièrement votre domicile et maintenez un taux d'humidité inférieur à 60%.
Enfin, n'hésitez pas à communiquer avec votre équipe médicale. Signalez tout symptôme nouveau, même s'il vous paraît bénin. Tenez un carnet de suivi avec vos symptômes, vos prises de médicaments, et vos questions pour les consultations. Cette organisation facilite grandement le suivi médical.
Quand Consulter un Médecin ?
Il est crucial de savoir quand consulter en urgence lors d'une infection fongique du SNC. Certains signes nécessitent une consultation immédiate aux urgences [10,12].
Consultez immédiatement si vous présentez : des céphalées sévères et soudaines, des troubles de la conscience, des convulsions, ou une fièvre élevée associée à des signes neurologiques. Ces symptômes peuvent indiquer une aggravation de l'infection ou une complication [1,10].
Pour les patients déjà traités, surveillez attentivement l'apparition de nouveaux symptômes. Une recrudescence des maux de tête, des troubles visuels, ou une fatigue inhabituelle peuvent signaler une récidive [11,12].
N'attendez pas non plus en cas d'effets indésirables sévères des traitements : jaunisse, diminution importante des urines, ou éruption cutanée étendue. Ces signes peuvent indiquer une toxicité médicamenteuse nécessitant un ajustement thérapeutique [3].
Pour les consultations programmées, respectez le calendrier établi par votre médecin. Ces rendez-vous permettent de surveiller l'évolution de l'infection et d'adapter les traitements. En cas de doute, n'hésitez jamais à contacter votre équipe médicale : il vaut mieux consulter pour rien que de passer à côté d'une complication.
Questions Fréquentes
Les infections fongiques du SNC sont-elles contagieuses ?
Non, ces infections ne se transmettent pas de personne à personne. Les champignons proviennent de l'environnement et infectent généralement des personnes prédisposées.
Combien de temps dure le traitement ?
La durée varie selon le champignon et la gravité : 2 à 6 mois en moyenne, parfois plus pour certaines formes. Certains patients nécessitent un traitement suppressif à vie.
Peut-on guérir complètement ?
Oui, la plupart des patients guérissent complètement avec un traitement approprié. Cependant, 20 à 30% conservent des séquelles mineures.
Les récidives sont-elles fréquentes ?
Les récidives surviennent chez 10 à 20% des patients dans les deux ans. Un suivi médical régulier permet de les détecter précocement.
Puis-je reprendre une activité normale ?
La plupart des patients reprennent leurs activités habituelles après traitement. Certains aménagements peuvent être nécessaires selon les séquelles éventuelles.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Infections invasives à méningocoque : un nombre de cas élevé en janvier et février 2025Lien
- [2] Principaux résultats de l'Enquête nationale de prévalence 2024 des infections associées aux soinsLien
- [3] Méningite : définition, causes et circonstances de survenueLien
- [4] Cryptococcose : symptômes, traitement, préventionLien
- [5] Effets indésirables des antifongiquesLien
- [6] CARMOD Golcadomide (BMS-986369) post-CAR T-cell therapyLien
- [7] Update on neuro infectious disease workups and consultationLien
- [8] Design and discovery of novel antifungal inhibitorsLien
- [9] Étude des mécanismes moléculaires associés aux infections virales du système nerveux centralLien
- [10] Blastomycose du système nerveux central chez un enfant immunocompétentLien
- [11] Exploration de la lignée myéloïde du système nerveux central grâce à la cytométrie en flux spectraleLien
- [12] Infections fongiques pulmonaires (à l'exception de la pneumocystose)Lien
- [13] Rôle des lymphocytes T résidents mémoires dans les maladies inflammatoires du système nerveux centralLien
- [14] Séquençage à haut débit pour le diagnostic en maladies infectieuses : exemple de la métagénomique shotgun dans les infections du système nerveux centralLien
- [15] Un cas d'infection fongique disséminée à Aspergillus terreus et Scedosporium spp. chez une chienne berger belge malinoisLien
- [16] Intérêt de la PCR multiplex panel FilmArray Meningitis/Encephalitis dans le diagnostic des infections du système nerveux centralLien
- [17] Infection du système nerveux – FFNLien
- [18] Traitement des infections fongiques du SNCLien
- [19] Infections du système nerveux central : symptômes et soinsLien
Publications scientifiques
- Etude des mécanismes moléculaires associés aux infections virales du système nerveux central: de la neuro-invasion aux désordres neuronaux (2023)
- Blastomycose du système nerveux central chez un enfant immunocompétent (2025)[PDF]
- Exploration de la lignée myéloïde du système nerveux central grâce à la cytométrie en flux spectrale (2022)
- Infections fongiques pulmonaires (à l'exception de la pneumocystose) (2024)1 citations
- Rôle des lymphocytes T résidents mémoires dans les maladies inflammatoires du système nerveux central (2025)
Ressources web
- Infection du système nerveux – FFN (ffn-neurologie.fr)
Les manifestations associent de manière extrêmement variée et plus ou moins affirmée des symptômes et signes infectieux (fièvre, frissons, altération de l'état ...
- Traitement des infections fongiques du SNC (infectiologie.org.tn)
Signes et symptômes. Abcès cerveau: • Crise comitiale, paralysie nerfs crâniens, hémiparésie, HTIC (selon la localisation). Méningites. • Céphalées ...
- Infections du système nerveux central : symptômes et soins (medicoverhospitals.in)
Le diagnostic implique généralement une ponction lombaire, des analyses de sang et des études d'imagerie pour évaluer la présence d'une infection. 4. Quels ...
- Infections du système nerveux central - AEMiP (aemip.fr)
Une méningite se caractérise par l'association inconstante de la triade céphalées, vomissements (classiquement en jet) et raideur méningée (patient « en chien ...
- Méningo-encéphalite amibienne primitive - Infections (msdmanuals.com)
Parfois, le premier symptôme est une altération de l'odorat ou du goût. Ensuite apparaissent des maux de tête, une raideur de la nuque, une sensibilité à la ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
