Infections de l'appareil reproducteur : Guide Complet 2025 | Symptômes, Traitements
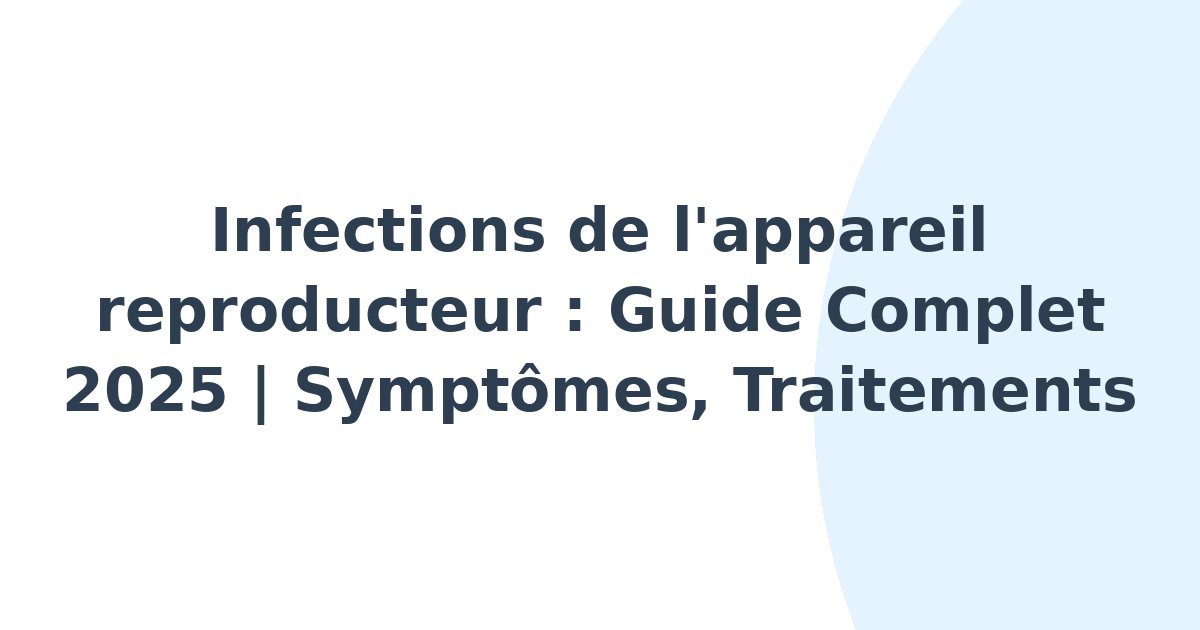
Les infections de l'appareil reproducteur touchent des millions de personnes chaque année en France. Ces pathologies, souvent méconnues, peuvent avoir des conséquences importantes sur votre santé intime et votre qualité de vie. Heureusement, les avancées médicales de 2024-2025 offrent de nouvelles perspectives thérapeutiques prometteuses.
Téléconsultation et Infections de l'appareil reproducteur
Partiellement adaptée à la téléconsultationLes infections de l'appareil reproducteur nécessitent généralement un examen clinique pour confirmer le diagnostic et identifier l'agent pathogène responsable. Cependant, la téléconsultation peut être utile pour l'évaluation initiale des symptômes, l'orientation diagnostique et le suivi thérapeutique après diagnostic établi.
Ce qui peut être évalué à distance
Description précise des symptômes (douleurs, écoulements, démangeaisons, brûlures), évaluation de l'intensité et de l'évolution des signes, analyse des facteurs de risque et du contexte (rapports récents, changement de partenaire), orientation diagnostique initiale, suivi de l'efficacité d'un traitement déjà prescrit.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen gynécologique ou urologique complet pour visualiser les lésions, prélèvements microbiologiques pour identifier l'agent pathogène, palpation abdominale et pelvienne, échographie pelvienne si suspicion de complication.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Préparer votre téléconsultation
Pour que votre téléconsultation soit la plus efficace possible, préparez les éléments suivants :
- Symptômes et durée : Noter précisément les écoulements (couleur, odeur, abondance), les douleurs pelviennes ou génitales, les brûlures mictionnelles, les démangeaisons, la fièvre, et indiquer depuis combien de jours ces symptômes sont présents.
- Traitements en cours : Mentionner tout traitement antibiotique, antifongique ou antiseptique en cours, les contraceptifs hormonaux, les traitements immunosuppresseurs, et tout traitement récent pour une infection similaire.
- Antécédents médicaux pertinents : Antécédents d'infections sexuellement transmissibles, d'infections urinaires récurrentes, de diabète, d'immunodépression, interventions gynécologiques ou urologiques récentes, allergies médicamenteuses connues.
- Examens récents disponibles : Résultats de prélèvements vaginaux, urétraux ou urinaires récents, échographies pelviennes, bilans sanguins récents (NFS, CRP), tests de dépistage des IST effectués.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion d'infection compliquée (salpingite, prostatite), échec d'un premier traitement antibiotique, symptômes persistants malgré un traitement adapté, nécessité de prélèvements microbiologiques pour diagnostic précis.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Douleurs pelviennes intenses avec fièvre élevée évoquant une salpingite aiguë, signes de sepsis avec altération de l'état général, rétention urinaire aiguë chez l'homme.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Fièvre élevée (>38,5°C) avec frissons et douleurs pelviennes intenses
- Douleurs abdominales sévères avec nausées et vomissements
- Écoulements purulents abondants avec altération de l'état général
- Impossibilité d'uriner ou douleurs urinaires extrêmes chez l'homme
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Gynécologue ou urologue — consultation en présentiel recommandée
Un spécialiste en gynécologie ou urologie peut réaliser l'examen clinique spécialisé et les prélèvements nécessaires au diagnostic précis. Une consultation en présentiel est généralement recommandée pour confirmer le diagnostic et adapter le traitement.

- Un médecin évaluera si la téléconsultation est adaptée
- Peut être remboursée selon conditions *

Infections de l'appareil reproducteur : Définition et Vue d'Ensemble
Les infections de l'appareil reproducteur regroupent toutes les pathologies infectieuses qui affectent les organes génitaux, tant chez l'homme que chez la femme. Ces troubles peuvent toucher différentes structures : vagin, col de l'utérus, trompes de Fallope, ovaires, prostate, épididyme ou testicules [2,7,8].
Mais qu'est-ce qui rend ces infections si particulières ? D'abord, leur diversité. Elles peuvent être causées par des bactéries, des virus, des champignons ou des parasites. Ensuite, leur impact potentiel sur la fertilité et la santé reproductive [6]. Concrètement, ces pathologies peuvent se manifester de façon aiguë ou chronique, avec des symptômes parfois discrets qui retardent le diagnostic.
Il faut savoir que certaines infections sont sexuellement transmissibles, tandis que d'autres résultent d'un déséquilibre de la flore naturelle. Cette distinction est cruciale pour comprendre les mécanismes de prévention et de traitement [2,8].
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques françaises révèlent une réalité préoccupante. Selon le Bulletin épidémiologique hebdomadaire de Santé Publique France, les infections de l'appareil reproducteur touchent environ 15% des femmes en âge de procréer chaque année [1]. Cette prévalence varie considérablement selon l'âge et la région.
Chez les femmes de 15 à 24 ans, l'incidence atteint 25%, soit une jeune femme sur quatre concernée annuellement [1]. Les infections à Chlamydia trachomatis représentent 40% des cas diagnostiqués, suivies par les infections à gonocoques (15%) et les candidoses récidivantes (20%) [1,2].
D'ailleurs, les disparités régionales sont marquées. Les régions PACA et Île-de-France enregistrent des taux supérieurs de 30% à la moyenne nationale, probablement liés à la densité urbaine et aux comportements à risque [1]. En comparaison européenne, la France se situe dans la moyenne, avec des taux similaires à l'Allemagne mais inférieurs au Royaume-Uni.
L'évolution sur les dix dernières années montre une augmentation de 15% des diagnostics, mais cette hausse s'explique en partie par l'amélioration du dépistage [1]. Les projections pour 2025-2030 suggèrent une stabilisation, voire une légère diminution grâce aux campagnes de prévention renforcées.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les agents pathogènes responsables de ces infections sont nombreux et variés. Les bactéries dominent le tableau clinique, avec Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, et diverses espèces de mycoplasmes [5,8]. Ces micro-organismes ont développé des stratégies d'adaptation remarquables pour coloniser les muqueuses génitales.
Mais les virus ne sont pas en reste. Le papillomavirus humain (HPV) représente l'infection virale la plus fréquente, touchant jusqu'à 80% des personnes sexuellement actives au cours de leur vie [3]. L'herpès génital, causé par les virus HSV-1 et HSV-2, concerne environ 12% de la population adulte française.
Les facteurs de risque sont multiples et souvent intriqués. L'âge jeune (15-25 ans) constitue le principal facteur, suivi par le nombre de partenaires sexuels et l'absence de protection [2,6]. D'autres éléments favorisants incluent l'immunodépression, le diabète, la prise d'antibiotiques à large spectre, et certaines pratiques d'hygiène inadaptées.
Il est important de noter que certaines infections peuvent survenir sans rapport sexuel. Les candidoses vaginales, par exemple, résultent souvent d'un déséquilibre de la flore vaginale normale [4,7]. Stress, fatigue, modifications hormonales peuvent déclencher ces épisodes infectieux.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes des infections de l'appareil reproducteur peuvent être trompeurs. Chez la femme, les pertes vaginales anormales constituent le signe le plus fréquent : modification de la couleur, de l'odeur ou de la consistance [2,7]. Ces pertes peuvent s'accompagner de démangeaisons, de brûlures ou de douleurs lors des rapports sexuels.
Les douleurs pelviennes représentent un autre symptôme d'alarme, particulièrement quand elles irradient vers le bas du dos ou les cuisses. Elles peuvent signaler une infection haute, touchant l'utérus, les trompes ou les ovaires [7]. Attention également aux saignements entre les règles ou après les rapports sexuels.
Chez l'homme, l'urétrite se manifeste par des brûlures mictionnelles, un écoulement urétral purulent ou des douleurs testiculaires [8]. Ces symptômes peuvent être discrets au début, d'où l'importance de consulter rapidement en cas de doute.
Mais attention : de nombreuses infections restent asymptomatiques, surtout chez l'homme. C'est pourquoi le dépistage régulier est essentiel, particulièrement en cas de changement de partenaire [2,8]. Certains signes généraux comme la fièvre, les frissons ou la fatigue peuvent accompagner les formes sévères.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des infections de l'appareil reproducteur repose sur une démarche méthodique. L'interrogatoire médical constitue la première étape cruciale : antécédents, symptômes, vie sexuelle, contraception [2]. Votre médecin vous posera des questions précises, parfois intimes, mais nécessaires pour orienter le diagnostic.
L'examen clinique comprend un examen gynécologique chez la femme ou génital chez l'homme. Le médecin recherche des signes d'inflammation, d'infection ou de lésions suspectes [7,8]. Cet examen peut être inconfortable mais reste indispensable pour une évaluation complète.
Les examens complémentaires varient selon la suspicion clinique. Les prélèvements microbiologiques (frottis vaginal, prélèvement urétral, ECBU) permettent d'identifier l'agent pathogène responsable [2,8]. Les techniques de biologie moléculaire, comme la PCR, offrent une sensibilité et une spécificité excellentes.
Dans certains cas, des examens d'imagerie peuvent être nécessaires. L'échographie pelvienne aide à détecter les complications (abcès, hydrosalpinx) [7]. La coelioscopie reste réservée aux formes complexes ou aux échecs thérapeutiques. Les résultats sont généralement disponibles sous 48 à 72 heures.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement des infections de l'appareil reproducteur a considérablement évolué ces dernières années. Les antibiotiques restent la pierre angulaire du traitement des infections bactériennes [2,8]. Le choix de la molécule dépend de l'agent pathogène identifié et de sa sensibilité aux antimicrobiens.
Pour les infections à Chlamydia, l'azithromycine en dose unique (1g) ou la doxycycline sur 7 jours constituent les traitements de référence [8]. Les infections gonococciques nécessitent souvent une bithérapie associant ceftriaxone et azithromycine, en raison des résistances croissantes.
Les antifongiques traitent efficacement les candidoses. Le fluconazole oral (150mg en dose unique) reste le traitement de première intention pour les épisodes simples [7]. Les formes récidivantes peuvent nécessiter un traitement d'entretien prolongé.
Concernant les infections virales, les antiviraux comme l'aciclovir ou le valaciclovir réduisent la durée et l'intensité des poussées d'herpès génital. Pour le HPV, aucun traitement antiviral spécifique n'existe, mais les lésions peuvent être traitées par cryothérapie, laser ou chirurgie [3].
L'important à retenir : le traitement du ou des partenaires est souvent indispensable pour éviter les réinfections [2,8]. Cette approche, appelée "traitement épidémiologique", améliore significativement les taux de guérison.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge des infections de l'appareil reproducteur. Les innovations thérapeutiques récentes ouvrent de nouvelles perspectives prometteuses [6]. Ces avancées concernent tant les dispositifs médicaux que les approches pharmacologiques innovantes.
Le dispositif OPTILUME représente une innovation majeure dans le traitement des complications infectieuses . Cette technologie révolutionnaire permet une approche moins invasive avec des résultats cliniques encourageants. Les premiers retours d'expérience montrent une réduction significative des récidives.
Les recherches actuelles explorent également de nouvelles voies thérapeutiques [6]. Les thérapies ciblées, basées sur une meilleure compréhension des mécanismes physiopathologiques, promettent des traitements plus efficaces et mieux tolérés. L'immunothérapie locale fait l'objet d'études cliniques prometteuses.
D'ailleurs, les dispositifs de traitement innovants développés en 2024-2025 intègrent des technologies de pointe . Ces solutions combinent efficacité thérapeutique et amélioration de la qualité de vie des patients. Les essais cliniques en cours suggèrent des taux de succès supérieurs aux traitements conventionnels.
La recherche fondamentale progresse également. Les études sur les biomarqueurs prédictifs permettront bientôt une médecine personnalisée [7]. Cette approche individualisée optimisera les choix thérapeutiques selon le profil de chaque patient.
Vivre au Quotidien avec les Infections de l'appareil reproducteur
Vivre avec des infections récurrentes de l'appareil reproducteur peut impacter significativement votre quotidien. L'aspect psychologique ne doit pas être négligé : anxiété, baisse de l'estime de soi, difficultés relationnelles sont fréquentes [6]. Il est normal de ressentir ces émotions, et il existe des solutions pour mieux les gérer.
L'impact sur la vie sexuelle constitue souvent la préoccupation principale. Les douleurs, les récidives fréquentes ou la peur de transmettre l'infection peuvent altérer l'intimité du couple. Une communication ouverte avec votre partenaire et un suivi médical adapté permettent de surmonter ces difficultés.
Au niveau professionnel, certaines infections peuvent occasionner des arrêts de travail répétés. Les douleurs pelviennes chroniques, par exemple, peuvent limiter certaines activités [7]. N'hésitez pas à discuter avec votre médecin des aménagements possibles.
Heureusement, des stratégies d'adaptation existent. L'hygiène intime adaptée, la gestion du stress, une alimentation équilibrée et un sommeil de qualité contribuent à réduire les récidives [4,7]. Certains patients trouvent également un soutien précieux dans les groupes de parole ou les associations de patients.
Les Complications Possibles
Les complications des infections de l'appareil reproducteur peuvent être graves si le traitement est retardé ou inadéquat. Chez la femme, la maladie inflammatoire pelvienne (MIP) représente la complication la plus redoutée [7]. Cette infection ascendante peut toucher l'utérus, les trompes et les ovaires, avec des conséquences potentiellement dramatiques.
L'infertilité constitue une complication majeure, particulièrement après une MIP. Les adhérences tubaires consécutives à l'inflammation peuvent obstruer les trompes de Fallope, compromettant définitivement la fertilité naturelle [6,7]. Le risque de grossesse extra-utérine est également multiplié par 6 à 10.
Chez l'homme, l'épididymite et l'orchite peuvent compliquer les infections génitales non traitées [8]. Ces inflammations douloureuses peuvent altérer la spermatogenèse et, dans les cas sévères, conduire à une stérilité. L'abcès scrotal reste heureusement exceptionnel.
D'autres complications systémiques peuvent survenir. L'arthrite réactionnelle (syndrome de Reiter) associe arthrite, urétrite et conjonctivite [8]. Cette complication auto-immune peut persister plusieurs mois malgré l'éradication de l'infection initiale.
Il faut également mentionner les complications obstétricales. Les infections non traitées pendant la grossesse peuvent provoquer des accouchements prématurés, des infections néonatales ou des conjonctivites du nouveau-né [2,6].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des infections de l'appareil reproducteur dépend largement de la précocité du diagnostic et de l'adéquation du traitement. Globalement, les infections simples guérissent complètement avec un traitement approprié [2,8]. Les taux de guérison dépassent 95% pour les infections bactériennes traitées précocement.
Cependant, certaines infections posent des défis particuliers. Les infections à mycoplasmes peuvent nécessiter des traitements prolongés et parfois plusieurs lignes thérapeutiques [5]. Les récidives sont fréquentes, touchant environ 20% des patients dans l'année suivant le premier épisode.
Pour les infections virales, le pronostic diffère selon l'agent pathogène. L'herpès génital évolue par poussées récurrentes, mais leur fréquence et leur intensité diminuent généralement avec le temps [2]. Le HPV peut régresser spontanément chez les sujets jeunes immunocompétents [3].
L'impact sur la fertilité reste une préoccupation majeure. Heureusement, les techniques de procréation médicalement assistée offrent des solutions aux couples confrontés à l'infertilité secondaire [6]. Les taux de succès sont encourageants, particulièrement avec la fécondation in vitro.
À long terme, un suivi médical régulier permet de prévenir les récidives et de détecter précocement d'éventuelles complications. La qualité de vie peut être préservée avec une prise en charge adaptée [7].
Peut-on Prévenir les Infections de l'appareil reproducteur ?
La prévention des infections de l'appareil reproducteur repose sur plusieurs piliers fondamentaux. L'utilisation du préservatif reste la mesure de protection la plus efficace contre les infections sexuellement transmissibles [2,6]. Cette barrière mécanique réduit de 80 à 95% le risque de transmission selon l'agent pathogène.
La vaccination constitue un outil préventif majeur pour certaines infections. Le vaccin contre le HPV, recommandé chez les jeunes filles et garçons dès 11 ans, prévient efficacement les infections par les souches les plus oncogènes [3]. La couverture vaccinale française reste insuffisante, autour de 60%, alors que l'objectif est de 80%.
L'hygiène intime joue un rôle crucial mais doit être adaptée. Les douches vaginales sont déconseillées car elles perturbent l'équilibre de la flore vaginale protectrice [7]. Un lavage externe quotidien avec un savon doux suffit. Évitez les produits parfumés ou antiseptiques agressifs.
Le dépistage régulier permet une détection précoce des infections asymptomatiques [2,8]. Les recommandations préconisent un dépistage annuel des IST chez les personnes sexuellement actives, particulièrement en cas de changement de partenaire.
D'autres mesures préventives incluent la limitation du nombre de partenaires sexuels, l'éviction des facteurs de risque (tabac, stress chronique) et le maintien d'un système immunitaire optimal par une alimentation équilibrée et une activité physique régulière [6].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont émis des recommandations précises concernant la prise en charge des infections de l'appareil reproducteur. La Haute Autorité de Santé (HAS) actualise régulièrement ses guidelines en fonction des données scientifiques les plus récentes . Ces recommandations s'appuient sur une analyse rigoureuse de la littérature médicale internationale.
Santé Publique France insiste particulièrement sur l'importance du dépistage précoce et du traitement des partenaires [1]. Les campagnes de sensibilisation ciblent prioritairement les populations à risque : jeunes de 15-25 ans, personnes avec partenaires multiples, et populations précaires.
Les recommandations 2024-2025 intègrent les nouvelles innovations thérapeutiques validées . L'évaluation des dispositifs médicaux innovants suit un processus rigoureux d'évaluation médico-économique. L'objectif est d'optimiser le rapport bénéfice-risque tout en maîtrisant les coûts de santé publique.
Concernant la prévention, les autorités recommandent une approche globale combinant éducation sexuelle, vaccination HPV, et amélioration de l'accès au dépistage [1]. Les centres de planification familiale et les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) constituent le maillage territorial de cette stratégie.
L'ANSM surveille étroitement l'évolution des résistances aux antimicrobiens et adapte les recommandations thérapeutiques en conséquence [8]. Cette vigilance est cruciale face à l'émergence de souches multirésistantes.
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses ressources sont disponibles pour vous accompagner dans votre parcours de soins. Les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) offrent des consultations anonymes et gratuites [1]. Ces structures spécialisées proposent dépistage, conseil et orientation thérapeutique.
Les associations de patients jouent un rôle essentiel dans l'information et le soutien. Elles organisent des groupes de parole, des conférences d'information et des campagnes de sensibilisation. Ces structures permettent de rompre l'isolement et de partager les expériences.
Les plateformes numériques se développent également. Applications mobiles de suivi des symptômes, forums de discussion modérés par des professionnels de santé, téléconsultations spécialisées enrichissent l'offre de soins . Ces outils facilitent l'accès à l'information médicale fiable.
Les centres de planification familiale proposent des consultations spécialisées en santé reproductive. Leurs équipes pluridisciplinaires (médecins, sages-femmes, psychologues) offrent une prise en charge globale adaptée à chaque situation.
N'oubliez pas que votre médecin traitant reste votre interlocuteur privilégié. Il coordonne votre parcours de soins et vous oriente vers les spécialistes si nécessaire. La relation de confiance avec votre médecin est fondamentale pour une prise en charge optimale.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux gérer les infections de l'appareil reproducteur au quotidien. Premièrement, tenez un carnet de symptômes détaillé : dates, intensité, facteurs déclenchants. Cette information précieuse aidera votre médecin à adapter le traitement et identifier les facteurs de récidive.
Concernant l'hygiène intime, adoptez des gestes simples mais efficaces. Utilisez un savon doux non parfumé, séchez soigneusement après la toilette, et changez régulièrement vos sous-vêtements [7]. Privilégiez les matières naturelles comme le coton qui laissent respirer la peau.
En cas de traitement antibiotique, respectez scrupuleusement la posologie et la durée prescrites, même si les symptômes disparaissent rapidement. L'arrêt prématuré favorise les résistances et les récidives [8]. Pensez également à prendre des probiotiques pour préserver votre flore intestinale.
Pour les couples, la communication est essentielle. Parlez ouvertement de vos symptômes, de vos craintes et de l'impact sur votre intimité. N'hésitez pas à consulter ensemble un professionnel de santé si nécessaire. Le soutien mutuel facilite grandement la guérison.
Enfin, maintenez un mode de vie sain : alimentation équilibrée, activité physique régulière, gestion du stress. Ces facteurs influencent positivement votre système immunitaire et réduisent le risque de récidive [6].
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous alerter et motiver une consultation médicale rapide. Les douleurs pelviennes intenses, particulièrement si elles s'accompagnent de fièvre, peuvent signaler une infection haute nécessitant un traitement urgent [7]. N'attendez pas que la douleur devienne insupportable.
Chez la femme, consultez sans délai en cas de pertes vaginales malodorantes, de saignements entre les règles ou après les rapports sexuels [2,7]. Ces symptômes peuvent révéler une infection sévère ou des complications. De même, toute douleur lors des rapports sexuels mérite une évaluation médicale.
Chez l'homme, un écoulement urétral purulent, des brûlures mictionnelles persistantes ou des douleurs testiculaires imposent une consultation rapide [8]. Ces signes peuvent évoluer vers des complications graves si le traitement est retardé.
Plus généralement, consultez si vos symptômes persistent malgré un traitement bien conduit, s'ils récidivent fréquemment (plus de 3 épisodes par an), ou s'ils s'aggravent progressivement [2,8]. Votre médecin pourra alors réajuster le traitement ou rechercher une cause sous-jacente.
En cas d'urgence (fièvre élevée, douleurs intenses, état général altéré), n'hésitez pas à vous rendre aux urgences ou à contacter le 15. Certaines complications nécessitent une prise en charge hospitalière immédiate.
Questions Fréquentes
Les infections de l'appareil reproducteur sont-elles toujours sexuellement transmissibles ?
Non, toutes les infections ne sont pas sexuellement transmissibles. Les candidoses vaginales, par exemple, résultent souvent d'un déséquilibre de la flore naturelle. Cependant, les principales infections bactériennes (Chlamydia, gonocoque) se transmettent effectivement par voie sexuelle.
Peut-on avoir des rapports sexuels pendant le traitement ?
Il est généralement recommandé d'éviter les rapports sexuels pendant le traitement et jusqu'à la guérison complète. Cette précaution évite la réinfection et permet une cicatrisation optimale des muqueuses irritées.
Les infections peuvent-elles affecter la fertilité ?
Oui, certaines infections non traitées peuvent compromettre la fertilité, particulièrement chez la femme. Les infections hautes peuvent provoquer des adhérences tubaires. C'est pourquoi un traitement précoce est essentiel.
Faut-il traiter le partenaire même s'il n'a pas de symptômes ?
Absolument. Le traitement du partenaire est indispensable pour éviter les réinfections. De nombreuses infections restent asymptomatiques, particulièrement chez l'homme, mais la transmission reste possible.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] BEH – Bulletin épidémiologique hebdomadaire. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [2] OPTILUME. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [3] Symptômes, diagnostic et évolution des IST. www.ameli.fr.Lien
- [4] Dispositifs de traitement de l'incontinence urinaire et du .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] THÈSE. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [10] Genital infection by Human Papillomavirus (HPV) in women from Santa Catarina/Brazil. 2022.Lien
- [13] Prévalence des infections urogénitales d'origine fongiques dans la région de tiaret. 2022.Lien
- [14] Étude des mycoplasmes impliqués dans les infections uro-génitales. 2023.Lien
- [15] Contrôle des infections sexuellement transmissibles au niveau des muqueuses du tractus reproducteur féminin. 2022.Lien
- [16] Présentation de la vaginite (infection ou inflammation .... www.msdmanuals.com.Lien
- [17] Infections à Chlamydia et autres infections non .... www.msdmanuals.com.Lien
Publications scientifiques
- L'infection des ruminants par Coxiella burnetti: Quid de l'impact clinique? (2022)
- les urgences chirurgicales de l'appareil reproducteur chez femelles non parturientes: Etude rétrospective chez les carnivores domestiques (2023)[PDF]
- [HTML][HTML] Genital infection by Human Papillomavirus (HPV) in women from Santa Catarina/Brazil (2022)2 citations
- Dog sertoli cells primary cultures: validation of preparative method to study possible canine herpesvirus (CHV-1) infection (2022)
- [PDF][PDF] Les pathologies de l'appareil génital de la vache au niveau de l'abattoir d'El Harrach-Alger [PDF]
Ressources web
- Présentation de la vaginite (infection ou inflammation ... (msdmanuals.com)
Les infections vaginales (comme la vaginose bactérienne, la vaginite à Trichomonas et les infections à levures) sont traitées par des antibiotiques ou des ...
- Symptômes, diagnostic et évolution des IST (ameli.fr)
Symptômes d'alerte d'une infection sexuellement transmissible · un écoulement par le pénis ; · des pertes vaginales (vaginite) d'une couleur ou d'une odeur ...
- Infections à Chlamydia et autres infections non ... (msdmanuals.com)
Les symptômes incluent un écoulement au niveau du pénis ou du vagin et des mictions douloureuses ou plus fréquentes. Si cette infection passe inaperçue ou n'est ...
- Traitement de l'infection de l'appareil génito-urinaire - Exphar (exphar.com)
2. Symptômes · Douleurs au niveau ventre · Pertes vaginales inhabituelles et malodorantes · Brûlures en urinant · Relations sexuelles douloureuses · Pertes de sang ...
- Tout ce qu'il faut savoir sur les quatre principales infections ... (who.int)
6 juin 2019 — La miction douloureuse est l'un des symptômes, mais la maladie est le plus souvent asymptomatique. La chlamydiose peut toucher l'appareil ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
