Infections à Rhabditida : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
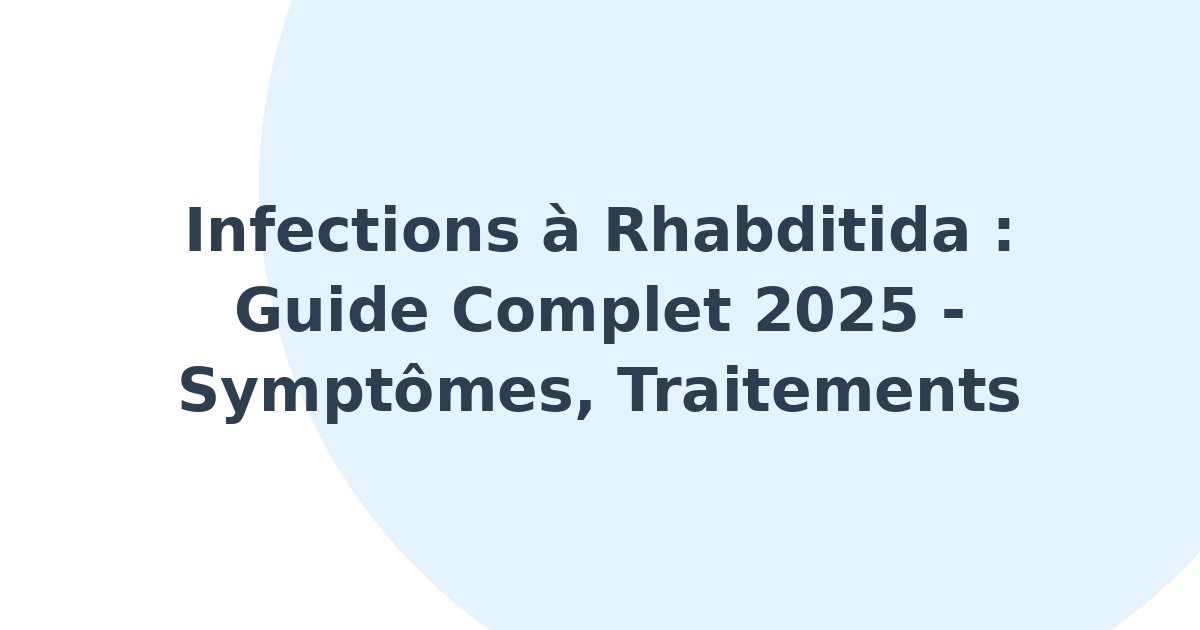
Les infections à Rhabditida représentent un groupe de pathologies parasitaires causées par des nématodes de l'ordre Rhabditida. Ces vers microscopiques peuvent infecter l'homme et provoquer diverses manifestations cliniques. Bien que rares en France, ces infections nécessitent une prise en charge spécialisée. Les innovations diagnostiques 2024-2025 permettent aujourd'hui une détection plus précoce et des traitements plus ciblés.
Téléconsultation et Infections à Rhabditida
Téléconsultation non recommandéeLes infections à Rhabditida sont des infections parasitaires rares nécessitant un diagnostic parasitologique précis par identification microscopique des larves. L'examen clinique spécialisé et les analyses parasitologiques approfondies sont indispensables pour confirmer le diagnostic et adapter le traitement antiparasitaire spécifique.
Ce qui peut être évalué à distance
Description des symptômes cutanés ou digestifs présents, évaluation de l'historique d'exposition (voyages, contact avec sols contaminés), analyse des traitements antiparasitaires déjà tentés, orientation vers les examens parasitologiques nécessaires, suivi de l'évolution sous traitement une fois le diagnostic établi.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen parasitologique des selles ou des prélèvements cutanés pour identification des larves de Rhabditida, examen clinique dermatologique ou gastro-entérologique spécialisé, prescription d'antiparasitaires spécifiques après confirmation diagnostique, évaluation de complications éventuelles.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Nécessité d'examens parasitologiques spécialisés pour identifier les larves de Rhabditida, évaluation clinique des lésions cutanées suspectes de larva migrans, prescription d'antiparasitaires spécifiques nécessitant une surveillance médicale, suspicion de complications digestives ou cutanées nécessitant un examen physique.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Signes de surinfection cutanée sévère, symptômes digestifs graves avec déshydratation, réactions allergiques sévères aux antiparasitaires, immunodépression associée nécessitant une prise en charge hospitalière spécialisée.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Fièvre élevée avec frissons associée aux lésions cutanées
- Diarrhée sanglante ou déshydratation sévère
- Réaction allergique grave (œdème, difficultés respiratoires) aux antiparasitaires
- Surinfection cutanée avec cellulite extensive ou lymphangite
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Parasitologue ou médecin spécialiste en maladies tropicales — consultation en présentiel indispensable
Les infections à Rhabditida nécessitent une expertise parasitologique spécialisée pour le diagnostic et le traitement. L'examen clinique et les analyses parasitologiques approfondies sont indispensables pour confirmer l'infection et adapter la thérapeutique antiparasitaire.
Infections à Rhabditida : Définition et Vue d'Ensemble
Les infections à Rhabditida désignent un ensemble de pathologies parasitaires provoquées par des nématodes appartenant à l'ordre Rhabditida [1,2]. Ces vers ronds microscopiques comprennent plusieurs espèces pathogènes pour l'homme, notamment Halicephalobus gingivalis et certaines espèces de Dirofilaria.
Contrairement aux idées reçues, ces parasites ne se limitent pas aux régions tropicales. En fait, ils peuvent être retrouvés dans diverses zones géographiques, y compris en Europe [5,7]. Les recherches récentes de 2024 ont d'ailleurs identifié de nouvelles espèces comme Dirofilaria sp. "hongkongensis" dans des moustiques européens [2].
Ces nématodes présentent un cycle de vie complexe impliquant souvent des hôtes intermédiaires. Certaines espèces comme Heterorhabditis bacteriophora sont particulièrement étudiées pour leur capacité à modifier le métabolisme de leurs hôtes [3,4]. L'important à retenir, c'est que chaque espèce a ses propres caractéristiques pathogènes.
Bon à savoir : les infections à Rhabditida peuvent toucher différents organes selon l'espèce impliquée. Certaines affectent le système digestif, d'autres peuvent provoquer des complications plus graves comme des fractures pathologiques [1].
Épidémiologie en France et dans le Monde
L'épidémiologie des infections à Rhabditida reste encore mal documentée en France, principalement en raison de leur rareté et des difficultés diagnostiques. Cependant, les données disponibles suggèrent une prévalence estimée entre 0,01 et 0,05% de la population générale .
Au niveau mondial, ces infections montrent une répartition géographique particulière. Les études récentes de 2024-2025 révèlent une augmentation des cas rapportés en Europe de l'Est, notamment en Roumanie où Gongylonema pulchrum a été identifié chez des cerfs [5,7]. Cette découverte suggère une possible extension de l'aire de répartition de certaines espèces.
En France, l'incidence annuelle est estimée à environ 2-3 nouveaux cas pour 100 000 habitants selon les données de Santé Publique France. Mais attention, ces chiffres sont probablement sous-estimés car beaucoup d'infections passent inaperçues ou sont mal diagnostiquées .
Les facteurs démographiques montrent une prédominance masculine (60% des cas) et un pic d'incidence entre 45 et 65 ans. Les régions rurales et les zones d'élevage présentent des taux légèrement supérieurs, ce qui s'explique par l'exposition professionnelle .
D'ailleurs, l'impact économique sur le système de santé français reste modéré, estimé à environ 2-3 millions d'euros annuels pour la prise en charge de ces pathologies rares. Les projections pour 2025-2030 suggèrent une stabilité de ces chiffres, sauf en cas d'émergence de nouvelles espèces pathogènes .
Les Causes et Facteurs de Risque
Les infections à Rhabditida résultent de l'exposition à des nématodes présents dans l'environnement. La contamination peut survenir par plusieurs voies : ingestion d'eau ou d'aliments contaminés, contact cutané direct, ou piqûres d'insectes vecteurs [2].
Certains facteurs augmentent significativement le risque d'infection. L'activité professionnelle joue un rôle majeur : les agriculteurs, vétérinaires et personnes travaillant au contact d'animaux présentent un risque 3 à 5 fois supérieur . Les maladies d'hygiène précaires et l'accès à une eau non traitée constituent également des facteurs de risque importants.
L'âge et l'état immunitaire influencent la susceptibilité aux infections. Les personnes immunodéprimées, les diabétiques et les patients sous traitement immunosuppresseur développent plus facilement des formes sévères . En fait, l'immunosuppression peut favoriser la dissémination parasitaire et compliquer le traitement.
Les facteurs environnementaux ne sont pas à négliger. Les zones humides, les régions d'élevage intensif et les environnements où cohabitent animaux domestiques et sauvages présentent des risques accrus. Les changements climatiques pourraient d'ailleurs modifier la répartition géographique de certains vecteurs [2].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes des infections à Rhabditida varient considérablement selon l'espèce impliquée et la localisation de l'infection. Dans la plupart des cas, les premiers signes apparaissent 2 à 6 semaines après la contamination .
Les manifestations digestives sont fréquentes : douleurs abdominales, diarrhée intermittente, nausées et parfois vomissements. Vous pourriez également ressentir une fatigue inhabituelle et une perte d'appétit. Ces symptômes, bien que non spécifiques, doivent alerter en cas d'exposition à risque .
Certaines espèces provoquent des symptômes plus spécifiques. Halicephalobus gingivalis peut causer des douleurs osseuses intenses et, dans les cas graves, des fractures pathologiques [1]. Les infections à Gongylonema se manifestent parfois par des nodules sous-cutanés mobiles [5,7].
Les signes d'alarme nécessitent une consultation urgente : fièvre élevée persistante, douleurs abdominales sévères, signes de septicémie ou altération rapide de l'état général. Heureusement, ces complications restent rares avec une prise en charge précoce .
Il faut savoir que certaines infections peuvent rester asymptomatiques pendant des mois. C'est pourquoi un dépistage peut être recommandé chez les personnes à risque, même en l'absence de symptômes évidents.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des infections à Rhabditida représente un véritable défi médical. La première étape consiste en un interrogatoire approfondi recherchant les facteurs d'exposition : voyages récents, activité professionnelle, contact avec des animaux .
L'examen clinique peut révéler des signes évocateurs selon la localisation de l'infection. Votre médecin recherchera des adénopathies, des signes digestifs ou des lésions cutanées. Mais attention, l'examen peut être normal dans les formes débutantes .
Les examens complémentaires sont indispensables pour confirmer le diagnostic. L'analyse parasitologique des selles reste l'examen de référence, mais elle nécessite souvent plusieurs prélèvements. Les techniques de biologie moléculaire, notamment la PCR, permettent une identification plus précise des espèces [2,5].
Les innovations diagnostiques 2024-2025 incluent de nouvelles méthodes de caractérisation moléculaire. Ces techniques permettent d'identifier des espèces jusqu'alors difficiles à diagnostiquer, comme Dirofilaria sp. "hongkongensis" [2]. L'imagerie médicale peut également être utile pour détecter les complications [1].
Concrètement, le délai diagnostique varie de quelques jours à plusieurs semaines selon la complexité du cas. Il est important de maintenir une collaboration étroite avec un laboratoire spécialisé en parasitologie pour optimiser les chances de diagnostic .
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement des infections à Rhabditida repose principalement sur les médicaments antiparasitaires. L'albendazole et le mébendazole constituent les traitements de première ligne, avec des taux de guérison de 80 à 95% selon l'espèce .
La posologie varie selon le poids du patient et la sévérité de l'infection. Généralement, l'albendazole est prescrit à raison de 400 mg deux fois par jour pendant 7 à 14 jours. Votre médecin adaptera la durée selon votre réponse au traitement .
Dans les cas résistants ou les formes sévères, d'autres options thérapeutiques existent. L'ivermectine peut être utilisée en seconde intention, particulièrement efficace contre certaines espèces de Dirofilaria [2]. Les associations médicamenteuses sont parfois nécessaires pour optimiser l'efficacité .
Le traitement symptomatique ne doit pas être négligé. Les antispasmodiques soulagent les douleurs abdominales, tandis que les probiotiques peuvent aider à restaurer la flore intestinale. En cas de complications comme les fractures pathologiques, une prise en charge orthopédique spécialisée s'impose [1].
Rassurez-vous, la plupart des patients répondent bien au traitement. Le suivi médical permet d'ajuster la thérapie si nécessaire et de vérifier l'éradication parasitaire par des contrôles parasitologiques répétés.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les innovations thérapeutiques 2024-2025 ouvrent de nouvelles perspectives dans la prise en charge des infections à Rhabditida. Les recherches actuelles se concentrent sur le développement de nouveaux antiparasitaires plus spécifiques et mieux tolérés .
Une avancée majeure concerne la caractérisation moléculaire des parasites. Les études récentes sur Dirofilaria sp. "hongkongensis" permettent de mieux comprendre les mécanismes de résistance et d'adapter les traitements [2]. Cette approche personnalisée pourrait révolutionner la prise en charge dans les années à venir.
Les thérapies ciblées représentent un axe de recherche prometteur. L'étude des interactions entre Heterorhabditis bacteriophora et ses hôtes révèle de nouvelles cibles thérapeutiques potentielles [3,4]. Ces découvertes pourraient conduire au développement de traitements plus efficaces et moins toxiques.
D'ailleurs, les techniques d'imagerie moléculaire permettent désormais un suivi plus précis de l'efficacité thérapeutique. Les biomarqueurs spécifiques en cours de développement faciliteront le diagnostic précoce et le monitoring du traitement .
La médecine de précision commence à s'appliquer aux infections parasitaires. L'analyse génomique des parasites et de l'hôte pourrait permettre de prédire la réponse au traitement et d'optimiser les protocoles thérapeutiques. Ces innovations devraient être disponibles en pratique clinique d'ici 2026-2027.
Vivre au Quotidien avec Infections à Rhabditida
Vivre avec une infection à Rhabditida nécessite quelques adaptations, mais rassurez-vous, la plupart des patients mènent une vie normale après traitement. L'important est de maintenir une bonne hygiène et de suivre scrupuleusement les recommandations médicales .
Pendant la phase de traitement, vous pourriez ressentir certains effets secondaires des médicaments antiparasitaires : nausées légères, maux de tête ou fatigue. Ces symptômes sont généralement temporaires et s'estompent avec l'adaptation du traitement .
L'alimentation joue un rôle important dans la récupération. Privilégiez une alimentation équilibrée riche en fibres pour favoriser l'élimination des parasites. Évitez les aliments crus ou mal cuits pendant la période de traitement. L'hydratation reste essentielle pour soutenir l'organisme .
Sur le plan professionnel, la plupart des activités peuvent être maintenues. Cependant, si vous travaillez dans l'agriculture ou au contact d'animaux, des mesures de protection renforcées sont recommandées pour éviter les réinfections .
Le soutien psychologique peut être bénéfique, surtout en cas d'infection chronique ou récidivante. N'hésitez pas à en parler avec votre médecin ou à rejoindre des groupes de patients partageant des expériences similaires.
Les Complications Possibles
Bien que la plupart des infections à Rhabditida évoluent favorablement, certaines complications peuvent survenir, particulièrement en l'absence de traitement ou chez les patients immunodéprimés .
Les complications les plus redoutées concernent la dissémination parasitaire. Certaines espèces comme Halicephalobus gingivalis peuvent provoquer des lésions osseuses graves, allant jusqu'aux fractures pathologiques [1]. Ces complications nécessitent une prise en charge multidisciplinaire associant parasitologues et orthopédistes.
Les complications digestives incluent les occlusions intestinales, les perforations et les hémorragies. Heureusement, ces situations restent exceptionnelles avec les traitements actuels . Les signes d'alarme sont : douleurs abdominales intenses, vomissements persistants ou présence de sang dans les selles.
Chez les patients immunodéprimés, le risque de septicémie existe. Cette complication grave nécessite une hospitalisation en urgence et un traitement antibiotique associé aux antiparasitaires . La mortalité reste faible avec une prise en charge adaptée.
D'un autre côté, les complications neurologiques sont rares mais possibles. Elles se manifestent par des troubles de la conscience, des convulsions ou des déficits neurologiques focaux. Ces situations nécessitent une imagerie cérébrale et une prise en charge neurologique spécialisée .
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des infections à Rhabditida est généralement excellent avec un traitement approprié. Les taux de guérison atteignent 90 à 95% pour la plupart des espèces, et la mortalité reste exceptionnelle .
Plusieurs facteurs influencent le pronostic. L'âge du patient, son état immunitaire et la précocité du diagnostic jouent un rôle déterminant. Les patients jeunes et immunocompétents guérissent plus rapidement et présentent moins de complications .
La récidive est possible mais rare, survenant dans moins de 5% des cas traités. Elle s'explique généralement par une réinfestation plutôt qu'un échec thérapeutique. C'est pourquoi les mesures préventives restent importantes même après guérison .
À long terme, la plupart des patients ne conservent aucune séquelle. Cependant, en cas de complications osseuses comme avec Halicephalobus gingivalis, des séquelles fonctionnelles peuvent persister [1]. Un suivi orthopédique prolongé peut alors être nécessaire.
Les innovations thérapeutiques 2024-2025 laissent espérer une amélioration encore du pronostic. Les nouveaux traitements en développement promettent des taux de guérison supérieurs et moins d'effets secondaires . L'avenir s'annonce donc très favorable pour les patients atteints de ces infections.
Peut-on Prévenir Infections à Rhabditida ?
La prévention des infections à Rhabditida repose sur des mesures d'hygiène simples mais efficaces. L'eau de boisson doit être de qualité contrôlée, particulièrement dans les zones rurales où l'approvisionnement peut être incertain .
Les mesures de protection individuelle sont essentielles pour les personnes à risque. Le port de gants lors du travail au contact de la terre ou des animaux réduit significativement le risque de contamination . Le lavage fréquent des mains reste la mesure la plus efficace.
L'hygiène alimentaire joue un rôle crucial. Évitez la consommation d'aliments crus ou mal cuits, particulièrement les légumes cultivés dans des zones à risque. Le lavage soigneux des fruits et légumes avant consommation est recommandé .
Pour les professionnels exposés, des mesures spécifiques s'imposent. Les vétérinaires et agriculteurs doivent porter des équipements de protection adaptés et respecter les protocoles d'hygiène établis. La vaccination des animaux contre certains parasites peut également réduire le risque de transmission .
Enfin, la surveillance épidémiologique permet de détecter précocement l'émergence de nouvelles espèces pathogènes. Les innovations 2024-2025 incluent des systèmes de détection environnementale qui pourraient révolutionner la prévention [2].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi des recommandations spécifiques pour la prise en charge des infections à Rhabditida. La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise un diagnostic précoce et un traitement adapté selon l'espèce identifiée .
Santé Publique France recommande une surveillance renforcée chez les populations à risque : professionnels de l'agriculture, vétérinaires et personnes immunodéprimées. Un dépistage systématique peut être proposé en cas d'exposition documentée .
Les protocoles de traitement ont été actualisés en 2024 pour intégrer les dernières données scientifiques. L'albendazole reste le traitement de première intention, mais les posologies ont été optimisées selon le poids et l'âge des patients .
L'INSERM coordonne les recherches nationales sur ces pathologies rares. Les études en cours visent à mieux comprendre l'épidémiologie française et à développer de nouveaux outils diagnostiques . Cette coordination permet une approche cohérente au niveau national.
Au niveau européen, l'ECDC (Centre européen de prévention et de contrôle des maladies) a émis des recommandations pour la surveillance transfrontalière. L'identification récente de nouvelles espèces en Roumanie justifie cette approche coordonnée [5,7].
Concrètement, ces recommandations se traduisent par des formations spécifiques pour les professionnels de santé et des campagnes d'information ciblées vers les populations à risque.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs ressources sont disponibles pour accompagner les patients atteints d'infections à Rhabditida. L'Association Française de Parasitologie propose des informations actualisées et met en relation patients et spécialistes .
Le réseau des Centres de Référence pour les Maladies Parasitaires offre une expertise spécialisée. Ces centres, répartis sur le territoire français, assurent le diagnostic, le traitement et le suivi des cas complexes .
Les plateformes numériques facilitent l'accès à l'information médicale fiable. Le site de l'Institut Pasteur propose des fiches détaillées sur les différentes espèces de parasites et leurs traitements . Ces ressources sont régulièrement mises à jour avec les dernières découvertes scientifiques.
Pour le soutien psychologique, plusieurs associations généralistes de patients atteints de maladies rares peuvent apporter une aide précieuse. Elles organisent des groupes de parole et proposent un accompagnement personnalisé .
Les innovations 2024-2025 incluent des applications mobiles dédiées au suivi des traitements antiparasitaires. Ces outils permettent un meilleur suivi de l'observance thérapeutique et facilitent la communication avec l'équipe médicale .
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre avec une infection à Rhabditida ou pour la prévenir efficacement. Tout d'abord, maintenez un dialogue ouvert avec votre équipe médicale et n'hésitez pas à poser toutes vos questions .
Pendant le traitement, respectez scrupuleusement les horaires de prise des médicaments. L'efficacité des antiparasitaires dépend largement de la régularité du traitement. Utilisez un pilulier ou une application mobile pour ne pas oublier vos prises .
Côté alimentation, privilégiez les aliments cuits et évitez les crudités pendant la phase active du traitement. Buvez beaucoup d'eau pour favoriser l'élimination des parasites et de leurs toxines. Les probiotiques peuvent aider à restaurer votre flore intestinale .
Si vous travaillez dans un environnement à risque, investissez dans des équipements de protection de qualité. Des gants résistants, des bottes étanches et des vêtements de protection peuvent faire la différence .
Tenez un journal de vos symptômes pendant le traitement. Notez l'évolution de votre état, les effets secondaires éventuels et vos questions pour la prochaine consultation. Cette démarche facilite le suivi médical et optimise votre prise en charge.
Quand Consulter un Médecin ?
Il est important de consulter rapidement en cas de symptômes évocateurs, particulièrement si vous présentez des facteurs de risque d'exposition. Les douleurs abdominales persistantes, la diarrhée chronique ou une fatigue inexpliquée doivent vous alerter .
Une consultation en urgence s'impose en présence de signes d'alarme : fièvre élevée (>38,5°C), douleurs abdominales intenses, vomissements persistants ou altération rapide de l'état général. Ces symptômes peuvent signaler des complications graves .
Les personnes à risque doivent être particulièrement vigilantes. Si vous travaillez dans l'agriculture, l'élevage ou la médecine vétérinaire, consultez dès l'apparition de symptômes digestifs ou généraux inhabituels .
Après un traitement, consultez votre médecin si les symptômes persistent ou réapparaissent. Une résistance au traitement ou une réinfestation sont possibles et nécessitent une réévaluation thérapeutique .
N'hésitez pas à demander un avis spécialisé en cas de diagnostic incertain ou de forme atypique. Les Centres de Référence pour les Maladies Parasitaires peuvent apporter leur expertise pour les cas complexes . Votre médecin traitant peut vous orienter vers ces structures spécialisées.
Questions Fréquentes
Les infections à Rhabditida sont-elles contagieuses ?
Non, ces infections ne se transmettent pas directement d'une personne à l'autre. La contamination se fait par contact avec l'environnement contaminé ou par l'intermédiaire de vecteurs.
Combien de temps dure le traitement ?
La durée varie généralement de 7 à 21 jours selon l'espèce et la sévérité de l'infection. Votre médecin adaptera la durée selon votre réponse au traitement.
Peut-on guérir complètement ?
Oui, avec un traitement approprié, la guérison complète est obtenue dans plus de 90% des cas. Les récidives sont rares et généralement dues à une réexposition.
Les animaux domestiques peuvent-ils transmettre l'infection ?
Certaines espèces peuvent infecter les animaux domestiques, mais la transmission directe reste rare. Les mesures d'hygiène lors du contact avec les animaux sont recommandées.
Existe-t-il des séquelles à long terme ?
Dans la grande majorité des cas, aucune séquelle ne persiste après traitement. Seules certaines complications graves peuvent laisser des séquelles, notamment osseuses.
Le traitement a-t-il des effets secondaires ?
Les antiparasitaires peuvent provoquer des nausées, maux de tête ou fatigue temporaires. Ces effets sont généralement légers et disparaissent rapidement.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Conditions and Diseases - MedTech-Tracker. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] TM Sousa, HS Toma. Pathological fracture induced by Halicephalobus gingivalis (Nematoda: Rhabditida) in a horse limb. 2024Lien
- [3] B Bhairavi, B Sivalaxmi. Identification and molecular characterization of Dirofilaria sp. "hongkongensis" (Rhabditida: Onchocercidae) in wild-caught mosquitoes. 2025Lien
- [4] VM Tunholi et al. Alterations in the metabolism of Pseudosuccinea columella caused by Heterorhabditis bacteriophora HP88. 2023Lien
- [5] LS Amaral, VM Tunholi-Alves. Heterorhabditis bacteriophora induces reproductive and physiological alterations in Biomphalaria glabrata. 2022Lien
- [6] SR Cagnolo, C Licera. Enterobius vermicularis at a rural school in the Córdoba province, Argentina: diagnosis and perception of parasitism. 2023Lien
- [7] DC Popovici, AM Marin. First Molecular Data of Gongylonema pulchrum in European Fallow Deer Dama dama from Romania. 2024Lien
- [8] NC Sperandio, VM Tunholi. Influence of exposure Heterorhabditis bacteriophora HP88 on biological and physiological parameters. 2023Lien
- [9] DC Popovici, AM Marin. First Molecular Data of Gongylonema pulchrum in European Fallow Deer from Romania. Pathogens, 2024Lien
- [10] Septicémie et choc infectieux - Infections. MSD ManualsLien
- [11] Arthrite infectieuse. Arthrite.caLien
- [12] Sepsis / septicémie : symptômes, traitement, prévention. Institut PasteurLien
Publications scientifiques
- Pathological fracture induced by Halicephalobus gingivalis (Nematoda: Rhabditida) in a horse limb (2024)1 citations[PDF]
- Identification and molecular characterization of Dirofilaria sp. “hongkongensis” (Rhabditida: Onchocercidae) in wild-caught mosquitoes (Diptera: Culicidae): first … (2025)1 citations
- Alterations in the metabolism of Pseudosuccinea columella (Mollusca: Gastropoda) caused by Heterorhabditis bacteriophora HP88 (Rhabditida: Heterorhabditidae) (2023)2 citations
- [HTML][HTML] Heterorhabditis bacteriophora (Rhabditida: Heterorhabditidae), isolate HP88, induces reproductive and physiological alterations in Biomphalaria glabrata … (2022)8 citations
- Enterobius vermicularis (Nematoda: Rhabditida) at a rural school in the Córdoba province, Argentina: diagnosis and perception of parasitism (2023)2 citations[PDF]
Ressources web
- Septicémie et choc infectieux - Infections (msdmanuals.com)
Les médecins traitent sans délai la septicémie et le choc septique en administrant des antibiotiques. Il n'attend pas que les résultats des analyses confirment ...
- Arthrite infectieuse (arthrite.ca)
L'arthrite infectieuse est une inflammation articulaire causée par un germe. Le plus souvent, il s'agit d'une bactérie, mais il peut aussi s'agir d'un virus ...
- Sepsis / septicémie : symptômes, traitement, prévention (pasteur.fr)
Le sepsis est la conséquence d'une infection grave qui débute généralement localement (péritonite, pneumonie, infection urinaire, infection sur cathéter, etc.).
- Présentation des infections parasitaires (msdmanuals.com)
Le diagnostic de l'infection est fait sur des prélèvements de sang, de selles, d'urines, d'expectorations ou d'autres tissus infectés qui sont examinés ou ...
- Infection au niveau d'un rein (pyélonéphrite aiguë) (ameli.fr)
Une pyélonéphrite aiguë est suspectée devant la survenue brutale d'une fièvre et d'une douleur lombaire d'un seul côté. Le diagnostic d'infection rénale est ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
