Infections à Neisseriaceae : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
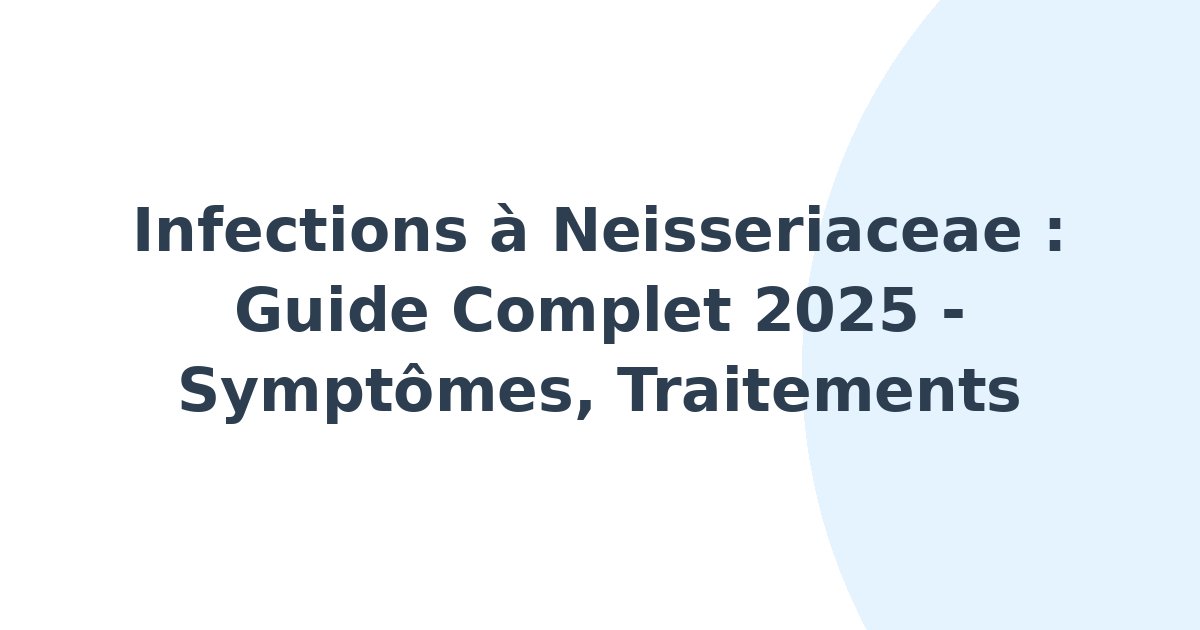
Les infections à Neisseriaceae regroupent plusieurs pathologies causées par des bactéries du genre Neisseria. Ces micro-organismes sont responsables d'infections parfois graves comme la méningite à méningocoque ou la gonorrhée. En France, ces pathologies touchent des milliers de personnes chaque année et nécessitent une prise en charge rapide et adaptée.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Infections à Neisseriaceae : Définition et Vue d'Ensemble
Les infections à Neisseriaceae sont causées par des bactéries appartenant à la famille des Neisseriaceae. Cette famille comprend principalement deux espèces pathogènes majeures : Neisseria meningitidis (méningocoque) et Neisseria gonorrhoeae (gonocoque) [1,2].
Le méningocoque provoque des infections invasives potentiellement mortelles, notamment la méningite et la septicémie. D'ailleurs, cette bactérie peut coloniser le nasopharynx de façon asymptomatique chez 10 à 20% de la population générale [2]. Mais dans certains cas, elle franchit les barrières naturelles et provoque des infections graves.
Le gonocoque, quant à lui, est responsable de la gonorrhée, une infection sexuellement transmissible en forte augmentation. Selon les dernières données de Santé Publique France, le nombre de cas de gonorrhée a augmenté de 91% entre 2016 et 2022 [3,4]. Cette progression inquiétante s'accompagne d'une résistance croissante aux antibiotiques.
Il existe également d'autres espèces de Neisseria, généralement considérées comme commensales, mais qui peuvent parfois causer des infections opportunistes chez les personnes immunodéprimées [13]. Ces infections émergentes font l'objet d'une surveillance accrue depuis 2024.
Épidémiologie en France et dans le Monde
L'épidémiologie des infections à Neisseriaceae en France révèle des tendances préoccupantes. Pour les infections invasives à méningocoque, Santé Publique France rapporte environ 400 à 500 cas annuels, avec une incidence de 0,7 cas pour 100 000 habitants [2]. Cette incidence reste stable depuis plusieurs années, mais la répartition des sérogroupes évolue.
Concernant la gonorrhée, les chiffres sont plus alarmants. L'étude PrévIST 2022-2023 montre une incidence de 127 cas pour 100 000 habitants chez les hommes et 45 cas pour 100 000 habitants chez les femmes [3]. Cette différence s'explique en partie par un dépistage plus fréquent chez les hommes symptomatiques.
Les données régionales révèlent des disparités importantes. L'Île-de-France concentre 30% des cas de gonorrhée, suivie par les régions PACA et Auvergne-Rhône-Alpes [4]. Cette concentration urbaine s'explique par des facteurs sociodémographiques et comportementaux spécifiques.
Au niveau international, l'Organisation mondiale de la santé estime à 82 millions le nombre de nouveaux cas de gonorrhée chaque année dans le monde [6]. En Europe, la France se situe dans la moyenne haute avec une tendance à la hausse similaire à celle observée au Royaume-Uni et en Allemagne.
Les projections pour 2025-2030 suggèrent une poursuite de cette augmentation, particulièrement chez les 15-24 ans [1,4]. Cette évolution nécessite un renforcement des stratégies de prévention et de dépistage.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les infections à Neisseriaceae résultent de l'exposition à des bactéries pathogènes dans des circonstances favorisant leur transmission. Pour le méningocoque, la transmission se fait principalement par voie respiratoire, via les gouttelettes de salive lors de contacts rapprochés [2].
Plusieurs facteurs augmentent le risque d'infection invasive à méningocoque. L'âge constitue un facteur majeur : les nourrissons de moins de 1 an et les adolescents de 15-19 ans présentent les taux d'incidence les plus élevés [2]. D'ailleurs, la vie en collectivité (crèches, internats, casernes) favorise la transmission.
Pour la gonorrhée, les facteurs de risque sont bien identifiés. Les rapports sexuels non protégés constituent le principal mode de transmission [4,20]. Les populations les plus à risque incluent les hommes ayant des rapports avec des hommes, les personnes ayant de multiples partenaires sexuels, et celles âgées de 15 à 29 ans.
Certaines pathologies prédisposent aux infections à Neisseriaceae. Les déficits en complément (C5-C9) augmentent considérablement le risque d'infections récidivantes à méningocoque [2]. L'immunodépression, qu'elle soit congénitale ou acquise, constitue également un facteur de risque important.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes des infections à Neisseriaceae varient considérablement selon l'espèce bactérienne et la localisation de l'infection. Il est crucial de savoir les reconnaître car certaines formes nécessitent une prise en charge d'urgence.
La méningite à méningocoque débute souvent brutalement. Les premiers signes incluent une fièvre élevée, des maux de tête intenses, et une raideur de la nuque [2]. Mais attention, chez les nourrissons, ces signes classiques peuvent être absents. On observe plutôt une irritabilité, des vomissements, et parfois un bombement de la fontanelle.
Le purpura fulminans constitue le signe d'alarme majeur. Ces taches rouges ou violacées qui ne s'effacent pas à la pression témoignent d'une septicémie grave [2]. Face à ce symptôme, chaque minute compte et il faut appeler immédiatement le 15.
La gonorrhée présente des symptômes différents selon le sexe. Chez l'homme, elle provoque typiquement des brûlures urinaires et un écoulement purulent par l'urètre [4,20]. Ces symptômes apparaissent généralement 2 à 7 jours après la contamination.
Chez la femme, la gonorrhée est souvent asymptomatique, ce qui retarde le diagnostic. Quand des symptômes existent, ils peuvent inclure des pertes vaginales anormales, des douleurs pelviennes, ou des saignements entre les règles [20,21]. Cette forme silencieuse explique en partie la propagation de l'infection.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des infections à Neisseriaceae repose sur une démarche clinique et biologique rigoureuse. La rapidité du diagnostic maladiene souvent le pronostic, particulièrement pour les infections invasives à méningocoque [2].
Face à une suspicion de méningite, l'examen clinique recherche les signes méningés classiques. La ponction lombaire constitue l'examen de référence, permettant l'analyse du liquide céphalorachidien [2]. Cet examen révèle une pléocytose à prédominance de polynucléaires neutrophiles et permet l'identification bactérienne.
Les techniques de biologie moléculaire, notamment la PCR, ont révolutionné le diagnostic. Elles permettent une identification rapide du méningocoque, même après le début d'un traitement antibiotique [2]. D'ailleurs, ces techniques sont désormais recommandées en première intention par la HAS.
Pour la gonorrhée, le diagnostic repose sur la mise en évidence de Neisseria gonorrhoeae. Chez l'homme symptomatique, l'examen direct de l'écoulement urétral peut suffire [21]. Mais la culture reste l'examen de référence car elle permet de tester la sensibilité aux antibiotiques.
Les nouvelles recommandations 2024-2025 de la HAS préconisent l'utilisation systématique de tests de biologie moléculaire pour le diagnostic de gonorrhée [1,5]. Ces tests, plus sensibles que la culture, permettent également le dépistage sur des prélèvements non invasifs comme les urines.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement des infections à Neisseriaceae a considérablement évolué ces dernières années, notamment face à l'émergence de résistances bactériennes. Les protocoles thérapeutiques sont désormais très codifiés et régulièrement mis à jour [1,5].
Pour les infections invasives à méningocoque, l'urgence thérapeutique est absolue. Le traitement antibiotique doit être débuté dans l'heure qui suit la suspicion diagnostique [2]. La ceftriaxone constitue l'antibiotique de première intention, administrée par voie intraveineuse à forte dose.
La gonorrhée pose des défis thérapeutiques croissants en raison des résistances. Les nouvelles recommandations HAS 2024-2025 préconisent une bithérapie associant ceftriaxone et azithromycine [1,5]. Cette stratégie vise à limiter l'émergence de nouvelles résistances.
Mais certaines souches de gonocoque présentent déjà des résistances multiples. Dans ces cas, les options thérapeutiques se limitent parfois à des antibiotiques de dernière ligne comme la gentamicine ou la spectinomycine [15]. Ces situations nécessitent une prise en charge spécialisée.
Le suivi thérapeutique est crucial. Pour la gonorrhée, un test de contrôle est recommandé 3 à 7 jours après la fin du traitement [7]. Cette vérification permet de s'assurer de l'efficacité thérapeutique et de détecter d'éventuels échecs de traitement.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
La recherche sur les infections à Neisseriaceae connaît des avancées prometteuses en 2024-2025. Face à la résistance croissante aux antibiotiques, de nouvelles approches thérapeutiques émergent [7,8].
La microbisporicine (NAI-107) représente une innovation majeure. Cette nouvelle molécule a montré une efficacité remarquable contre Neisseria gonorrhoeae dans des modèles expérimentaux [14]. Les premiers essais cliniques chez l'homme sont prévus pour 2025.
Les stratégies de médecine personnalisée se développent également. L'analyse génomique rapide des souches bactériennes permet désormais d'adapter le traitement en temps réel [8]. Cette approche révolutionnaire pourrait transformer la prise en charge des infections résistantes.
Concernant la prévention, de nouveaux vaccins méningococciques sont en développement. Un vaccin pentavalent couvrant les sérogroupes A, B, C, W et Y fait l'objet d'essais cliniques de phase III [9,10]. Son efficacité pourrait révolutionner la prévention des infections invasives.
La recherche explore aussi des approches innovantes comme l'utilisation de bactériophages thérapeutiques. Ces virus spécifiques des bactéries pourraient constituer une alternative aux antibiotiques classiques [8]. Bien que prometteuse, cette approche nécessite encore plusieurs années de développement.
Vivre au Quotidien avec Infections à Neisseriaceae
Vivre avec les conséquences d'une infection à Neisseriaceae peut impacter significativement la qualité de vie. Heureusement, la plupart des patients récupèrent complètement avec un traitement approprié.
Pour les survivants de méningite, certaines séquelles peuvent persister. Les troubles auditifs touchent environ 10% des patients, nécessitant parfois un appareillage [2]. Des troubles cognitifs légers peuvent également survenir, affectant la concentration ou la mémoire.
La gonorrhée, quand elle est traitée rapidement, guérit généralement sans séquelles. Mais les infections non traitées peuvent provoquer des complications graves chez la femme, notamment une maladie inflammatoire pelvienne pouvant affecter la fertilité [20].
L'aspect psychologique ne doit pas être négligé. Une infection grave peut générer de l'anxiété ou des troubles post-traumatiques. Il est important de ne pas hésiter à demander un soutien psychologique si nécessaire.
Concrètement, la reprise des activités normales se fait progressivement. Pour les infections invasives, une période de convalescence de plusieurs semaines est souvent nécessaire. L'entourage joue un rôle crucial dans cette phase de récupération.
Les Complications Possibles
Les complications des infections à Neisseriaceae peuvent être graves et parfois irréversibles. Leur prévention repose sur un diagnostic et un traitement précoces [2].
Les infections invasives à méningocoque peuvent provoquer plusieurs types de complications. Le choc septique constitue la complication la plus redoutable, avec une mortalité élevée malgré les traitements modernes [2]. Il peut nécessiter une prise en charge en réanimation avec support des fonctions vitales.
Les séquelles neurologiques touchent environ 15% des survivants de méningite. Elles incluent la surdité (la plus fréquente), les troubles cognitifs, l'épilepsie, ou les paralysies [2]. Ces séquelles peuvent nécessiter une rééducation prolongée et un suivi spécialisé.
Pour la gonorrhée, les complications surviennent principalement en cas de traitement tardif ou inadéquat. Chez la femme, la maladie inflammatoire pelvienne peut provoquer une infertilité définitive [20]. Cette complication souligne l'importance du dépistage systématique.
Chez l'homme, l'épididymite constitue la complication la plus fréquente. Plus rarement, une arthrite gonococcique peut survenir, nécessitant un traitement antibiotique prolongé [20]. Ces complications justifient l'importance d'un traitement précoce et adapté.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des infections à Neisseriaceae dépend largement de la rapidité de prise en charge et du type d'infection. Globalement, les perspectives se sont considérablement améliorées ces dernières décennies [2].
Pour les infections invasives à méningocoque, le pronostic reste sérieux mais s'améliore. La mortalité globale est d'environ 10%, mais elle peut atteindre 40% en cas de purpura fulminans [2]. Cependant, une prise en charge précoce et adaptée permet de réduire significativement ces chiffres.
L'âge constitue un facteur pronostique important. Les nourrissons et les personnes âgées présentent un risque de complications plus élevé [2]. À l'inverse, les adolescents et jeunes adultes ont généralement un meilleur pronostic.
Pour la gonorrhée, le pronostic est excellent quand l'infection est diagnostiquée et traitée précocement. La guérison est obtenue dans plus de 95% des cas avec les traitements actuels [1,5]. Mais les formes résistantes posent des défis croissants.
Les nouvelles stratégies thérapeutiques développées en 2024-2025 laissent espérer une amélioration du pronostic, notamment pour les infections résistantes [7,8]. L'avenir semble donc plutôt optimiste, à maladie de maintenir une vigilance constante face à l'évolution des résistances.
Peut-on Prévenir Infections à Neisseriaceae ?
La prévention des infections à Neisseriaceae repose sur plusieurs stratégies complémentaires. Certaines mesures sont très efficaces, d'autres font encore l'objet de recherches [2,9].
La vaccination constitue l'arme principale contre les infections invasives à méningocoque. Plusieurs vaccins sont disponibles, couvrant différents sérogroupes [2]. Le vaccin contre le méningocoque C est obligatoire chez les nourrissons depuis 2018, et la vaccination contre les sérogroupes A, C, W, Y est recommandée chez les adolescents.
Concernant le méningocoque B, un vaccin spécifique existe mais n'est pas encore généralisé. Les nouvelles recommandations 2024-2025 étendent ses indications à certaines populations à risque [9]. D'ailleurs, un vaccin pentavalent couvrant tous les sérogroupes principaux est en développement.
Pour la gonorrhée, la prévention repose essentiellement sur les mesures de protection lors des rapports sexuels. L'utilisation systématique du préservatif reste la méthode la plus efficace [4,20]. Le dépistage régulier des personnes à risque permet également de limiter la transmission.
La prophylaxie post-exposition joue un rôle important. En cas de contact avec un cas de méningite, un traitement antibiotique préventif peut être prescrit aux personnes proches [2]. Cette mesure a considérablement réduit les cas secondaires.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont publié des recommandations actualisées concernant la prise en charge des infections à Neisseriaceae. Ces guidelines 2024-2025 intègrent les dernières avancées scientifiques [1,5].
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 de nouvelles recommandations pour la prise en charge de la gonorrhée. Ces guidelines préconisent l'utilisation systématique de tests de biologie moléculaire et une bithérapie antibiotique [1,5]. L'objectif est de limiter l'émergence de résistances.
Santé Publique France coordonne la surveillance épidémiologique des infections à Neisseriaceae. Leurs rapports annuels permettent d'adapter les stratégies de prévention et de prise en charge [2,3]. Les données 2024 confirment la nécessité de renforcer la surveillance des résistances.
Les recommandations européennes, relayées par les autorités françaises, insistent sur l'importance de la surveillance internationale [10]. Cette coordination permet de détecter précocement l'émergence de nouvelles souches résistantes.
Concrètement, ces recommandations se traduisent par des protocoles de soins standardisés dans tous les établissements de santé. Elles définissent également les indications de vaccination et les modalités de prophylaxie post-exposition [8,9].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs organismes accompagnent les patients et familles touchés par les infections à Neisseriaceae. Ces structures offrent information, soutien et aide pratique.
L'Association Petit Ange soutient les familles touchées par la méningite. Elle propose un accompagnement psychologique, des informations médicales actualisées, et organise des groupes de parole. Leur site internet constitue une ressource précieuse pour comprendre la maladie.
La Fondation pour la Recherche Médicale finance des projets de recherche sur les infections à Neisseriaceae. Elle informe également le grand public sur les avancées scientifiques et les enjeux de santé publique.
Au niveau international, Meningitis Research Foundation développe des outils d'information traduits en français. Leurs campagnes de sensibilisation contribuent à améliorer la reconnaissance des symptômes par le grand public.
Les centres de référence des infections invasives bactériennes, répartis sur le territoire français, offrent une expertise spécialisée. Ils assurent le diagnostic, le traitement des cas complexes, et participent à la surveillance épidémiologique.
Enfin, les réseaux sociaux permettent aux patients et familles d'échanger leurs expériences. Ces communautés virtuelles offrent un soutien précieux, particulièrement dans les phases difficiles de la maladie.
Nos Conseils Pratiques
Face aux infections à Neisseriaceae, quelques conseils pratiques peuvent faire la différence. Ces recommandations s'appuient sur l'expérience clinique et les retours de patients.
Reconnaître les signes d'urgence constitue la priorité absolue. Toute fièvre associée à des taches cutanées qui ne s'effacent pas à la pression doit conduire à une consultation immédiate. N'hésitez jamais à appeler le 15 en cas de doute.
Pour la prévention de la gonorrhée, l'utilisation systématique du préservatif reste la règle d'or. Mais attention, cette protection n'est efficace que si elle est utilisée dès le début du rapport et pour tous les types de relations sexuelles.
Le dépistage régulier s'impose pour les personnes à risque. Les recommandations actuelles préconisent un dépistage annuel, voire plus fréquent selon les situations. Ce dépistage peut se faire chez le médecin traitant, en centre de dépistage, ou même à domicile avec certains tests.
En cas de traitement antibiotique, respectez scrupuleusement la prescription. Ne jamais arrêter le traitement prématurément, même si les symptômes disparaissent. Cette règle est cruciale pour éviter les résistances bactériennes.
Enfin, n'oubliez pas d'informer vos partenaires sexuels en cas de diagnostic de gonorrhée. Cette démarche, parfois délicate, est essentielle pour briser la chaîne de transmission.
Quand Consulter un Médecin ?
Savoir quand consulter pour une suspicion d'infection à Neisseriaceae peut sauver des vies. Certains signes nécessitent une prise en charge d'urgence absolue.
Consultez immédiatement (appelez le 15) si vous observez : une fièvre élevée avec des taches cutanées qui ne s'effacent pas à la pression, des maux de tête intenses avec raideur de nuque, ou une altération rapide de l'état de conscience [2].
Pour la gonorrhée, consultez rapidement en cas de : brûlures urinaires persistantes, écoulement anormal par les organes génitaux, douleurs pelviennes chez la femme, ou douleurs testiculaires chez l'homme [20,21].
N'attendez pas pour consulter si vous avez eu un rapport à risque. Le dépistage précoce permet un traitement efficace et limite les complications. De nombreuses structures proposent des consultations sans rendez-vous.
En cas de contact avec un cas de méningite, consultez votre médecin même sans symptômes. Une prophylaxie antibiotique pourrait être nécessaire selon les circonstances du contact [2].
Bon à savoir : les services d'urgence sont formés à reconnaître ces infections. En cas de doute, il vaut toujours mieux consulter pour rien que de passer à côté d'une infection grave.
Questions Fréquentes
Les infections à Neisseriaceae sont-elles contagieuses ?Cela dépend du type d'infection. La méningite à méningocoque peut se transmettre par les gouttelettes respiratoires lors de contacts rapprochés, mais la contagiosité reste faible. La gonorrhée se transmet exclusivement par voie sexuelle [2,4].
Peut-on avoir plusieurs fois une gonorrhée ?
Oui, absolument. L'infection par le gonocoque ne confère aucune immunité. Il est donc possible d'être réinfecté plusieurs fois, d'où l'importance de la prévention et du traitement des partenaires [20].
Les vaccins contre le méningocoque sont-ils efficaces ?
Les vaccins actuels sont très efficaces contre les sérogroupes qu'ils couvrent. L'efficacité vaccinale dépasse 90% pour la plupart des vaccins disponibles [2,9].
Comment savoir si le traitement de la gonorrhée a fonctionné ?
Un test de contrôle est recommandé 3 à 7 jours après la fin du traitement. Ce test permet de vérifier l'efficacité thérapeutique et de détecter d'éventuelles résistances [7].
Les infections à Neisseriaceae peuvent-elles affecter la fertilité ?
La gonorrhée non traitée peut effectivement provoquer une infertilité, particulièrement chez la femme. C'est pourquoi un diagnostic et un traitement précoces sont essentiels [20].
Questions Fréquentes
Les infections à Neisseriaceae sont-elles contagieuses ?
Cela dépend du type d'infection. La méningite à méningocoque peut se transmettre par les gouttelettes respiratoires lors de contacts rapprochés, mais la contagiosité reste faible. La gonorrhée se transmet exclusivement par voie sexuelle.
Peut-on avoir plusieurs fois une gonorrhée ?
Oui, absolument. L'infection par le gonocoque ne confère aucune immunité. Il est donc possible d'être réinfecté plusieurs fois, d'où l'importance de la prévention et du traitement des partenaires.
Les vaccins contre le méningocoque sont-ils efficaces ?
Les vaccins actuels sont très efficaces contre les sérogroupes qu'ils couvrent. L'efficacité vaccinale dépasse 90% pour la plupart des vaccins disponibles.
Comment savoir si le traitement de la gonorrhée a fonctionné ?
Un test de contrôle est recommandé 3 à 7 jours après la fin du traitement. Ce test permet de vérifier l'efficacité thérapeutique et de détecter d'éventuelles résistances.
Les infections à Neisseriaceae peuvent-elles affecter la fertilité ?
La gonorrhée non traitée peut effectivement provoquer une infertilité, particulièrement chez la femme. C'est pourquoi un diagnostic et un traitement précoces sont essentiels.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Recommandations de prise en charge des personnes infectées par Neisseria gonorrhoeaeLien
- [2] Infections invasives à méningocoque - Surveillance épidémiologiqueLien
- [3] Etude PrévIST 2022-2023 - Surveillance des IST en FranceLien
- [4] Gonococcie - Données épidémiologiques françaisesLien
- [5] Guidelines HAS 2024-2025 - Prise en charge Neisseria gonorrhoeaeLien
- [6] WHO Fact Sheet - Gonorrhoea Global EpidemiologyLien
- [7] Guide thérapeutique gonorrhée - Innovations 2024-2025Lien
- [8] Consensus thérapeutique - Recommandations 2024-2025Lien
- [9] Stratégies vaccinales méningocoque - Innovations 2024-2025Lien
- [10] Global Meningococcal Initiative - Surveillance and Control 2024Lien
- [13] Beyond the usual suspects: infections by commensal Neisseria speciesLien
- [14] Microbisporicin (NAI-107) efficacy against Neisseria gonorrhoeaeLien
- [15] Managing treatment failure in Neisseria gonorrhoeae infectionLien
- [20] Gonorrhée - Manuel MSD grand publicLien
- [21] Gonocoque : Dépistage et diagnosticLien
Publications scientifiques
- Experimental Urethral Infection with Neisseria gonorrhoeae (2022)14 citations[PDF]
- [HTML][HTML] Beyond the usual suspects: reviewing infections caused by typically-commensal Neisseria species (2023)12 citations
- Microbisporicin (NAI-107) protects Galleria mellonella from infection with Neisseria gonorrhoeae (2023)6 citations
- Managing treatment failure in Neisseria gonorrhoeae infection: current guidelines and future directions (2024)12 citations
- Is there an association between previous infection with Neisseria gonorrhoeae and gonococcal AMR? A cross-sectional analysis of national and sentinel surveillance … (2023)13 citations[PDF]
Ressources web
- Gonorrhée - Infections - Manuels MSD pour le grand public (msdmanuals.com)
En général, la gonorrhée ne provoque des symptômes qu'aux sites de l'infection initiale, le plus souvent au niveau du col de l'utérus, du pénis, de l'urètre ou ...
- Gonorrhée (infection à Neisseria gonorrhoeae) (who.int)
4 juil. 2024 — Signes et symptômes · pertes vaginales · miction douloureuse ou sensation de brûlure en urinant · saignements vaginaux entre les règles ou pendant ...
- Gonocoque : Symptômes, Dépistage et Traitement (cerballiance.fr)
Ces infections se caractérisent par un écoulement purulent, des douleurs de type brulures notamment lors des mictions, des difficultés pour uriner et une ...
- Neisseria gonorrhoeae : Fiche technique santé-sécurité (canada.ca)
8 juil. 2024 — Les patients atteints de pharyngite présentent des maux de gorge, de la fièvre et une lymphadénopathie cervicale, et ceux atteints de proctite ...
- Dépistage et prise en charge de l'infection à Neisseria ... (has-sante.fr)
1.1 Histoire naturelle de la maladie La symptomatologie est le plus souvent bruyante chez l'homme, sous forme d'urétrite aiguë ; chez la femme, l'infection est ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
