Infections à Anaplasmataceae : Symptômes, Diagnostic et Traitements 2025
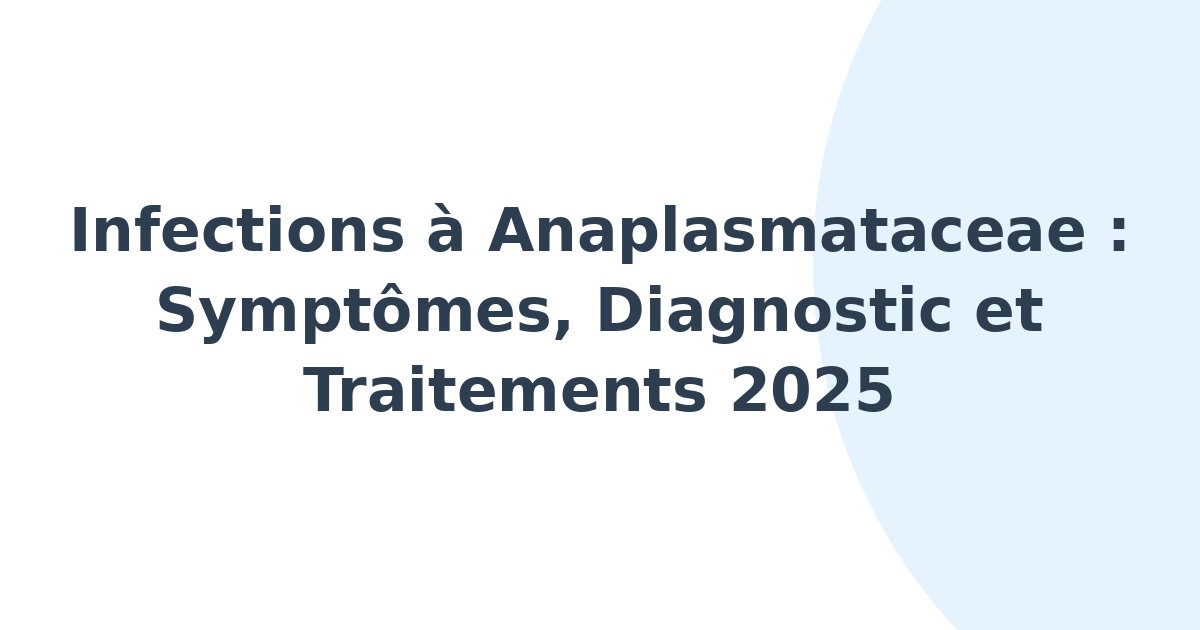
Les infections à Anaplasmataceae représentent un groupe de maladies transmises par les tiques, encore méconnues du grand public. Ces pathologies bactériennes touchent chaque année des milliers de personnes en France [1]. Bien que souvent asymptomatiques, elles peuvent parfois provoquer des complications graves. Heureusement, un diagnostic précoce et un traitement adapté permettent une guérison complète dans la majorité des cas [2,3].

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Infections à Anaplasmataceae : Définition et Vue d'Ensemble
Les infections à Anaplasmataceae sont causées par des bactéries intracellulaires obligatoires de la famille des Anaplasmataceae [7]. Cette famille comprend principalement les genres Anaplasma et Ehrlichia, responsables respectivement de l'anaplasmose et de l'ehrlichiose [9,13].
Ces micro-organismes ont une particularité : ils ne peuvent survivre qu'à l'intérieur des cellules de leur hôte. Concrètement, ils infectent les globules blancs et parfois les plaquettes sanguines [14]. Cette caractéristique explique pourquoi ces infections peuvent perturber le système immunitaire.
Mais alors, comment ces bactéries arrivent-elles dans notre organisme ? La transmission se fait exclusivement par piqûre de tique infectée [1,15]. En France, les principales espèces vectrices sont Ixodes ricinus et Dermacentor reticulatus. D'ailleurs, ces mêmes tiques peuvent transmettre d'autres pathogènes comme la borréliose de Lyme [1].
L'important à retenir : ces infections font partie des maladies vectorielles émergentes en Europe. Leur fréquence augmente progressivement, notamment en raison du réchauffement climatique qui favorise l'expansion des populations de tiques [2,5].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, les infections à Anaplasmataceae restent relativement rares mais leur incidence augmente régulièrement. Selon les données de Santé publique France, on estime entre 50 et 100 cas diagnostiqués annuellement, mais ce chiffre sous-estime probablement la réalité [1]. En effet, de nombreuses infections passent inaperçues car asymptomatiques.
La répartition géographique n'est pas uniforme sur le territoire. Les régions les plus touchées correspondent aux zones d'endémie des tiques : Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine [1]. Ces régions concentrent environ 70% des cas déclarés. Cependant, l'expansion géographique des tiques fait que de nouvelles zones deviennent à risque chaque année.
Au niveau mondial, la situation varie considérablement selon les continents. Une récente analyse géospatiale de 2025 révèle que les zones à haut risque se concentrent en Amérique du Nord, Europe centrale et certaines régions d'Asie [2,5,8]. Les États-Unis rapportent plusieurs milliers de cas annuels, principalement dans les États du Nord-Est et du Midwest.
Concernant les caractéristiques démographiques, les infections touchent préférentiellement les adultes de 40 à 70 ans, avec une légère prédominance masculine [6,10]. Cette répartition s'explique par une exposition professionnelle ou récréative plus fréquente aux environnements forestiers. D'ailleurs, les activités à risque incluent la randonnée, la chasse, le jardinage et les professions forestières.
Les projections pour les prochaines années sont préoccupantes. Les modèles prédictifs suggèrent une augmentation de 20 à 30% de l'incidence d'ici 2030, principalement due au changement climatique [2,8]. Cette évolution nécessite une vigilance accrue des professionnels de santé et du grand public.
Les Causes et Facteurs de Risque
La cause unique des infections à Anaplasmataceae est la piqûre de tique infectée. Mais attention, toutes les tiques ne sont pas porteuses de ces bactéries [1,15]. Le taux d'infection varie selon les régions et les espèces de tiques, oscillant généralement entre 1 et 15% [6,10].
Plusieurs facteurs augmentent votre risque d'exposition. L'activité professionnelle joue un rôle majeur : forestiers, agriculteurs, vétérinaires et jardiniers sont particulièrement exposés [1]. Les loisirs de plein air constituent également un facteur de risque important, notamment la randonnée, le camping et la chasse.
La saisonnalité influence considérablement le risque d'infection. Les tiques sont plus actives de mars à octobre, avec un pic d'activité en mai-juin et septembre-octobre [1,11]. Cette période correspond aux moments où les maladies climatiques (température et humidité) sont optimales pour leur développement.
Certaines caractéristiques individuelles peuvent modifier le risque. L'âge avancé et l'immunodépression augmentent la susceptibilité aux formes sévères [12,13]. Cependant, il faut savoir que même les personnes en parfaite santé peuvent développer une infection symptomatique.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes des infections à Anaplasmataceae peuvent être trompeurs car ils ressemblent souvent à ceux d'une grippe banale. Cette similitude explique pourquoi le diagnostic est parfois retardé [13,15].
La période d'incubation varie généralement de 5 à 21 jours après la piqûre de tique. Les premiers signes apparaissent progressivement : fièvre modérée à élevée (38-40°C), maux de tête intenses, fatigue importante et douleurs musculaires [13]. Ces symptômes peuvent s'accompagner de frissons et de sueurs nocturnes.
Contrairement à la maladie de Lyme, l'érythème migrant (la fameuse tache rouge qui s'étend) n'apparaît jamais dans les infections à Anaplasmataceae [1,13]. Cette absence constitue un élément différentiel important pour le médecin.
Certains patients développent des symptômes digestifs : nausées, vomissements, diarrhée et douleurs abdominales [15]. Ces manifestations touchent environ 30% des personnes infectées. D'ailleurs, elles peuvent parfois dominer le tableau clinique et orienter à tort vers une gastro-entérite.
Bon à savoir : de nombreuses infections restent complètement asymptomatiques. Les études montrent que 50 à 80% des personnes infectées ne développent aucun symptôme [12,13]. Cette particularité explique pourquoi ces maladies sont sous-diagnostiquées.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des infections à Anaplasmataceae repose sur plusieurs éléments complémentaires. Votre médecin commencera par un interrogatoire détaillé pour rechercher une notion de piqûre de tique ou d'exposition en zone à risque [4,13].
L'examen clinique recherche les signes évocateurs : fièvre, adénopathies (ganglions gonflés) et parfois une éruption cutanée discrète [13,15]. Cependant, ces signes ne sont pas spécifiques et peuvent se retrouver dans de nombreuses autres infections.
Les examens biologiques constituent l'étape clé du diagnostic. La numération formule sanguine révèle souvent des anomalies caractéristiques : diminution des globules blancs (leucopénie), baisse des plaquettes (thrombopénie) et élévation des enzymes hépatiques [13,14]. Ces perturbations orientent fortement vers une infection à Anaplasmataceae.
Le diagnostic de certitude repose sur des tests spécialisés. La PCR (amplification génique) permet de détecter directement l'ADN bactérien dans le sang [4,14]. Cette technique, très sensible, donne des résultats rapides (24-48h). En parallèle, la sérologie recherche les anticorps spécifiques, mais elle nécessite souvent deux prélèvements à 15 jours d'intervalle.
Les innovations diagnostiques de 2024-2025 incluent de nouveaux tests multiplex capables de détecter simultanément plusieurs agents pathogènes transmis par les tiques [2,4]. Ces outils révolutionnent la prise en charge en permettant un diagnostic plus rapide et plus complet.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Heureusement, les infections à Anaplasmataceae répondent excellemment aux antibiotiques appropriés. Le traitement de référence reste la doxycycline, un antibiotique de la famille des tétracyclines [13,15].
La posologie standard consiste en 100 mg de doxycycline deux fois par jour pendant 10 à 14 jours [13]. Ce traitement doit être débuté le plus rapidement possible après le diagnostic. En effet, plus la prise en charge est précoce, plus l'évolution est favorable.
Pour les patients qui ne peuvent pas prendre de doxycycline (allergie, grossesse, enfants de moins de 8 ans), des alternatives existent. Le chloramphénicol peut être utilisé, bien qu'il soit moins efficace [15]. Chez la femme enceinte, l'azithromycine représente une option thérapeutique acceptable.
Le traitement symptomatique accompagne l'antibiothérapie. Il comprend la prise d'antalgiques pour soulager les douleurs et d'antipyrétiques pour contrôler la fièvre. L'hydratation reste importante, surtout en cas de fièvre élevée.
Rassurez-vous : l'amélioration clinique survient généralement dans les 24 à 48 heures suivant le début du traitement [13,15]. Cette réponse rapide constitue même un élément diagnostique rétrospectif. Cependant, la fatigue peut persister plusieurs semaines après la guérison.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
La recherche sur les infections à Anaplasmataceae connaît des avancées prometteuses. Les études de 2024-2025 se concentrent sur l'amélioration des stratégies diagnostiques et thérapeutiques [2,3,4].
Une innovation majeure concerne le développement de tests diagnostiques rapides utilisables au cabinet médical. Ces dispositifs, basés sur la détection d'antigènes, permettraient un diagnostic en moins de 30 minutes [4]. Cette rapidité révolutionnerait la prise en charge, notamment dans les zones rurales éloignées des laboratoires spécialisés.
Du côté thérapeutique, de nouveaux protocoles de prévention post-exposition sont à l'étude [3]. L'idée consiste à administrer préventivement un antibiotique après une piqûre de tique à haut risque, sur le modèle de ce qui existe déjà pour la maladie de Lyme.
Les recherches sur les vaccins progressent également. Plusieurs équipes travaillent sur des vaccins dirigés contre les protéines de surface des bactéries Anaplasmataceae [3]. Bien que ces travaux en soient encore au stade préclinique, ils ouvrent des perspectives intéressantes pour la prévention.
Enfin, l'intelligence artificielle fait son entrée dans ce domaine. Des algorithmes de prédiction du risque sont développés pour identifier les zones et périodes de forte transmission [2,8]. Ces outils aideront les autorités sanitaires à mieux cibler leurs actions de prévention.
Vivre au Quotidien avec Infections à Anaplasmataceae
Vivre avec une infection à Anaplasmataceae, c'est d'abord comprendre que dans la grande majorité des cas, la guérison est complète après traitement [13,15]. Cette maladie ne devient pas chronique comme peut l'être la borréliose de Lyme dans certains cas.
Pendant la phase aiguë, il est normal de ressentir une fatigue importante. Votre corps combat l'infection et a besoin d'énergie pour cela. N'hésitez pas à vous reposer et à adapter votre rythme de vie temporairement. La plupart des patients reprennent leurs activités normales dans les 2 à 3 semaines suivant le début du traitement.
Certaines personnes s'inquiètent d'une possible récidive. Rassurez-vous : une fois guérie, l'infection ne récidive pas. Cependant, vous n'êtes pas immunisé à vie et pourriez théoriquement être réinfecté par une nouvelle piqûre de tique [15]. C'est pourquoi la prévention reste importante même après avoir été malade.
L'impact psychologique ne doit pas être négligé. Certains patients développent une phobie des tiques après leur infection. Cette réaction est compréhensible mais ne doit pas vous empêcher de profiter des activités de plein air. Des techniques de relaxation et, si nécessaire, un accompagnement psychologique peuvent aider à surmonter ces craintes.
Les Complications Possibles
Bien que rares, les complications des infections à Anaplasmataceae peuvent être graves si le traitement est retardé. Il est important de les connaître pour comprendre l'importance d'un diagnostic précoce [13,15].
Les complications hématologiques sont les plus fréquentes. La diminution sévère des plaquettes peut provoquer des saignements spontanés : ecchymoses, saignements de nez ou gingivaux [13]. Dans les cas extrêmes, des hémorragies internes peuvent survenir, nécessitant une hospitalisation d'urgence.
L'atteinte du système nerveux central constitue une complication redoutable mais heureusement exceptionnelle. Elle peut se manifester par une méningite, une encéphalite ou des troubles de la conscience [15]. Ces formes neurologiques nécessitent une prise en charge en milieu hospitalier spécialisé.
Certains patients développent des complications respiratoires : pneumonie atypique ou syndrome de détresse respiratoire aiguë [13]. Ces manifestations sont plus fréquentes chez les personnes âgées ou immunodéprimées.
Rassurez-vous : ces complications restent exceptionnelles lorsque le traitement est débuté rapidement. C'est pourquoi il est crucial de consulter rapidement en cas de fièvre après une exposition aux tiques [15]. Le pronostic est excellent avec une prise en charge adaptée.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des infections à Anaplasmataceae est globalement excellent lorsque le diagnostic est posé et le traitement débuté rapidement [13,15]. Cette affirmation rassurante s'appuie sur de nombreuses études cliniques.
Avec un traitement antibiotique approprié, le taux de guérison avoisine les 100% [13]. La mortalité, autrefois redoutable avant l'ère des antibiotiques, est devenue exceptionnelle dans les pays développés. Elle ne concerne que les formes très sévères non traitées ou diagnostiquées tardivement.
La durée de convalescence varie selon les individus. La plupart des patients reprennent leurs activités normales dans les 2 à 4 semaines suivant le début du traitement [15]. Cependant, une fatigue résiduelle peut persister plusieurs semaines, particulièrement chez les personnes âgées.
Contrairement à d'autres maladies transmises par les tiques, les infections à Anaplasmataceae ne laissent généralement pas de séquelles à long terme [13]. Cette caractéristique les distingue favorablement de certaines formes de borréliose de Lyme ou d'encéphalite à tiques.
L'immunité acquise après infection reste un sujet débattu. Bien qu'une certaine protection semble exister, elle n'est ni complète ni définitive [15]. C'est pourquoi la prévention reste importante même après avoir été infecté.
Peut-on Prévenir Infections à Anaplasmataceae ?
La prévention des infections à Anaplasmataceae repose entièrement sur la protection contre les piqûres de tiques. Aucun vaccin n'est actuellement disponible, ce qui rend les mesures préventives d'autant plus importantes [1,3].
Lors de vos sorties en nature, adoptez une tenue vestimentaire adaptée : pantalons longs, chaussures fermées, manches longues et chapeau [1]. Privilégiez les vêtements clairs qui permettent de repérer plus facilement les tiques. Rentrez le bas du pantalon dans les chaussettes - ce geste simple mais efficace limite l'accès des tiques à votre peau.
Les répulsifs cutanés constituent un complément utile. Choisissez des produits contenant du DEET, de l'icaridine ou de l'IR3535, reconnus efficaces contre les tiques [1]. Appliquez-les sur les parties découvertes du corps et renouvelez l'application selon les recommandations du fabricant.
Après chaque sortie, procédez à une inspection minutieuse de tout votre corps. Les tiques privilégient les zones chaudes et humides : aisselles, aines, cuir chevelu, derrière les oreilles [1]. Cette vérification doit être systématique, même après une courte promenade.
Si vous découvrez une tique accrochée, retirez-la rapidement avec un tire-tique ou une pince fine [1]. Plus la tique reste attachée longtemps, plus le risque de transmission augmente. Désinfectez ensuite la zone de piqûre et surveillez l'apparition éventuelle de symptômes dans les semaines suivantes.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont récemment actualisé leurs recommandations concernant les maladies vectorielles à tiques, incluant les infections à Anaplasmataceae [1]. Ces nouvelles directives, publiées en 2024-2025, reflètent l'évolution des connaissances scientifiques.
La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande une vigilance particulière dans les zones d'endémie identifiées [1]. Ces régions font l'objet d'une surveillance épidémiologique renforcée et d'actions de sensibilisation ciblées auprès des professionnels de santé et du grand public.
Concernant le diagnostic, les recommandations insistent sur l'importance de l'interrogatoire et de la recherche systématique d'une exposition aux tiques [1]. Les médecins sont encouragés à prescrire les examens spécialisés dès que le contexte clinique et épidémiologique l'évoque.
Pour la prévention, les autorités prônent une approche "One Health" intégrant la santé humaine, animale et environnementale [1]. Cette stratégie globale vise à mieux comprendre et contrôler la circulation des agents pathogènes dans les écosystèmes.
Les nouvelles recommandations incluent également des protocoles de surveillance post-exposition pour les professionnels à risque [1]. Ces mesures permettent une détection précoce des infections et une prise en charge optimale.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs organismes peuvent vous accompagner dans votre parcours de soins et répondre à vos questions sur les infections à Anaplasmataceae. Ces ressources constituent un soutien précieux pour les patients et leurs familles.
L'association France Lyme élargit progressivement son champ d'action aux autres maladies vectorielles à tiques, incluant les infections à Anaplasmataceae. Elle propose des informations fiables, des témoignages de patients et un soutien psychologique. Leur site internet regorge de conseils pratiques pour la prévention et la prise en charge.
Le Centre National de Référence des Borrelia coordonne la surveillance épidémiologique et fournit une expertise diagnostique pour l'ensemble des maladies transmises par les tiques [1]. Les professionnels de santé peuvent les consulter pour les cas complexes ou atypiques.
Santé publique France met à disposition du grand public des documents d'information régulièrement actualisés [1]. Ces ressources, validées scientifiquement, constituent une source fiable pour s'informer sur les risques et les mesures de prévention.
N'hésitez pas à solliciter votre médecin traitant qui reste votre interlocuteur privilégié. Il peut vous orienter vers des spécialistes si nécessaire et coordonner votre prise en charge. La communication avec votre équipe soignante est essentielle pour un suivi optimal.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos recommandations concrètes pour vous protéger efficacement des infections à Anaplasmataceae tout en continuant à profiter des activités de plein air.
Avant vos sorties, consultez les cartes de risque disponibles sur les sites des autorités sanitaires [1]. Ces outils vous informent sur les zones et périodes de forte activité des tiques. Adaptez vos précautions en conséquence, sans pour autant renoncer à vos loisirs favoris.
Constituez-vous une trousse de prévention : répulsif efficace, tire-tique, désinfectant et vêtements adaptés. Gardez cette trousse dans votre voiture ou sac de randonnée pour l'avoir toujours à disposition. Un petit investissement qui peut vous éviter bien des désagréments.
Apprenez à reconnaître les habitats favorables aux tiques : lisières de forêt, hautes herbes, sous-bois humides [1]. Ces connaissances vous permettront d'adapter votre vigilance selon les environnements traversés. Les sentiers bien entretenus présentent généralement moins de risques.
En cas de piqûre de tique, notez la date et le lieu de l'exposition. Cette information sera précieuse pour votre médecin en cas de symptômes ultérieurs. Photographiez éventuellement la zone de piqûre pour documenter son évolution.
Enfin, restez informé des évolutions scientifiques sans tomber dans l'excès d'information. Les recommandations évoluent régulièrement et il est important de se tenir au courant des nouveautés diagnostiques et thérapeutiques [2,4].
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous amener à consulter rapidement votre médecin. La règle d'or : toute fièvre survenant dans les 3 semaines suivant une exposition aux tiques justifie une consultation médicale [1,13].
Consultez en urgence si vous présentez une fièvre élevée (supérieure à 39°C) associée à des maux de tête intenses, surtout si vous vous souvenez d'une piqûre de tique récente [13,15]. Ces symptômes peuvent évoquer une infection à Anaplasmataceae ou une autre maladie vectorielle.
D'autres signes doivent vous alerter : apparition d'ecchymoses spontanées, saignements inhabituels (nez, gencives), fatigue extrême ou troubles de la conscience [13]. Ces manifestations peuvent témoigner de complications nécessitant une prise en charge urgente.
Même en l'absence de symptômes, une consultation peut être justifiée après une piqûre de tique dans certaines circonstances : tique restée attachée plus de 24 heures, piqûre en zone d'endémie connue, ou si vous présentez des facteurs de risque particuliers [1].
N'hésitez jamais à contacter votre médecin en cas de doute. Il vaut mieux une consultation "pour rien" qu'un diagnostic tardif. Votre médecin saura évaluer le risque et décider des examens éventuellement nécessaires [15].
Questions Fréquentes
Les infections à Anaplasmataceae sont-elles contagieuses entre humains ?Non, ces infections ne se transmettent pas d'une personne à l'autre. La transmission nécessite obligatoirement une piqûre de tique infectée [13,15].
Peut-on attraper plusieurs maladies avec une seule piqûre de tique ?
Oui, c'est possible. Une même tique peut être porteuse de plusieurs agents pathogènes : Anaplasma, Borrelia (Lyme), virus de l'encéphalite à tiques [1,6]. C'est pourquoi les nouveaux tests multiplex sont si utiles [4].
Faut-il traiter préventivement après chaque piqûre de tique ?
Non, le traitement préventif systématique n'est pas recommandé. Il est réservé à des situations particulières évaluées au cas par cas par le médecin [1,3].
Les animaux domestiques peuvent-ils transmettre l'infection ?
Les chiens et chats peuvent être infectés par les mêmes bactéries, mais ils ne transmettent pas directement l'infection à l'homme. Cependant, ils peuvent ramener des tiques infectées à la maison [10,11].
Combien de temps une tique doit-elle rester attachée pour transmettre l'infection ?
Le risque de transmission augmente avec la durée d'attachement. Il devient significatif après 12-24 heures, d'où l'importance d'un retrait rapide [1,15].
Questions Fréquentes
Les infections à Anaplasmataceae sont-elles contagieuses entre humains ?
Non, ces infections ne se transmettent pas d'une personne à l'autre. La transmission nécessite obligatoirement une piqûre de tique infectée.
Peut-on attraper plusieurs maladies avec une seule piqûre de tique ?
Oui, c'est possible. Une même tique peut être porteuse de plusieurs agents pathogènes : Anaplasma, Borrelia (Lyme), virus de l'encéphalite à tiques.
Faut-il traiter préventivement après chaque piqûre de tique ?
Non, le traitement préventif systématique n'est pas recommandé. Il est réservé à des situations particulières évaluées au cas par cas par le médecin.
Les animaux domestiques peuvent-ils transmettre l'infection ?
Les chiens et chats peuvent être infectés par les mêmes bactéries, mais ils ne transmettent pas directement l'infection à l'homme. Cependant, ils peuvent ramener des tiques infectées à la maison.
Combien de temps une tique doit-elle rester attachée pour transmettre l'infection ?
Le risque de transmission augmente avec la durée d'attachement. Il devient significatif après 12-24 heures, d'où l'importance d'un retrait rapide.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Borréliose de Lyme et autres maladies vectorielles à tiques - Recommandations HAS 2024-2025Lien
- [2] The global distribution and risk prediction of Anaplasmataceae species: a systematic review and geospatial modelling analysisLien
- [3] Prevention and control of tick-borne anaplasmosis - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] Testing for Vector-Borne Infections - My Health ToolkitLien
- [5] The global distribution and risk prediction of Anaplasmataceae species: a systematic review and geospatial modelling analysis (2025)Lien
- [6] Distribution and Prevalence of Anaplasmataceae, Rickettsiaceae and Coxiellaceae in African Ticks: A Systematic Review and Meta-Analysis (2023)Lien
- [7] Anaplasmataceae: Ehrlichia and Neorickettsia (2022)Lien
- [8] Anaplasmataceae: global distribution and predicted high-risk areas (2025)Lien
- [9] Anaplasmataceae: Anaplasma (2022)Lien
- [10] Molecular epidemiological investigation of Piroplasms and Anaplasmataceae bacteria in Egyptian domestic animals and associated ticks (2022)Lien
- [11] Molecular screening of piroplasms and Anaplasmataceae agents in Hyalomma dromedarii ticks from camels over different seasons in Egypt (2024)Lien
- [12] Cytokine pattern during asymptomatic Anaplasma spp. infections and effect of co-infections by malaria and helminths in schoolchildren (2025)Lien
- [13] Ehrlichiose et anaplasmose - Infections MSD ManualsLien
- [14] ANAPLASMA - CHRU StrasbourgLien
- [15] Anaplasmose - Centre canadien de contrôle des maladies infectieusesLien
Publications scientifiques
- The global distribution and risk prediction of Anaplasmataceae species: a systematic review and geospatial modelling analysis (2025)1 citations[PDF]
- Distribution and Prevalence of Anaplasmataceae, Rickettsiaceae and Coxiellaceae in African Ticks: A Systematic Review and Meta-Analysis (2023)12 citations
- Anaplasmataceae: Ehrlichia and Neorickettsia (2022)4 citations
- Anaplasmataceae: global distribution and predicted high-risk areas (2025)[PDF]
- Anaplasmataceae: Anaplasma (2022)3 citations
Ressources web
- Ehrlichiose et anaplasmose - Infections (msdmanuals.com)
L'ehrlichiose et l'anaplasmose sont des infections bactériennes transmises par des tiques responsables de fièvre, de frissons, de douleurs musculaires, ...
- ANAPLASMA (chru-strasbourg.fr)
Chez l'homme, la maladie se manifeste par une fièvre, fréquemment accompagnée de frissons, d'un état de malaise ou d'un syndrome polyalgique associé à des cé ...
- Anaplasmose (ccnmi.ca)
Les infections causées par l'anaplasmose se manifestent par une forte poussée de fièvre accompagnée d'un ou de plusieurs des symptômes suivants : maux de tête, ...
- Anaplasmose humaine (fr.wikipedia.org)
Indices pour le diagnostic · syndrome grippal avec sérologie au moins égale à 1/80 en IFI, · ou si des morulae sont visibles dans les frottis sanguins.
- La lutte contre les agents pathogènes vectorisés chez le ... (esccap.org)
Diagnostic. Le diagnostic des infections dues aux bactéries Anaplasmataceae chez le chien repose sur le croise- ment de données concernant la probabilité d ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
