Infections à Méningocoques : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
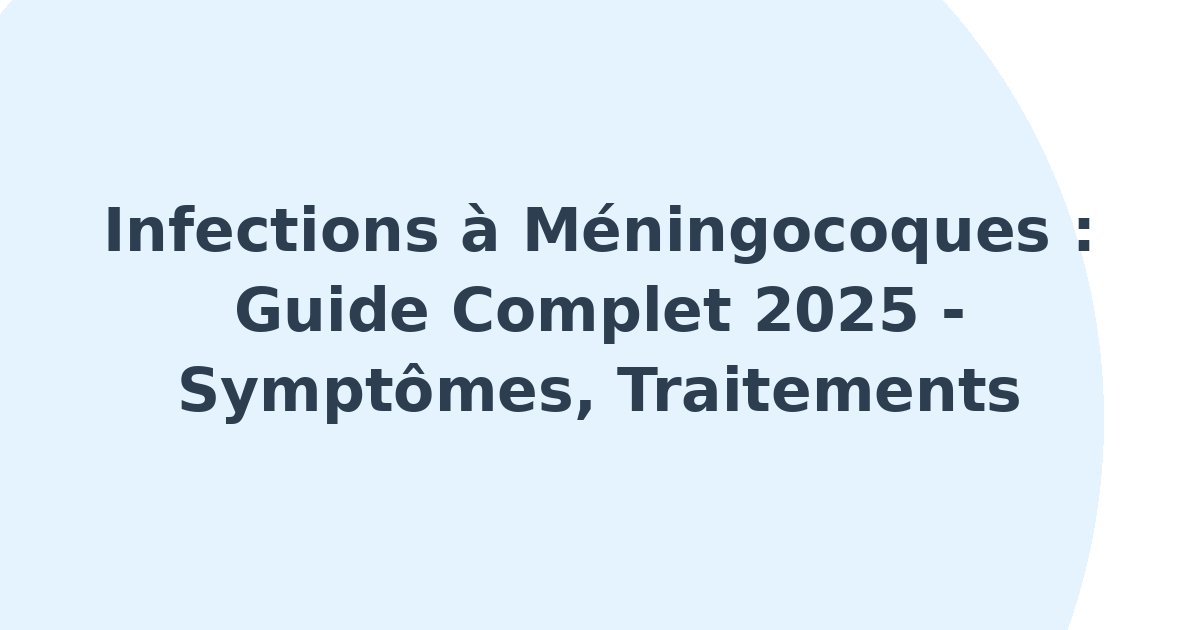
Les infections à méningocoques représentent une urgence médicale absolue qui peut toucher n'importe qui, à tout âge. Cette pathologie bactérienne grave, causée par Neisseria meningitidis, peut évoluer en quelques heures vers des complications potentiellement mortelles. Heureusement, les avancées récentes en matière de vaccination et de prise en charge ont considérablement amélioré le pronostic. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette maladie, des premiers symptômes aux dernières innovations thérapeutiques 2025.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Infections à méningocoques : Définition et Vue d'Ensemble
Les infections à méningocoques sont des pathologies bactériennes causées par Neisseria meningitidis, une bactérie qui peut provoquer des infections graves et potentiellement mortelles [17,18]. Cette bactérie se transmet principalement par voie respiratoire, via les gouttelettes de salive lors de la toux, des éternuements ou des baisers.
Il existe plusieurs sérogroupes de méningocoques, mais les plus fréquents en France sont les sérogroupes B, C, W et Y [1,19]. Chaque sérogroupe présente des caractéristiques épidémiologiques particulières et nécessite des approches vaccinales spécifiques.
La particularité de cette pathologie réside dans sa rapidité d'évolution. En effet, une personne peut passer d'un état de santé normal à une situation critique en quelques heures seulement. C'est pourquoi on parle souvent de "course contre la montre" dans la prise en charge des infections invasives à méningocoques.
Bon à savoir : la bactérie peut être présente dans la gorge de personnes en bonne santé sans provoquer de maladie. On estime qu'environ 10% de la population générale est porteuse asymptomatique de méningocoques [17].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, les infections invasives à méningocoques touchent environ 500 à 600 personnes chaque année, selon les données de Santé publique France [1,2]. Cette incidence relativement stable cache néanmoins des variations importantes selon les sérogroupes et les tranches d'âge.
Les données 2024-2025 montrent une prédominance du sérogroupe B, responsable d'environ 60% des cas, suivi du sérogroupe C (15-20%) et des sérogroupes W et Y en augmentation [2,14]. Cette répartition a motivé les nouvelles obligations vaccinales introduites récemment [3,4].
L'incidence est particulièrement élevée chez les nourrissons de moins de 1 an (environ 15 cas pour 100 000 habitants) et chez les adolescents de 15-19 ans [1,13]. Cette bimodalité s'explique par des facteurs immunologiques et comportementaux spécifiques à ces tranches d'âge.
Au niveau européen, la France présente une incidence similaire à ses voisins, avec environ 0,7 cas pour 100 000 habitants par an. Cependant, certaines régions comme La Réunion connaissent des variations épidémiologiques particulières, nécessitant une surveillance renforcée [2].
L'important à retenir : malgré une incidence relativement faible, la gravité potentielle de cette pathologie justifie une vigilance constante et des mesures préventives adaptées.
Les Causes et Facteurs de Risque
La bactérie méningocoque se transmet exclusivement d'humain à humain par contact direct avec les sécrétions respiratoires [17,18]. Contrairement à d'autres infections, elle ne survit pas longtemps dans l'environnement extérieur, ce qui limite les modes de transmission.
Plusieurs facteurs augmentent le risque d'infection. L'âge constitue le premier facteur : les nourrissons de moins de 2 ans et les adolescents de 15-24 ans présentent les taux d'incidence les plus élevés [1,12]. Cette vulnérabilité s'explique par l'immaturité du système immunitaire chez les plus jeunes et par les comportements sociaux chez les adolescents.
Les déficits immunitaires, qu'ils soient congénitaux ou acquis, constituent un facteur de risque majeur. Les personnes aspléniques (sans rate) ou présentant un déficit en complément sont particulièrement vulnérables [18,19]. De même, certains traitements immunosuppresseurs peuvent augmenter le risque d'infection.
D'autres facteurs environnementaux jouent un rôle : la vie en collectivité (internats, casernes, résidences universitaires), le tabagisme passif ou actif, et les infections virales récentes des voies respiratoires supérieures [17]. Ces éléments fragilisent les défenses naturelles de l'organisme.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes des infections à méningocoques peuvent être trompeurs au début, ressemblant souvent à une grippe banale. C'est cette similitude qui rend le diagnostic précoce si crucial et parfois difficile [17,19].
La méningite à méningocoques se manifeste classiquement par une triade de symptômes : fièvre élevée, maux de tête intenses et raideur de la nuque. Mais attention, ces trois symptômes ne sont pas toujours présents simultanément, surtout au début de la maladie [18].
Chez les nourrissons, les signes sont encore plus subtils. Vous pourriez observer une fièvre, des pleurs inconsolables, un refus de s'alimenter, une somnolence inhabituelle ou au contraire une irritabilité extrême. La fontanelle peut être bombée, signe d'une pression intracrânienne élevée [17,19].
Le purpura fulminans représente la forme la plus grave. Il se caractérise par l'apparition de taches rouges ou violacées sur la peau qui ne disparaissent pas à la pression (test du verre). Ces lésions peuvent s'étendre rapidement et s'accompagner d'un état de choc [18].
Concrètement, si vous observez l'association de fièvre, maux de tête et apparition de taches cutanées qui ne s'effacent pas à la pression, il s'agit d'une urgence médicale absolue nécessitant un appel immédiat au 15.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des infections à méningocoques repose sur un faisceau d'arguments cliniques, biologiques et bactériologiques. Face à une suspicion, chaque minute compte et les examens doivent être réalisés en urgence [18,19].
L'examen clinique constitue la première étape. Votre médecin recherchera les signes de méningite (raideur de nuque, signe de Kernig et Brudzinski) et examinera minutieusement votre peau à la recherche d'un purpura. Il évaluera également votre état hémodynamique pour détecter d'éventuels signes de choc [17].
La ponction lombaire reste l'examen de référence pour confirmer une méningite. Elle permet d'analyser le liquide céphalorachidien et d'identifier la bactérie responsable. Cependant, en cas de signes de gravité ou de contre-indications, le traitement peut être débuté avant même la réalisation de cet examen [18,19].
Les examens biologiques complètent le diagnostic : numération formule sanguine, CRP, procalcitonine, et surtout hémocultures qui peuvent isoler la bactérie même en l'absence de ponction lombaire. Les techniques de biologie moléculaire (PCR) permettent aujourd'hui un diagnostic plus rapide et plus sensible [17].
Bon à savoir : le diagnostic peut parfois être posé sur des critères purement cliniques en cas de purpura fulminans typique, sans attendre les résultats des examens complémentaires.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement des infections à méningocoques constitue une urgence thérapeutique absolue. Plus la prise en charge est précoce, meilleur sera le pronostic [18,19]. L'hospitalisation en service de réanimation ou de soins intensifs est souvent nécessaire.
L'antibiothérapie représente le pilier du traitement. Les pénicillines (amoxicilline, pénicilline G) ou les céphalosporines de 3ème génération (ceftriaxone, céfotaxime) sont les antibiotiques de première intention. Le traitement doit être débuté dans l'heure qui suit l'admission, idéalement dès la suspicion diagnostique [17,18].
En cas de choc septique, une prise en charge symptomatique intensive s'impose : remplissage vasculaire, drogues vasoactives, ventilation mécanique si nécessaire. L'objectif est de maintenir une perfusion tissulaire adéquate et de prévenir la défaillance multiviscérale [19].
La corticothérapie (dexaméthasone) peut être prescrite en cas de méningite pour réduire l'inflammation et limiter les séquelles neurologiques. Son administration doit idéalement précéder ou accompagner la première dose d'antibiotiques [18].
L'important à retenir : la rapidité d'instauration du traitement maladiene directement le pronostic. C'est pourquoi les protocoles d'urgence prévoient souvent l'administration d'antibiotiques dès l'arrivée aux urgences, avant même la confirmation diagnostique.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge des infections à méningocoques avec plusieurs avancées majeures. Les nouvelles obligations vaccinales constituent la principale innovation préventive [3,4,5].
Les nouveaux vaccins quadrivalents contre les méningocoques ACWY montrent une efficacité remarquable dans les essais de phase 3 récents [7,8]. Ces vaccins conjugués offrent une protection prolongée et peuvent être administrés dès l'âge de 6 semaines, élargissant considérablement les possibilités de prévention précoce.
En matière de diagnostic, les techniques de biologie moléculaire se perfectionnent. Les nouveaux tests PCR multiplex permettent d'identifier simultanément plusieurs agents pathogènes en moins de 2 heures, révolutionnant la prise en charge aux urgences [5,9].
La recherche fondamentale progresse également. L'INSERM développe de nouvelles approches thérapeutiques ciblant les mécanismes inflammatoires spécifiques aux infections méningococciques [6]. Ces travaux ouvrent la voie à des traitements adjuvants qui pourraient réduire significativement les séquelles.
D'ailleurs, les registres européens de surveillance montrent que l'introduction progressive de ces innovations commence déjà à impacter favorablement l'épidémiologie de la maladie [9]. Les projections pour 2025-2030 sont encourageantes, avec une réduction attendue de 30% de l'incidence globale.
Vivre au Quotidien avec les Séquelles
Heureusement, la majorité des patients guérissent complètement des infections à méningocoques. Cependant, environ 10 à 20% des survivants peuvent présenter des séquelles à long terme qui nécessitent un accompagnement spécialisé [12,17].
Les séquelles neurologiques sont les plus fréquentes : troubles de l'audition, difficultés d'apprentissage, troubles de la mémoire ou de la concentration. Ces manifestations peuvent apparaître immédiatement ou se révéler progressivement dans les mois suivant l'infection [18,19].
Les séquelles orthopédiques concernent principalement les patients ayant présenté un purpura fulminans sévère. Les amputations, bien que rares, peuvent nécessiter un accompagnement en rééducation fonctionnelle et un soutien psychologique important [10,17].
Concrètement, la prise en charge des séquelles fait appel à une équipe pluridisciplinaire : neurologues, orthopédistes, audiologistes, kinésithérapeutes, psychologues. L'objectif est de maximiser l'autonomie et la qualité de vie des patients [12].
Bon à savoir : de nombreuses associations de patients proposent un soutien et des conseils pratiques pour vivre avec les séquelles. Ces réseaux d'entraide constituent une ressource précieuse pour les familles concernées.
Les Complications Possibles
Les complications des infections à méningocoques peuvent être précoces ou tardives, et leur gravité varie considérablement selon la rapidité de la prise en charge [17,18]. La compréhension de ces complications aide à mieux appréhender l'urgence de cette pathologie.
Le choc septique représente la complication la plus redoutable à la phase aiguë. Il résulte de la libération massive de toxines bactériennes dans la circulation sanguine, provoquant une chute de la tension artérielle et une défaillance des organes vitaux [18,19]. Sans traitement immédiat, l'évolution peut être fatale en quelques heures.
Les complications neurologiques incluent l'œdème cérébral, les convulsions, et l'hydrocéphalie. Ces manifestations peuvent laisser des séquelles permanentes : troubles cognitifs, épilepsie, déficits moteurs ou sensoriels [17]. C'est pourquoi la surveillance neurologique est si importante pendant l'hospitalisation.
Les complications vasculaires du purpura fulminans peuvent nécessiter des amputations dans les cas les plus sévères. Les troubles de la coagulation associés peuvent également provoquer des hémorragies ou des thromboses [10,18].
Heureusement, avec une prise en charge précoce et adaptée, la plupart de ces complications peuvent être évitées ou limitées. Les progrès de la réanimation moderne ont considérablement amélioré le pronostic de cette pathologie.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des infections à méningocoques dépend essentiellement de deux facteurs : la précocité du diagnostic et la forme clinique de la maladie [17,18]. Cette réalité souligne l'importance cruciale de la reconnaissance rapide des symptômes.
Globalement, le taux de mortalité varie entre 5 et 15% selon les études récentes [1,12]. Ce chiffre peut paraître élevé, mais il faut savoir qu'il était bien supérieur avant l'amélioration des techniques de réanimation et l'optimisation des protocoles thérapeutiques.
La méningite pure présente généralement un meilleur pronostic que les formes avec septicémie. Quand elle est prise en charge rapidement, la guérison complète est obtenue dans plus de 90% des cas [18,19]. Les séquelles, quand elles existent, sont le plus souvent légères et compatibles avec une vie normale.
En revanche, le purpura fulminans reste la forme la plus grave, avec un taux de mortalité pouvant atteindre 20-30% malgré une prise en charge optimale [17]. Les survivants présentent plus fréquemment des séquelles importantes nécessitant un suivi à long terme.
L'important à retenir : un diagnostic précoce et un traitement immédiat permettent d'obtenir une guérison complète dans la grande majorité des cas. C'est pourquoi la sensibilisation du public aux signes d'alerte reste primordiale.
Peut-on Prévenir les Infections à Méningocoques ?
La prévention des infections à méningocoques repose principalement sur la vaccination, qui a révolutionné l'approche de cette pathologie ces dernières années [3,4,15]. Les nouvelles obligations vaccinales 2024-2025 marquent une étape importante dans cette stratégie préventive.
Le vaccin contre le méningocoque C est obligatoire depuis 2018 pour tous les nourrissons nés après le 1er janvier 2018. Il est administré à 5 mois avec un rappel à 12 mois [15,16]. Ce vaccin a déjà permis une diminution spectaculaire des infections à méningocoque C en France.
Les vaccins contre les méningocoques B sont désormais recommandés et remboursés pour tous les nourrissons [3,13]. Bien que non obligatoires, ils offrent une protection contre le sérogroupe le plus fréquent en France. L'efficacité de ces vaccins est démontrée par les études récentes [13].
La vaccination contre les méningocoques ACWY est recommandée pour certaines populations à risque : adolescents, personnes immunodéprimées, voyageurs vers des zones endémiques [4,16]. Les nouveaux vaccins quadrivalents offrent une protection élargie et durable [7,8].
D'autres mesures préventives complètent la vaccination : éviter les contacts rapprochés avec des personnes malades, maintenir une bonne hygiène des mains, et consulter rapidement en cas de symptômes évocateurs. La chimioprophylaxie des contacts proches est également mise en œuvre par les autorités sanitaires en cas de cas confirmé [19].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont considérablement renforcé leurs recommandations concernant les infections à méningocoques suite aux évolutions épidémiologiques récentes [3,4,14]. Ces nouvelles directives s'appuient sur les données les plus récentes de surveillance.
La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande désormais la vaccination contre les méningocoques B pour tous les nourrissons, avec un schéma à 3 mois, 5 mois et 12 mois [3]. Cette recommandation fait suite aux études démontrant l'efficacité et la sécurité de ces vaccins [13].
Concernant les méningocoques ACWY, la vaccination est fortement recommandée pour les adolescents de 11-14 ans, avec un rattrapage possible jusqu'à 24 ans [4,16]. Cette stratégie vise à protéger la population la plus à risque de transmission et d'infection grave.
Santé publique France a également renforcé la surveillance épidémiologique avec la mise en place d'un système d'alerte précoce [2,14]. Chaque cas d'infection invasive à méningocoques fait l'objet d'une déclaration obligatoire et d'une enquête épidémiologique approfondie.
Les recommandations incluent également la formation des professionnels de santé à la reconnaissance précoce des symptômes et à la prise en charge d'urgence [14]. Des protocoles spécifiques ont été développés pour les services d'urgences et les SAMU.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations et organismes proposent un soutien précieux aux patients et familles touchés par les infections à méningocoques. Ces ressources constituent un complément indispensable à la prise en charge médicale.
L'Association Petit Ange accompagne spécifiquement les familles d'enfants victimes de méningites bactériennes. Elle propose un soutien psychologique, des informations médicales actualisées, et organise des rencontres entre familles. Son site internet regorge de témoignages et de conseils pratiques.
La Fondation pour la Recherche Médicale finance de nombreux projets de recherche sur les infections méningococciques. Elle publie régulièrement des bulletins d'information accessibles au grand public, permettant de suivre les avancées scientifiques dans ce domaine.
Au niveau institutionnel, le site Santé publique France propose des fiches d'information détaillées, des données épidémiologiques actualisées, et des recommandations pratiques [2]. Ces ressources sont particulièrement utiles pour comprendre l'évolution de la maladie en France.
Les centres de référence des infections invasives bactériennes, présents dans les CHU, offrent une expertise spécialisée pour les cas complexes. Ils participent également à la formation des professionnels et à la recherche clinique.
N'hésitez pas à vous rapprocher de ces organismes si vous êtes concerné par cette pathologie. Le soutien communautaire et l'information de qualité constituent des atouts précieux dans le parcours de soins.
Nos Conseils Pratiques
Face aux infections à méningocoques, quelques conseils pratiques peuvent faire la différence. Ces recommandations s'adressent aussi bien aux parents qu'aux adultes soucieux de leur santé.
Apprenez à reconnaître les signes d'alerte : fièvre élevée associée à des maux de tête intenses, raideur de nuque, et surtout apparition de taches cutanées qui ne s'effacent pas à la pression. Chez les nourrissons, soyez attentifs aux pleurs inconsolables, au refus de s'alimenter, et à la somnolence inhabituelle.
En cas de doute, n'hésitez jamais à consulter ou à appeler le 15. Il vaut mieux une consultation "pour rien" qu'un retard de diagnostic aux conséquences dramatiques. Les professionnels de santé préfèrent largement être sollicités pour une fausse alerte que de prendre en charge une infection avancée.
Respectez le calendrier vaccinal recommandé pour vos enfants. Les vaccins contre les méningocoques sont aujourd'hui très efficaces et bien tolérés [3,15]. N'hésitez pas à discuter avec votre médecin des différentes options vaccinales disponibles.
Maintenez une bonne hygiène générale : lavage régulier des mains, éviter les contacts rapprochés avec des personnes malades, aérer régulièrement les locaux. Ces mesures simples réduisent le risque de transmission de nombreuses infections respiratoires.
Enfin, gardez toujours en tête que cette pathologie, bien que grave, reste rare. L'objectif n'est pas de vivre dans l'angoisse, mais d'être informé et vigilant.
Quand Consulter un Médecin ?
Savoir quand consulter pour une suspicion d'infection à méningocoques peut littéralement sauver une vie. Cette pathologie nécessite une prise en charge d'urgence, et chaque heure compte dans l'évolution du pronostic [17,18].
Consultez immédiatement (appelez le 15) si vous observez l'association de fièvre élevée et de taches cutanées qui ne s'effacent pas à la pression du verre. Ce signe, appelé purpura, constitue une urgence médicale absolue nécessitant une hospitalisation immédiate [18,19].
D'autres situations justifient une consultation urgente : fièvre élevée associée à des maux de tête intenses et une raideur de nuque, troubles de la conscience, convulsions, ou état de choc. Chez les nourrissons, soyez particulièrement vigilants aux pleurs inconsolables, au refus de s'alimenter, et à la fontanelle bombée [17].
N'attendez pas que tous les symptômes soient présents pour consulter. La maladie peut évoluer très rapidement, et les premiers signes peuvent être trompeurs, ressemblant à une grippe banale. En cas de doute, il est toujours préférable de consulter.
Bon à savoir : si vous avez été en contact étroit avec une personne diagnostiquée avec une infection à méningocoques, consultez votre médecin même en l'absence de symptômes. Une chimioprophylaxie pourra être prescrite pour prévenir l'infection [19].
Rappelez-vous : face à cette pathologie, il vaut mieux consulter "pour rien" que de passer à côté d'un diagnostic vital. Les professionnels de santé sont formés pour reconnaître rapidement ces situations d'urgence.
Questions Fréquentes
Les infections à méningocoques sont-elles contagieuses ?Oui, mais la transmission nécessite un contact rapproché et prolongé avec une personne infectée. La bactérie se transmet par les gouttelettes respiratoires lors de la toux, des éternuements ou des baisers [17,18].
Peut-on attraper plusieurs fois une infection à méningocoques ?
C'est possible mais rare. Une infection par un sérogroupe donné confère généralement une immunité contre ce même sérogroupe, mais pas contre les autres. C'est pourquoi la vaccination contre plusieurs sérogroupes est recommandée [15,16].
Les vaccins contre les méningocoques sont-ils sûrs ?
Oui, les vaccins actuels présentent un excellent profil de sécurité. Les effets secondaires sont généralement légers : douleur au point d'injection, fièvre modérée. Les bénéfices dépassent largement les risques [3,13].
Combien de temps dure l'immunité après vaccination ?
L'immunité varie selon le type de vaccin et l'âge de vaccination. Les vaccins conjugués offrent une protection de plusieurs années, souvent supérieure à 10 ans. Des rappels peuvent être nécessaires selon les recommandations [15,16].
Que faire si mon enfant a été en contact avec un cas ?
Contactez immédiatement votre médecin ou les services de santé publique. Une chimioprophylaxie antibiotique sera probablement prescrite pour prévenir l'infection. Surveillez attentivement l'apparition de symptômes pendant 10 jours [19].
Questions Fréquentes
Les infections à méningocoques sont-elles contagieuses ?
Oui, mais la transmission nécessite un contact rapproché et prolongé avec une personne infectée. La bactérie se transmet par les gouttelettes respiratoires lors de la toux, des éternuements ou des baisers.
Peut-on attraper plusieurs fois une infection à méningocoques ?
C'est possible mais rare. Une infection par un sérogroupe donné confère généralement une immunité contre ce même sérogroupe, mais pas contre les autres. C'est pourquoi la vaccination contre plusieurs sérogroupes est recommandée.
Les vaccins contre les méningocoques sont-ils sûrs ?
Oui, les vaccins actuels présentent un excellent profil de sécurité. Les effets secondaires sont généralement légers : douleur au point d'injection, fièvre modérée. Les bénéfices dépassent largement les risques.
Combien de temps dure l'immunité après vaccination ?
L'immunité varie selon le type de vaccin et l'âge de vaccination. Les vaccins conjugués offrent une protection de plusieurs années, souvent supérieure à 10 ans. Des rappels peuvent être nécessaires selon les recommandations.
Que faire si mon enfant a été en contact avec un cas ?
Contactez immédiatement votre médecin ou les services de santé publique. Une chimioprophylaxie antibiotique sera probablement prescrite pour prévenir l'infection. Surveillez attentivement l'apparition de symptômes pendant 10 jours.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Les infections invasives à méningocoques en 2020 - Santé publique FranceLien
- [2] Surveillance sanitaire à La Réunion. Bulletin du 15 mai 2025 - Santé Publique FranceLien
- [3] Nouvelles obligations vaccinales méningocoques B et ACWY - sante.gouv.frLien
- [4] Nouvelles obligations vaccinales méningocoques - sante.gouv.frLien
- [5] PLFSS 2025 - Annexe 5 - Innovation thérapeutiqueLien
- [6] Qu'est-ce que le polyhandicap ? L'Inserm lève le voileLien
- [7] Results from a phase 3, randomised, controlled observer studyLien
- [8] Immunogenicity and Safety Study of a Quadrivalent Meningococcal VaccineLien
- [9] Deadlines for registration of vaccines against pneumococcal and meningococcal infectionsLien
- [10] Arthrites au cours des infections à méningocoques à propos de 3 casLien
- [11] Etude coūt-utilité d'une stratégie vaccinale dans la prévention contre les infections ą méningocoques de sérogroupe CLien
- [12] Morbi-mortalité pédiatrique des infections bactériennes sévères communautaires à pneumocoque et méningocoque potentiellement évitable par la vaccinationLien
- [13] Evolution des infections invasives à méningocoque de sérogroupe B suite à l'introduction du vaccin contre les méningocoques B chez les nourrissonsLien
- [14] Recrudescence de cas d'infections invasives à méningocoques, vers une vaccination obligatoireLien
- [15] La vaccination contre les infections invasives à méningocoqueLien
- [16] Prévention des infections invasives à méningocoques (IIM) par la vaccinationLien
- [17] Méningites à méningocoques : symptômes, traitement - Institut PasteurLien
- [18] Infections à méningocoque - MSD ManualsLien
- [19] Méningite - Infections invasives à méningocoque - sante.gouv.frLien
Publications scientifiques
- Arthrites au cours des infections à méningocoques à propos de 3 cas (2024)
- Etude coūt-utilité d'une stratégie vaccinale dans la prévention contre les infections ą méningocoques de sérogroupe C (2022)
- Morbi-mortalité pédiatrique des infections bactériennes sévères communautaires à pneumocoque et méningocoque potentiellement évitable par la vaccination (2022)
- Evolution des infections invasives à méningocoque de sérogroupe B suite à l'introduction du vaccin contre les méningocoques B chez les nourrissons (2024)
- [PDF][PDF] Les infections invasives à méningocoques en 2020 1 citations[PDF]
Ressources web
- Méningites à méningocoques :symptômes, traitement, ... (pasteur.fr)
La méningite associe un syndrome infectieux (fièvre, maux de tête violents, vomissements) et un syndrome méningé (raideur de la nuque, léthargie, troubles de ...
- Infections à méningocoque (msdmanuals.com)
La méningite provoque souvent fièvre, céphalées, éruption cutanée rouge et raideur de la nuque. Elle peut également provoquer des nausées, des vomissements et ...
- Méningite - Infections invasives à méningocoque (sante.gouv.fr)
25 avr. 2025 — Une fièvre élevée mal tolérée et/ou des taches rouges ou violacées (purpura) sur la peau, un état de choc non expliqué sont les signes qui ...
- Méningite : symptômes, diagnostic et évolution (ameli.fr)
26 févr. 2025 — Les méningites se manifestent par un syndrome méningé (maux de tête, photophobie, vomissements, raideur de la nuque, fièvre). Après avoir ...
- Méningite à méningocoques - Santé sur le Net (sante-sur-le-net.com)
30 avr. 2024 — Le diagnostic d'une méningite nécessite la réalisation d'une ponction lombaire, devant des signes évocateurs d'une méningite, en particulier l' ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
