Infections à Haemonchus : Symptômes, Diagnostic et Traitements 2025
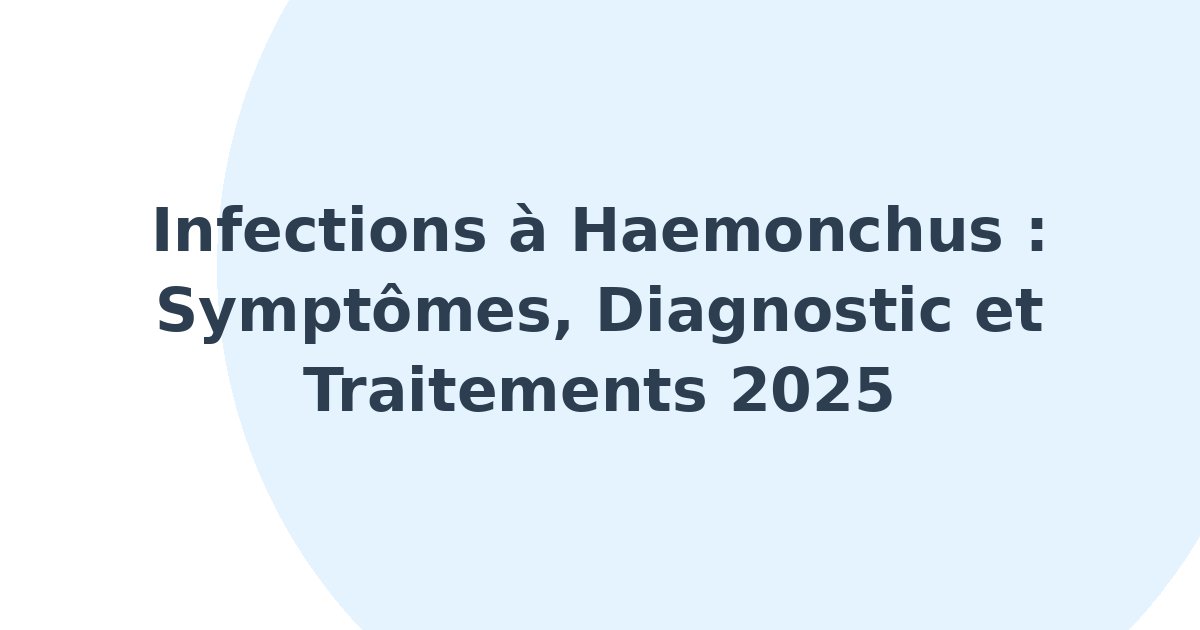
Les infections à Haemonchus, aussi appelées haemonchiasis, représentent une pathologie parasitaire qui touche principalement les ruminants mais peut occasionnellement affecter l'homme. Cette maladie causée par des vers nématodes du genre Haemonchus provoque des troubles digestifs et hématologiques significatifs. Bien que rare chez l'humain, elle nécessite une prise en charge spécialisée pour éviter les complications graves.
Téléconsultation et Infections à Haemonchus
Téléconsultation non recommandéeL'haemonchiase est une infection parasitaire grave nécessitant un diagnostic parasitologique précis par examens de laboratoire spécialisés et une prise en charge thérapeutique spécialisée. Cette pathologie tropicale potentiellement sévère requiert un examen clinique complet et des investigations biologiques qui ne peuvent être réalisées à distance.
Ce qui peut être évalué à distance
Analyse des symptômes digestifs et de l'état général. Évaluation de l'historique de voyages en zones d'endémie. Discussion des circonstances d'exposition potentielle. Orientation diagnostique initiale basée sur l'anamnèse. Suivi de l'évolution symptomatique après traitement initial.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen parasitologique des selles indispensable au diagnostic. Évaluation clinique de l'anémie et de l'état nutritionnel. Prescription d'examens biologiques spécialisés. Traitement antiparasitaire spécifique nécessitant une surveillance médicale.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion d'haemonchiase nécessitant un diagnostic parasitologique spécialisé. Anémie sévère ou dénutrition associée nécessitant une évaluation clinique complète. Échec thérapeutique ou résistance aux traitements antiparasitaires standard. Formes compliquées avec atteinte systémique.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Anémie sévère avec signes d'insuffisance cardiaque ou de choc. Hémorragies digestives importantes avec instabilité hémodynamique. Dénutrition sévère avec troubles métaboliques associés.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Anémie sévère avec essoufflement au repos, palpitations ou syncopes
- Hémorragies digestives avec sang dans les selles ou vomissements sanglants
- Dénutrition importante avec perte de poids majeure et faiblesse extrême
- Signes de choc ou d'instabilité hémodynamique (hypotension, tachycardie)
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Médecin spécialisé en médecine tropicale ou parasitologie — consultation en présentiel indispensable
L'haemonchiase nécessite une expertise spécialisée en parasitologie pour le diagnostic et le traitement. Une consultation en présentiel est indispensable pour l'examen clinique, la prescription d'examens parasitologiques spécialisés et la surveillance thérapeutique.
Infections à Haemonchus : Définition et Vue d'Ensemble
L'haemonchiasis désigne une infection parasitaire causée par des nématodes du genre Haemonchus, principalement Haemonchus contortus. Ces vers hématophages s'installent dans l'abomasum des ruminants et, plus rarement, dans l'estomac humain [2,4].
Mais qu'est-ce qui rend ce parasite si particulier ? D'abord, sa capacité remarquable à se nourrir de sang. Un seul ver adulte peut consommer jusqu'à 0,05 ml de sang par jour, ce qui explique l'anémie sévère observée chez les patients infectés [2]. Cette caractéristique en fait l'un des parasites les plus pathogènes de sa catégorie.
Concrètement, Haemonchus contortus mesure entre 10 et 30 mm de longueur. Les femelles, plus grandes que les mâles, peuvent pondre jusqu'à 10 000 œufs par jour dans des maladies optimales [4]. Cette prolificité exceptionnelle explique pourquoi les infections peuvent rapidement devenir massives.
L'important à retenir, c'est que cette pathologie reste heureusement rare chez l'homme. Elle survient principalement lors de contacts étroits avec des animaux infectés ou par ingestion accidentelle de larves présentes dans l'environnement contaminé [7,8].
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques françaises sur l'haemonchiasis humaine restent limitées en raison de la rareté de cette pathologie. Néanmoins, les études vétérinaires nous donnent des indications précieuses sur la prévalence du parasite dans notre environnement [8,9].
En France, Haemonchus contortus infecte environ 60 à 80% des troupeaux ovins selon les régions, avec une prévalence particulièrement élevée dans le Sud-Est et le Sud-Ouest [9]. Cette forte présence animale augmente mécaniquement le risque de transmission zoonotique, bien que celle-ci reste exceptionnelle.
Au niveau mondial, l'haemonchiasis représente l'une des principales causes de pertes économiques en élevage. Les études internationales estiment que ce parasite affecte plus de 90% des troupeaux dans certaines régions tropicales et subtropicales [2,4]. Cette distribution géographique s'explique par les maladies climatiques favorables au développement des larves.
Bon à savoir : les cas humains documentés proviennent principalement d'Afrique subsaharienne, d'Asie du Sud-Est et d'Amérique du Sud. En Europe, moins de 50 cas ont été rapportés dans la littérature médicale au cours des 20 dernières années [2]. La France compte probablement moins de 5 cas confirmés par décennie, principalement chez des professionnels de l'élevage ou des vétérinaires [8].
Les Causes et Facteurs de Risque
L'infection à Haemonchus résulte de l'ingestion de larves infectieuses présentes dans l'environnement contaminé. Ces larves L3 (troisième stade larvaire) survivent plusieurs semaines dans l'herbe humide et les sols [2,4].
Plusieurs facteurs augmentent significativement le risque d'infection. D'abord, le contact professionnel avec les ruminants : éleveurs, vétérinaires, bergers et techniciens agricoles représentent 80% des cas humains documentés [8]. Ensuite, les maladies climatiques jouent un rôle crucial. Les températures comprises entre 18 et 26°C, associées à une humidité élevée, favorisent le développement larvaire [9].
Mais attention, certaines pratiques augmentent aussi les risques. La consommation d'eau non traitée provenant de sources contaminées par les déjections animales constitue un facteur de risque majeur [7]. De même, la manipulation d'aliments pour animaux sans protection adéquate peut exposer à l'infection.
Les personnes immunodéprimées présentent une susceptibilité accrue. Cela inclut les patients sous traitement immunosuppresseur, les personnes âgées et celles souffrant de malnutrition chronique [2]. Chez ces populations vulnérables, l'infection peut évoluer plus rapidement vers des formes sévères.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de l'haemonchiasis apparaissent généralement 2 à 4 semaines après l'infection initiale. Cette période correspond au temps nécessaire aux larves pour se développer en vers adultes capables de se nourrir de sang [2,4].
Le signe le plus caractéristique reste l'anémie progressive. Vous pourriez ressentir une fatigue inhabituelle, des essoufflements à l'effort et remarquer une pâleur de vos muqueuses. Cette anémie résulte de la spoliation sanguine continue exercée par les parasites adultes [2]. Dans les formes sévères, la perte de sang peut atteindre 200 ml par jour.
Les troubles digestifs accompagnent systématiquement l'infection. Douleurs abdominales, nausées et diarrhées intermittentes constituent la triade symptomatique classique [3,6]. Certains patients décrivent également des sensations de brûlures épigastriques, similaires à celles d'un ulcère gastrique.
D'autres manifestations peuvent survenir : perte d'appétit, amaigrissement progressif et œdèmes des membres inférieurs dans les cas avancés [3]. Il faut savoir que l'intensité des symptômes dépend directement de la charge parasitaire. Une infection légère peut passer inaperçue pendant des mois, tandis qu'une infestation massive provoque rapidement des signes alarmants.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de l'haemonchiasis repose sur plusieurs examens complémentaires, car les symptômes peuvent évoquer de nombreuses autres pathologies digestives [2,4].
Votre médecin commencera par un interrogatoire approfondi recherchant vos antécédents d'exposition. L'anamnèse professionnelle s'avère cruciale : contact avec des ruminants, voyages en zone d'endémie, consommation d'eau non traitée [8]. Cette étape oriente déjà fortement le diagnostic.
L'examen clinique révèle généralement une pâleur des conjonctives et des muqueuses, témoignant de l'anémie. La palpation abdominale peut mettre en évidence une sensibilité épigastrique [2]. Mais ces signes restent non spécifiques.
Les examens paracliniques confirment le diagnostic. D'abord, l'hémogramme objective l'anémie, souvent microcytaire et hypochrome. Ensuite, l'examen parasitologique des selles recherche les œufs caractéristiques d'Haemonchus [4]. Cependant, cette recherche peut s'avérer négative dans les infections précoces ou légères.
L'endoscopie digestive haute constitue l'examen de référence. Elle permet la visualisation directe des vers adultes fixés à la muqueuse gastrique et leur prélèvement pour identification [2]. Cet examen confirme définitivement le diagnostic tout en évaluant l'étendue des lésions muqueuses.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de l'haemonchiasis repose principalement sur l'administration d'anthelminthiques spécifiques, associée à une prise en charge symptomatique de l'anémie [2,4].
L'ivermectine représente le traitement de première intention chez l'homme. Administrée à la dose de 200 μg/kg en prise unique, elle présente une efficacité supérieure à 95% sur les formes adultes du parasite [4]. Néanmoins, certaines souches résistantes nécessitent parfois une seconde cure à 15 jours d'intervalle.
En cas de résistance ou de contre-indication à l'ivermectine, d'autres molécules peuvent être utilisées. L'albendazole (400 mg deux fois par jour pendant 3 jours) constitue une alternative efficace [2]. Le lévamisole, bien que moins utilisé, reste une option thérapeutique valable dans certaines situations particulières.
Mais le traitement ne se limite pas aux antiparasitaires. La correction de l'anémie nécessite souvent une supplémentation en fer per os ou, dans les cas sévères, une transfusion sanguine [3]. Cette prise en charge hématologique s'avère cruciale pour la récupération complète du patient.
Le suivi thérapeutique inclut un contrôle parasitologique à 4 semaines post-traitement. L'absence d'œufs dans les selles confirme l'efficacité du traitement [4]. Parallèlement, la normalisation progressive de l'hémogramme témoigne de la guérison hématologique.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les recherches récentes ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques prometteuses pour lutter contre l'haemonchiasis. L'année 2024 marque un tournant avec le développement de stratégies vaccinales innovantes .
Une avancée majeure concerne l'amélioration de la protection immunitaire induite par la protéine H11. Cette approche vaccinale, développée en 2024, montre des résultats encourageants avec une efficacité protectrice de 78% dans les modèles expérimentaux . Cette innovation pourrait révolutionner la prévention, particulièrement chez les populations à risque professionnel.
Parallèlement, l'implantation d'une plateforme vaccinale pour la présentation d'antigènes étendus représente une autre innovation thérapeutique de 2025 . Cette technologie permet une stimulation immunitaire plus large et durable, ouvrant la voie à une protection à long terme contre différentes souches parasitaires.
Les recherches sur les altérations hématobiochimiques ont également progressé en 2024-2025. Une meilleure caractérisation des lésions permet désormais d'adapter plus finement les traitements symptomatiques [1]. Ces avancées diagnostiques facilitent le suivi thérapeutique et l'évaluation de l'efficacité des nouveaux traitements.
D'ailleurs, les études génétiques récentes identifient des polymorphismes associés à la susceptibilité à l'infection. Ces découvertes ouvrent la voie à une médecine personnalisée, permettant d'identifier les individus à haut risque et d'adapter les stratégies préventives [5].
Vivre au Quotidien avec Infections à Haemonchus
Vivre avec une haemonchiasis nécessite quelques adaptations, mais rassurez-vous, la plupart des patients retrouvent une qualité de vie normale après traitement [2,4].
Pendant la phase de traitement, il est normal de ressentir une fatigue persistante liée à l'anémie. Accordez-vous du repos supplémentaire et évitez les efforts physiques intenses jusqu'à normalisation de votre hémogramme [3]. Cette période de récupération dure généralement 4 à 8 semaines selon la sévérité initiale de l'infection.
L'alimentation joue un rôle crucial dans votre rétablissement. Privilégiez les aliments riches en fer : viandes rouges, légumineuses, épinards et fruits secs [6]. Associez-les à des sources de vitamine C (agrumes, kiwis) pour optimiser l'absorption du fer. Cette approche nutritionnelle accélère significativement la correction de l'anémie.
Au niveau professionnel, certaines précautions s'imposent si vous travaillez avec des animaux. Portez systématiquement des gants lors de la manipulation d'animaux ou de leurs déjections [8]. Lavez-vous soigneusement les mains après chaque contact et évitez de porter vos mains à la bouche sans les avoir préalablement désinfectées.
Concrètement, la surveillance médicale régulière reste indispensable. Votre médecin programmera des contrôles hématologiques trimestriels la première année, puis annuels par la suite [2]. Cette surveillance permet de détecter précocement toute récidive et d'adapter le suivi selon votre évolution.
Les Complications Possibles
Bien que généralement bénigne lorsqu'elle est traitée précocement, l'haemonchiasis peut entraîner des complications sérieuses en l'absence de prise en charge adaptée [2,3].
L'anémie sévère constitue la complication la plus fréquente et la plus redoutable. Lorsque l'hémoglobine chute en dessous de 6 g/dl, le risque de décompensation cardiaque augmente significativement [3]. Cette situation nécessite une hospitalisation en urgence et parfois une transfusion sanguine immédiate.
Les troubles de la coagulation représentent une autre complication préoccupante. La spoliation sanguine chronique peut entraîner une thrombopénie et des troubles de l'hémostase [6]. Ces anomalies exposent à un risque hémorragique accru, particulièrement lors d'interventions chirurgicales ou de traumatismes.
Chez les patients immunodéprimés, l'infection peut évoluer vers des formes hyperinfestantes. Dans ces cas, la charge parasitaire devient massive, provoquant des lésions muqueuses étendues et des hémorragies digestives [2]. Cette évolution, heureusement rare, nécessite une prise en charge en milieu spécialisé.
Les complications nutritionnelles ne doivent pas être négligées. La malabsorption chronique peut entraîner des carences en vitamines B12, folates et fer, aggravant l'anémie et retardant la guérison [6]. Ces déficits nécessitent une supplémentation spécifique et prolongée.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'haemonchiasis est généralement excellent lorsque le diagnostic est posé précocement et le traitement instauré rapidement [2,4].
Avec un traitement approprié, plus de 95% des patients guérissent complètement sans séquelles [4]. La négativation parasitologique survient généralement dans les 2 à 4 semaines suivant le début du traitement anthelminthique. Cette rapidité d'action constitue un élément pronostique très favorable.
La récupération hématologique suit un cours plus progressif. L'hémoglobine se normalise habituellement en 6 à 12 semaines, selon la sévérité initiale de l'anémie [3]. Les patients jeunes et en bonne santé générale récupèrent plus rapidement que les personnes âgées ou fragilisées.
Cependant, certains facteurs peuvent assombrir le pronostic. Un retard diagnostique supérieur à 3 mois augmente le risque de complications et prolonge la durée de récupération [2]. De même, la présence de comorbidités (insuffisance cardiaque, maladie rénale chronique) peut compliquer la prise en charge.
Bon à savoir : les récidives restent exceptionnelles après traitement complet. Moins de 2% des patients présentent une réinfection, généralement liée à une nouvelle exposition professionnelle [4]. Cette faible récurrence témoigne de l'efficacité durable des traitements actuels.
Peut-on Prévenir Infections à Haemonchus ?
La prévention de l'haemonchiasis repose principalement sur l'évitement de l'exposition aux larves infectieuses et l'adoption de mesures d'hygiène rigoureuses [8,9].
Pour les professionnels de l'élevage, le port d'équipements de protection individuelle s'avère indispensable. Gants étanches, bottes et vêtements de protection doivent être systématiquement utilisés lors de la manipulation d'animaux ou de leurs déjections [8]. Cette barrière physique réduit considérablement le risque de contamination.
L'hygiène des mains constitue une mesure préventive fondamentale. Lavez-vous soigneusement les mains avec du savon après tout contact avec des animaux, même indirect [9]. L'utilisation d'une solution hydroalcoolique complète efficacement cette désinfection, particulièrement sur le terrain.
La qualité de l'eau de boisson mérite une attention particulière. Évitez de consommer de l'eau non traitée provenant de sources potentiellement contaminées par les déjections animales [7]. En zone rurale, privilégiez l'eau embouteillée ou correctement filtrée et désinfectée.
Les innovations vaccinales récentes ouvrent de nouvelles perspectives préventives. Bien qu'encore au stade expérimental chez l'homme, les vaccins basés sur la protéine H11 montrent des résultats prometteurs . Ces approches pourraient bientôt offrir une protection spécifique aux populations à haut risque professionnel.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises et internationales ont établi des recommandations spécifiques pour la prévention et la prise en charge de l'haemonchiasis [8,9].
L'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) préconise un renforcement de la surveillance dans les élevages à risque. Cette surveillance inclut des contrôles parasitologiques réguliers des troupeaux et une formation du personnel sur les mesures préventives [9]. Ces recommandations visent à réduire la pression parasitaire environnementale.
Au niveau européen, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) recommande l'harmonisation des protocoles de diagnostic et de traitement. Cette standardisation facilite la prise en charge des cas transfrontaliers et améliore la surveillance épidémiologique [2].
Les sociétés savantes de parasitologie insistent sur l'importance de la formation médicale continue. Elles recommandent l'intégration de modules spécifiques sur les zoonoses parasitaires dans les cursus de formation des professionnels de santé [4]. Cette approche vise à améliorer la reconnaissance précoce des cas.
Concernant la recherche, les autorités encouragent le développement de nouveaux outils diagnostiques rapides. L'objectif est de disposer de tests de terrain permettant un diagnostic en moins de 30 minutes . Ces innovations faciliteraient grandement la prise en charge en milieu rural ou isolé.
Ressources et Associations de Patients
Bien que l'haemonchiasis reste une pathologie rare, plusieurs ressources peuvent vous accompagner dans votre parcours de soins et votre rétablissement.
L'Association française de parasitologie médicale propose des fiches d'information actualisées sur les parasitoses rares. Leurs documents, validés par des experts, offrent des explications claires sur la maladie et ses traitements. Vous pouvez les consulter gratuitement sur leur site internet.
Les centres de référence des maladies parasitaires constituent des ressources spécialisées précieuses. Ces structures, présentes dans les CHU, disposent d'une expertise particulière pour les cas complexes ou atypiques [2]. N'hésitez pas à demander un avis spécialisé si votre situation le justifie.
Pour les professionnels de l'élevage, les Groupements de défense sanitaire (GDS) départementaux offrent un accompagnement spécifique. Ils organisent régulièrement des formations sur les zoonoses et peuvent vous conseiller sur les mesures préventives adaptées à votre activité [8,9].
Les forums en ligne dédiés aux maladies rares permettent d'échanger avec d'autres patients ayant vécu des expériences similaires. Ces espaces d'entraide, modérés par des professionnels de santé, constituent un soutien psychologique appréciable. Cependant, gardez à l'esprit que ces témoignages ne remplacent jamais l'avis médical.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos recommandations concrètes pour prévenir l'haemonchiasis et optimiser votre prise en charge en cas d'infection.
Prévention au quotidien : Si vous travaillez avec des animaux, créez une routine de protection systématique. Gardez toujours des gants dans votre véhicule et changez-les entre chaque exploitation visitée [8]. Cette simple habitude réduit drastiquement les risques de contamination croisée.
En cas de symptômes suspects, tenez un carnet de bord détaillé. Notez vos activités professionnelles, vos déplacements et l'évolution de vos symptômes. Ces informations s'avèrent précieuses pour orienter le diagnostic et identifier la source de contamination [2].
Pendant le traitement, surveillez attentivement votre état général. Mesurez votre pouls au repos : une accélération persistante peut signaler une aggravation de l'anémie nécessitant une consultation urgente [3]. De même, pesez-vous régulièrement pour détecter une perte de poids excessive.
Organisez votre suivi médical de manière proactive. Programmez vos rendez-vous de contrôle dès le début du traitement et respectez scrupuleusement le calendrier établi [4]. Cette anticipation évite les retards de prise en charge et optimise vos chances de guérison complète.
Enfin, n'hésitez jamais à poser des questions à votre équipe soignante. Une bonne compréhension de votre pathologie et de son traitement améliore significativement l'observance thérapeutique et les résultats cliniques.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous alerter et motiver une consultation médicale rapide, particulièrement si vous avez été exposé à des risques de contamination [2,4].
Consultez en urgence si vous présentez une fatigue extrême avec essoufflement au moindre effort. Ces symptômes peuvent témoigner d'une anémie sévère nécessitant une prise en charge immédiate [3]. De même, des vertiges importants ou des malaises doivent vous conduire aux urgences sans délai.
Une consultation programmée s'impose en cas de fatigue persistante inexpliquée, surtout si elle s'accompagne de pâleur des muqueuses. N'attendez pas que les symptômes s'aggravent : un diagnostic précoce améliore considérablement le pronostic [2].
Les troubles digestifs chroniques méritent également une attention médicale. Douleurs abdominales récurrentes, nausées persistantes ou modifications du transit intestinal doivent être explorés, particulièrement chez les professionnels à risque [6].
Bon à savoir : si vous travaillez avec des animaux, informez systématiquement votre médecin de votre activité professionnelle lors de toute consultation. Cette information oriente le diagnostic et peut éviter des errances diagnostiques coûteuses en temps et en santé [8].
En cas de doute, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant par téléphone. Il saura évaluer l'urgence de la situation et vous orienter vers la structure de soins la plus appropriée.
Questions Fréquentes
L'haemonchiasis est-elle contagieuse entre humains ?
Non, cette pathologie ne se transmet pas directement d'une personne à l'autre. La contamination nécessite l'ingestion de larves présentes dans l'environnement contaminé par les déjections animales.
Peut-on guérir complètement de cette infection ?
Oui, avec un traitement approprié, plus de 95% des patients guérissent sans séquelles. La clé du succès réside dans un diagnostic précoce et un traitement adapté.
Combien de temps dure le traitement ?
Le traitement antiparasitaire dure généralement 1 à 3 jours selon la molécule utilisée. Cependant, la récupération complète, notamment hématologique, peut prendre 2 à 3 mois.
Peut-on continuer à travailler avec des animaux après guérison ?
Oui, mais en respectant scrupuleusement les mesures de protection individuelle. Le port de gants et le respect des règles d'hygiène permettent de poursuivre l'activité professionnelle en toute sécurité.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Enhancing H11 Protein-Induced Immune Protection - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] Implantation of a vaccine platform for extended antigen - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Haematobiochemical alterations and lesion characterization - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] A Review: Haemonchus contortus Infection in Pasture-Based Sheep Production SystemsLien
- [5] Hematological, biochemical alterations and methane production in sheep submitted to mixed infectionLien
- [7] Haemonchosis in Sheep and Goats, Control Strategies and Development of VaccinesLien
- [8] Putative SNPs in Ovar-DRB1 and GALNTL6 Genes Conferring Susceptibility to Natural InfectionLien
- [10] Phosphorus impairment in metabolism, reduced bones density and animal performanceLien
- [12] Haemonchus contortus : le parasite du moutonLien
- [13] LES STRONGLES DIGESTIFS : HAEMONCHusLien
- [14] Vigilance Haemonchose !Lien
Publications scientifiques
- [HTML][HTML] A Review: Haemonchus contortus Infection in Pasture-Based Sheep Production Systems, with a Focus on the Pathogenesis of Anaemia and Changes in … (2022)71 citations
- [HTML][HTML] Hematological, biochemical alterations and methane production in sheep submitted to mixed infection of Haemonchus contortus and Trichostrongylus … (2022)8 citations
- [HTML][HTML] … cost of host resistance on body fat growth in ewe lambs from lines selected for resistance or susceptibility to experimental infections with Haemonchus … (2024)
- [HTML][HTML] Haemonchosis in Sheep and Goats, Control Strategies and Development of Vaccines against Haemonchus contortus (2022)63 citations
- Putative SNPs in Ovar-DRB1 and GALNTL6 Genes Conferring Susceptibility to Natural Infection of Haemonchus Contortus in Southern Indian Sheep (2024)3 citations
Ressources web
- Haemonchus contortus : le parasite du mouton et de la ... (supervet.expert)
8 juin 2022 — Les symptômes peuvent varier en fonction du degré de l'infestation, de l'âge des moutons et des chèvres et de leur état de santé général.
- LES STRONGLES DIGESTIFS : HAEMONCHus (gds03.webmo.fr)
L'haemonchose est une maladie parasitaire due à un strongle digestif de la caillette : Haemonchus. Ce parasite est très pathogène chez les ovins et les caprins.
- » Vigilance Haemonchose ! (inn-ovin.fr)
En cas d'infestation massive, la brebis atteinte s'anémie rapidement (la muqueuse oculaire devient très pâle : c'est le premier symptôme à vérifier), est ...
- Haemonchus contortus (fr.wikipedia.org)
Ce parasite est responsable d'anémies et d'œdèmes chez le mouton et la chèvre, pouvant mener jusqu'à la mort de l'animal.
- Manuel de lutte contre les parasites internes du mouton (agrireseau.net)
Signes cliniques : La plupart des infections sont légères et les symptômes, rares. Le parasite cause une colite bénigne. Nécropsie : Le parasite adulte est ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
