Infections à Deltarétrovirus : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
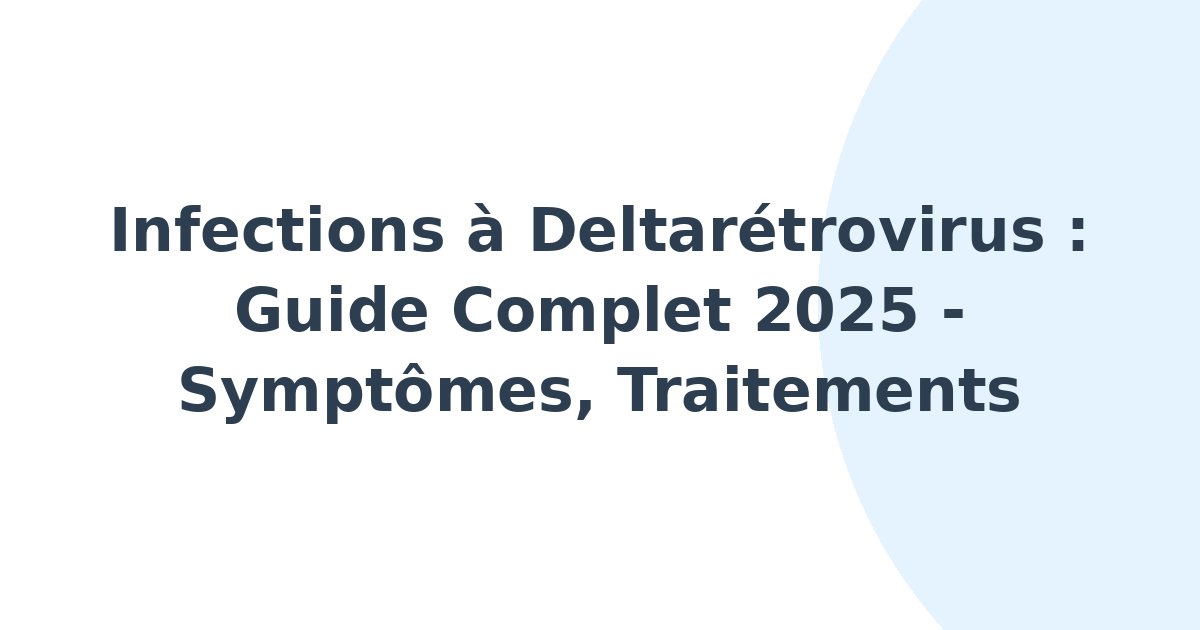
Les infections à deltarétrovirus représentent un groupe de pathologies virales complexes qui touchent principalement les lymphocytes T. Ces virus, notamment le HTLV-1 et HTLV-2, peuvent rester silencieux pendant des années avant de se manifester. Bien que rares en France, ces infections nécessitent une prise en charge spécialisée et un suivi régulier pour prévenir les complications graves.
Téléconsultation et Infections à deltarétrovirus
Téléconsultation non recommandéeLes infections à deltarétrovirus (incluant HTLV-1 et HTLV-2) nécessitent une prise en charge spécialisée complexe avec examens biologiques spécifiques, évaluation neurologique approfondie et suivi multidisciplinaire. Le diagnostic et la surveillance de ces infections rétrovirales requièrent des examens complémentaires indispensables qui ne peuvent être réalisés à distance.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation des symptômes neurologiques rapportés par le patient, analyse de l'historique familial et des facteurs de risque, discussion des résultats d'examens déjà réalisés, suivi de l'observance thérapeutique, orientation vers les structures spécialisées appropriées.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Confirmation diagnostique par sérologie et PCR spécifiques, examen neurologique complet pour dépister une myélopathie associée, évaluation ophtalmologique pour recherche d'uvéite, prise en charge multidisciplinaire incluant infectiologue et neurologue.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion diagnostique initiale nécessitant des examens sérologiques spécialisés, apparition de troubles neurologiques progressifs nécessitant un examen neurologique complet, surveillance de l'évolution vers une myélopathie associée HTLV-1, évaluation d'une uvéite associée.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Aggravation rapide des troubles neurologiques avec perte de la marche, troubles sphinctériens aigus, signes d'hypertension intracrânienne associés à une myélopathie.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Perte brutale ou aggravation rapide de la capacité de marche
- Troubles sphinctériens aigus avec rétention urinaire ou incontinence
- Faiblesse musculaire progressive sévère des membres inférieurs
- Troubles sensitifs étendus avec perte de sensibilité
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Infectiologue — consultation en présentiel indispensable
Les infections à deltarétrovirus nécessitent une prise en charge spécialisée par un infectiologue, souvent en collaboration avec un neurologue. Une consultation en présentiel est indispensable pour réaliser les examens diagnostiques spécifiques et assurer un suivi multidisciplinaire adapté.
Infections à deltarétrovirus : Définition et Vue d'Ensemble
Les deltarétrovirus constituent une famille de virus qui s'attaquent spécifiquement aux cellules du système immunitaire. Le terme "delta" fait référence à leur structure génétique particulière, différente des autres rétrovirus comme le VIH [2].
Ces virus se caractérisent par leur capacité à s'intégrer dans l'ADN de nos cellules. Une fois installés, ils peuvent rester dormants pendant des décennies. C'est ce qui rend leur détection si difficile au début de l'infection [3].
Les deux principaux types qui nous concernent sont le HTLV-1 (Human T-lymphotropic virus type 1) et le HTLV-2. Le premier est responsable de pathologies plus graves, notamment la leucémie T de l'adulte et la paraparésie spastique tropicale. Le second semble moins pathogène, mais les recherches continuent [5].
Concrètement, ces virus transforment progressivement les lymphocytes T, ces cellules essentielles à notre défense immunitaire. Cette transformation peut aboutir à des cancers du sang ou à des maladies neurologiques invalidantes. Heureusement, seule une minorité des personnes infectées développera ces complications graves [1,2].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, la prévalence des infections à deltarétrovirus reste heureusement faible. Les données de Santé publique France indiquent environ 3 000 à 5 000 personnes infectées par le HTLV-1, soit une prévalence de 0,005% de la population générale .
Cette répartition n'est pas homogène sur le territoire. Les départements d'outre-mer, notamment la Guyane et les Antilles, présentent des taux nettement plus élevés, atteignant parfois 2 à 5% de la population. Cette différence s'explique par les liens historiques avec les zones d'endémie mondiale .
À l'échelle internationale, on estime que 10 à 20 millions de personnes vivent avec une infection à HTLV-1. Les régions les plus touchées incluent le Japon (particulièrement l'île de Kyushu), certaines zones d'Afrique subsaharienne, les Caraïbes et l'Amérique du Sud [2,5].
L'incidence annuelle en France métropolitaine reste stable, avec environ 50 à 100 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Mais attention, ces chiffres sous-estiment probablement la réalité car beaucoup d'infections passent inaperçues . Les innovations diagnostiques de 2024-2025 permettent désormais une détection plus précoce et plus précise .
Les Causes et Facteurs de Risque
La transmission du deltarétrovirus se fait principalement par trois voies bien identifiées. La transmission sexuelle représente le mode le plus fréquent chez l'adulte, particulièrement lors de rapports non protégés avec un partenaire infecté [2,7].
La transmission mère-enfant constitue un enjeu majeur de santé publique. Elle peut survenir pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement. D'ailleurs, l'allaitement maternel représente le risque le plus élevé, avec un taux de transmission pouvant atteindre 15 à 25% [7]. C'est pourquoi le dépistage chez les femmes enceintes devient crucial.
La transmission sanguine, bien que plus rare aujourd'hui grâce aux contrôles stricts, reste possible. Elle concerne principalement les transfusions sanguines, le partage de seringues chez les usagers de drogues, ou les accidents d'exposition au sang en milieu médical [2].
Certains facteurs augmentent le risque d'infection. L'origine géographique joue un rôle important : les personnes originaires des zones d'endémie ou ayant vécu dans ces régions présentent un risque accru. L'âge avancé et un système immunitaire affaibli peuvent également favoriser la progression de l'infection vers des formes symptomatiques [5,7].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
La particularité des infections à deltarétrovirus, c'est leur capacité à rester silencieuses pendant des années, voire des décennies. La plupart des personnes infectées ne développeront jamais de symptômes. Mais quand ils apparaissent, ils peuvent être très variés [3,5].
Les premiers signes sont souvent non spécifiques. Vous pourriez ressentir une fatigue persistante, des douleurs articulaires ou musculaires, ou encore des épisodes fébriles inexpliqués. Ces symptômes ressemblent à ceux de nombreuses autres pathologies, ce qui complique le diagnostic [2].
Quand l'infection évolue vers une leucémie T de l'adulte, les symptômes deviennent plus alarmants. On observe alors une augmentation du volume des ganglions lymphatiques, des sueurs nocturnes importantes, une perte de poids inexpliquée et parfois des lésions cutanées particulières [3,5].
La paraparésie spastique tropicale se manifeste différemment. Elle débute généralement par une raideur progressive des jambes, des difficultés à la marche, et parfois des troubles urinaires. Ces symptômes neurologiques s'installent lentement, sur plusieurs mois ou années [2,5]. Il est normal de s'inquiéter face à ces signes, mais rappelez-vous que seule une minorité des personnes infectées développera ces complications.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des infections à deltarétrovirus suit un protocole précis, mais il peut être long à établir. Tout commence généralement par une prise de sang pour rechercher les anticorps spécifiques contre le HTLV-1 et HTLV-2 [2,7].
Le test de dépistage initial utilise la technique ELISA. Si ce test est positif, il faut le confirmer par des méthodes plus spécifiques comme le Western Blot ou la PCR quantitative. Cette étape de confirmation est cruciale car les faux positifs existent [7]. Les innovations de 2024-2025 ont considérablement amélioré la précision de ces tests .
En cas de confirmation, votre médecin procédera à un bilan complet. Cela inclut une numération formule sanguine, un dosage des LDH (marqueurs de destruction cellulaire), et souvent une imagerie pour rechercher des ganglions ou des lésions d'organes [3].
Le typage viral permet de distinguer HTLV-1 de HTLV-2, information essentielle pour évaluer le pronostic. Des examens spécialisés peuvent être nécessaires selon les symptômes : ponction lombaire en cas de signes neurologiques, biopsie ganglionnaire si suspicion de leucémie [2,5]. Bon à savoir : le diagnostic peut prendre plusieurs semaines, le temps de réaliser tous ces examens complémentaires.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Il faut être honnête : il n'existe pas encore de traitement curatif pour éliminer complètement le deltarétrovirus de l'organisme. Cependant, plusieurs approches thérapeutiques permettent de contrôler l'infection et de traiter ses complications [4,5].
Pour les formes asymptomatiques, la surveillance régulière reste la règle. Votre médecin programmera des bilans sanguins tous les 6 à 12 mois pour détecter précocement toute évolution vers une forme symptomatique [2]. Cette approche "wait and see" peut sembler frustrante, mais elle évite les effets secondaires de traitements inutiles.
Quand une leucémie T de l'adulte se développe, le traitement devient plus agressif. Les protocoles de chimiothérapie associent généralement plusieurs médicaments : cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine et prednisolone (protocole CHOP). Dans certains cas, la greffe de moelle osseuse peut être envisagée [3,5].
Pour la paraparésie spastique tropicale, les corticoïdes constituent le traitement de première ligne. Ils permettent de réduire l'inflammation au niveau de la moelle épinière. Des médicaments comme l'interféron alpha ont également montré une certaine efficacité [2]. Les recherches récentes explorent l'utilisation d'antiviraux repositionnés, avec des résultats prometteurs [4].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la recherche sur les deltarétrovirus. Les équipes de Steven Van Gucht et Vanessa Mathys ont développé de nouvelles approches diagnostiques qui révolutionnent la détection précoce .
Une découverte majeure concerne l'inhibition du complexe peptidase signal. Cette approche bloque le clivage de la protéine p12 en p8, empêchant ainsi la transmission virale. Les premiers essais montrent une réduction significative de la charge virale [1]. Cette innovation pourrait transformer la prise en charge des patients infectés.
Le repositionnement d'antiviraux existants ouvre également de nouvelles perspectives. Des médicaments initialement développés contre d'autres virus montrent une activité prometteuse contre la protéase du HTLV-1. Les simulations moléculaires confirment leur potentiel thérapeutique [4].
Côté vaccination, les recherches progressent enfin. Après des décennies d'échecs, plusieurs candidats vaccins entrent en phase d'essais cliniques. L'approche multi-épitopes semble particulièrement prometteuse, ciblant plusieurs protéines virales simultanément [5,6]. Les innovations du MedTech-Tracker 2024-2025 incluent également de nouveaux outils de diagnostic rapide et des thérapies personnalisées .
Vivre au Quotidien avec Infections à deltarétrovirus
Recevoir un diagnostic d'infection à deltarétrovirus bouleverse forcément la vie. Mais rassurez-vous, la majorité des personnes infectées mènent une existence tout à fait normale [2,5].
L'important, c'est d'adopter un mode de vie sain pour préserver votre système immunitaire. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un sommeil de qualité constituent les piliers de cette approche. Évitez le tabac et limitez l'alcool, car ils peuvent affaiblir vos défenses naturelles [2].
La question de la transmission préoccupe souvent les patients. Vous pouvez avoir des relations intimes normales en utilisant systématiquement des préservatifs. Pour les femmes en âge de procréer, une consultation spécialisée avant toute grossesse est indispensable pour évaluer les risques [7].
Le soutien psychologique ne doit pas être négligé. Beaucoup de patients traversent des phases d'anxiété ou de dépression après le diagnostic. N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à consulter un psychologue spécialisé. Des groupes de parole existent également dans certaines régions [5]. L'important à retenir : vous n'êtes pas seul face à cette maladie, et des solutions existent pour maintenir une bonne qualité de vie.
Les Complications Possibles
Bien que la majorité des personnes infectées restent asymptomatiques, certaines complications peuvent survenir. La leucémie T de l'adulte représente la complication la plus redoutée, touchant environ 2 à 5% des porteurs du HTLV-1 [3,5].
Cette leucémie se présente sous quatre formes cliniques distinctes. La forme aiguë est la plus agressive, avec une évolution rapide et un pronostic sombre. Les formes chronique et subaiguë évoluent plus lentement, permettant parfois des rémissions prolongées. La forme smoldering reste longtemps stable [3].
La paraparésie spastique tropicale affecte quant à elle 1 à 3% des porteurs. Cette maladie neurologique se caractérise par une inflammation chronique de la moelle épinière. Elle débute insidieusement par une raideur des jambes et peut progresser vers une paralysie partielle [2,5].
D'autres complications, plus rares, peuvent survenir. Les infections opportunistes touchent parfois les patients dont le système immunitaire est affaibli. Des manifestations cutanées, des troubles oculaires ou des atteintes pulmonaires ont également été rapportés [2]. Heureusement, les traitements actuels permettent souvent de contrôler ces complications et d'améliorer la qualité de vie des patients.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des infections à deltarétrovirus varie énormément selon que vous développez ou non des complications. Pour la grande majorité des porteurs asymptomatiques, l'espérance de vie reste normale [2,5].
Les statistiques sont rassurantes : plus de 90% des personnes infectées par le HTLV-1 ne développeront jamais de maladie grave. Elles vivront avec le virus sans même s'en apercevoir. C'est pourquoi beaucoup d'infections ne sont découvertes que par hasard, lors d'un don du sang ou d'un bilan médical [5].
Quand une leucémie T se développe, le pronostic dépend de la forme clinique. La forme aiguë reste de mauvais pronostic malgré les traitements, avec une survie médiane de 6 à 10 mois. En revanche, les formes chroniques permettent souvent une survie de plusieurs années, parfois plus de 10 ans [3].
Pour la paraparésie spastique tropicale, l'évolution est généralement lente. Beaucoup de patients conservent une autonomie satisfaisante pendant des années. Les traitements actuels permettent de ralentir la progression et d'améliorer les symptômes [2]. L'important à retenir : un diagnostic d'infection à deltarétrovirus n'est pas une condamnation. Avec un suivi médical approprié, la plupart des patients mènent une vie normale.
Peut-on Prévenir Infections à deltarétrovirus ?
La prévention des infections à deltarétrovirus repose sur des mesures simples mais efficaces. La prévention sexuelle constitue le pilier principal : l'utilisation systématique de préservatifs lors des rapports sexuels réduit considérablement le risque de transmission [2,7].
Pour les femmes enceintes porteuses du virus, des mesures spécifiques s'imposent. L'allaitement maternel étant le mode de transmission le plus efficace vers l'enfant, il est formellement contre-indiqué. L'alimentation au biberon avec du lait artificiel devient alors obligatoire [7]. Cette recommandation peut être difficile à accepter, mais elle protège efficacement le nouveau-né.
Le dépistage systématique dans certaines populations à risque permet une détection précoce. En France, il est recommandé chez les donneurs de sang, les femmes enceintes originaires de zones d'endémie, et les partenaires de personnes infectées [7]. Les innovations diagnostiques de 2024-2025 facilitent ce dépistage .
La recherche vaccinale progresse enfin. Plusieurs candidats vaccins montrent des résultats encourageants dans les modèles animaux. L'approche multi-épitopes développée récemment pourrait offrir une protection efficace contre l'infection [5,6]. Mais il faudra encore attendre plusieurs années avant qu'un vaccin soit disponible pour le grand public.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi des recommandations précises pour la prise en charge des infections à deltarétrovirus. La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise un dépistage systématique chez les femmes enceintes originaires de zones d'endémie .
Santé publique France recommande également le dépistage chez tous les donneurs de sang et de tissus. Cette mesure, mise en place depuis les années 1990, a considérablement réduit le risque de transmission transfusionnelle. Les techniques de détection se sont affinées avec les innovations 2024-2025 .
Pour le suivi des patients infectés, les recommandations sont claires. Un bilan biologique complet doit être réalisé tous les 6 à 12 mois chez les porteurs asymptomatiques. Ce suivi permet de détecter précocement toute évolution vers une forme symptomatique .
L'INSERM coordonne plusieurs programmes de recherche sur ces virus. Les études épidémiologiques récentes confirment la stabilité de la prévalence en France métropolitaine, mais soulignent l'importance du dépistage en outre-mer . Les nouvelles directives 2024-2025 intègrent les avancées diagnostiques et thérapeutiques récentes, offrant une prise en charge plus personnalisée .
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations accompagnent les patients atteints d'infections à deltarétrovirus. Bien que ces pathologies soient rares, des réseaux de soutien existent pour vous aider dans votre parcours [5].
L'Association française de lutte contre les rétrovirus (AFLR) propose des informations actualisées et met en relation les patients. Elle organise régulièrement des conférences avec des spécialistes et facilite les échanges d'expériences entre malades.
Au niveau international, la HTLV European Research Network coordonne les efforts de recherche et diffuse les dernières avancées scientifiques. Cette organisation permet aux patients français d'accéder aux innovations thérapeutiques développées dans d'autres pays .
Les centres de référence pour les maladies rares constituent également des ressources précieuses. Ils proposent une expertise spécialisée et coordonnent les soins complexes. Le centre de référence des rétrovirus humains, basé à Paris, centralise l'expertise française sur ces pathologies . N'hésitez pas à demander à votre médecin de vous orienter vers ces structures spécialisées si vous en ressentez le besoin.
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec une infection à deltarétrovirus demande quelques adaptations, mais rien d'insurmontable. Voici nos conseils pour optimiser votre qualité de vie et préserver votre santé [2,5].
Adoptez une hygiène de vie irréprochable. Une alimentation riche en fruits et légumes, pauvre en graisses saturées, soutient votre système immunitaire. L'activité physique régulière, même modérée, améliore votre maladie générale et votre moral. Visez 30 minutes de marche quotidienne au minimum [2].
Surveillez attentivement votre état de santé. Notez tout symptôme inhabituel : fatigue persistante, fièvre, douleurs articulaires, troubles neurologiques. Ces informations aideront votre médecin à adapter votre suivi. Respectez scrupuleusement vos rendez-vous médicaux, même si vous vous sentez bien [5].
Protégez vos proches en adoptant les bonnes pratiques. Utilisez systématiquement des préservatifs lors des rapports sexuels. Ne partagez jamais d'objets pouvant être souillés par du sang : rasoirs, brosses à dents, matériel de manucure. Informez vos partenaires sexuels de votre statut pour qu'ils puissent se faire dépister [2,7]. Concrètement, ces précautions deviennent rapidement des automatismes et n'altèrent pas votre qualité de vie.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous amener à consulter rapidement votre médecin. Si vous êtes porteur asymptomatique, toute modification de votre état général mérite une évaluation médicale [2,5].
Les symptômes d'alarme incluent une fatigue intense et persistante, des sueurs nocturnes abondantes, une perte de poids inexpliquée de plus de 10% en quelques mois. L'apparition de ganglions palpables, surtout s'ils sont durs et indolores, nécessite un examen urgent [3].
Les signes neurologiques doivent également vous alerter. Une raideur progressive des jambes, des difficultés à la marche, des troubles de l'équilibre ou des problèmes urinaires peuvent signaler une paraparésie spastique débutante [2]. Plus tôt elle est prise en charge, mieux elle peut être contrôlée.
En cas de fièvre persistante, d'infections à répétition ou de lésions cutanées inhabituelles, n'attendez pas. Ces manifestations peuvent traduire une immunodépression liée à l'évolution de l'infection [5]. Votre médecin traitant saura évaluer la situation et vous orienter si nécessaire vers un spécialiste. L'important, c'est de ne pas rester seul face à vos inquiétudes.
Questions Fréquentes
Les infections à deltarétrovirus sont-elles contagieuses ?
Oui, mais la transmission nécessite un contact direct avec du sang, des sécrétions génitales ou le lait maternel. Les contacts quotidiens normaux ne présentent aucun risque.
Combien de temps peut-on vivre avec une infection à deltarétrovirus ?
Plus de 90% des porteurs ont une espérance de vie normale. Seule une minorité développe des complications graves nécessitant un traitement spécialisé.
Existe-t-il un vaccin contre les deltarétrovirus ?
Pas encore, mais la recherche progresse. Plusieurs candidats vaccins sont en cours de développement, notamment des approches multi-épitopes prometteuses.
Peut-on guérir d'une infection à deltarétrovirus ?
Il n'existe pas de traitement curatif actuellement. Cependant, des traitements efficaces permettent de contrôler les complications quand elles surviennent.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Conditions and Diseases - MedTech-Tracker. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] Steven Van Gucht. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Vanessa Mathys. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] A Thoma-Kress, F Simon. Inhibition of the signal peptidase complex blocks cleavage of HTLV-1 ORF-I encoded p12 to p8 and impairs virus transmission. 2025Lien
- [5] Y Li, DP Gladue. Insights of important mammalian viruses: Infection, pathogenesis and drugs. 2023Lien
- [6] S Nadgir. HTLV-1: The Fundamental Proteins for ATLLien
- [8] H Jahantigh, N Ahmadi. Repurposing antiviral drugs against HTLV-1 protease by molecular docking and molecular dynamics simulation. 2023Lien
- [9] L Ratner. A role for an HTLV-1 vaccine? 2022Lien
- [10] A Samad, NS Meghla. Immune epitopes identification and designing of a multi-epitope vaccine against bovine leukemia virus. 2022Lien
- [11] NJ Yunzoom, A Maryam. Detection of Human T Lymphotrophic Virus-I Tax Gene among Pregnant WomenLien
Publications scientifiques
- Inhibition of the signal peptidase complex blocks cleavage of HTLV-1 ORF-I encoded p12 to p8 and impairs virus transmission (2025)
- Insights of important mammalian viruses: Infection, pathogenesis and drugs (2023)
- HTLV-1: The Fundamental Proteins for ATL
- Temporal patterns of bovine leukemia virus infection in dairy herds in Atlantic Canada (2024)1 citations[PDF]
- Repurposing antiviral drugs against HTLV-1 protease by molecular docking and molecular dynamics simulation (2023)17 citations
Ressources web
- Hépatite delta : état de connaissances et nouvelles ... (fmcgastro.org)
30 juin 2021 — Le bulevirtide est un nouveau traitement ayant récemment obtenu son AMM pour tout patient VHD avec réplication virale (sauf en cas de cirrhose ...
- HEPATITE DELTA : LE POINT SUR LE DEPISTAGE ET LA ... (labovialle.com)
Un test sérologique sanguin peut détecter la présence d'anticorps anti-VHD, témoignant d'une infection passée ou actuelle. En cas de positivité, un test d' ...
- Hépatite D (delta) : symptômes, transmission, traitement (sante.journaldesfemmes.fr)
19 oct. 2022 — L'hépatite D (delta) est la forme la plus sévère des hépatites virales chroniques car elle peut évoluer vers une cirrhose ou un cancer du ...
- recommander (has-sante.fr)
21 sept. 2023 — Le Pegasys® dispose d'une AMM dans le traitement de l'infection B chronique. C'est pourtant le traitement de référence de l'infection Delta.
- L'hépatite virale Delta, D comme délaissée… (arcat-sante.org)
Diagnostic sérologique de l'infection : Le diagnostic d'hépatite aiguë D repose sur la présence de l'antigène delta (mais l'antigénémie est très fugace, de une ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
