Infections à Coronaviridae : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
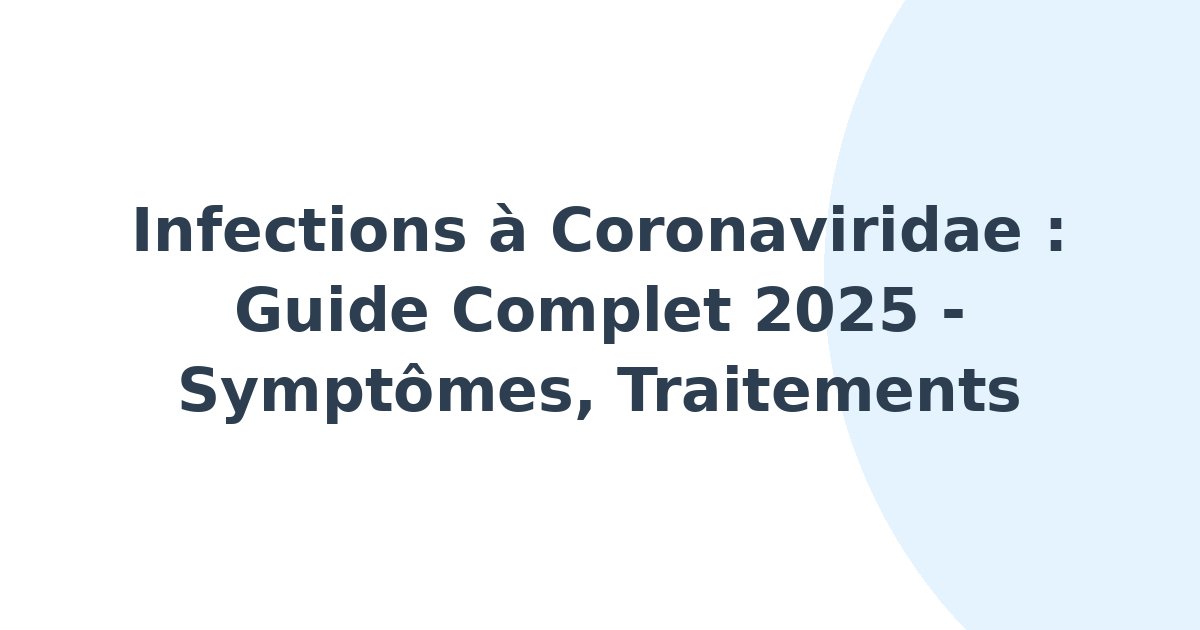
Les infections à Coronaviridae regroupent plusieurs pathologies virales qui touchent des millions de personnes chaque année. Cette famille de virus, responsable notamment du COVID-19, du SRAS et du MERS, continue d'évoluer et de défier la médecine moderne. Comprendre ces infections devient essentiel pour mieux les prévenir et les traiter.
Téléconsultation et Infections à Coronaviridae
Partiellement adaptée à la téléconsultationLes infections à Coronaviridae présentent un spectre clinique variable, du simple rhume au COVID-19 sévère. La téléconsultation peut être adaptée pour l'évaluation initiale des formes légères à modérées et le suivi des patients, mais nécessite une évaluation médicale au cas par cas. L'examen clinique présentiel reste souvent nécessaire pour évaluer l'état respiratoire et détecter les complications.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation des symptômes respiratoires (toux, essoufflement, fièvre), analyse de l'évolution clinique et de la durée des symptômes, vérification des facteurs de risque de complications, orientation diagnostique initiale selon le contexte épidémiologique, évaluation de la capacité à s'isoler et des mesures de prévention.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen de l'auscultation pulmonaire pour détecter les signes de pneumonie, évaluation précise de la détresse respiratoire et de la saturation en oxygène, réalisation de tests diagnostiques spécifiques (PCR, antigéniques), prise en charge des formes sévères nécessitant une hospitalisation.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Préparer votre téléconsultation
Pour que votre téléconsultation soit la plus efficace possible, préparez les éléments suivants :
- Symptômes et durée : Noter précisément la présence et l'intensité de la fièvre, toux (sèche ou productive), essoufflement au repos ou à l'effort, perte d'odorat ou de goût, maux de tête, courbatures, troubles digestifs, et depuis combien de jours ces symptômes sont apparus.
- Traitements en cours : Mentionner tous les traitements symptomatiques pris (paracétamol, anti-inflammatoires, antitussifs), les traitements immunosuppresseurs, corticoïdes, anticoagulants, et tout traitement spécifique au COVID-19 si applicable.
- Antécédents médicaux pertinents : Antécédents respiratoires (asthme, BPCO, apnées du sommeil), maladies cardiovasculaires, diabète, obésité, immunodépression, âge supérieur à 65 ans, grossesse, antécédents de complications liées aux coronavirus.
- Examens récents disponibles : Résultats de tests COVID-19 récents (PCR, antigéniques), mesures de saturation en oxygène si disponibles, radiographies thoraciques récentes, bilans biologiques avec marqueurs inflammatoires si réalisés.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion de pneumonie nécessitant une auscultation pulmonaire, patients présentant des facteurs de risque élevés de complications, évaluation de la saturation en oxygène impossible à domicile, nécessité de réaliser des tests diagnostiques spécifiques non disponibles.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Détresse respiratoire aiguë avec essoufflement au repos, douleurs thoraciques importantes, fièvre persistante malgré le traitement, altération de l'état général avec confusion ou malaise.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Difficultés respiratoires importantes ou essoufflement au repos
- Douleur thoracique persistante ou oppression thoracique
- Fièvre élevée persistante (>39°C) malgré le traitement depuis plus de 48h
- Altération de l'état de conscience, confusion ou malaise important
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Généraliste — consultation en présentiel recommandée
Le médecin généraliste est généralement le plus adapté pour la prise en charge initiale des infections à Coronaviridae. Une consultation en présentiel est souvent recommandée pour permettre un examen clinique complet, notamment l'auscultation pulmonaire et l'évaluation de l'état respiratoire.

- Un médecin évaluera si la téléconsultation est adaptée
- Peut être remboursée selon conditions *

Infections à Coronaviridae : Définition et Vue d'Ensemble
Les Coronaviridae constituent une famille de virus à ARN qui infectent principalement les voies respiratoires des mammifères et des oiseaux . Ces virus tirent leur nom de leur apparence caractéristique en couronne, visible au microscope électronique.
Cette famille virale comprend quatre genres principaux : les Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus et Deltacoronavirus . Chez l'homme, sept coronavirus sont connus pour causer des maladies, allant du simple rhume aux pneumonies sévères.
Mais ce qui rend ces virus particulièrement préoccupants, c'est leur capacité à muter rapidement. D'ailleurs, cette caractéristique explique pourquoi nous avons vu émerger successivement le SRAS-CoV en 2003, le MERS-CoV en 2012, puis le SARS-CoV-2 en 2019 [4]. Chaque émergence a représenté un défi majeur pour la santé publique mondiale.
L'important à retenir, c'est que ces infections ne se limitent pas au COVID-19. En fait, quatre coronavirus circulent de manière endémique et causent des rhumes saisonniers chez l'adulte et l'enfant [1,2].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, les infections respiratoires aiguës liées aux Coronaviridae représentent un enjeu majeur de santé publique. Selon Santé Publique France, ces pathologies touchent chaque année plusieurs millions de personnes [1].
Les données épidémiologiques 2024-2025 révèlent des tendances préoccupantes. Le COVID-19 continue de circuler avec des vagues saisonnières, tandis que les coronavirus endémiques maintiennent leur présence constante [1]. L'incidence annuelle des infections symptomatiques est estimée à environ 15-20% de la population française.
Concrètement, cela représente près de 10 à 13 millions de cas par an, tous coronavirus confondus. Mais ces chiffres ne reflètent que la partie visible de l'iceberg, car de nombreuses infections restent asymptomatiques ou peu symptomatiques [2].
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne des pays développés. Cependant, les variations régionales sont importantes : l'Île-de-France et les grandes métropoles enregistrent des taux d'incidence supérieurs de 20 à 30% par rapport aux zones rurales [1].
L'analyse par tranches d'âge montre que les personnes de plus de 65 ans représentent 60% des hospitalisations liées aux Coronaviridae, bien qu'elles ne constituent que 20% de la population [1]. Cette surreprésentation s'explique par la fragilité immunitaire liée à l'âge.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les infections à Coronaviridae résultent de la transmission interhumaine principalement par voie respiratoire. Les gouttelettes émises lors de la toux, des éternuements ou même de la parole constituent le mode de contamination principal [2,4].
Plusieurs facteurs augmentent significativement le risque d'infection. L'âge avancé représente le facteur de risque le plus important, avec un risque multiplié par 3 après 70 ans [1]. Les pathologies chroniques comme le diabète, l'hypertension ou les maladies cardiovasculaires doublent également le risque de forme sévère.
D'ailleurs, l'immunodépression, qu'elle soit liée à une maladie ou à un traitement, constitue un facteur de risque majeur. Ces patients développent des infections plus prolongées et plus sévères . L'obésité, avec un IMC supérieur à 30, multiplie par 1,5 le risque de complications.
Mais il ne faut pas oublier les facteurs environnementaux. La promiscuité, la mauvaise ventilation des locaux et les rassemblements favorisent la transmission [2]. C'est pourquoi les épidémies touchent souvent en premier les collectivités : EHPAD, écoles, entreprises.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes des infections à Coronaviridae varient considérablement selon le virus en cause et l'état de santé du patient. Pour les coronavirus endémiques, les signes ressemblent à ceux d'un rhume classique : écoulement nasal, mal de gorge, toux légère [2].
Concernant le SARS-CoV-2, la présentation clinique s'est diversifiée avec les variants successifs. Les symptômes les plus fréquents incluent la fièvre (présente chez 80% des patients), la toux sèche (70%), et la fatigue intense (60%) [2,4]. La perte d'odorat et de goût, très caractéristique au début de la pandémie, est devenue moins fréquente avec les variants récents.
Mais attention, certains signes doivent alerter immédiatement. La dyspnée (difficulté respiratoire), les douleurs thoraciques persistantes, ou la confusion mentale nécessitent une consultation urgente [2]. Ces symptômes peuvent annoncer une forme sévère nécessitant une hospitalisation.
Il est important de noter que 20 à 40% des infections restent asymptomatiques, particulièrement chez les jeunes adultes . Cette particularité complique le contrôle épidémiologique mais explique aussi la propagation silencieuse de ces virus.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des infections à Coronaviridae repose aujourd'hui sur plusieurs approches complémentaires. L'examen clinique reste la première étape, permettant d'évaluer la sévérité et d'orienter les investigations [2].
Les tests de détection virale constituent l'outil diagnostic de référence. La RT-PCR sur prélèvement nasopharyngé reste le gold standard, avec une sensibilité supérieure à 95% [4]. Les tests antigéniques rapides, bien que moins sensibles, offrent l'avantage d'un résultat immédiat et restent utiles en première intention.
Pour les formes sévères, l'imagerie thoracique devient indispensable. Le scanner thoracique révèle des lésions caractéristiques : opacités en verre dépoli, condensations périphériques [2]. Ces images aident à évaluer l'extension pulmonaire et guident la prise en charge thérapeutique.
D'ailleurs, les examens biologiques apportent des informations pronostiques importantes. L'élévation des D-dimères, de la CRP ou de la ferritine peut signaler une forme sévère nécessitant une surveillance renforcée [4]. Ces marqueurs permettent d'adapter précocement la stratégie thérapeutique.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge des infections à Coronaviridae a considérablement évolué depuis 2020. Pour les formes légères à modérées, le traitement reste essentiellement symptomatique : repos, hydratation, paracétamol pour la fièvre [2].
Les antiviraux spécifiques ont révolutionné la prise en charge des formes sévères. Le Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) réduit de 89% le risque d'hospitalisation s'il est administré dans les 5 premiers jours [3]. Le remdesivir reste indiqué pour les patients hospitalisés nécessitant une oxygénothérapie.
Concernant les traitements immunomodulateurs, les corticoïdes comme la dexaméthasone ont prouvé leur efficacité dans les formes sévères avec hypoxémie . Ils réduisent la mortalité de 17% chez les patients sous ventilation mécanique.
Mais l'innovation ne s'arrête pas là. Les anticorps monoclonaux, bien que moins utilisés avec les variants récents, gardent leur place dans certaines situations spécifiques . L'important est d'adapter le traitement au profil de chaque patient et à la sévérité de l'infection.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
La recherche sur les Coronaviridae connaît une accélération remarquable en 2024-2025. Les inhibiteurs de protéase issus de produits naturels représentent une voie prometteuse, avec plusieurs molécules en phase d'essais cliniques [3].
L'une des avancées les plus significatives concerne le développement de vaccins universels contre les coronavirus. Ces vaccins de nouvelle génération visent à protéger contre plusieurs souches simultanément, y compris les variants futurs . Les premiers résultats des essais de phase II sont encourageants.
En parallèle, la recherche sur les traitements courts progresse rapidement. Des études récentes montrent qu'un traitement de 42 jours avec le GS-441524 oral présente une efficacité équivalente au protocole standard de 84 jours . Cette approche pourrait révolutionner la prise en charge en réduisant les effets secondaires.
D'ailleurs, l'immunologie systémique ouvre de nouvelles perspectives. Les recherches sur les voies antivirales conservées entre espèces permettent d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques . Ces travaux pourraient déboucher sur des traitements plus efficaces et mieux tolérés.
Concrètement, plusieurs innovations thérapeutiques sont attendues d'ici 2026 . Les thérapies combinées, associant antiviraux et immunomodulateurs, font l'objet d'essais cliniques prometteurs.
Vivre au Quotidien avec Infections à Coronaviridae
Vivre avec une infection à Coronaviridae nécessite des adaptations importantes du mode de vie. La fatigue persistante, symptôme fréquent, impose un rythme de vie plus lent et des périodes de repos régulières [2].
L'isolement constitue un défi majeur, particulièrement difficile sur le plan psychologique. Il est recommandé de maintenir le lien social par téléphone ou visioconférence tout en respectant les mesures barrières [2]. Cette période d'isolement dure généralement 7 à 10 jours selon les recommandations actuelles.
Pour les formes prolongées, l'organisation du domicile devient cruciale. Aménager un espace de repos confortable, assurer une bonne ventilation des pièces, et prévoir des réserves alimentaires facilitent la convalescence . Certains patients développent des symptômes persistants nécessitant un suivi médical prolongé.
Bon à savoir : la reprise d'activité doit être progressive. Même après la disparition des symptômes aigus, il est conseillé d'éviter les efforts intenses pendant au moins deux semaines [2]. Cette précaution permet d'éviter les rechutes et les complications tardives.
Les Complications Possibles
Les complications des infections à Coronaviridae peuvent affecter plusieurs organes et systèmes. Au niveau respiratoire, la pneumonie reste la complication la plus fréquente, touchant 10 à 15% des patients symptomatiques [2,4].
Le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) représente la complication la plus grave, nécessitant une ventilation mécanique. Il survient chez 3 à 5% des patients hospitalisés et s'associe à une mortalité élevée [4]. Cette complication résulte d'une réaction inflammatoire excessive au niveau pulmonaire.
Mais les complications ne se limitent pas aux poumons. Les atteintes cardiovasculaires incluent myocardites, troubles du rythme et événements thromboemboliques [2]. Ces complications expliquent pourquoi les patients cardiaques nécessitent une surveillance particulière.
D'ailleurs, les complications neurologiques émergent comme un enjeu majeur. Troubles cognitifs, céphalées persistantes, et dans de rares cas, encéphalites ont été rapportés . Ces manifestations peuvent persister plusieurs mois après l'infection initiale.
L'important à retenir, c'est que la plupart de ces complications sont réversibles avec une prise en charge adaptée. Le diagnostic précoce et le traitement approprié réduisent significativement le risque de séquelles permanentes .
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des infections à Coronaviridae dépend largement du virus en cause et des caractéristiques du patient. Pour les coronavirus endémiques, la guérison survient généralement en 7 à 10 jours sans séquelles [2].
Concernant le SARS-CoV-2, 80% des patients présentent une forme légère à modérée avec guérison complète en 2 à 3 semaines [4]. Cependant, 10 à 20% développent des symptômes persistants au-delà de 4 semaines, définissant le COVID long [2].
Les facteurs pronostiques sont bien identifiés. L'âge avancé, les comorbidités, et le délai de prise en charge influencent significativement l'évolution [1]. Les patients de moins de 50 ans sans facteur de risque ont un excellent pronostic, avec moins de 0,1% de formes sévères.
Rassurez-vous, les données récentes montrent une amélioration constante du pronostic. La mortalité hospitalière a diminué de 50% entre 2020 et 2024 grâce aux progrès thérapeutiques [1]. Cette amélioration résulte de la meilleure connaissance de la maladie et de l'optimisation des traitements.
En fait, la vaccination a révolutionné le pronostic en réduisant de 90% le risque de forme sévère chez les personnes vaccinées [2]. Cette protection persiste plusieurs mois après la vaccination complète.
Peut-on Prévenir Infections à Coronaviridae ?
La prévention des infections à Coronaviridae repose sur plusieurs stratégies complémentaires. La vaccination constitue la mesure préventive la plus efficace, réduisant de 90% le risque d'infection symptomatique [2].
Les gestes barrières restent fondamentaux : lavage fréquent des mains, port du masque en situation à risque, distanciation physique [2]. Ces mesures simples mais efficaces ont prouvé leur utilité pendant la pandémie et restent recommandées.
L'amélioration de la qualité de l'air intérieur représente un axe préventif majeur. Une bonne ventilation, l'utilisation de purificateurs d'air, et l'évitement des espaces confinés réduisent significativement le risque de transmission .
Mais la prévention passe aussi par le renforcement des défenses naturelles. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, et un sommeil suffisant optimisent la réponse immunitaire [2]. Ces mesures d'hygiène de vie constituent un socle préventif solide.
D'ailleurs, la surveillance épidémiologique permet d'adapter les mesures préventives. Les systèmes d'alerte précoce développés depuis 2020 facilitent la détection rapide des nouvelles vagues épidémiques [1].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi des recommandations précises pour la prise en charge des infections à Coronaviridae. Santé Publique France actualise régulièrement ses guidelines en fonction de l'évolution épidémiologique [1].
La stratégie vaccinale privilégie la protection des populations à risque. Les personnes de plus de 65 ans, les immunodéprimés, et les patients avec comorbidités bénéficient d'un rappel vaccinal annuel [2]. Cette approche ciblée optimise l'utilisation des ressources sanitaires.
Concernant la prise en charge thérapeutique, les recommandations évoluent avec les données scientifiques. L'utilisation précoce d'antiviraux chez les patients à risque est désormais systématiquement recommandée [2]. Cette stratégie réduit significativement le risque d'hospitalisation.
L'Institut Pasteur contribue activement à l'élaboration de ces recommandations par ses travaux de recherche [4]. Ses études sur l'évolution virale et l'efficacité vaccinale guident les décisions de santé publique.
En pratique, ces recommandations sont diffusées aux professionnels de santé via des bulletins épidémiologiques hebdomadaires [1]. Cette communication régulière assure une prise en charge homogène sur l'ensemble du territoire.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations de patients accompagnent les personnes touchées par les infections à Coronaviridae. Ces structures offrent soutien psychologique, information médicale, et aide pratique aux malades et leurs familles.
L'association "COVID Long France" s'est spécialisée dans l'accompagnement des patients présentant des symptômes persistants. Elle propose des groupes de parole, des webinaires informatifs, et un réseau de professionnels de santé spécialisés [2].
Les plateformes d'information officielles constituent des ressources fiables. Le site Ameli.fr propose des fiches pratiques régulièrement mises à jour, tandis que le site de l'Institut Pasteur offre des contenus scientifiques vulgarisés [2,4].
Pour les professionnels de santé, Santé Publique France met à disposition des outils d'aide à la décision et des protocoles de prise en charge [1]. Ces ressources facilitent l'harmonisation des pratiques sur l'ensemble du territoire.
Bon à savoir : de nombreuses ressources sont disponibles en ligne, mais il est important de vérifier leur fiabilité. Privilégiez toujours les sources officielles et les sites d'organismes reconnus pour obtenir des informations médicales fiables.
Nos Conseils Pratiques
Face aux infections à Coronaviridae, quelques conseils pratiques peuvent faire la différence. En cas de symptômes, isolez-vous immédiatement et contactez votre médecin traitant pour évaluer la nécessité d'un test diagnostique [2].
Pendant la maladie, maintenez une hydratation suffisante et reposez-vous autant que nécessaire. N'hésitez pas à prendre du paracétamol pour soulager la fièvre et les douleurs, en respectant les doses recommandées .
Surveillez attentivement l'évolution de vos symptômes. Une aggravation de la dyspnée, l'apparition de douleurs thoraciques, ou une altération de l'état général doivent vous amener à consulter rapidement [2].
Pour protéger votre entourage, respectez scrupuleusement les mesures d'isolement. Portez un masque lors des contacts inévitables, aérez régulièrement votre logement, et désinfectez les surfaces fréquemment touchées [2].
Après la guérison, reprenez progressivement vos activités. Écoutez votre corps et n'hésitez pas à consulter si des symptômes persistent au-delà de 4 semaines . Un suivi médical peut être nécessaire pour certains patients.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes d'alarme nécessitent une consultation médicale urgente lors d'une infection à Coronaviridae. La dyspnée, même légère, doit alerter, particulièrement chez les personnes à risque [2].
Consultez immédiatement si vous présentez des difficultés respiratoires, des douleurs thoraciques persistantes, ou une saturation en oxygène inférieure à 95% [2]. Ces symptômes peuvent signaler une atteinte pulmonaire nécessitant une prise en charge hospitalière.
L'altération de l'état général, avec confusion, somnolence excessive, ou impossibilité de s'alimenter, constitue également un motif de consultation urgente [4]. Ces signes peuvent révéler une forme sévère ou des complications systémiques.
Pour les patients à risque (plus de 65 ans, immunodéprimés, porteurs de comorbidités), une consultation précoce est recommandée dès l'apparition des premiers symptômes [2]. Cette démarche permet d'évaluer l'opportunité d'un traitement antiviral précoce.
N'hésitez jamais à contacter votre médecin traitant en cas de doute. Il est préférable de consulter pour rien que de passer à côté d'une complication potentiellement grave . La téléconsultation peut être une alternative pratique pour l'évaluation initiale.
Questions Fréquentes
Combien de temps dure une infection à Coronaviridae ?
La durée varie selon le virus et la sévérité. Pour un rhume à coronavirus, comptez 7-10 jours. Pour le COVID-19, la phase aiguë dure 2-3 semaines, mais 10-20% des patients développent des symptômes persistants.
Peut-on attraper plusieurs fois une infection à Coronaviridae ?
Oui, la réinfection est possible, particulièrement avec les variants du SARS-CoV-2. L'immunité naturelle et vaccinale diminue avec le temps, d'où l'importance des rappels vaccinaux.
Les enfants sont-ils moins touchés par ces infections ?
Les enfants développent généralement des formes moins sévères, mais ils peuvent transmettre le virus. Les coronavirus endémiques causent fréquemment des rhumes chez l'enfant.
Quand reprendre le travail après une infection ?
Après disparition de la fièvre depuis 48h et amélioration des symptômes. Pour le COVID-19, l'isolement dure généralement 7-10 jours selon les recommandations actuelles.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Infections respiratoires aiguës (grippe, bronchiolite, COVID ...). Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [2] Reconnaître le Covid-19 et ses symptômes, adopter ... www.ameli.fr.Lien
- [8] SARS-CoV-2 Main Protease Inhibitors from Natural Product Repository as Therapeutic Candidates for the Treatment of Coronaviridae Infections. Current Medicinal Chemistry. 2025.Lien
- [16] Covid-19 (virus SARS-CoV-2). www.pasteur.fr.Lien
Publications scientifiques
- SARS-CoV-2 Main Protease Inhibitors from Natural Product Repository as Therapeutic Candidates for the Treatment of Coronaviridae Infections (2025)2 citations
- Clinical symptoms and signs in hamsters during experimental infection with the SARS-CoV-2 virus (Coronaviridae: Betacoronavirus) (2023)2 citations
- Compounds for use in the treatment of viral infections by virus of the family coronaviridae (2022)[PDF]
- [HTML][HTML] Systems immunology of transcriptional responses to viral infection identifies conserved antiviral pathways across macaques and humans (2024)2 citations
- Coronaviridae—Old friends, new enemy! (2022)51 citations[PDF]
Ressources web
- Reconnaître le Covid-19 et ses symptômes, adopter ... (ameli.fr)
L'infection par le Covid-19 est une maladie respiratoire et les principaux symptômes sont : une fièvre ou sensation de fièvre ; des signes respiratoires, comme ...
- Covid-19 (virus SARS-CoV-2) (pasteur.fr)
D'autres présentent des symptômes légers et peu spécifiques : maux de tête, fièvre, toux, diarrhée, fatigue. Une perte brutale de l'odorat et/ou du goût peut ...
- Symptômes, transmission et traitement (COVID-19) (quebec.ca)
15 nov. 2024 — À surveiller : fièvre, toux, difficulté à respirer. Les symptômes peuvent être légers ou sévères. Vous pouvez transmettre le virus sans le ...
- Coronavirus COVID-19 - symptômes, causes, traitements ... (vidal.fr)
8 déc. 2023 — Cette maladie, dont les symptômes évoquent ceux de la grippe saisonnière, est plus sévère chez les personnes âgées et les personnes rendues ...
- Quels sont les symptômes de la Covid-19 et quels gestes ... (service-public.fr)
Lorsque le test de dépistage à la Covid-19 est positif : évitez le contact avec les personnes fragiles, prévenez votre entourage, contactez votre médecin, ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
