Infarctus : Symptômes, Traitements et Prévention - Guide Complet 2025
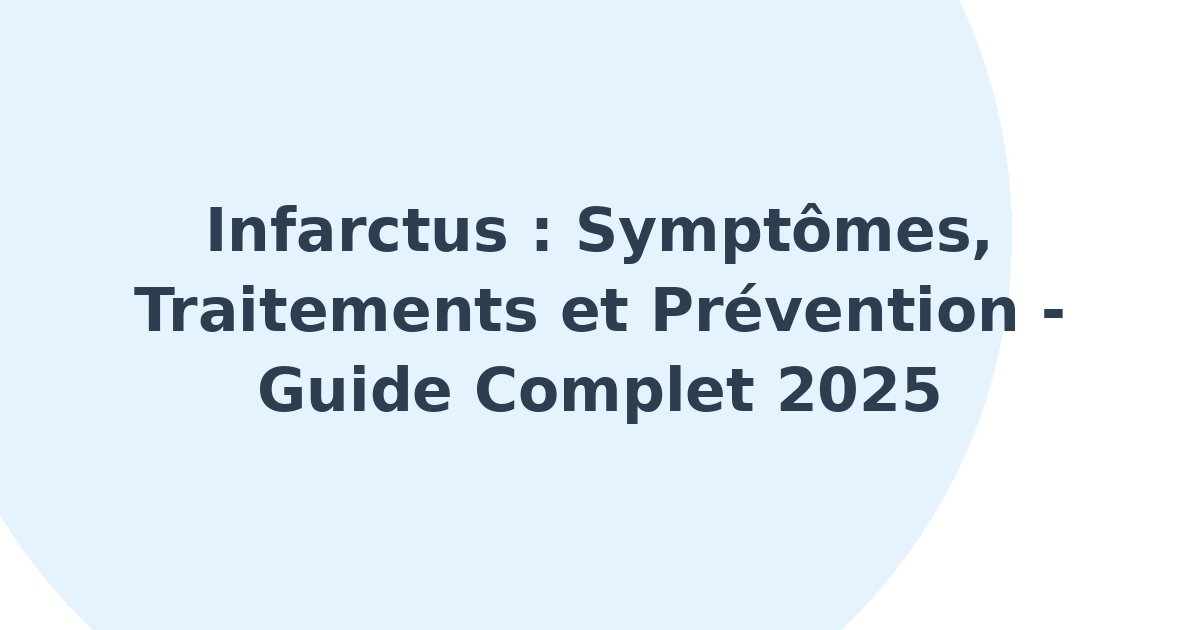
L'infarctus du myocarde, communément appelé crise cardiaque, représente une urgence médicale absolue qui touche plus de 120 000 personnes chaque année en France [1,2]. Cette pathologie cardiovasculaire survient lorsque l'irrigation sanguine du muscle cardiaque est brutalement interrompue, provoquant la mort des cellules cardiaques. Comprendre ses mécanismes, reconnaître ses symptômes et connaître les traitements disponibles peut littéralement sauver des vies.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Infarctus : Définition et Vue d'Ensemble
L'infarctus du myocarde correspond à la destruction d'une partie du muscle cardiaque suite à l'obstruction d'une artère coronaire [3]. Imaginez votre cœur comme une pompe qui a besoin d'être constamment alimentée en oxygène. Lorsqu'une de ses artères nourricières se bouche, c'est comme si vous coupiez l'électricité à une partie de cette pompe vitale.
Concrètement, cette obstruction résulte généralement de la formation d'un caillot sanguin sur une plaque d'athérome préexistante. La plaque, constituée de cholestérol et de débris cellulaires, se fissure et déclenche une cascade de coagulation. En quelques minutes, le caillot peut complètement bloquer l'artère [6].
Il existe plusieurs types d'infarctus selon leur localisation et leur étendue. L'infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST (STEMI) représente la forme la plus grave, nécessitant une intervention d'urgence dans les 90 minutes [19]. D'ailleurs, chaque minute compte : plus la prise en charge est rapide, plus les chances de survie et de récupération sont importantes.
Bon à savoir : le terme "crise cardiaque" est souvent utilisé dans le langage courant, mais les médecins préfèrent parler d'infarctus du myocarde pour être plus précis sur la nature de cette pathologie cardiovasculaire.
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les chiffres de l'infarctus en France révèlent l'ampleur de cette pathologie cardiovasculaire majeure. Selon Santé Publique France, environ 120 000 infarctus surviennent chaque année dans notre pays, soit un toutes les 4 minutes [1,2]. Cette incidence place la France dans la moyenne européenne, avec des variations régionales notables.
L'analyse épidémiologique montre des disparités frappantes selon l'âge et le sexe. Les hommes sont touchés 3 fois plus souvent que les femmes avant 65 ans, mais cet écart se réduit après la ménopause [4,5]. L'âge moyen de survenue est de 66 ans chez les hommes et 74 ans chez les femmes. Cependant, une tendance inquiétante émerge : l'infarctus chez les jeunes adultes, particulièrement les femmes de moins de 50 ans, est en augmentation [15,18].
Géographiquement, les régions du Nord et de l'Est de la France présentent des taux d'incidence supérieurs à la moyenne nationale, probablement liés aux facteurs socio-économiques et aux habitudes de vie [2]. À l'inverse, les régions méditerranéennes bénéficient d'un effet protecteur, attribué en partie au régime alimentaire local.
Sur le plan international, la France se situe favorablement par rapport aux États-Unis où l'incidence atteint 735 000 cas annuels, mais reste derrière les pays nordiques comme la Finlande qui affichent les taux les plus bas d'Europe [1]. Cette différence s'explique par des politiques de prévention cardiovasculaire particulièrement efficaces dans ces pays.
Les Causes et Facteurs de Risque
L'athérosclérose constitue la cause principale de l'infarctus du myocarde dans plus de 90% des cas [3]. Ce processus insidieux débute dès l'adolescence par l'accumulation de cholestérol dans la paroi des artères coronaires. Au fil des années, ces dépôts forment des plaques qui rétrécissent progressivement le calibre artériel.
Mais alors, qu'est-ce qui déclenche l'infarctus ? La rupture ou l'érosion de ces plaques d'athérome provoque la formation d'un caillot sanguin qui obstrue complètement l'artère [6]. Cette rupture peut survenir même sur des plaques peu sténosantes, expliquant pourquoi certains infarctus surviennent chez des personnes sans symptômes préalables.
Les facteurs de risque cardiovasculaire se divisent en deux catégories. D'un côté, les facteurs non modifiables : l'âge, le sexe masculin et l'hérédité familiale. De l'autre, les facteurs sur lesquels vous pouvez agir : le tabagisme (qui multiplie le risque par 3), l'hypertension artérielle, le diabète, l'hypercholestérolémie et l'obésité [3].
Il faut savoir que certaines situations particulières augmentent temporairement le risque d'infarctus. Le stress intense, l'effort physique inhabituel chez une personne sédentaire, ou encore la consommation de drogues comme la cocaïne peuvent déclencher un infarctus chez des sujets prédisposés. D'ailleurs, les études récentes montrent que la pollution atmosphérique constitue également un facteur de risque émergent [9].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
La douleur thoracique reste le symptôme le plus caractéristique de l'infarctus, mais attention aux idées reçues ! Cette douleur ne ressemble pas toujours au "coup de poignard" dramatique des films. Elle se manifeste plutôt comme une sensation d'oppression, de serrement ou de brûlure intense au centre de la poitrine [6].
Cette douleur présente des caractéristiques particulières qui doivent vous alerter. Elle persiste plus de 20 minutes, ne cède pas au repos ni à la prise de trinitrine, et irradie souvent vers le bras gauche, la mâchoire, le cou ou le dos. Certains patients la décrivent comme "un étau qui serre la poitrine" ou "un poids énorme sur le thorax" [6].
Mais l'infarctus ne se limite pas à la douleur thoracique. D'autres symptômes peuvent l'accompagner ou même la remplacer : des nausées et vomissements, une sueur froide profuse, un essoufflement soudain, des palpitations ou une fatigue extrême inexpliquée. Ces signes sont particulièrement fréquents chez les femmes, les diabétiques et les personnes âgées [18].
Chez les femmes, l'infarctus se présente souvent de manière atypique. Au lieu de la douleur thoracique classique, elles peuvent ressentir une fatigue inhabituelle, des douleurs dans le dos ou l'estomac, ou encore un simple malaise général [15,18]. Cette présentation atypique explique en partie pourquoi le diagnostic est parfois retardé chez les femmes, avec des conséquences potentiellement graves.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Face à une suspicion d'infarctus, chaque minute compte et le diagnostic doit être posé rapidement. L'électrocardiogramme (ECG) constitue l'examen de première intention, réalisé dès l'arrivée aux urgences ou par l'équipe du SAMU [12]. Cet examen indolore de quelques minutes peut révéler les signes électriques caractéristiques de l'infarctus.
Parallèlement, une prise de sang permet de doser les troponines cardiaques, des protéines libérées par les cellules cardiaques lorsqu'elles sont endommagées. Ces marqueurs biologiques confirment le diagnostic d'infarctus et permettent d'évaluer l'étendue des dégâts [21]. Leur taux augmente dans les 3 à 6 heures suivant le début des symptômes et reste élevé plusieurs jours.
L'échocardiographie complète souvent ce bilan initial. Cet examen par ultrasons visualise le cœur en temps réel et permet d'évaluer la fonction cardiaque, de détecter d'éventuelles complications comme un épanchement péricardique ou une rupture de pilier mitral [21]. Il aide également à guider la stratégie thérapeutique.
Dans certains cas complexes, d'autres examens peuvent être nécessaires. La coronarographie, examen de référence pour visualiser les artères coronaires, est souvent réalisée en urgence pour localiser précisément l'obstruction et planifier le traitement de reperfusion [12]. Bon à savoir : tous ces examens sont pris en charge à 100% par l'Assurance Maladie dans le cadre de l'ALD (Affection de Longue Durée).
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de l'infarctus repose sur un principe fondamental : restaurer rapidement la circulation sanguine dans l'artère obstruée. Cette "reperfusion" peut être obtenue par deux méthodes principales, chacune ayant ses indications spécifiques selon le contexte clinique [20,21].
L'angioplastie coronaire primaire représente le traitement de référence lorsqu'elle peut être réalisée dans les 90 minutes suivant le diagnostic. Cette intervention consiste à introduire un petit ballonnet dans l'artère obstruée pour l'ouvrir, puis à poser un stent (petit ressort métallique) pour maintenir l'artère ouverte [20]. Cette technique permet de sauver le maximum de muscle cardiaque.
Quand l'angioplastie n'est pas disponible rapidement, la thrombolyse constitue une alternative efficace. Ce traitement médicamenteux dissout le caillot sanguin grâce à des substances comme l'altéplase [11]. Bien que moins efficace que l'angioplastie, la thrombolyse peut être administrée plus rapidement, parfois même à domicile par le SAMU.
Le traitement médical accompagne toujours ces interventions de reperfusion. Il comprend des antiagrégants plaquettaires (aspirine, clopidogrel) pour prévenir la formation de nouveaux caillots, des anticoagulants, et souvent des bêtabloquants et des inhibiteurs de l'enzyme de conversion [20]. Ces médicaments, pris à vie dans la plupart des cas, réduisent significativement le risque de récidive.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
La recherche cardiovasculaire connaît une effervescence remarquable avec des avancées prometteuses pour l'avenir des patients [7,8]. Les thérapies cellulaires représentent l'une des pistes les plus innovantes, avec des essais cliniques testant l'injection de cellules souches pour régénérer le muscle cardiaque endommagé après un infarctus.
Les nouvelles approches pharmacologiques se multiplient également. Selon les données récentes, 45 compagnies pharmaceutiques travaillent activement sur des thérapeutiques innovantes pour l'infarctus du myocarde [10]. Ces recherches portent notamment sur des molécules capables de limiter les dégâts cellulaires lors de la reperfusion, un phénomène appelé "lésions de reperfusion".
L'intelligence artificielle révolutionne aussi la prise en charge de l'infarctus. Des algorithmes d'apprentissage automatique analysent désormais les ECG avec une précision supérieure à celle de certains médecins expérimentés, permettant un diagnostic plus rapide et plus fiable [9]. Ces outils d'aide au diagnostic commencent à être déployés dans les services d'urgence français.
La médecine personnalisée ouvre également de nouvelles perspectives. Les tests génétiques permettent d'identifier les patients à haut risque de complications ou de mauvaise réponse aux traitements anticoagulants, autorisant une adaptation individualisée des protocoles thérapeutiques [8]. Cette approche sur mesure promet d'améliorer significativement les résultats cliniques.
Vivre au Quotidien avec un Antécédent d'Infarctus
Après un infarctus, la vie continue, mais elle s'organise différemment. La réadaptation cardiaque constitue une étape cruciale de votre rétablissement, généralement proposée dans les semaines suivant votre sortie d'hospitalisation. Ce programme personnalisé combine exercice physique adapté, éducation thérapeutique et soutien psychologique [20].
L'activité physique, loin d'être interdite, devient votre alliée. Bien sûr, elle doit être progressive et encadrée au début. La marche quotidienne, puis progressivement d'autres activités comme la natation ou le vélo, contribuent à renforcer votre cœur et à améliorer votre qualité de vie [20]. L'important est de respecter vos limites et de suivre les conseils de votre cardiologue.
Côté alimentation, adopter un régime méditerranéen s'avère particulièrement bénéfique. Privilégiez les fruits, légumes, poissons gras, huile d'olive et noix, tout en limitant les graisses saturées et le sel. Cette approche nutritionnelle peut réduire de 30% le risque de récidive cardiovasculaire [3].
La gestion du stress devient également primordiale. Techniques de relaxation, méditation, yoga ou simple pratique d'un hobby peuvent vous aider à mieux gérer les tensions du quotidien. N'hésitez pas à solliciter un soutien psychologique si vous en ressentez le besoin : il est normal de traverser des périodes d'anxiété après un tel événement [17].
Les Complications Possibles
Bien que la prise en charge moderne de l'infarctus ait considérablement amélioré le pronostic, certaines complications peuvent survenir, particulièrement dans les premiers jours suivant l'événement aigu [20,21]. La connaissance de ces risques permet une surveillance adaptée et une intervention précoce si nécessaire.
L'insuffisance cardiaque représente la complication la plus fréquente, touchant environ 20% des patients après un infarctus étendu. Elle résulte de la perte de muscle cardiaque fonctionnel et se manifeste par un essoufflement, une fatigue et parfois des œdèmes des membres inférieurs [7]. Heureusement, les traitements actuels permettent de bien contrôler cette pathologie dans la majorité des cas.
Les troubles du rythme cardiaque constituent une autre complication redoutable, pouvant survenir dans les heures ou jours suivant l'infarctus. Ces arythmies, allant de simples extrasystoles à des troubles plus graves comme la fibrillation ventriculaire, nécessitent parfois la pose d'un défibrillateur implantable [21].
Plus rarement, des complications mécaniques peuvent survenir : rupture de la paroi cardiaque, dysfonctionnement d'une valve ou formation d'un caillot dans le ventricule gauche. Ces situations, bien qu'exceptionnelles avec les traitements actuels, peuvent nécessiter une intervention chirurgicale d'urgence [20]. L'important à retenir : un suivi cardiologique régulier permet de dépister et traiter précocement ces complications.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic après un infarctus s'est considérablement amélioré ces dernières décennies grâce aux progrès thérapeutiques. Aujourd'hui, la mortalité hospitalière de l'infarctus du myocarde est inférieure à 5% dans les centres spécialisés, contre plus de 30% il y a quarante ans [1,2]. Cette amélioration spectaculaire résulte de la généralisation des techniques de reperfusion et de l'optimisation des traitements médicamenteux.
À long terme, le pronostic dépend de plusieurs facteurs. L'étendue de l'infarctus, évaluée par l'échocardiographie et l'IRM cardiaque, constitue le principal déterminant. Un infarctus limité avec préservation de la fonction ventriculaire gauche offre un excellent pronostic, avec une survie à 10 ans supérieure à 85% [20]. À l'inverse, un infarctus étendu avec altération sévère de la fonction cardiaque nécessite une surveillance plus rapprochée.
L'âge au moment de l'infarctus influence également le pronostic. Les patients jeunes, comme dans notre témoignage, ont généralement une excellente récupération et peuvent reprendre une vie normale. Chez les personnes âgées, le pronostic reste favorable mais peut être influencé par la présence d'autres pathologies [8].
Concrètement, la majorité des patients reprennent leurs activités professionnelles dans les 2 à 3 mois suivant l'infarctus. Certains témoignent même d'une amélioration de leur qualité de vie grâce aux modifications du mode de vie adoptées après l'événement [17]. L'essentiel est de respecter le traitement prescrit et le suivi cardiologique régulier.
Peut-on Prévenir l'Infarctus ?
La prévention de l'infarctus repose sur une approche globale visant à contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire modifiables. Cette stratégie préventive peut réduire de 80% le risque de survenue d'un premier infarctus, selon les données épidémiologiques récentes [3,4].
L'arrêt du tabac constitue la mesure préventive la plus efficace. Le tabagisme multiplie par 3 le risque d'infarctus, mais la bonne nouvelle est que ce risque diminue rapidement après l'arrêt : de 50% dès la première année, pour rejoindre celui des non-fumeurs après 5 ans [3]. Les substituts nicotiniques et les nouveaux traitements comme la varénicline facilitent grandement le sevrage tabagique.
Le contrôle de la pression artérielle et du cholestérol s'avère également crucial. Une tension artérielle maintenue en dessous de 140/90 mmHg et un LDL-cholestérol inférieur à 1,9 g/L (ou 1,6 g/L en prévention primaire) réduisent significativement le risque cardiovasculaire [3]. Ces objectifs sont généralement atteignables par une combinaison de mesures hygiéno-diététiques et de traitements médicamenteux si nécessaire.
L'activité physique régulière représente un pilier de la prévention. Trente minutes de marche rapide cinq fois par semaine suffisent à obtenir un bénéfice cardiovasculaire significatif [8]. Cette activité améliore la fonction cardiaque, réduit la pression artérielle et favorise un bon équilibre du cholestérol. D'ailleurs, il n'est jamais trop tard pour commencer : même après 60 ans, la mise en route d'une activité physique adaptée apporte des bénéfices mesurables.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont publié des recommandations précises pour optimiser la prise en charge de l'infarctus du myocarde. La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise une prise en charge dans les 90 minutes suivant le diagnostic pour l'angioplastie primaire, délai respecté dans 75% des cas en France selon les dernières données [1,2].
Santé Publique France insiste particulièrement sur la prévention primaire, notamment chez les populations à risque. Les recommandations 2024-2025 mettent l'accent sur le dépistage précoce des facteurs de risque cardiovasculaire dès l'âge de 40 ans, avec un bilan lipidique et une mesure de la pression artérielle annuels [2,4].
Concernant la réadaptation cardiaque, les autorités recommandent sa prescription systématique après un infarctus. Malheureusement, seulement 30% des patients français en bénéficient actuellement, contre 60% en Allemagne [2]. Cette sous-utilisation représente un enjeu majeur d'amélioration de la qualité des soins.
Les nouvelles recommandations 2025 intègrent également les innovations technologiques. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'interprétation des ECG et la télémédecine pour le suivi des patients chroniques sont désormais encouragées [9]. Ces outils permettent d'améliorer l'accès aux soins, particulièrement dans les zones sous-médicalisées.
Enfin, les autorités insistent sur l'importance de la formation continue des professionnels de santé. Les protocoles de prise en charge évoluent rapidement, et une mise à jour régulière des connaissances est indispensable pour maintenir la qualité des soins [8].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations accompagnent les patients et leurs familles dans leur parcours post-infarctus. La Fédération Française de Cardiologie propose des programmes d'éducation thérapeutique, des clubs cœur et santé pour maintenir une activité physique adaptée, ainsi que des brochures d'information actualisées régulièrement.
L'Association de Cardiologie du Nord offre un soutien spécifique aux patients de cette région particulièrement touchée par les maladies cardiovasculaires [2]. Elle organise des conférences, des ateliers cuisine santé et met en relation les patients pour favoriser l'entraide et le partage d'expériences.
Au niveau numérique, plusieurs applications mobiles facilitent le suivi post-infarctus. "Mon Coach Cœur" développée avec la Fédération Française de Cardiologie, permet de suivre ses paramètres vitaux, ses médicaments et propose des conseils personnalisés. Ces outils digitaux complètent utilement le suivi médical traditionnel.
Pour les proches, des groupes de soutien existent dans la plupart des grandes villes. Vivre avec une personne ayant fait un infarctus génère souvent de l'anxiété et des questionnements légitimes. Ces groupes offrent un espace d'écoute et de partage d'expériences précieux pour mieux accompagner leur proche dans sa convalescence.
Nos Conseils Pratiques
Adopter de bonnes habitudes au quotidien peut considérablement réduire votre risque cardiovasculaire. Commencez par planifier vos repas en privilégiant les aliments frais et peu transformés. Préparez vos menus de la semaine le dimanche, cela vous évitera les tentations de dernière minute et vous aidera à maintenir une alimentation équilibrée.
Pour l'activité physique, l'astuce est de l'intégrer naturellement dans votre routine. Descendez un arrêt de bus plus tôt, prenez les escaliers plutôt que l'ascenseur, garez-vous un peu plus loin de votre destination. Ces petits gestes, répétés quotidiennement, représentent un bénéfice cardiovasculaire non négligeable.
Côté gestion du stress, identifiez vos facteurs de tension et développez des stratégies personnalisées. Certains trouvent leur équilibre dans la méditation, d'autres dans le jardinage ou la lecture. L'important est de vous accorder quotidiennement un moment de détente, même bref.
Tenez un carnet de santé où vous noterez vos chiffres de tension, votre poids, vos médicaments et vos rendez-vous médicaux. Cette habitude facilite le suivi médical et vous permet de mieux comprendre l'évolution de votre état de santé. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à votre médecin : il n'y a pas de question idiote en matière de santé cardiaque.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous amener à consulter en urgence, sans attendre. Toute douleur thoracique persistante plus de quelques minutes, surtout si elle s'accompagne d'essoufflement, de sueurs ou de nausées, justifie un appel immédiat au 15 [6]. N'ayez pas peur de "déranger pour rien" : il vaut mieux une fausse alerte qu'un infarctus non traité.
Si vous avez des antécédents cardiovasculaires, soyez particulièrement vigilant aux changements dans votre tolérance à l'effort. Un essoufflement inhabituel lors d'activités habituellement bien tolérées, une fatigue inexpliquée ou des palpitations nouvelles méritent une consultation rapide chez votre cardiologue [20].
Pour le suivi de routine, respectez scrupuleusement vos rendez-vous cardiologiques. Généralement programmés tous les 6 mois après un infarctus, ces consultations permettent d'adapter votre traitement et de dépister précocement d'éventuelles complications [21]. N'hésitez pas à avancer un rendez-vous si vous ressentez des symptômes nouveaux.
Enfin, consultez votre médecin traitant si vous souhaitez modifier votre traitement ou si vous ressentez des effets secondaires. Certains patients arrêtent leurs médicaments sans avis médical, ce qui peut avoir des conséquences graves. Votre médecin peut toujours adapter votre prescription pour améliorer votre tolérance tout en maintenant l'efficacité du traitement.
Questions Fréquentes
Peut-on faire du sport après un infarctus ?Absolument ! L'activité physique est même recommandée et fait partie intégrante de la réadaptation cardiaque. Elle doit cependant être progressive et adaptée à votre état cardiaque. Commencez par de la marche, puis progressivement d'autres activités selon les conseils de votre cardiologue [20].
Les femmes font-elles moins d'infarctus que les hommes ?
Avant la ménopause, oui. Les hormones féminines exercent un effet protecteur sur les artères. Mais après 65 ans, cette protection disparaît et les femmes rattrapent les hommes en termes de risque cardiovasculaire. D'ailleurs, l'infarctus chez les jeunes femmes est en augmentation [15,18].
Faut-il éviter les efforts physiques après un infarctus ?
Au contraire ! Après la phase aiguë et avec l'accord de votre cardiologue, l'exercice physique régulier améliore votre pronostic et votre qualité de vie. L'important est de respecter une progression adaptée et d'éviter les efforts violents non préparés [20].
Les médicaments après un infarctus sont-ils à vie ?
Dans la plupart des cas, oui. Les antiagrégants plaquettaires, les statines et souvent les bêtabloquants sont prescrits au long cours pour prévenir la récidive. Cependant, votre médecin peut adapter votre traitement selon l'évolution de votre état de santé [21].
Questions Fréquentes
Peut-on faire du sport après un infarctus ?
Absolument ! L'activité physique est même recommandée et fait partie intégrante de la réadaptation cardiaque. Elle doit cependant être progressive et adaptée à votre état cardiaque.
Les femmes font-elles moins d'infarctus que les hommes ?
Avant la ménopause, oui. Les hormones féminines exercent un effet protecteur. Mais après 65 ans, cette protection disparaît et le risque s'égalise.
Les médicaments après un infarctus sont-ils à vie ?
Dans la plupart des cas, oui. Les antiagrégants plaquettaires, statines et bêtabloquants sont prescrits au long cours pour prévenir la récidive.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Épidémiologie des cardiopathies ischémiques en France. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [2] Les maladies cardiovasculaires en France : un impact majeur et des inégalités persistantes. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [3] Définition et facteurs favorisants de l'infarctus du myocarde. Assurance Maladie. 2024-2025.Lien
- [7] Insuffisance cardiaque : les traitements de demain au cœur de la recherche. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [8] Prévention et gériatrie: un défi majeur pour la cardiologie. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [9] Que retenir du colloque dédié aux maladies cardiométaboliques. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [10] Myocardial Infarction Clinical Trial Pipeline Appears Robust. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [11] Phase III EXPECTS Trial Finds Alteplase Boosts 90-Day Recovery. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [15] Intérêt d'un observatoire de l'infarctus du myocarde des femmes de moins de 50 ans: étude WAMIF. 2023.Lien
- [18] L'Inégalité de prise en charge de l'infarctus du myocarde chez les femmes en France. 2025.Lien
Publications scientifiques
- Prise en charge de l'infarctus cérébral à la phase initiale (2022)3 citations
- Les causes des infarctus spléniques: une revue quasi systématique de la littérature (2024)
- Quelles pistes d'avenir pour le traitement de l'infarctus cérébral aigu? (2023)1 citations
- Intérêt d'un observatoire de l'infarctus du myocarde des femmes de moins de 50 ans: étude WAMIF (2023)1 citations
- L'infarctus mésentérique artériel: une complication rare de la prééclampsie du postpartum (2025)
Ressources web
- Infarctus du myocarde - symptômes, causes, traitements et ... (vidal.fr)
4 mars 2024 — Les symptômes de l'infarctus sont une douleur de la poitrine qui dure plus de 20 à 30 minutes. Elle irradie derrière le sternum, dans le dos, ...
- Reconnaître un infarctus (ou crise cardiaque) et agir au ... (ameli.fr)
Appelez le 15 ou le 112 devant une douleur thoracique en étau, diffusant dans les bras et mâchoires. L'infarctus ou crise cardiaque nécessite un traitement
- Infarctus – diagnostic, traitement (hirslanden.com)
Un ECG et la détermination du taux de troponine dans le sang permettront au médecin d'établir un diagnostic rapidement. La troponine est une substance produite ...
- Infarctus du myocarde (crise cardiaque) : définition, causes ... (elsan.care)
14 sept. 2022 — Quels sont les signes et symptômes d'un début d'infarctus du myocarde ? · Une douleur brutale, vive et persistante, qui commence au niveau de ...
- Infarctus du myocarde aigu - Troubles cardiovasculaires (msdmanuals.com)
Les symptômes comprennent une gêne thoracique avec ou sans dyspnée, nausées et/ou transpiration. Le diagnostic repose sur l'ECG et sur l'éventuelle présence de ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
