Incontinence Anale : Symptômes, Causes et Traitements 2025 | Guide Complet
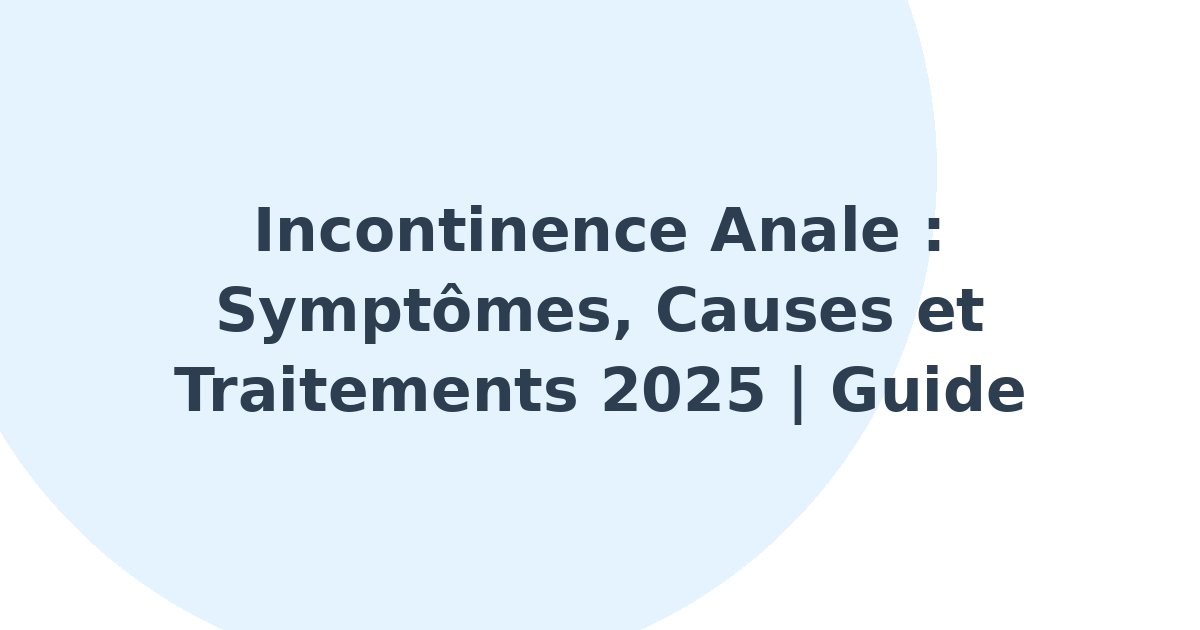
L'incontinence anale touche près de 3% des adultes français, soit environ 2 millions de personnes [1,2]. Cette pathologie, caractérisée par la perte involontaire de selles ou de gaz, reste souvent taboue malgré son impact majeur sur la qualité de vie. Heureusement, les innovations thérapeutiques 2024-2025 offrent de nouveaux espoirs avec des traitements révolutionnaires comme la thérapie par cellules souches [4,5]. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette maladie et les solutions disponibles aujourd'hui.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Incontinence anale : Définition et Vue d'Ensemble
L'incontinence anale se définit comme l'incapacité à contrôler l'évacuation des selles et des gaz intestinaux. Cette pathologie complexe résulte d'un dysfonctionnement du système de continence anorectale, impliquant les sphincters anal interne et externe, les muscles du plancher pelvien et les mécanismes neurologiques de contrôle [9,14].
Contrairement aux idées reçues, l'incontinence anale ne se limite pas aux fuites de selles liquides. Elle englobe également l'incontinence aux gaz, aux selles molles et parfois même aux selles formées. D'ailleurs, on distingue plusieurs degrés de sévérité selon l'échelle de Wexner, allant de l'incontinence occasionnelle aux gaz jusqu'à la perte complète de contrôle [15].
Il est important de comprendre que cette maladie n'est pas une fatalité liée au vieillissement. En fait, elle peut survenir à tout âge et touche aussi bien les hommes que les femmes, bien que certains facteurs de risque diffèrent selon le sexe [7,8]. L'important à retenir : des solutions existent et la prise en charge précoce améliore considérablement les résultats thérapeutiques.
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques françaises révèlent une prévalence de l'incontinence anale comprise entre 2,2% et 15% selon les études et les critères diagnostiques utilisés [1,2]. Concrètement, cela représente entre 1,5 et 10 millions de Français concernés par cette pathologie. Les chiffres varient considérablement car beaucoup de patients n'osent pas consulter ou en parler à leur médecin.
L'incidence annuelle est estimée à 0,5% de la population adulte, avec une augmentation notable chez les personnes âgées de plus de 65 ans où elle atteint 7% [12]. Mais attention, cette pathologie ne touche pas que les seniors : 30% des cas concernent des adultes de moins de 50 ans, particulièrement les femmes en post-partum [13].
Comparativement aux autres pays européens, la France présente des taux similaires à ceux observés en Allemagne et au Royaume-Uni. Cependant, les données américaines montrent une prévalence légèrement supérieure, atteignant 18% chez les femmes de plus de 70 ans [7]. Cette différence s'explique probablement par des critères diagnostiques plus larges et une meilleure déclaration des symptômes outre-Atlantique.
Les projections pour 2030 suggèrent une augmentation de 25% du nombre de cas en France, principalement due au vieillissement de la population et à l'amélioration du diagnostic [1,2]. L'impact économique sur le système de santé français est estimé à 180 millions d'euros annuels, incluant les consultations, examens et traitements spécialisés.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes de l'incontinence anale sont multiples et souvent intriquées. Les traumatismes obstétricaux représentent la première cause chez la femme, concernant 15% des accouchements par voie basse avec déchirure du sphincter anal [13]. Ces lésions peuvent passer inaperçues initialement et se révéler des années plus tard, particulièrement après la ménopause [8].
Chez l'homme, les interventions chirurgicales ano-rectales constituent le principal facteur de risque. La chirurgie de la fissure anale, notamment la sphinctérotomie, peut entraîner une incontinence dans 5 à 10% des cas [10]. D'ailleurs, les nouvelles techniques chirurgicales visent à réduire ce risque tout en maintenant l'efficacité thérapeutique.
Les maladies inflammatoires chroniques intestinales (MICI) représentent une cause importante et souvent sous-estimée. La maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique peuvent altérer la fonction sphinctérienne par inflammation chronique ou complications chirurgicales [11]. Il faut savoir que 20% des patients atteints de MICI développent une incontinence anale au cours de l'évolution de leur maladie.
Le vieillissement physiologique joue également un rôle majeur. Avec l'âge, on observe une diminution de la force de contraction des sphincters, une altération de la sensibilité rectale et des modifications de la compliance rectale [12]. Ces changements expliquent pourquoi l'incontinence anale devient plus fréquente après 70 ans, touchant jusqu'à 15% de cette population.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de l'incontinence anale varient considérablement d'une personne à l'autre. Le signe le plus évident reste la perte involontaire de selles, mais attention : cette pathologie peut débuter de manière très subtile [14,15]. Beaucoup de patients rapportent d'abord des difficultés à retenir les gaz, particulièrement en position debout ou lors d'efforts.
L'urgence défécatoire constitue souvent le premier symptôme alarmant. Vous ressentez soudainement un besoin impérieux d'aller aux toilettes, sans pouvoir vous retenir plus de quelques minutes. Cette sensation peut survenir de jour comme de nuit, perturbant considérablement le sommeil et les activités quotidiennes [16].
Les fuites peuvent être de différents types : liquides, molles ou parfois solides. Certains patients décrivent des "accidents" lors de la toux, des éternuements ou des efforts physiques. D'autres mentionnent des souillures matinales au réveil, sans avoir ressenti le besoin d'aller aux toilettes [9].
Il est normal de s'inquiéter face à ces symptômes, mais rassurez-vous : leur apparition ne signifie pas forcément une incontinence sévère. En fait, beaucoup de troubles légers peuvent être améliorés rapidement avec une prise en charge adaptée. L'important est de ne pas attendre et de consulter dès les premiers signes.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de l'incontinence anale repose sur une démarche méthodique associant interrogatoire, examen clinique et explorations complémentaires [9,15]. La première étape consiste en un entretien approfondi où votre médecin évaluera la fréquence, la sévérité et l'impact des symptômes sur votre qualité de vie.
L'échelle de Wexner est systématiquement utilisée pour quantifier l'incontinence. Ce score, allant de 0 (continence parfaite) à 20 (incontinence totale), permet d'évaluer objectivement votre situation et de suivre l'évolution sous traitement. Concrètement, un score supérieur à 9 indique une incontinence sévère nécessitant une prise en charge spécialisée [15].
L'examen proctologique comprend l'inspection de la région anale, le toucher rectal et l'évaluation du tonus sphinctérien. Votre médecin recherchera des signes de lésions anatomiques, de prolapsus ou d'inflammation. Cet examen, bien que parfois inconfortable, reste indispensable pour orienter le diagnostic [16].
Les explorations complémentaires incluent la manométrie anorectale, examen de référence qui mesure les pressions sphinctériennes et évalue la sensibilité rectale. L'échographie endoanale permet de visualiser l'anatomie des sphincters et de détecter d'éventuelles lésions. Dans certains cas, une IRM pelvienne ou une défécographie peuvent être nécessaires pour compléter le bilan [9].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge de l'incontinence anale suit une approche progressive, débutant par les mesures conservatrices avant d'envisager les options chirurgicales [1,9]. Les modifications diététiques constituent souvent la première étape : éviter les aliments irritants, augmenter les fibres pour normaliser la consistance des selles, et maintenir une hydratation adéquate.
La rééducation périnéale représente un pilier thérapeutique majeur. Cette approche, menée par des kinésithérapeutes spécialisés, vise à renforcer les muscles du plancher pelvien et à améliorer la coordination ano-rectale. Les résultats sont encourageants : 60 à 70% des patients constatent une amélioration significative après 3 mois de rééducation [9,16].
Les traitements médicamenteux incluent les ralentisseurs du transit (lopéramide), les agents épaississants des selles et parfois les antispasmodiques. Bien sûr, ces médicaments doivent être adaptés à chaque situation et prescrits par un médecin expérimenté [14].
Quand les traitements conservateurs échouent, plusieurs options chirurgicales existent. La réparation sphinctérienne directe peut être proposée en cas de lésion anatomique identifiée. Les techniques de neuromodulation, comme la stimulation des racines sacrées, offrent de bons résultats dans les formes neurologiques [1,2]. Pour les cas les plus sévères, la création d'un sphincter artificiel ou d'une stomie peut être envisagée, bien que ces solutions restent exceptionnelles.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge de l'incontinence anale avec l'émergence de thérapies révolutionnaires [1,2]. Les nouveaux outils de prise en charge en proctologie intègrent désormais des approches de médecine régénérative particulièrement prometteuses.
La thérapie par cellules souches représente l'innovation la plus spectaculaire. L'UCI Health a récemment ouvert un essai clinique utilisant des cellules souches mésenchymateuses pour réparer les sphincters endommagés [4]. Cette approche révolutionnaire vise à régénérer les tissus musculaires et nerveux, offrant un espoir inédit aux patients souffrant d'incontinence sévère.
Parallèlement, Cook MyoSite a terminé l'inclusion de patients dans l'étude CELLEBRATE, évaluant l'efficacité de cellules musculaires autologues injectées dans le sphincter anal [5]. Les premiers résultats, attendus fin 2025, pourraient révolutionner notre approche thérapeutique. D'ailleurs, cette technique présente l'avantage d'utiliser les propres cellules du patient, limitant ainsi les risques de rejet.
Les innovations technologiques incluent également de nouveaux dispositifs de neuromodulation plus précis et moins invasifs. Ces systèmes de stimulation électrique ciblée permettent une modulation fine de l'activité sphinctérienne, avec des taux de succès supérieurs aux techniques traditionnelles [1,2]. L'important à retenir : ces avancées ouvrent des perspectives thérapeutiques inédites pour les patients en échec des traitements conventionnels.
Vivre au Quotidien avec l'Incontinence Anale
Vivre avec une incontinence anale nécessite des adaptations quotidiennes, mais rassurez-vous : de nombreuses stratégies permettent de maintenir une qualité de vie satisfaisante [7,14]. L'organisation des activités autour des habitudes intestinales devient rapidement naturelle. Beaucoup de patients développent des routines matinales incluant une toilette intestinale programmée.
Les protections modernes ont considérablement évolué. Les changes anatomiques discrets, les protections adhésives et les sous-vêtements absorbants permettent de sortir en toute sérénité. Il existe même des applications mobiles pour localiser les toilettes publiques les plus proches, facilitant les déplacements [15].
L'adaptation vestimentaire joue un rôle important. Privilégier des vêtements sombres, des tissus faciles d'entretien et des coupes permettant un accès rapide aux toilettes. Certains patients constituent des "kits d'urgence" avec lingerie de rechange et produits d'hygiène, qu'ils gardent au bureau ou en voiture.
L'impact psychologique ne doit pas être négligé. Cette pathologie peut générer anxiété, dépression et isolement social [16]. Heureusement, les groupes de soutien et les associations de patients offrent un accompagnement précieux. Parler avec d'autres personnes vivant la même situation aide énormément à dédramatiser et à trouver des solutions pratiques.
Les Complications Possibles
L'incontinence anale non traitée peut entraîner diverses complications, principalement dermatologiques et psychosociales [14,16]. Les lésions cutanées péri-anales représentent la complication la plus fréquente. Le contact prolongé avec les selles provoque irritations, eczéma et parfois surinfections bactériennes ou mycosiques.
Les complications psychologiques sont souvent sous-estimées mais particulièrement invalidantes. Anxiété, dépression et isolement social touchent près de 40% des patients [7]. Cette détresse psychologique peut créer un cercle vicieux : le stress aggrave les symptômes digestifs, qui à leur tour augmentent l'anxiété.
Chez la femme ménopausée, l'incontinence anale peut s'associer à d'autres troubles de la statique pelvienne comme l'incontinence urinaire ou le prolapsus génital [8]. Cette association complique la prise en charge et nécessite souvent une approche multidisciplinaire impliquant gynécologues, urologues et proctologues.
Il faut savoir que certaines complications peuvent survenir lors des traitements eux-mêmes. La chirurgie sphinctérienne comporte des risques de récidive, d'infection ou de troubles de la cicatrisation [10]. C'est pourquoi une évaluation rigoureuse du rapport bénéfice-risque est indispensable avant toute intervention chirurgicale.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'incontinence anale dépend largement de la cause sous-jacente, de la précocité du diagnostic et de l'adhésion au traitement [9,12]. Dans les formes légères à modérées, 70% des patients obtiennent une amélioration significative avec les traitements conservateurs. Cette amélioration se maintient généralement à long terme si les recommandations sont suivies.
Pour les incontinences post-obstétricales, le pronostic est particulièrement favorable quand la prise en charge débute précocement [13]. La rééducation périnéale, initiée dans les 6 mois suivant l'accouchement, permet une récupération complète dans 80% des cas. Malheureusement, les formes diagnostiquées tardivement, parfois des années après l'accouchement, présentent des taux de succès moindres.
Chez les personnes âgées, l'évolution est plus variable [12]. Si les causes réversibles (constipation, médicaments, infections) sont corrigées, l'amélioration peut être spectaculaire. En revanche, les formes liées au vieillissement physiologique nécessitent souvent une prise en charge au long cours avec adaptations régulières du traitement.
L'important à retenir : même dans les cas sévères, des solutions existent toujours. Les innovations thérapeutiques 2024-2025, notamment la thérapie cellulaire, ouvrent de nouveaux horizons pour les patients en échec des traitements conventionnels [4,5]. Le pronostic s'améliore constamment grâce aux progrès de la recherche médicale.
Peut-on Prévenir l'Incontinence Anale ?
La prévention de l'incontinence anale repose sur plusieurs stratégies ciblées selon les facteurs de risque identifiés [7,13]. Chez la femme enceinte, la préparation périnéale pendant la grossesse et la maîtrise de l'accouchement constituent les mesures préventives essentielles. Les exercices de Kegel, pratiqués régulièrement dès le 2ème trimestre, renforcent les muscles du plancher pelvien.
La prévention primaire passe également par le maintien d'un transit intestinal régulier. Une alimentation riche en fibres, une hydratation suffisante et une activité physique adaptée préviennent la constipation chronique, facteur de risque majeur d'incontinence [14]. Concrètement, 25 à 30 grammes de fibres par jour et 1,5 litre d'eau constituent les recommandations de base.
En cas d'intervention chirurgicale ano-rectale, le choix de la technique opératoire influence considérablement le risque d'incontinence post-opératoire. Les nouvelles approches chirurgicales, comme la sphinctérotomie interne postérieure modifiée, réduisent significativement ce risque [10]. Il est donc crucial de discuter avec votre chirurgien des alternatives thérapeutiques disponibles.
Pour les personnes âgées, la prévention tertiaire vise à éviter l'aggravation d'une incontinence débutante [12]. Cela inclut la révision régulière des traitements médicamenteux, la prise en charge des pathologies associées et le maintien d'une activité physique adaptée. D'ailleurs, certains médicaments (antidépresseurs, antispasmodiques) peuvent aggraver l'incontinence et nécessitent parfois une adaptation posologique.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont récemment actualisé leurs recommandations concernant la prise en charge de l'incontinence anale [1,2]. La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise une approche multidisciplinaire associant gastro-entérologues, proctologues, kinésithérapeutes et psychologues. Cette coordination des soins améliore significativement les résultats thérapeutiques.
Les recommandations 2024-2025 insistent sur l'importance du diagnostic précoce et de l'évaluation systématique par échelle de Wexner [1]. Tout patient présentant des symptômes d'incontinence doit bénéficier d'un bilan initial comprenant interrogatoire standardisé, examen clinique et manométrie anorectale si nécessaire.
Concernant les traitements, les autorités privilégient l'approche progressive : mesures hygiéno-diététiques, rééducation périnéale, puis traitements médicamenteux avant d'envisager la chirurgie [2]. Les innovations thérapeutiques comme la thérapie cellulaire font l'objet d'une évaluation spécifique dans le cadre d'essais cliniques contrôlés.
La Société Nationale Française de Gastro-Entérologie (SNFGE) recommande également une formation spécifique des professionnels de santé. En effet, l'incontinence anale reste sous-diagnostiquée, principalement par méconnaissance des symptômes et des possibilités thérapeutiques [9]. Des programmes de formation continue sont désormais proposés aux médecins généralistes et spécialistes.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations françaises accompagnent les patients souffrant d'incontinence anale et de troubles proctologiques [15,16]. L'Association Française des Malades Atteints de Maladies Inflammatoires Chroniques Intestinales (AFMICI) propose un soutien spécifique aux patients dont l'incontinence est liée aux MICI [11].
La Fédération des Maladies de l'Appareil Digestif (FMAD) offre des ressources documentaires, des forums de discussion et organise des rencontres régionales. Ces événements permettent aux patients d'échanger leurs expériences et de découvrir les dernières innovations thérapeutiques. D'ailleurs, ces associations jouent un rôle crucial dans la déstigmatisation de cette pathologie.
Au niveau européen, l'International Continence Society propose des guides patients traduits en français et des webinaires éducatifs. Ces ressources internationales complètent l'information disponible en France et permettent de comparer les approches thérapeutiques selon les pays [7].
Les plateformes numériques se développent également. Des applications mobiles dédiées permettent de tenir un journal des symptômes, de localiser les toilettes publiques et de recevoir des conseils personnalisés. Certaines proposent même des programmes d'exercices de rééducation périnéale guidés par vidéo.
Nos Conseils Pratiques
Gérer au quotidien une incontinence anale nécessite quelques adaptations simples mais efficaces [14,16]. Premièrement, établissez une routine intestinale régulière. Essayez d'aller aux toilettes à heures fixes, idéalement après les repas quand le réflexe gastro-colique est le plus actif. Cette programmation réduit considérablement les accidents imprévisibles.
L'alimentation joue un rôle clé dans la gestion des symptômes. Tenez un journal alimentaire pour identifier les aliments déclencheurs : épices, café, alcool, produits laitiers ou édulcorants artificiels. Privilégiez les fibres solubles (avoine, pommes, carottes) qui normalisent la consistance des selles sans irriter l'intestin [14].
Pour les sorties, préparez toujours un "kit d'urgence" : lingerie de rechange, lingettes, sac plastique et éventuellement une protection. Repérez les toilettes dès votre arrivée dans un lieu public. Bon à savoir : de nombreuses applications gratuites géolocalisent les toilettes publiques accessibles.
N'hésitez pas à communiquer avec vos proches sur votre pathologie. Le soutien familial améliore considérablement la qualité de vie et réduit l'anxiété [16]. Enfin, maintenez une activité physique adaptée : marche, natation ou yoga renforcent les muscles du plancher pelvien tout en préservant votre bien-être psychologique.
Quand Consulter un Médecin ?
Il est essentiel de consulter rapidement dès l'apparition des premiers symptômes d'incontinence anale [9,15]. N'attendez pas que la situation s'aggrave : plus la prise en charge est précoce, meilleurs sont les résultats thérapeutiques. Consultez votre médecin traitant si vous présentez des fuites de selles ou de gaz plus de deux fois par mois.
Certains signes nécessitent une consultation urgente : apparition brutale d'une incontinence totale, douleurs anales intenses, fièvre associée aux troubles de continence, ou saignements rectaux abondants. Ces symptômes peuvent révéler une pathologie sous-jacente nécessitant un traitement immédiat [16].
La consultation chez un spécialiste (gastro-entérologue ou proctologue) s'impose en cas d'échec du traitement initial après 3 mois, de récidive après amélioration, ou si l'incontinence s'accompagne d'autres troubles digestifs [9]. Ces spécialistes disposent d'examens complémentaires spécifiques et maîtrisent les techniques thérapeutiques avancées.
Pour les femmes, une consultation gynécologique peut être utile, particulièrement en post-partum ou après la ménopause [8,13]. L'incontinence anale s'associe fréquemment à d'autres troubles pelviens nécessitant une prise en charge coordonnée. D'ailleurs, certains centres proposent des consultations multidisciplinaires regroupant plusieurs spécialistes.
Questions Fréquentes
L'incontinence anale est-elle définitive ?Non, dans la majorité des cas, l'incontinence anale peut être améliorée voire guérie avec un traitement adapté. 70% des patients constatent une amélioration significative avec les traitements conservateurs [9].
Peut-on avoir une vie normale avec cette pathologie ?
Absolument. Avec une prise en charge appropriée et quelques adaptations du quotidien, la plupart des patients retrouvent une qualité de vie satisfaisante. Les innovations thérapeutiques 2024-2025 offrent encore plus d'espoir [4,5].
Les protections sont-elles remboursées ?
Oui, certaines protections peuvent être prises en charge par l'Assurance Maladie sur prescription médicale, particulièrement en cas d'incontinence sévère documentée [15].
L'incontinence anale touche-t-elle plus les femmes ?
Les femmes sont effectivement plus touchées, principalement en raison des traumatismes obstétricaux. Cependant, les hommes peuvent également développer cette pathologie, notamment après chirurgie ano-rectale [7,10].
Existe-t-il des traitements naturels efficaces ?
La rééducation périnéale, les modifications alimentaires et certaines plantes (psyllium, probiotiques) peuvent aider. Cependant, ces approches doivent compléter, non remplacer, un suivi médical approprié [14].
Actes médicaux associés
Les actes CCAM suivants peuvent être pratiqués dans le cadre de Incontinence anale :
Questions Fréquentes
L'incontinence anale est-elle définitive ?
Non, dans la majorité des cas, l'incontinence anale peut être améliorée voire guérie avec un traitement adapté. 70% des patients constatent une amélioration significative avec les traitements conservateurs.
Peut-on avoir une vie normale avec cette pathologie ?
Absolument. Avec une prise en charge appropriée et quelques adaptations du quotidien, la plupart des patients retrouvent une qualité de vie satisfaisante. Les innovations thérapeutiques 2024-2025 offrent encore plus d'espoir.
Les protections sont-elles remboursées ?
Oui, certaines protections peuvent être prises en charge par l'Assurance Maladie sur prescription médicale, particulièrement en cas d'incontinence sévère documentée.
L'incontinence anale touche-t-elle plus les femmes ?
Les femmes sont effectivement plus touchées, principalement en raison des traumatismes obstétricaux. Cependant, les hommes peuvent également développer cette pathologie, notamment après chirurgie ano-rectale.
Existe-t-il des traitements naturels efficaces ?
La rééducation périnéale, les modifications alimentaires et certaines plantes (psyllium, probiotiques) peuvent aider. Cependant, ces approches doivent compléter, non remplacer, un suivi médical approprié.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Les nouveaux outils de prise en charge en proctologie. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [2] POST U. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] Fecal incontinence stem cell trial opens at UCI Health. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] Cook MyoSite Announces Completion of Enrollment for the CELLEBRATE Study.Lien
- [7] Prevention and management of urinary incontinence, anal incontinence and pelvic organ prolapse in military women and female elite athletes.Lien
- [8] Troubles de la statique pelvienne et incontinence anale chez la femme après la ménopause.Lien
- [9] Incontinence anale: que proposer aux patients?Lien
- [10] Sphinctérotomie interne postérieure modifiée avec un lambeau cutané pour fissure anale et sténose anale.Lien
- [11] L'incontinence anale, un symptôme à ne pas négliger dans les maladies inflammatoires chroniques intestinales.Lien
- [12] Prise en charge des troubles de la continence anale et de la statique rectale chez le sujet très âgé.Lien
- [13] Prise en charge des troubles de la statique postérieure et de l'incontinence fécale en post partum.Lien
- [14] Incontinence fécale : explication, symptômes et causes.Lien
- [15] Incontinence anale.Lien
- [16] Incontinence fécale - Troubles gastro-intestinaux.Lien
Publications scientifiques
- [HTML][HTML] Que faire devant une incontinence anale chez l'enfant? (2025)
- Prevention and management of urinary incontinence, anal incontinence and pelvic organ prolapse in military women and female elite athletes (2022)6 citations[PDF]
- [HTML][HTML] Troubles de la statique pelvienne et incontinence anale chez la femme après la ménopause (2023)
- [PDF][PDF] Incontinence anale: que proposer aux patients? [PDF]
- Sphinctérotomie interne postérieure modifiée avec un lambeau cutané pour fissure anale et sténose anale: peu de récidives et d'incontinence anale (2022)
Ressources web
- Incontinence fécale : explication, symptômes et causes (thdlab.fr)
Incontinence fécale : symptômes · perte involontaire de selles solides, de selles liquides, de mucus et de gaz intestinaux ; · absence de perception du besoin de ...
- Incontinence anale (deuxiemeavis.fr)
24 avr. 2025 — L'incontinence anale se définit comme la perte incontrôlée de selles et/ou de gaz par l'anus. Cette pathologie n'est pas grave en soi, ...
- Incontinence fécale - Troubles gastro-intestinaux (msdmanuals.com)
L'incontinence fécale est la survenue de défécations involontaires. Le diagnostic est clinique. Le traitement repose sur un programme de gestion intestinale et ...
- Incontinence anale - Maladies de l'anus et du périnée (hug.ch)
27 févr. 2025 — Le diagnostic d'incontinence anale repose principalement sur l'anamnèse et l'examen clinique complet (proctologique, neurologique et gyné ...
- Comment traiter l'incontinence fécale (thdlab.fr)
Le traitement de l'incontinence fécale doit donc partir d'un diagnostic précis. Pendant l'examen, le spécialiste peut identifier les causes du problème en se ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
