Hypoxie-ischémie du cerveau : Guide Complet 2025 | Symptômes, Traitements
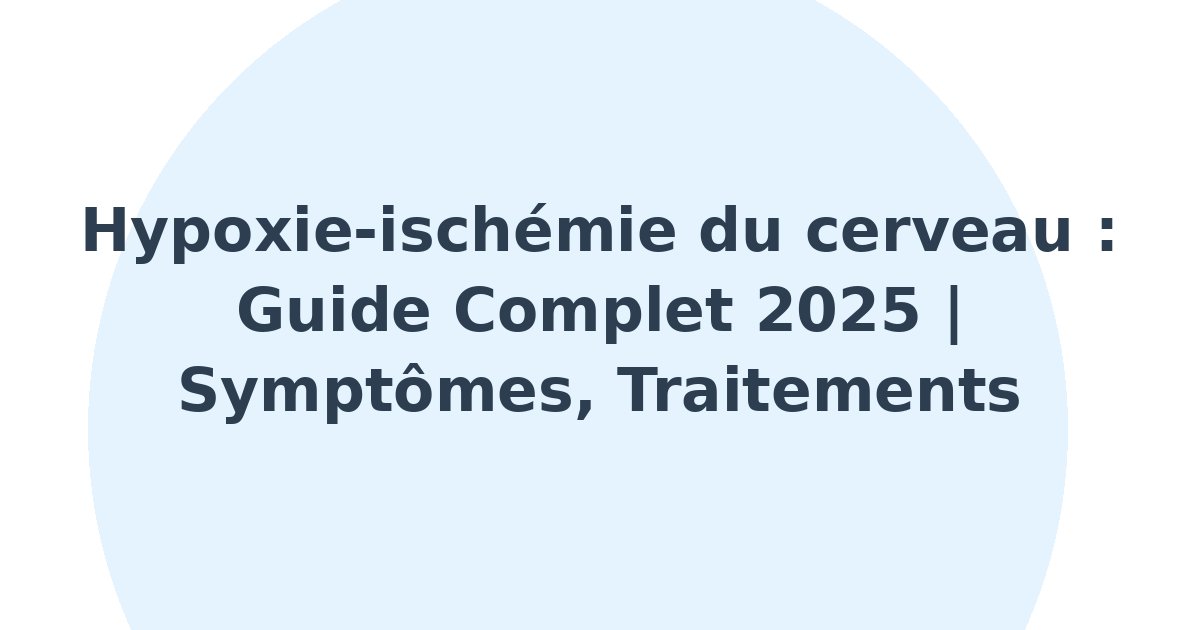
L'hypoxie-ischémie du cerveau représente une urgence médicale majeure qui survient lorsque le cerveau ne reçoit plus suffisamment d'oxygène et de sang. Cette pathologie neurologique grave peut toucher aussi bien les nouveau-nés que les adultes, avec des conséquences potentiellement irréversibles sur les fonctions cérébrales. Heureusement, les avancées thérapeutiques récentes offrent de nouveaux espoirs.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Hypoxie-ischémie du cerveau : Définition et Vue d'Ensemble
L'hypoxie-ischémie cérébrale désigne une pathologie complexe résultant de la combinaison de deux phénomènes distincts mais souvent liés. D'une part, l'hypoxie correspond à une diminution de l'apport en oxygène aux tissus cérébraux [14]. D'autre part, l'ischémie se caractérise par une réduction du débit sanguin cérébral, privant les neurones des nutriments essentiels [15].
Cette double agression métabolique déclenche une cascade de réactions cellulaires délétères. Les neurones, particulièrement vulnérables au manque d'oxygène, commencent à dysfonctionner en quelques minutes seulement. Mais le processus ne s'arrête pas là : la reperfusion, c'est-à-dire le retour de l'oxygène, peut paradoxalement aggraver les lésions par la production de radicaux libres [6].
Concrètement, imaginez votre cerveau comme une ville très active qui consomme énormément d'énergie. Si l'électricité et l'eau sont coupées simultanément, les conséquences sont dramatiques. C'est exactement ce qui se passe lors d'une hypoxie-ischémie cérébrale.
L'important à retenir, c'est que cette pathologie peut survenir à tout âge. Chez le nouveau-né, elle représente l'une des principales causes de handicap neurologique [10]. Chez l'adulte, elle accompagne souvent les accidents vasculaires cérébraux ou les arrêts cardiaques [16].
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques françaises révèlent l'ampleur de cette pathologie neurologique. En France, l'hypoxie-ischémie néonatale touche environ 2 à 3 nouveau-nés pour 1000 naissances vivantes, soit près de 1500 à 2250 cas par an [12]. Ces chiffres placent notre pays dans la moyenne européenne, légèrement en dessous des pays nordiques qui affichent des taux plus élevés.
Chez l'adulte, la situation est plus complexe à quantifier. L'hypoxie-ischémie cérébrale accompagne fréquemment les accidents vasculaires cérébraux, qui touchent 140 000 personnes chaque année en France selon Santé Publique France. Environ 30% de ces AVC présentent une composante hypoxique-ischémique significative [15].
D'ailleurs, les projections démographiques sont préoccupantes. Avec le vieillissement de la population, les experts estiment une augmentation de 25% des cas d'hypoxie-ischémie cérébrale d'ici 2030. Cette évolution s'explique par l'augmentation des pathologies cardiovasculaires et des facteurs de risque associés.
Bon à savoir : les variations régionales existent. Les régions industrielles du Nord et de l'Est affichent des taux légèrement supérieurs, probablement liés aux facteurs environnementaux et socio-économiques. L'impact économique sur notre système de santé est considérable : on estime le coût annuel à plus de 2 milliards d'euros, incluant les soins aigus et la prise en charge des séquelles [3].
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes de l'hypoxie-ischémie cérébrale varient considérablement selon l'âge du patient. Chez le nouveau-né, les complications obstétricales représentent la principale origine : dystocie, procidence du cordon ombilical, décollement placentaire ou souffrance fœtale aiguë [10]. Ces situations d'urgence peuvent compromettre l'oxygénation cérébrale en quelques minutes.
Chez l'adulte, les causes sont plus diversifiées. L'arrêt cardiaque constitue la première cause, suivi des accidents vasculaires cérébraux ischémiques [15]. Mais d'autres situations peuvent déclencher cette pathologie : noyade, intoxication au monoxyde de carbone, choc hémorragique sévère ou encore complications anesthésiques.
Certains facteurs de risque augmentent significativement la probabilité de survenue. L'âge avancé, les antécédents cardiovasculaires, le diabète et l'hypertension artérielle figurent en tête de liste [16]. Le tabagisme multiplie par trois le risque, tandis que l'obésité et la sédentarité contribuent également à cette vulnérabilité.
Il faut savoir que certaines professions exposent davantage à ces risques. Les plongeurs, les pilotes d'avion ou les travailleurs en milieu confiné présentent une incidence légèrement supérieure. D'ailleurs, les innovations récentes en matière de prévention ciblent spécifiquement ces populations à risque [1,2].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de l'hypoxie-ischémie cérébrale dépendent étroitement de l'âge du patient et de la sévérité de l'atteinte. Chez le nouveau-né, les signes peuvent être subtils au début : hypotonie, difficultés alimentaires, troubles de la succion ou anomalies du tonus musculaire [12]. Ces manifestations précoces nécessitent une surveillance attentive de l'équipe médicale.
Mais les symptômes peuvent rapidement s'aggraver. Les convulsions néonatales représentent un signe d'alarme majeur, survenant dans 60% des cas d'hypoxie-ischémie sévère. L'apnée, la cyanose et les troubles de la conscience complètent ce tableau clinique inquiétant [10].
Chez l'adulte, la présentation clinique est souvent plus dramatique. La perte de conscience brutale constitue le symptôme le plus fréquent, accompagnée de troubles respiratoires et cardiovasculaires [16]. Les déficits neurologiques focaux peuvent apparaître : hémiparésie, troubles du langage, déficits visuels ou troubles de la coordination.
L'important à retenir, c'est que chaque minute compte. Les symptômes évoluent rapidement et peuvent masquer la gravité réelle de la situation. Certains patients présentent des phases de récupération apparente, suivies d'une dégradation secondaire liée aux phénomènes de reperfusion [6]. Cette évolution biphasique rend le diagnostic parfois difficile dans les premières heures.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de l'hypoxie-ischémie cérébrale repose sur une approche multidisciplinaire combinant clinique, biologie et imagerie. En urgence, l'évaluation clinique prime : score de Glasgow, examen neurologique complet et recherche de signes de souffrance cérébrale [15]. Cette première étape permet d'orienter rapidement la prise en charge.
L'imagerie cérébrale joue un rôle crucial dans le diagnostic. Le scanner cérébral, réalisable rapidement, peut révéler des signes précoces d'œdème ou d'ischémie. Mais l'IRM reste l'examen de référence, particulièrement en séquence de diffusion qui détecte les lésions ischémiques dès les premières heures [4]. Les innovations 2024 incluent de nouveaux scores IRM permettant une évaluation pronostique plus précise chez le nouveau-né.
Les examens biologiques complètent ce bilan diagnostique. Le dosage des biomarqueurs neurologiques comme la protéine S100B ou l'énolase neuronale spécifique aide à évaluer l'étendue des lésions cérébrales [6]. Ces marqueurs, dosés de manière répétée, permettent de suivre l'évolution et d'adapter le traitement.
Chez le nouveau-né, l'électroencéphalogramme (EEG) revêt une importance particulière. Il permet de détecter les crises convulsives infracliniques et d'évaluer l'activité cérébrale de fond. Les nouvelles techniques d'EEG amplitude-intégré facilitent la surveillance continue en réanimation néonatale [10].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge de l'hypoxie-ischémie cérébrale a considérablement évolué ces dernières années. Le traitement repose avant tout sur la correction rapide des causes sous-jacentes : réanimation cardio-respiratoire, correction des troubles hémodynamiques et maintien d'une oxygénation optimale [16]. Cette approche symptomatique reste la base de toute prise en charge.
Chez le nouveau-né, l'hypothermie thérapeutique représente une révolution thérapeutique majeure. Cette technique, qui consiste à refroidir le corps du bébé à 33-34°C pendant 72 heures, réduit significativement les séquelles neurologiques [5,10]. Les études récentes montrent une diminution de 25% du risque de handicap sévère grâce à cette approche neuroprotectrice.
Le contrôle de la pression intracrânienne constitue un autre pilier thérapeutique. Les osmothérapies, la position proclive et parfois la chirurgie de décompression permettent de limiter l'œdème cérébral [15]. Ces mesures, appliquées précocement, peuvent prévenir l'engagement cérébral et ses conséquences dramatiques.
D'ailleurs, la prise en charge des complications est tout aussi importante. Le traitement des convulsions par antiépileptiques, la prévention des infections nosocomiales et la nutrition adaptée participent à l'amélioration du pronostic [6]. L'approche multidisciplinaire implique neurologues, réanimateurs, kinésithérapeutes et orthophonistes dès la phase aiguë.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les innovations thérapeutiques 2024-2025 ouvrent de nouvelles perspectives passionnantes dans le traitement de l'hypoxie-ischémie cérébrale. La thérapie par le lactate représente l'une des approches les plus prometteuses actuellement à l'étude [6,8]. Cette molécule, longtemps considérée comme un déchet métabolique, s'avère être un neuroprotecteur puissant lorsqu'elle est administrée précocement.
Les recherches menées en 2024 démontrent que l'association lactate-hypothermie pourrait révolutionner la prise en charge néonatale [8]. Cette double approche neuroprotectrice montre des résultats préliminaires encourageants, avec une réduction supplémentaire de 15% des séquelles neurologiques par rapport à l'hypothermie seule.
Mais ce n'est pas tout : les polyphénols de raisin extraits de manière éco-durable font également l'objet d'études approfondies [7]. Ces composés naturels, administrés selon une approche nutritionnelle intergénérationnelle, pourraient offrir une protection cérébrale préventive. Les premiers essais cliniques débutent en 2025 dans plusieurs centres français.
L'innovation technologique n'est pas en reste. Les nouveaux scores IRM développés par le NICHD permettent une évaluation pronostique plus précise [4]. Ces outils d'aide à la décision, intégrant intelligence artificielle et imagerie avancée, facilitent l'adaptation thérapeutique personnalisée. Les projets ministériels 2023 financent actuellement plusieurs études multicentriques sur ces innovations [3].
Vivre au Quotidien avec Hypoxie-ischémie du cerveau
Vivre avec les séquelles d'une hypoxie-ischémie cérébrale nécessite une adaptation constante et un accompagnement personnalisé. Les déficits peuvent toucher différents domaines : motricité, cognition, langage ou comportement. Chaque personne développe ses propres stratégies d'adaptation, avec l'aide de professionnels spécialisés [12].
La rééducation occupe une place centrale dans cette nouvelle vie. Kinésithérapie, orthophonie, ergothérapie et neuropsychologie forment un quartet thérapeutique indispensable. Ces prises en charge, souvent longues, permettent de récupérer certaines fonctions ou de développer des compensations efficaces [16].
L'adaptation du domicile devient souvent nécessaire. Barres d'appui, rampes d'accès, aménagement de la salle de bain : ces modifications facilitent l'autonomie au quotidien. Les aides techniques modernes, comme les systèmes de communication assistée, ouvrent de nouvelles possibilités d'expression et d'interaction sociale.
Mais l'aspect psychologique ne doit pas être négligé. L'acceptation du handicap, la gestion de la frustration et le maintien de l'estime de soi représentent des défis majeurs. Le soutien familial et l'accompagnement psychologique sont essentiels pour traverser ces épreuves. Heureusement, de nombreuses associations proposent des groupes de parole et des activités adaptées.
Les Complications Possibles
Les complications de l'hypoxie-ischémie cérébrale peuvent survenir à court, moyen ou long terme. Dans la phase aiguë, l'œdème cérébral représente la complication la plus redoutable, pouvant conduire à l'engagement cérébral et au décès [15]. Cette complication nécessite une surveillance neurologique intensive et parfois des gestes chirurgicaux d'urgence.
Les troubles épileptiques constituent une autre complication fréquente, touchant jusqu'à 40% des patients survivants. Ces crises peuvent être précoces, survenant dans les premières 48 heures, ou tardives, apparaissant plusieurs mois après l'épisode initial [6]. Le traitement antiépileptique au long cours devient alors nécessaire.
À plus long terme, les séquelles neurologiques dominent le tableau clinique. Les déficits moteurs peuvent aller de la simple maladresse à l'hémiplégie complète. Les troubles cognitifs, souvent plus subtils, affectent la mémoire, l'attention et les fonctions exécutives [16]. Ces déficits impactent significativement la qualité de vie et l'autonomie des patients.
Chez l'enfant, les complications peuvent se révéler progressivement avec la croissance. Les troubles des apprentissages, les difficultés scolaires et les problèmes comportementaux nécessitent un suivi spécialisé prolongé [12]. D'ailleurs, certaines séquelles ne deviennent apparentes qu'à l'adolescence, lorsque les exigences cognitives augmentent.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'hypoxie-ischémie cérébrale dépend de nombreux facteurs, rendant chaque situation unique. La durée de l'hypoxie constitue le facteur pronostique le plus important : au-delà de 10 minutes d'arrêt circulatoire, le risque de séquelles neurologiques sévères augmente considérablement [16]. Mais heureusement, des récupérations surprenantes restent possibles.
Chez le nouveau-né, l'hypothermie thérapeutique a considérablement amélioré le pronostic. Avant cette innovation, 60% des enfants présentaient des séquelles majeures. Aujourd'hui, ce pourcentage est tombé à 45% grâce à cette neuroprotection [5,10]. Les innovations récentes avec le lactate pourraient encore améliorer ces statistiques.
L'âge au moment de l'accident influence également le pronostic. Paradoxalement, le cerveau immature du nouveau-né présente une meilleure plasticité que celui de l'adulte. Cette capacité de récupération explique pourquoi certains enfants récupèrent des fonctions que l'on pensait définitivement perdues [12].
Il faut savoir que le pronostic fonctionnel ne se limite pas aux déficits neurologiques. La qualité de vie, l'insertion sociale et professionnelle constituent des critères tout aussi importants. Avec un accompagnement adapté, de nombreux patients retrouvent une vie épanouissante malgré leurs séquelles. Les nouveaux outils d'évaluation pronostique développés en 2024 permettent une meilleure information des familles [4].
Peut-on Prévenir Hypoxie-ischémie du cerveau ?
La prévention de l'hypoxie-ischémie cérébrale repose sur une approche à plusieurs niveaux. En période périnatale, le suivi obstétrical rigoureux permet de détecter précocement les situations à risque : souffrance fœtale, anomalies du rythme cardiaque fœtal ou complications du travail [10]. Cette surveillance attentive a permis de réduire significativement l'incidence de cette pathologie.
Chez l'adulte, la prévention cardiovasculaire occupe une place centrale. Le contrôle de l'hypertension artérielle, du diabète et du cholestérol réduit considérablement le risque d'accidents ischémiques cérébraux [15]. L'arrêt du tabac, la pratique d'une activité physique régulière et une alimentation équilibrée complètent cette démarche préventive.
Les innovations 2024-2025 incluent des approches préventives nutritionnelles prometteuses. Les polyphénols de raisin administrés selon une approche intergénérationnelle pourraient offrir une neuroprotection préventive [7]. Cette stratégie, encore expérimentale, fait l'objet d'études approfondies dans plusieurs centres de recherche français.
Mais la prévention passe aussi par la formation des professionnels de santé. Les nouveaux protocoles de réanimation, l'amélioration des délais de prise en charge et la généralisation des défibrillateurs automatiques contribuent à réduire la durée des épisodes hypoxiques [1,2]. Ces mesures collectives ont un impact majeur sur l'incidence et la gravité de cette pathologie.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont émis des recommandations précises concernant la prise en charge de l'hypoxie-ischémie cérébrale. La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise une approche standardisée basée sur les preuves scientifiques les plus récentes. Ces guidelines, mises à jour en 2024, intègrent les innovations thérapeutiques validées [3].
Pour la période néonatale, les recommandations insistent sur l'importance de l'hypothermie thérapeutique précoce. Cette intervention doit être initiée dans les 6 heures suivant la naissance pour être efficace [5]. Les critères de sélection des patients ont été affinés grâce aux nouveaux scores pronostiques développés par les équipes de recherche françaises.
L'INSERM souligne l'importance de la recherche translationnelle dans ce domaine. Les projets financés en 2023 visent à développer de nouvelles approches thérapeutiques, notamment l'utilisation du lactate comme neuroprotecteur [8]. Ces recherches, menées en collaboration avec les centres hospitaliers universitaires, pourraient révolutionner la prise en charge dans les années à venir.
Santé Publique France recommande également le renforcement de la prévention primaire. Les campagnes de sensibilisation aux facteurs de risque cardiovasculaires, la promotion de l'activité physique et la lutte contre le tabagisme constituent des priorités de santé publique [1,2]. Ces mesures préventives ont un impact direct sur l'incidence de l'hypoxie-ischémie cérébrale.
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses associations accompagnent les patients et leurs familles confrontés à l'hypoxie-ischémie cérébrale. La Fédération Nationale des Associations d'Aide aux Handicapés Moteurs (FAHM) propose un soutien spécialisé pour les personnes présentant des séquelles motrices. Leurs équipes offrent conseils pratiques, aide administrative et soutien psychologique.
L'association France AVC constitue une ressource précieuse pour les adultes victimes d'accidents vasculaires cérébraux avec composante hypoxique-ischémique. Leurs groupes de parole, organisés dans toute la France, permettent aux patients de partager leur expérience et de s'entraider. Les ateliers pratiques abordent les questions du quotidien : conduite automobile, retour au travail, vie affective.
Pour les familles d'enfants concernés, l'association Neuropédiatrie propose un accompagnement spécialisé. Leurs professionnels aident à naviguer dans le parcours de soins complexe, de la phase aiguë à la rééducation au long cours. Les camps de vacances adaptés offrent aux enfants des moments de détente et de socialisation.
Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) constituent le point d'entrée administratif pour l'obtention des aides et compensations. Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé (AEEH), Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ou Allocation Adulte Handicapé (AAH) : ces dispositifs financent une partie des frais liés au handicap.
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec les conséquences d'une hypoxie-ischémie cérébrale nécessite une organisation quotidienne adaptée. Premier conseil : établissez une routine structurée qui sécurise et facilite les activités de la vie quotidienne. Les repères temporels et spatiaux aident à compenser certains troubles cognitifs [12].
L'aménagement de l'environnement joue un rôle crucial. Éliminez les obstacles, installez des éclairages suffisants et créez des zones de repos facilement accessibles. Les nouvelles technologies d'assistance peuvent considérablement améliorer l'autonomie : tablettes adaptées, systèmes de rappel vocal ou applications de communication.
Ne négligez pas l'importance de l'activité physique adaptée. Même avec des limitations motrices, l'exercice régulier améliore la circulation cérébrale et favorise la neuroplasticité [16]. Kinésithérapie, balnéothérapie ou activités sportives adaptées : choisissez selon vos capacités et vos goûts.
L'aspect nutritionnel mérite également votre attention. Une alimentation riche en antioxydants, oméga-3 et vitamines du groupe B soutient la récupération cérébrale. Les recherches récentes sur les polyphénols suggèrent des bénéfices potentiels, même si les preuves restent préliminaires [7]. Discutez avec votre médecin des compléments alimentaires adaptés à votre situation.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous alerter et motiver une consultation médicale urgente. Chez le nouveau-né, toute modification du comportement alimentaire, des troubles du tonus ou des mouvements anormaux nécessitent un avis pédiatrique immédiat [10]. Les parents développent souvent une intuition précieuse : faites confiance à votre instinct si quelque chose vous inquiète.
Chez l'adulte, les signes d'alerte neurologique imposent un appel au 15 sans délai : perte de conscience brutale, troubles de la parole, faiblesse d'un côté du corps ou troubles visuels soudains [15]. Ces symptômes peuvent révéler un accident vasculaire cérébral en cours, nécessitant une prise en charge d'urgence.
Pour les patients suivis après un épisode d'hypoxie-ischémie, surveillez l'apparition de nouveaux symptômes. L'aggravation des déficits existants, l'apparition de crises convulsives ou des troubles du comportement inhabituels doivent motiver une consultation rapide [6]. Ces signes peuvent révéler des complications tardives ou l'évolution de la pathologie.
N'hésitez pas à consulter également pour des questions apparemment mineures. Les troubles du sommeil, les difficultés de concentration ou les changements d'humeur peuvent être liés aux séquelles de l'hypoxie-ischémie [16]. Votre médecin traitant saura vous orienter vers les spécialistes appropriés si nécessaire.
Questions Fréquentes
L'hypoxie-ischémie cérébrale est-elle toujours grave ?La gravité dépend de la durée et de l'intensité de l'épisode hypoxique. Les formes légères peuvent ne laisser aucune séquelle, tandis que les formes sévères entraînent des handicaps importants [16]. L'intervention précoce améliore considérablement le pronostic.
Peut-on récupérer complètement après une hypoxie-ischémie ?
Une récupération complète reste possible, surtout chez l'enfant grâce à la plasticité cérébrale. Cependant, des séquelles subtiles peuvent persister et ne se révéler qu'avec le temps [12]. Le suivi médical prolongé est essentiel.
Les innovations thérapeutiques sont-elles accessibles en France ?
L'hypothermie thérapeutique est désormais standard dans tous les centres de néonatologie français. Les nouvelles approches comme le lactate font l'objet d'essais cliniques dans plusieurs CHU [6,8]. L'accès aux innovations se démocratise progressivement.
Comment soutenir un proche touché par cette pathologie ?
L'écoute, la patience et l'encouragement constituent les piliers du soutien familial. Informez-vous sur la pathologie, participez aux rendez-vous médicaux et n'hésitez pas à solliciter l'aide des associations spécialisées. Votre présence bienveillante fait la différence.
Questions Fréquentes
L'hypoxie-ischémie cérébrale est-elle toujours grave ?
La gravité dépend de la durée et de l'intensité de l'épisode hypoxique. Les formes légères peuvent ne laisser aucune séquelle, tandis que les formes sévères entraînent des handicaps importants. L'intervention précoce améliore considérablement le pronostic.
Peut-on récupérer complètement après une hypoxie-ischémie ?
Une récupération complète reste possible, surtout chez l'enfant grâce à la plasticité cérébrale. Cependant, des séquelles subtiles peuvent persister et ne se révéler qu'avec le temps. Le suivi médical prolongé est essentiel.
Les innovations thérapeutiques sont-elles accessibles en France ?
L'hypothermie thérapeutique est désormais standard dans tous les centres de néonatologie français. Les nouvelles approches comme le lactate font l'objet d'essais cliniques dans plusieurs CHU. L'accès aux innovations se démocratise progressivement.
Comment soutenir un proche touché par cette pathologie ?
L'écoute, la patience et l'encouragement constituent les piliers du soutien familial. Informez-vous sur la pathologie, participez aux rendez-vous médicaux et n'hésitez pas à solliciter l'aide des associations spécialisées.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Effets indésirables. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] L'actu pour tous. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] APPELS À PROJETS MINISTÉRIELS - ANNÉE 2023. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] NICHD Magnetic Resonance Brain Imaging Score in Term. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [5] Whole-Body Hypothermia for Neonatal Encephalopathy. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [6] Lactate: une approche thérapeutique très prometteuse dans le cadre de l'hypoxie-ischémie néonataleLien
- [7] Polyphénols de raisin extraits de manière éco-durable: neuroprotection dans l'hypoxie-ischémie néonataleLien
- [8] Lactate et hypothermie: une double approche pour la neuroprotection dans l'hypoxie-ischémie néonataleLien
- [10] Neuroprotection dans le contexte de l'hypoxie-ischémie néonatale: Détermination des meilleures conditions d'hypothermieLien
- [12] Le cerveau du prématuré: périodes critiques, vulnérabilité et plasticitéLien
- [14] Hypoxie : définition, symptômes, diagnostic et traitementLien
- [15] Accident vasculaire cérébral ischémiqueLien
- [16] Hypoxie et anoxie - Lésion Cérébrale CanadaLien
Publications scientifiques
- Lactate: une approche thérapeutique très prometteuse dans le cadre de l'hypoxie-ischémie néonatale (2024)
- Polyphénols de raisin extraits de manière éco-durable: neuroprotection dans l'hypoxie-ischémie néonatale. Approche nutritionnelle intergénérationnelle (2023)
- … du lactate dans le cadre de l'hypoxie-ischémie néonatale: Lactate et hypothermie: une double approche pour la neuroprotection dans l'hypoxie-ischémie néonatale (2024)
- Interaction entre assistance extracorporelle veino-artérielle (ECMO VA) et cerveau: exemple de l'hypoxie différentielle (2022)
- Neuroprotection dans le contexte de l'hypoxie-ischémie néonatale: Détermination des meilleures conditions d'hypothermie neuroprotectrice chez le raton (2023)[PDF]
Ressources web
- Hypoxie : définition, symptômes, diagnostic et traitement (sante-sur-le-net.com)
17 déc. 2020 — Quels symptômes ? · Une tachycardie, ou accélération du rythme cardiaque ; · Une fatigue ; · Des maux de tête ; · Une hyperventilation, autrement ...
- Accident vasculaire cérébral ischémique (msdmanuals.com)
Le diagnostic est clinique, mais une TDM ou une IRM est effectuée pour exclure une hémorragie et confirmer la présence et l'étendue de l'accident ischémique. ...
- Hypoxie et anoxie - Lésion Cérébrale Canada (braininjurycanada.ca)
Symptômes de l'hypoxie et de l'anoxie · La difficulté à se concentrer · La difficulté à bouger · Des étourdissements · Des problèmes de mémoire · Des troubles de l' ...
- Accidents ischémiques transitoires (AIT) (msdmanuals.com)
Le diagnostic repose sur les symptômes, mais une imagerie cérébrale est également effectuée. D'autres examens d'imagerie et tests sanguins sont réalisés afin de ...
- Encéphalopathie hypoxique-ischémique : causes, ... (medicoverhospitals.in)
L'encéphalopathie hypoxique-ischémique est diagnostiquée en effectuant des examens physiques, des tests d'imagerie cérébrale comme l'IRM ou la tomodensitomé ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
