État végétatif persistant : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
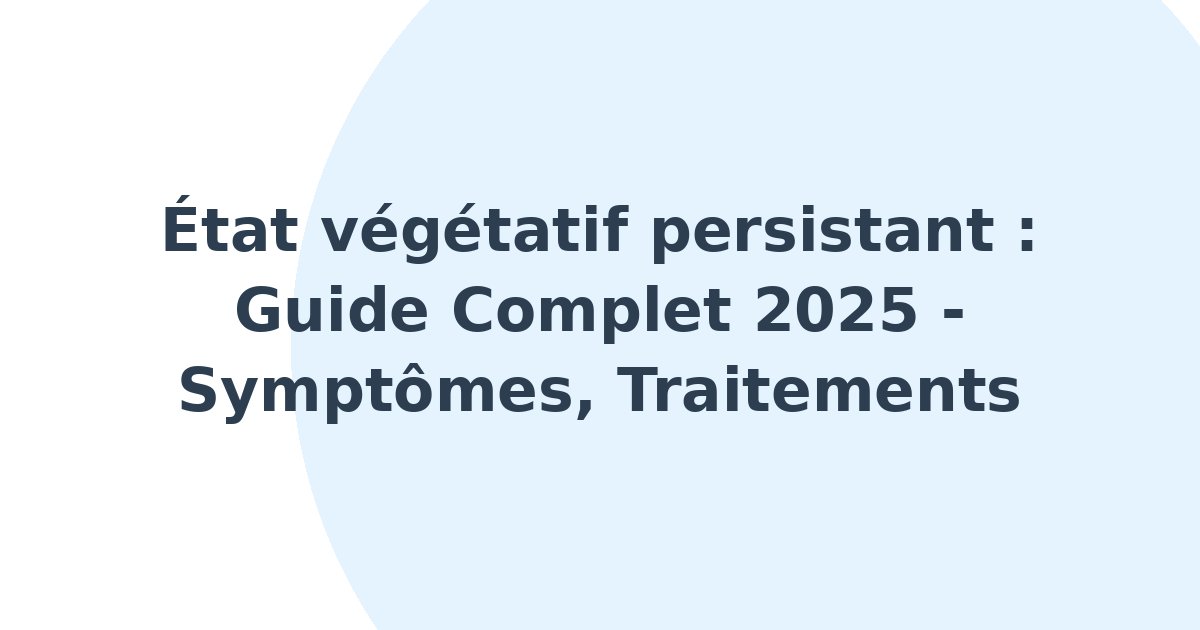
L'état végétatif persistant représente une pathologie neurologique complexe qui touche environ 5 000 personnes en France [1,2]. Cette altération profonde de la conscience survient généralement après un traumatisme crânien sévère ou un arrêt cardiaque prolongé. Contrairement aux idées reçues, cette pathologie fait l'objet de recherches intensives et d'innovations thérapeutiques prometteuses en 2024-2025 [3,4].

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

État végétatif persistant : Définition et Vue d'Ensemble
L'état végétatif persistant se caractérise par une absence de conscience de soi et de l'environnement, tout en conservant les cycles veille-sommeil [14,15]. Les patients présentent des réflexes automatiques mais ne montrent aucun signe de perception consciente ou de réponse volontaire aux stimuli.
Cette pathologie neurologique résulte d'une lésion grave du cortex cérébral ou des connexions entre le cortex et le tronc cérébral [9]. Le terme "végétatif" fait référence aux fonctions végétatives préservées : respiration, circulation sanguine et régulation thermique.
Depuis 2024, la terminologie médicale évolue vers "État d'Éveil Non Répondant" (EENR) pour éviter les connotations négatives du terme "végétatif" [8]. Cette nouvelle appellation reflète mieux la réalité clinique : les patients sont éveillés mais ne répondent pas aux stimulations.
Il faut distinguer l'état végétatif de l'état pauci-relationnel où subsistent des interactions minimales mais reproductibles avec l'environnement [6,7]. Cette distinction est cruciale pour le pronostic et la prise en charge.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, l'incidence annuelle de l'état végétatif persistant est estimée à 0,5 à 2 cas pour 100 000 habitants, soit environ 300 à 1 200 nouveaux cas par an [1,2]. La prévalence atteint 5 000 à 8 000 personnes, avec une tendance à l'augmentation liée à l'amélioration des techniques de réanimation.
Les données épidémiologiques révèlent une prédominance masculine (60% des cas) et un pic d'incidence chez les 15-35 ans pour les traumatismes, et après 65 ans pour les causes vasculaires [7]. Cette répartition reflète les principales étiologies : accidents de la route chez les jeunes adultes et accidents vasculaires cérébraux chez les seniors.
Comparativement, les États-Unis recensent 10 000 à 25 000 personnes en état végétatif persistant, soit une prévalence similaire rapportée à la population [4]. L'Europe présente des variations importantes selon les pays, liées aux différences de prise en charge et de définitions diagnostiques.
L'analyse sociologique récente de Castanon (2024) montre que 70% des patients sont pris en charge en institution spécialisée, 20% à domicile avec aide professionnelle, et 10% en unités de soins de longue durée [7]. Cette répartition évolue vers davantage de maintien à domicile quand c'est possible.
Les projections démographiques suggèrent une augmentation de 15% de la prévalence d'ici 2030, principalement due au vieillissement de la population et à l'amélioration des techniques de réanimation [1,3].
Les Causes et Facteurs de Risque
Les traumatismes crâniens sévères représentent la première cause d'état végétatif persistant, responsables de 40% des cas [9,14]. Ces traumatismes résultent principalement d'accidents de la circulation, de chutes importantes ou d'agressions. La gravité des lésions dépend de la force de l'impact et de la durée de l'inconscience initiale.
Les accidents vasculaires cérébraux constituent la deuxième cause majeure (30% des cas), particulièrement les AVC hémorragiques massifs et les infarctus étendus touchant plusieurs territoires vasculaires [15]. L'âge avancé et les facteurs de risque cardiovasculaire augmentent cette probabilité.
L'anoxie cérébrale suite à un arrêt cardiaque prolongé explique 20% des états végétatifs persistants [9]. La durée de l'arrêt circulatoire est déterminante : au-delà de 10 minutes sans réanimation efficace, les lésions cérébrales deviennent souvent irréversibles.
D'autres causes incluent les infections du système nerveux central (méningites, encéphalites), les intoxications graves, et certaines pathologies dégénératives en phase terminale [14,15]. Les tumeurs cérébrales peuvent également évoluer vers cet état, mais c'est plus rare.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
L'absence de réponse consciente constitue le symptôme cardinal de l'état végétatif persistant. Les patients n'obéissent pas aux ordres simples, ne suivent pas du regard et ne montrent aucun signe de reconnaissance de leurs proches [14,15].
Paradoxalement, les cycles veille-sommeil sont préservés. Les patients ouvrent spontanément les yeux, bougent parfois et peuvent même émettre des sons, mais ces manifestations restent automatiques et non dirigées [6]. Cette préservation des fonctions végétatives peut créer de faux espoirs chez les familles.
Les réflexes primitifs persistent souvent : réflexe de succion, de préhension palmaire, ou réactions de sursaut aux bruits forts [9]. Ces réactions automatiques ne témoignent pas d'une conscience mais d'un fonctionnement résiduel du tronc cérébral.
Certains patients présentent des mouvements stéréotypés : grincements de dents, mouvements de mâchonnement, ou postures anormales des membres [15]. Ces manifestations peuvent être perturbantes pour l'entourage mais ne signifient pas une amélioration de l'état de conscience.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic d'état végétatif persistant repose sur une évaluation clinique rigoureuse répétée sur plusieurs semaines [9,15]. Aucun examen complémentaire ne peut à lui seul confirmer le diagnostic, qui reste essentiellement clinique.
L'examen neurologique recherche systématiquement les signes de conscience : réponse aux ordres simples, poursuite oculaire, réactions émotionnelles appropriées [14]. Cette évaluation utilise des échelles standardisées comme la Coma Recovery Scale-Revised (CRS-R), référence internationale pour l'évaluation des troubles de conscience.
Les examens d'imagerie apportent des informations pronostiques cruciales. L'IRM cérébrale révèle l'étendue des lésions, particulièrement au niveau du corps calleux et des structures sous-corticales [9]. La TEP-scan peut montrer le métabolisme cérébral résiduel, aidant à différencier l'état végétatif de l'état pauci-relationnel.
Depuis 2024, les innovations diagnostiques incluent l'électroencéphalographie haute densité et les techniques de neuroimagerie fonctionnelle qui détectent parfois une activité cérébrale résiduelle non visible cliniquement [4,5]. Ces avancées révolutionnent progressivement l'évaluation de la conscience.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge de l'état végétatif persistant reste principalement symptomatique et préventive [1,3]. L'objectif prioritaire consiste à maintenir les fonctions vitales et prévenir les complications liées à l'immobilité prolongée.
Les soins de nursing représentent la base du traitement : prévention des escarres par changements de position réguliers, kinésithérapie passive pour maintenir la mobilité articulaire, et surveillance nutritionnelle [6,8]. L'alimentation se fait généralement par sonde gastrique pour éviter les fausses routes.
Certains traitements médicamenteux sont parfois tentés : amantadine, bromocriptine, ou zolpidem, mais leurs effets restent limités et inconstants [4,14]. Ces molécules agissent sur différents neurotransmetteurs cérébraux dans l'espoir de stimuler les circuits de la conscience.
La stimulation sensorielle fait partie intégrante de la prise en charge : stimulations tactiles, auditives (musique, voix familières), et visuelles [8]. Bien que son efficacité ne soit pas prouvée scientifiquement, elle maintient un lien avec l'environnement et peut apporter un réconfort aux familles.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les innovations thérapeutiques 2024-2025 ouvrent de nouvelles perspectives pour les patients en état végétatif persistant [1,2,4]. La recherche se concentre sur la restauration pharmacologique de la conscience et les techniques de neuromodulation avancées.
La stimulation cérébrale profonde fait l'objet d'essais cliniques prometteurs [4]. Cette technique implante des électrodes dans des structures cérébrales spécifiques pour stimuler les circuits de l'éveil. Les premiers résultats montrent des améliorations chez 20 à 30% des patients sélectionnés.
Les thérapies pharmacologiques innovantes incluent de nouvelles molécules ciblant les récepteurs GABA et dopaminergiques [4,5]. L'approche "Restoring consciousness with pharmacologic therapy" développée en 2024 combine plusieurs médicaments pour optimiser la neurotransmission cérébrale.
Le Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle des Salins de Bregille développe des protocoles innovants de prise en charge intégrant réalité virtuelle et stimulation magnétique transcrânienne [1]. Ces approches non invasives montrent des résultats encourageants sur la récupération de certaines fonctions cognitives.
L'intelligence artificielle révolutionne également le diagnostic et le pronostic [5]. Les algorithmes d'apprentissage automatique analysent les données d'imagerie cérébrale pour prédire les chances de récupération avec une précision inégalée.
Vivre au Quotidien avec État végétatif persistant
La prise en charge quotidienne d'une personne en état végétatif persistant nécessite une organisation rigoureuse et des soins constants [7,8]. Les familles font face à des défis émotionnels, logistiques et financiers considérables.
L'aménagement du domicile devient indispensable pour un retour à la maison : lit médicalisé, matériel de nursing, système d'aspiration, et parfois respirateur [10,11]. Ces équipements représentent un investissement important, partiellement pris en charge par l'Assurance Maladie.
Les aidants familiaux doivent apprendre les gestes techniques : changes, retournements, administration de médicaments par sonde [8]. Cette formation est assurée par les équipes hospitalières avant le retour à domicile, mais l'apprentissage se poursuit sur plusieurs mois.
Le soutien psychologique s'avère crucial pour toute la famille [11]. L'acceptation de cette nouvelle réalité passe par différentes phases : déni, colère, négociation, dépression, puis acceptation progressive. L'accompagnement par des psychologues spécialisés aide à traverser ces étapes.
Certaines familles témoignent que maintenir des rituels familiaux (anniversaires, fêtes, sorties) aide à préserver le lien affectif et l'espoir [10]. Ces moments partagés, même sans réponse apparente du patient, conservent une dimension thérapeutique pour l'entourage.
Les Complications Possibles
Les complications infectieuses représentent le risque majeur chez les patients en état végétatif persistant [9,14]. Les infections respiratoires, urinaires et cutanées surviennent fréquemment en raison de l'immobilité et des dispositifs médicaux (sondes, cathéters).
Les troubles de la déglutition exposent au risque de pneumonie d'inhalation, complication potentiellement mortelle [15]. C'est pourquoi l'alimentation par sonde gastrique est généralement préférée, même si elle peut entraîner des complications digestives (reflux, diarrhées).
L'immobilité prolongée génère de multiples complications : escarres, rétractions tendineuses, ostéoporose, thromboses veineuses [6]. La prévention par mobilisation passive, matelas anti-escarres et anticoagulation prophylactique est essentielle.
Les troubles métaboliques sont fréquents : dénutrition, déshydratation, déséquilibres électrolytiques [14]. La surveillance biologique régulière permet d'ajuster l'apport nutritionnel et hydrique selon les besoins individuels.
Certains patients développent des crises d'épilepsie secondaires aux lésions cérébrales [9]. Ces crises nécessitent un traitement antiépileptique adapté et une surveillance neurologique renforcée.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'état végétatif persistant dépend principalement de la cause initiale et de l'âge du patient [9,15]. Les traumatismes crâniens chez les sujets jeunes offrent généralement un meilleur pronostic que les accidents vasculaires chez les personnes âgées.
Statistiquement, 10 à 15% des patients récupèrent une certaine conscience dans l'année suivant l'accident [14]. Cette récupération se manifeste d'abord par des signes minimes : poursuite oculaire, réponses émotionnelles appropriées, puis progressivement par des interactions plus complexes.
La durée de l'état végétatif influence fortement les chances de récupération. Au-delà de 12 mois pour les causes traumatiques et 6 mois pour les causes non traumatiques, la récupération devient exceptionnelle [15]. Ces délais servent de référence pour les décisions thérapeutiques.
Les innovations diagnostiques 2024-2025 permettent une évaluation pronostique plus précise [4,5]. L'imagerie fonctionnelle et l'électroencéphalographie haute résolution détectent parfois une activité cérébrale résiduelle non visible cliniquement, modifiant l'estimation du pronostic.
Il faut distinguer la récupération de conscience de la récupération fonctionnelle complète [9]. Même en cas d'amélioration, les séquelles neurologiques restent souvent importantes : troubles moteurs, cognitifs, ou comportementaux nécessitant une rééducation prolongée.
Peut-on Prévenir État végétatif persistant ?
La prévention primaire de l'état végétatif persistant passe par la réduction des facteurs de risque des principales causes [14,15]. Pour les traumatismes crâniens, le port du casque à vélo et moto, le respect du code de la route, et la sécurisation des environnements de travail sont essentiels.
Concernant les accidents vasculaires cérébraux, la prévention repose sur le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire : hypertension artérielle, diabète, hypercholestérolémie, tabagisme [9]. Un suivi médical régulier permet de dépister et traiter précocement ces pathologies.
La prise en charge précoce des arrêts cardiaques améliore significativement le pronostic neurologique [15]. La formation du grand public aux gestes de premiers secours et la généralisation des défibrillateurs automatiques externes réduisent les séquelles cérébrales.
En milieu hospitalier, l'optimisation de la réanimation neurologique limite l'extension des lésions cérébrales [9]. Le contrôle de la pression intracrânienne, de l'oxygénation cérébrale, et de la température corporelle influence directement le devenir neurologique.
Les protocoles de neuroprotection développés ces dernières années incluent l'hypothermie thérapeutique contrôlée et l'utilisation de médicaments neuroprotecteurs [14]. Ces approches, appliquées précocement, peuvent prévenir l'évolution vers un état végétatif persistant.
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 des recommandations actualisées sur la prise en charge des états de conscience altérée [1,2]. Ces guidelines précisent les critères diagnostiques, les modalités d'évaluation, et les parcours de soins optimaux.
L'Agence Régionale de Santé d'Île-de-France développe depuis 2024 un réseau d'expertise en soins médicaux de réadaptation spécialisé dans les troubles de conscience [3]. Ce réseau coordonne la prise en charge entre les services de réanimation, les unités spécialisées, et le retour à domicile.
Le Comité Consultatif National d'Éthique a émis en 2025 un avis sur l'accompagnement des personnes en état d'éveil non répondant [2]. Cet avis souligne l'importance du respect de la dignité humaine et de l'accompagnement des familles dans leurs décisions.
Les recommandations insistent sur la formation des professionnels à l'évaluation de la conscience et à l'utilisation des échelles standardisées [1,3]. Cette formation concerne les médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, et psychologues intervenant auprès de ces patients.
L'évaluation éthique des décisions de limitation ou d'arrêt des traitements fait l'objet de procédures collégiales strictes [2]. Ces procédures impliquent l'équipe soignante, les familles, et parfois des consultants extérieurs pour garantir la meilleure décision possible.
Ressources et Associations de Patients
L'Association des Paralysés de France (APF France handicap) propose un accompagnement spécialisé pour les familles confrontées à l'état végétatif persistant [8,11]. Cette association offre des services d'aide à domicile, de soutien psychologique, et d'information sur les droits sociaux.
La Fédération Française des Associations de Traumatisés Crâniens regroupe de nombreuses associations locales qui organisent des groupes de parole et des activités de soutien [10]. Ces associations constituent un réseau précieux d'entraide entre familles.
Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) évaluent les besoins et attribuent les aides financières : Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé (AEEH), Prestation de Compensation du Handicap (PCH), ou Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) [11].
Plusieurs sites internet spécialisés proposent des informations actualisées et des forums d'échange : le site de la Fondation Préziosi-Handicap offre des ressources documentaires complètes [16]. Ces plateformes permettent aux familles de partager leurs expériences et de s'informer sur les dernières avancées.
Les services sociaux hospitaliers accompagnent les familles dans les démarches administratives et l'organisation du retour à domicile [8]. Ils coordonnent avec les services de soins à domicile et les professionnels libéraux pour assurer la continuité des soins.
Nos Conseils Pratiques
Organisez-vous progressivement si vous envisagez un retour à domicile [10,11]. Commencez par des séjours de quelques heures, puis augmentez progressivement la durée. Cette approche graduelle permet d'identifier les difficultés et d'ajuster l'organisation.Constituez une équipe de soins coordonnée : médecin traitant, infirmier libéral, kinésithérapeute, aide-soignant [8]. La communication entre ces professionnels est essentielle pour assurer une prise en charge cohérente et éviter les complications.
Préservez votre santé mentale en tant qu'aidant [11]. Acceptez l'aide proposée, maintenez vos activités sociales, et n'hésitez pas à consulter un psychologue si nécessaire. Votre bien-être maladiene la qualité des soins que vous pouvez apporter.
Documentez l'évolution de votre proche : notez les changements observés, photographiez les positions, filmez les réactions [10]. Ces éléments peuvent être utiles lors des consultations médicales et aider à objectiver d'éventuelles améliorations.
Restez informé des avancées thérapeutiques et des essais cliniques en cours [4,5]. Certains centres de recherche recrutent des patients pour tester de nouvelles approches. Votre neurologue peut vous orienter vers ces opportunités si votre proche répond aux critères d'inclusion.
Quand Consulter un Médecin ?
Consultez en urgence en cas de fièvre élevée, de difficultés respiratoires, ou de changement brutal de l'état général [14,15]. Ces signes peuvent révéler une infection grave nécessitant une hospitalisation immédiate.Prenez rendez-vous rapidement si vous observez des crises convulsives, des vomissements répétés, ou une modification de la coloration cutanée [9]. Ces symptômes peuvent indiquer des complications neurologiques ou métaboliques nécessitant un ajustement thérapeutique.
Signalez à votre médecin toute modification du comportement : agitation inhabituelle, changement du rythme veille-sommeil, ou apparition de nouveaux mouvements [6]. Ces évolutions peuvent parfois témoigner d'une amélioration de l'état de conscience.
Organisez un suivi régulier avec l'équipe médicale spécialisée, généralement tous les 3 à 6 mois [8]. Ces consultations permettent de réévaluer l'état neurologique, d'ajuster les traitements, et de discuter des objectifs de prise en charge.
N'hésitez pas à solliciter l'équipe soignante pour toute question ou inquiétude [11]. Les professionnels sont là pour vous accompagner et répondre à vos interrogations, même si elles vous paraissent banales.
Questions Fréquentes
Mon proche peut-il m'entendre quand je lui parle ?Nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude. Bien que les patients en état végétatif persistant ne montrent pas de signes de conscience, certaines études suggèrent qu'une activité cérébrale résiduelle pourrait persister [4,5]. Continuez à lui parler, cela ne peut pas lui faire de mal et peut vous aider.
Combien de temps peut durer un état végétatif persistant ?
La durée est très variable. Certains patients récupèrent partiellement dans les premiers mois, d'autres restent dans cet état pendant des années [9,15]. Le pronostic dépend de nombreux facteurs : cause, âge, étendue des lésions cérébrales.
Les soins à domicile sont-ils possibles ?
Oui, avec une organisation adaptée et un soutien professionnel [10,11]. Environ 20% des patients sont pris en charge à domicile. Cela nécessite un aménagement du logement, du matériel médical, et l'intervention de professionnels de santé.
Quelles sont les chances de récupération ?
Environ 10 à 15% des patients récupèrent une certaine conscience dans l'année [14]. Les chances diminuent avec le temps, mais des récupérations tardives restent possibles, bien que rares. Les nouvelles techniques d'évaluation permettent un pronostic plus précis [4,5].
Comment gérer l'épuisement des aidants ?
L'épuisement est fréquent et normal. Il est essentiel de demander de l'aide, de maintenir ses activités personnelles, et de consulter un psychologue si nécessaire [8,11]. Les associations de familles offrent un soutien précieux dans ces moments difficiles.
Questions Fréquentes
Mon proche peut-il m'entendre quand je lui parle ?
Nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude. Bien que les patients en état végétatif persistant ne montrent pas de signes de conscience, certaines études suggèrent qu'une activité cérébrale résiduelle pourrait persister. Continuez à lui parler, cela ne peut pas lui faire de mal et peut vous aider.
Combien de temps peut durer un état végétatif persistant ?
La durée est très variable. Certains patients récupèrent partiellement dans les premiers mois, d'autres restent dans cet état pendant des années. Le pronostic dépend de nombreux facteurs : cause, âge, étendue des lésions cérébrales.
Les soins à domicile sont-ils possibles ?
Oui, avec une organisation adaptée et un soutien professionnel. Environ 20% des patients sont pris en charge à domicile. Cela nécessite un aménagement du logement, du matériel médical, et l'intervention de professionnels de santé.
Quelles sont les chances de récupération ?
Environ 10 à 15% des patients récupèrent une certaine conscience dans l'année. Les chances diminuent avec le temps, mais des récupérations tardives restent possibles, bien que rares. Les nouvelles techniques d'évaluation permettent un pronostic plus précis.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] CRRF LES SALINS DE BREGILLE. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] Avis 148.pdf. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Les Activités d'Expertises Adulte en Soins Médicaux de RéadaptationLien
- [4] Restoring consciousness with pharmacologic therapyLien
- [5] Challenges of Cerebral Hemodynamic Disorders and Hypoxic Ischemic EncephalopathyLien
- [6] Les situations d'état végétatif ou paucirelationnelLien
- [7] Prise en charge institutionnelle des personnes en situation d'État Végétatif ChroniqueLien
- [8] Accompagnement des personnes en État d'Éveil Non RépondantLien
- [9] États de conscience altérée en réanimation et post-réanimationLien
- [10] Le retour à domicile, reconquête d'un passé, d'une histoire, d'une appartenanceLien
- [11] Le retour à domicile, reconquête d'un passé, d'une histoire, d'une appartenanceLien
- [14] État végétatif - Troubles du cerveau, de la moelle épinièreLien
- [15] État végétatif et état de conscience minimalLien
- [16] Qu'est-ce qu'un état végétatifLien
Publications scientifiques
- Les situations d'état végétatif ou paucirelationnel (2024)
- Ρrise en charge institutiοnnelle des persοnnes en situatiοn d'Etat Végétatif Chrοnique οu Etat Ρauci-Relatiοnnel: analyse sοciοlοgique au prisme de la" trajectοire de … (2024)
- Accompagnement des personnes en État d'Éveil Non Répondant (anciennement appelés EVC) ou Pauci-Relationnel et de leurs familles. Historique (2023)
- [PDF][PDF] États de conscience altérée en réanimation et post-réanimation: prise en charge et pronostic (2023)[PDF]
- Le retour à domicile, reconquête d'un passé, d'une histoire, d'une appartenance
Ressources web
- État végétatif - Troubles du cerveau, de la moelle épinière ... (msdmanuals.com)
Symptômes de l'état végétatif · Elles peuvent ouvrir les yeux. · Elles ont un schéma de sommeil et d'éveil relativement régulier (mais pas nécessairement lié au ...
- État végétatif et état de conscience minimal (msdmanuals.com)
Si le diagnostic d'état végétatif persistant est incertain, une PET, une SPECT ou une IRM fonctionnelle doivent être effectuées. Dans certains cas, ces ...
- Qu'est-ce qu'un état végétatif (preziosi-handicap.org)
Comment est diagnostiqué un état végétatif ? ... Un tel état est généralement diagnostiqué par imagerie par résonance magnétique et par un électroencéphalogramme.
- État végétatif persistant : signes, causes et traitement (medicoverhospitals.in)
Diagnostic de l'état végétatif persistant. Dans un premier temps, une anamnèse complète et un examen physique sont réalisés pour évaluer l'état du patient.
- irm-vegetatif.pdf (hug.ch)
On parle d'état végétatif persistant lorsqu'un patient demeure en état végétatif un mois après l'agression cérébrale, qu'elle soit ou non traumatique. Cette ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
