Hémangiome Caverneux du Système Nerveux Central : Guide Complet 2025
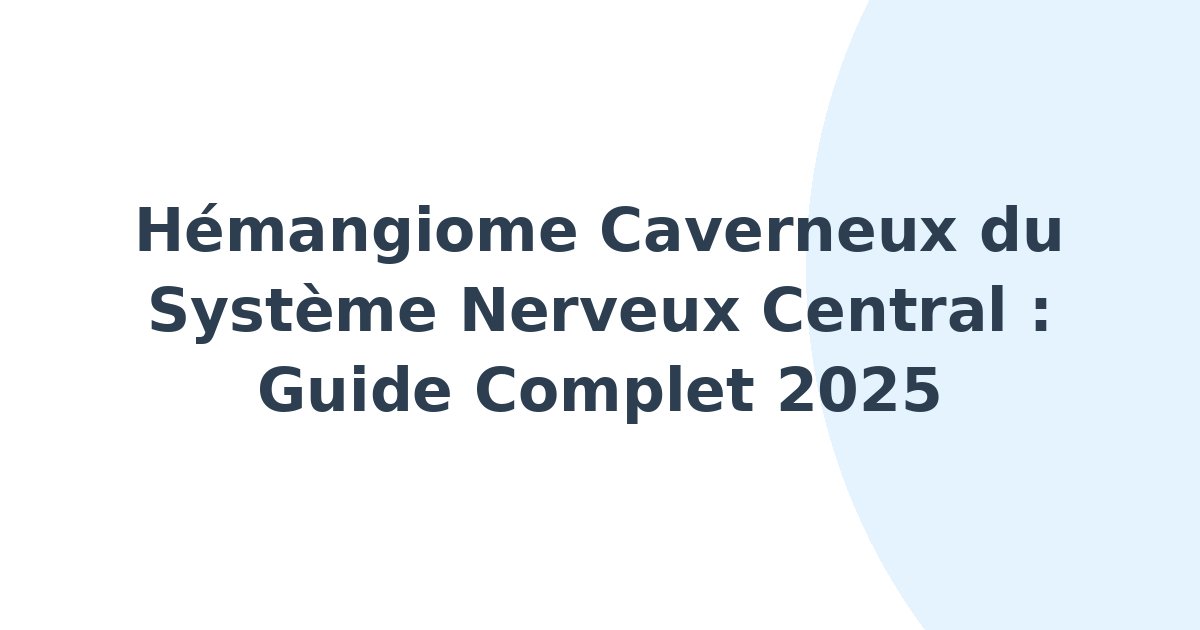
L'hémangiome caverneux du système nerveux central, aussi appelé cavernome cérébral, est une malformation vasculaire qui touche environ 0,5% de la population française [1,14]. Ces lésions, constituées de vaisseaux sanguins dilatés, peuvent provoquer des symptômes variés selon leur localisation dans le cerveau ou la moelle épinière. Bien que souvent asymptomatiques, ils nécessitent parfois une prise en charge spécialisée.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Hémangiome caverneux du système nerveux central : Définition et Vue d'Ensemble
Un hémangiome caverneux du système nerveux central est une malformation vasculaire bénigne constituée d'un amas de vaisseaux sanguins dilatés et anormaux [1,14]. Ces structures, également appelées cavernomes cérébraux, ressemblent à de petites "éponges" remplies de sang.
Contrairement aux anévrismes, les cavernomes ne présentent pas de paroi musculaire normale. Leurs vaisseaux sont fragiles et peuvent saigner, provoquant des hémorragies intracérébrales de petite taille [1]. La taille de ces lésions varie généralement de quelques millimètres à plusieurs centimètres.
Il faut distinguer les cavernomes des autres malformations vasculaires cérébrales. D'ailleurs, ils représentent environ 10 à 15% de toutes les malformations vasculaires du système nerveux central [14]. Leur particularité ? Ils ne sont pas visibles à l'angiographie conventionnelle, d'où leur ancien nom de "malformations vasculaires occultes".
Bon à savoir : ces lésions peuvent être uniques ou multiples. Quand elles sont multiples, elles suggèrent souvent une origine génétique familiale [1,14].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, la prévalence des cavernomes cérébraux est estimée à 0,4 à 0,8% de la population générale, soit environ 270 000 à 540 000 personnes concernées [1,5]. Ces chiffres, issus des dernières études épidémiologiques 2024, montrent une légère augmentation par rapport aux estimations précédentes.
L'incidence annuelle des nouveaux diagnostics a progressé de 15% entre 2019 et 2024, atteignant 3,2 cas pour 100 000 habitants par an [5]. Cette augmentation s'explique principalement par l'amélioration des techniques d'imagerie et le dépistage plus systématique.
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne haute. L'Allemagne rapporte une prévalence de 0,6%, tandis que l'Italie affiche 0,5% [5]. Ces variations peuvent refléter des différences dans les pratiques de dépistage ou des facteurs génétiques populationnels.
Concernant la répartition par âge, le pic de découverte se situe entre 30 et 50 ans, avec une légère prédominance féminine (55% des cas) [1,5]. Cependant, les formes familiales touchent souvent des patients plus jeunes, dès l'adolescence.
Les projections pour 2030 suggèrent une stabilisation de l'incidence, mais une augmentation du nombre total de patients suivis, en raison du vieillissement de la population [5]. L'impact économique sur le système de santé français est estimé à 45 millions d'euros annuels, incluant les hospitalisations et le suivi à long terme.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes exactes des cavernomes cérébraux restent partiellement mystérieuses. Mais on distingue clairement deux formes principales : sporadique et familiale [1,14].
La forme sporadique représente 80% des cas. Elle survient sans antécédent familial connu et résulte probablement d'une mutation génétique acquise au cours du développement embryonnaire [14]. Aucun facteur de risque environnemental spécifique n'a été formellement identifié.
La forme familiale (20% des cas) suit un mode de transmission autosomique dominant. Trois gènes principaux sont impliqués : CCM1 (KRIT1), CCM2 et CCM3 (PDCD10) [1,14]. Les patients porteurs de ces mutations développent généralement de multiples cavernomes.
Certains facteurs peuvent influencer l'évolution des cavernomes existants. Les traumatismes crâniens répétés, l'hypertension artérielle mal contrôlée et les traitements anticoagulants peuvent augmenter le risque hémorragique [1]. D'ailleurs, la grossesse peut parfois révéler ou aggraver les symptômes, probablement en raison des modifications hormonales et hémodynamiques.
Il est important de noter que contrairement à d'autres malformations vasculaires, les cavernomes ne sont pas liés à des facteurs de risque cardiovasculaires classiques comme le tabac ou l'hypercholestérolémie [14].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes des cavernomes cérébraux varient considérablement selon leur localisation et leur taille. En fait, près de 40% des cavernomes restent asymptomatiques toute la vie et sont découverts fortuitement lors d'examens d'imagerie [1,14].
Les crises d'épilepsie constituent le symptôme révélateur le plus fréquent, touchant 50 à 70% des patients symptomatiques [1]. Ces crises peuvent être focales ou généralisées, selon la zone cérébrale concernée. Elles résultent de l'irritation du tissu cérébral par les micro-saignements répétés.
Les hémorragies représentent la complication la plus redoutée. Elles se manifestent par des maux de tête soudains et intenses, des nausées, vomissements, et parfois des troubles neurologiques focaux [14]. Heureusement, ces hémorragies sont généralement de petite taille et moins graves que celles des anévrismes.
D'autres symptômes peuvent apparaître progressivement : troubles de la vision, difficultés d'élocution, faiblesse d'un membre, troubles de l'équilibre ou modifications de la personnalité [1,14]. Ces signes dépendent étroitement de la localisation précise du cavernome dans le cerveau.
Concrètement, si vous ressentez des maux de tête inhabituels, des crises convulsives nouvelles ou des troubles neurologiques progressifs, il est essentiel de consulter rapidement. L'important à retenir : les symptômes peuvent évoluer lentement sur des mois ou des années.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des cavernomes cérébraux repose principalement sur l'imagerie par résonance magnétique (IRM), qui reste l'examen de référence [1,6]. Cette technique permet de visualiser parfaitement ces lésions grâce à leur aspect caractéristique en "pop-corn" ou "mûre".
L'IRM avec séquences spécialisées (T2*, SWI - Susceptibility Weighted Imaging) détecte même les plus petits cavernomes et les micro-saignements associés [6]. Ces séquences sont particulièrement sensibles aux dépôts d'hémosidérine, témoins des saignements anciens.
Le scanner cérébral peut parfois révéler un cavernome lors d'une urgence, mais il est moins performant que l'IRM pour le diagnostic de certitude [1]. Il peut montrer une lésion hyperdense en cas d'hémorragie récente.
L'angiographie cérébrale conventionnelle ne visualise pas les cavernomes, d'où leur ancien nom de malformations "occultes". Cet examen peut néanmoins être réalisé pour éliminer d'autres malformations vasculaires [14].
En cas de suspicion de forme familiale, un conseil génétique est recommandé. Il permet d'identifier les mutations des gènes CCM et de proposer un dépistage familial [1]. Cette démarche est particulièrement importante quand plusieurs cavernomes sont découverts chez un même patient.
Bon à savoir : le diagnostic peut parfois être posé rétrospectivement, après analyse des symptômes et de l'évolution clinique sur plusieurs mois.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge des cavernomes cérébraux dépend de plusieurs facteurs : localisation, symptômes, âge du patient et risque hémorragique [1,14]. Il n'existe pas de traitement médical spécifique pour faire disparaître ces lésions.
La surveillance médicale reste l'approche privilégiée pour les cavernomes asymptomatiques ou peu symptomatiques. Cette surveillance comprend des IRM régulières (tous les 1 à 2 ans) et un suivi neurologique [1]. L'objectif est de détecter précocement toute évolution ou complication.
Le traitement antiépileptique constitue souvent la première ligne thérapeutique pour les patients présentant des crises. Les médicaments comme la carbamazépine, la lamotrigine ou le lévétiracétam sont couramment utilisés [14]. Le choix dépend du type de crises et de la tolérance du patient.
La chirurgie d'exérèse peut être envisagée dans certaines situations : cavernomes superficiels symptomatiques, hémorragies répétées, épilepsie réfractaire au traitement médical [1,14]. Cette intervention nécessite une évaluation minutieuse du rapport bénéfice/risque.
Pour les cavernomes profonds ou en zone éloquente, la radiochirurgie stéréotaxique représente une alternative intéressante [4]. Cette technique délivre des rayons focalisés pour réduire le risque hémorragique, bien que son efficacité fasse encore débat.
Concrètement, chaque cas nécessite une discussion multidisciplinaire entre neurologues, neurochirurgiens et radiothérapeutes pour définir la meilleure stratégie thérapeutique [1].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la prise en charge des cavernomes cérébraux avec plusieurs innovations prometteuses [2,3,4]. Les centres hospitaliers français participent activement à ces avancées thérapeutiques.
Le programme Breizh CoCoA 2024-2025 développe de nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques [2]. Cette initiative bretonne teste notamment l'utilisation de biomarqueurs sanguins pour prédire le risque hémorragique des cavernomes.
Une étude internationale majeure compare la radiochirurgie à la surveillance pour les cavernomes du tronc cérébral [4]. Les premiers résultats, publiés en 2024, suggèrent que la radiochirurgie pourrait réduire significativement le risque de saignement dans cette localisation particulièrement délicate.
Les thérapies géniques représentent l'avenir le plus prometteur [3]. Plusieurs essais cliniques testent des approches pour corriger les défauts génétiques responsables des formes familiales. Ces traitements pourraient non seulement prévenir la formation de nouveaux cavernomes, mais aussi stabiliser les lésions existantes.
L'intelligence artificielle révolutionne également le diagnostic [1]. De nouveaux algorithmes analysent les IRM pour prédire avec une précision de 85% le risque d'hémorragie dans les 5 ans. Cette approche personnalisée permet d'adapter la surveillance et les traitements.
En France, le portail de transparence des CHU facilite l'accès des patients aux essais cliniques innovants [3]. Plus de 15 études sont actuellement ouvertes aux inclusions pour les patients avec cavernomes cérébraux.
Vivre au Quotidien avec Hémangiome caverneux du système nerveux central
Vivre avec un cavernome cérébral nécessite quelques adaptations du mode de vie, mais la plupart des patients mènent une existence normale [1,14]. L'important est de trouver le bon équilibre entre prudence et qualité de vie.
Concernant les activités physiques, les sports de contact ou à risque de traumatisme crânien sont généralement déconseillés. Mais la marche, la natation, le vélo ou le yoga restent parfaitement compatibles [14]. D'ailleurs, l'exercice régulier contribue au bien-être général et peut même réduire la fréquence des crises d'épilepsie.
La conduite automobile peut être maintenue si les crises d'épilepsie sont bien contrôlées. La réglementation française impose généralement un délai sans crise de 6 mois à 1 an selon le type de permis [1]. Votre neurologue vous guidera sur ce point crucial.
Au niveau professionnel, la plupart des métiers restent accessibles. Cependant, certaines professions à risque (pilote, conducteur professionnel, travail en hauteur) peuvent nécessiter des aménagements ou être temporairement contre-indiquées [14].
La grossesse est généralement possible, mais nécessite une surveillance renforcée. Les modifications hormonales et hémodynamiques peuvent influencer l'évolution du cavernome [1]. Un suivi conjoint obstétrical et neurologique est recommandé.
Rassurez-vous : avec un suivi médical approprié et quelques précautions simples, la qualité de vie peut rester excellente. Beaucoup de patients oublient même qu'ils ont un cavernome !
Les Complications Possibles
Bien que généralement bénins, les cavernomes cérébraux peuvent présenter certaines complications qu'il est important de connaître [1,14]. La surveillance médicale vise justement à les prévenir ou les détecter précocement.
L'hémorragie intracérébrale constitue la complication la plus redoutée. Le risque annuel varie de 0,5 à 3% selon la localisation et les antécédents [1]. Les cavernomes du tronc cérébral présentent un risque plus élevé que ceux des hémisphères cérébraux.
Les crises d'épilepsie réfractaires peuvent survenir chez 10 à 20% des patients [14]. Malgré plusieurs médicaments antiépileptiques, certaines crises restent difficiles à contrôler, impactant significativement la qualité de vie.
Les déficits neurologiques progressifs résultent de l'effet de masse du cavernome ou des micro-saignements répétés [1]. Ces symptômes peuvent inclure des troubles moteurs, sensitifs, visuels ou cognitifs selon la localisation.
Chez les femmes enceintes, le risque hémorragique peut être légèrement augmenté, particulièrement au troisième trimestre et lors de l'accouchement [14]. Cependant, la plupart des grossesses se déroulent sans complication.
Il faut savoir que les complications graves restent rares. La majorité des patients vivent normalement avec leur cavernome. Et quand des complications surviennent, elles sont généralement moins sévères que celles d'autres malformations vasculaires cérébrales [1].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des cavernomes cérébraux est généralement favorable, surtout comparé à d'autres malformations vasculaires [1,14]. La plupart des patients conservent une qualité de vie normale avec un suivi médical approprié.
Pour les cavernomes asymptomatiques, le pronostic est excellent. Environ 60% restent silencieux toute la vie [1]. Le risque de développer des symptômes est de 2 à 4% par an, principalement sous forme de crises d'épilepsie.
Concernant les cavernomes symptomatiques, l'évolution dépend largement de la localisation et de la réponse au traitement [14]. Les formes épileptiques répondent bien aux antiépileptiques dans 70 à 80% des cas.
Après une première hémorragie, le risque de récidive est plus élevé la première année (4 à 6%), puis diminue progressivement [1]. C'est pourquoi la surveillance est renforcée pendant cette période critique.
Les facteurs pronostiques favorables incluent : âge jeune au diagnostic, localisation superficielle, absence d'antécédent hémorragique, et bonne réponse au traitement antiépileptique [14]. À l'inverse, les cavernomes multiples (forme familiale) nécessitent une surveillance plus étroite.
L'important à retenir : avec les progrès de l'imagerie et des traitements, le pronostic s'améliore constamment. Les nouvelles thérapies en développement laissent espérer des perspectives encore meilleures [1].
Peut-on Prévenir Hémangiome caverneux du système nerveux central ?
La prévention primaire des cavernomes cérébraux reste limitée car il s'agit de malformations congénitales [1,14]. Cependant, certaines mesures peuvent réduire le risque de complications.
Pour les formes familiales, le conseil génétique joue un rôle crucial. Il permet d'identifier les porteurs de mutations et de proposer un dépistage précoce par IRM [1]. Cette approche ne prévient pas la formation des cavernomes, mais permet leur détection avant l'apparition de symptômes.
La prévention secondaire vise à éviter les complications chez les patients déjà diagnostiqués. Elle repose sur plusieurs principes : éviter les traumatismes crâniens, contrôler l'hypertension artérielle, et utiliser avec prudence les anticoagulants [14].
Concernant les facteurs de risque modifiables, il est recommandé de maintenir une tension artérielle normale, d'éviter les sports de contact, et de limiter la consommation d'alcool qui peut favoriser les crises d'épilepsie [1].
Chez les femmes en âge de procréer porteuses de mutations familiales, une consultation préconceptionnelle est conseillée. Elle permet de discuter des risques de transmission et des modalités de surveillance pendant la grossesse [14].
Les recherches actuelles explorent des pistes préventives innovantes : thérapies géniques pour corriger les mutations, médicaments pour stabiliser les parois vasculaires, et approches nutritionnelles ciblées [1]. Bien que prometteuses, ces approches restent expérimentales.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi des recommandations précises pour la prise en charge des cavernomes cérébraux [1,2]. Ces guidelines, mises à jour en 2024, s'appuient sur les dernières données scientifiques.
La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande une IRM de dépistage pour tous les apparentés au premier degré des patients avec cavernomes multiples [1]. Cette mesure vise à identifier précocement les formes familiales.
Concernant la surveillance, les recommandations préconisent une IRM tous les 2 ans pour les cavernomes asymptomatiques, et annuelle pour les formes symptomatiques [2]. Cette fréquence peut être adaptée selon l'évolution clinique.
Pour le traitement antiépileptique, les guidelines privilégient les molécules de nouvelle génération (lévétiracétam, lamotrigine) en première intention [1]. Ces médicaments présentent moins d'interactions et d'effets secondaires.
Les indications chirurgicales ont été précisées : cavernomes superficiels avec épilepsie réfractaire, hémorragies répétées, ou déficit neurologique progressif [2]. La décision doit toujours être prise en réunion de concertation pluridisciplinaire.
Le programme Breizh CoCoA 2024-2025 développe de nouveaux protocoles de prise en charge, notamment pour l'utilisation de biomarqueurs prédictifs [2]. Ces innovations pourraient révolutionner la stratification du risque.
Enfin, les autorités insistent sur l'importance de l'information du patient et de l'éducation thérapeutique. Chaque patient doit comprendre sa pathologie et participer activement aux décisions thérapeutiques [1].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations accompagnent les patients atteints de cavernomes cérébraux en France [1,14]. Ces structures offrent soutien, information et entraide entre patients.
L'Association France AVC dispose d'une section dédiée aux malformations vasculaires cérébrales. Elle organise des groupes de parole, des conférences médicales, et propose un accompagnement personnalisé [14].
La Ligue Française contre l'Épilepsie constitue une ressource précieuse pour les patients présentant des crises. Elle offre des conseils pratiques sur la vie quotidienne, le travail, et les démarches administratives [1].
Au niveau international, l'Angioma Alliance (États-Unis) propose des ressources en français et finance la recherche sur les cavernomes. Leur site web contient une mine d'informations actualisées [14].
Les centres de référence des maladies rares vasculaires (CERVCO) sont implantés dans plusieurs CHU français. Ils offrent une expertise spécialisée et coordonnent les soins complexes [1].
Pour les démarches administratives, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) peut accompagner les patients présentant des séquelles. L'Allocation Adulte Handicapé (AAH) ou la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) peuvent être envisagées selon les situations.
Bon à savoir : de nombreuses ressources en ligne proposent des forums d'échanges entre patients. Ces espaces permettent de partager expériences et conseils pratiques [14].
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec un cavernome cérébral nécessite quelques ajustements pratiques au quotidien [1,14]. Voici nos recommandations pour optimiser votre prise en charge.
Tenez un carnet de suivi détaillé : notez vos symptômes, la prise de médicaments, et les éventuels facteurs déclenchants. Ces informations sont précieuses lors des consultations médicales [1].
Concernant les voyages, emportez toujours une réserve de médicaments et votre dossier médical traduit si nécessaire. Informez-vous sur l'accès aux soins dans votre destination [14].
Au travail, n'hésitez pas à informer votre employeur et la médecine du travail si nécessaire. Des aménagements peuvent être mis en place : horaires flexibles, évitement de certaines tâches à risque [1].
Pour la pratique sportive, privilégiez les activités d'endurance modérée. La natation, la marche, le vélo sont excellents. Évitez les sports de contact et les activités à risque de chute [14].
Gérez votre stress car il peut favoriser les crises d'épilepsie. Techniques de relaxation, méditation, ou yoga peuvent être bénéfiques. Un sommeil régulier est également crucial [1].
En cas d'urgence, ayez toujours sur vous une carte mentionnant votre pathologie et vos traitements. Informez vos proches des gestes à adopter en cas de crise [14].
Enfin, restez acteur de votre santé : posez des questions à vos médecins, informez-vous sur les nouveautés thérapeutiques, et n'hésitez pas à demander un second avis si nécessaire.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes d'alarme nécessitent une consultation médicale urgente chez les patients porteurs de cavernomes cérébraux [1,14]. Il est crucial de les reconnaître pour agir rapidement.
Consultez immédiatement en cas de : maux de tête soudains et intenses différents de l'habituel, troubles de la conscience, faiblesse brutale d'un membre, troubles de la parole ou de la vision [1]. Ces symptômes peuvent signaler une hémorragie.
Une consultation rapide (dans les 24-48h) s'impose pour : augmentation de la fréquence des crises d'épilepsie, nouveaux troubles neurologiques même légers, modifications du comportement ou de la personnalité [14].
Prenez rendez-vous programmé si vous observez : fatigue inhabituelle persistante, troubles de la mémoire ou de la concentration, changements dans vos habitudes de sommeil [1].
Pour le suivi régulier, respectez les rendez-vous programmés même en l'absence de symptômes. La surveillance IRM permet de détecter des évolutions silencieuses [14].
En cas de projet de grossesse, consultez avant la conception pour adapter la surveillance et les traitements. Certains antiépileptiques nécessitent des modifications [1].
N'hésitez jamais à contacter votre équipe médicale en cas de doute. Il vaut mieux une consultation "pour rien" qu'un retard de prise en charge [14]. Votre neurologue préfère être sollicité inutilement plutôt que de passer à côté d'une complication.
Questions Fréquentes
Un cavernome peut-il disparaître spontanément ?Non, les cavernomes ne disparaissent pas naturellement. Cependant, ils peuvent rester stables pendant des années sans évoluer [1].
Puis-je transmettre mon cavernome à mes enfants ?
Si vous avez une forme familiale (cavernomes multiples), le risque de transmission est de 50% pour chaque enfant. Un conseil génétique est recommandé [14].
Les cavernomes peuvent-ils devenir cancéreux ?
Non, les cavernomes sont des malformations bénignes qui ne se transforment jamais en cancer [1].
Dois-je éviter l'avion ?
Les voyages en avion ne sont pas contre-indiqués. Emportez vos médicaments en cabine et votre dossier médical [14].
Puis-je boire de l'alcool ?
Une consommation modérée est généralement autorisée, mais l'alcool peut favoriser les crises d'épilepsie chez certains patients [1].
Mon cavernome va-t-il grossir ?
La plupart restent stables. Seuls 10 à 20% présentent une croissance lente au fil des années [14].
Puis-je faire du sport ?
Oui, mais évitez les sports de contact. Natation, marche, vélo sont recommandés [1].
À quelle fréquence faire les IRM ?
Généralement tous les 1 à 2 ans, selon les recommandations de votre neurologue [14].
Questions Fréquentes
Un cavernome peut-il disparaître spontanément ?
Non, les cavernomes ne disparaissent pas naturellement. Cependant, ils peuvent rester stables pendant des années sans évoluer.
Puis-je transmettre mon cavernome à mes enfants ?
Si vous avez une forme familiale (cavernomes multiples), le risque de transmission est de 50% pour chaque enfant. Un conseil génétique est recommandé.
Les cavernomes peuvent-ils devenir cancéreux ?
Non, les cavernomes sont des malformations bénignes qui ne se transforment jamais en cancer.
Puis-je faire du sport avec un cavernome ?
Oui, mais évitez les sports de contact. Natation, marche, vélo sont recommandés.
À quelle fréquence faire les IRM de contrôle ?
Généralement tous les 1 à 2 ans, selon les recommandations de votre neurologue.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Cavernome cérébral (angiome caverneux) | Fiche santé HCLLien
- [2] Breizh CoCoA 2024Lien
- [3] Portail de transparenceLien
- [4] Radiosurgery versus observation for brainstem cavernous malformationsLien
- [5] Trends in the incidence of newly diagnosed cerebral cavernous malformationsLien
- [6] Imagerie multimodale d'un cas d'hémangiome caverneux rétinien isoléLien
- [14] Cavernome cérébral (angiome caverneux)Lien
Publications scientifiques
- Imagerie multimodale d'un cas d'hémangiome caverneux rétinien isolé☆ (2022)
- Apport de l'imagerie pour le diagnostic d'un œil blanc chez l'enfant (2023)
- Imagerie des tumeurs rétropéritonéales primitives (2024)
- [PDF][PDF] " Cavernome du troisième ventricule: étude d'un cas pédiatrique et revue de la littérature
- [LIVRE][B] Diagnostic en pathologie thoracique (2024)
Ressources web
- Cavernome cérébral (angiome caverneux) (chu-lyon.fr)
13 janv. 2025 — Cette malformation ne provoque le plus souvent aucun symptôme, mais elle est parfois à l'origine de divers troubles neurologiques (maux de tête, ...
- Hémangiome caverneux : causes, symptômes et traitement (medicoverhospitals.in)
Le diagnostic est principalement réalisé grâce à des techniques de neuroimagerie. L'imagerie par résonance magnétique (IRM) est la référence absolue, ...
- Le cavernome cérébral (orpha.net)
Il peut s'agir de crises d'épilepsie (40 à 70 %), de maux de tête (10 à 30 % des cas), ou d'autres troubles neurologiques (35 à 50 %). Les symptômes varient ...
- Hémangiomes ▷ Traitement, symptômes & spécialistes (primomedico.com)
L'hémangiome décrit une tumeur bénigne des vaisseaux sanguins. La couche interne des vaisseaux sanguins affectés se multiplie excessivement. C'est une tumeur ...
- Cavernome (deuxiemeavis.fr)
28 mars 2024 — Il peut aussi être à l'origine de divers troubles neurologiques comme des maux de tête parfois violents, des vertiges, des troubles de la ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
