Glycogénose de type II (Maladie de Pompe) : Guide Complet 2025
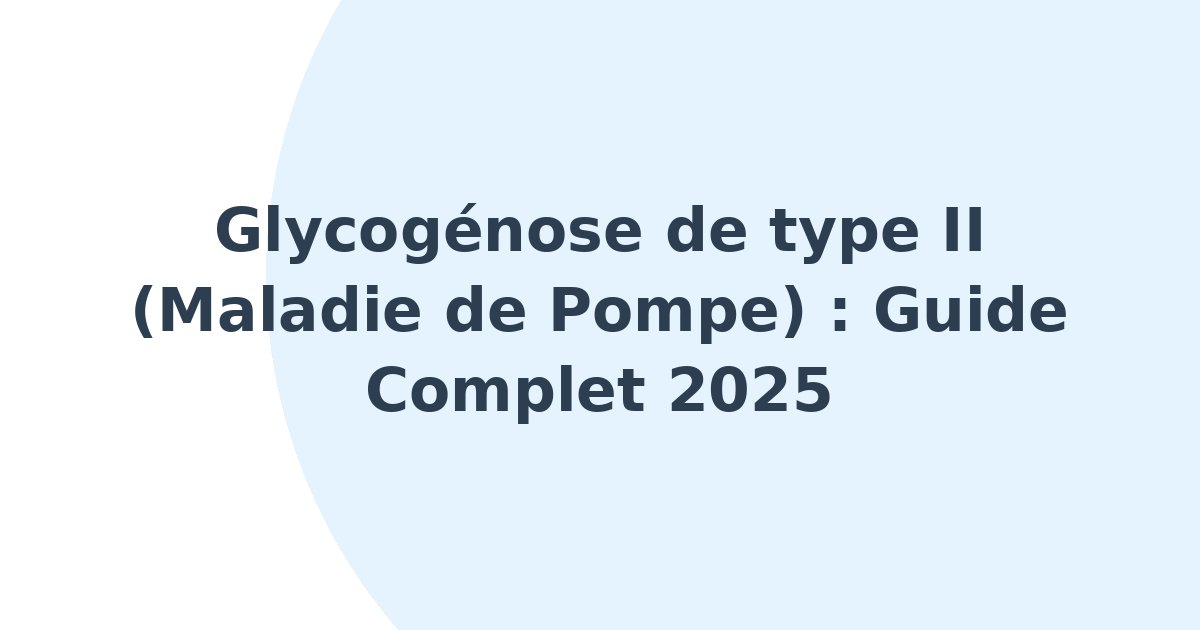
La glycogénose de type II, également appelée maladie de Pompe, est une pathologie génétique rare qui affecte le métabolisme du glycogène. Cette maladie héréditaire touche environ 1 personne sur 40 000 naissances en France selon les dernières données de la HAS [1,2]. Caractérisée par un déficit enzymatique, elle provoque une accumulation de glycogène dans les cellules musculaires et peut se manifester dès la naissance ou à l'âge adulte.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Glycogénose de type II : Définition et Vue d'Ensemble
La glycogénose de type II résulte d'un déficit en alpha-glucosidase acide, une enzyme essentielle au métabolisme du glycogène. Cette pathologie héréditaire autosomique récessive provoque une accumulation progressive de glycogène dans les lysosomes des cellules musculaires [3].
Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Imaginez vos muscles comme des entrepôts où s'accumulent des réserves d'énergie sous forme de glycogène. Normalement, une enzyme spécialisée décompose ces réserves quand vos muscles en ont besoin. Dans la maladie de Pompe, cette enzyme ne fonctionne pas correctement.
Il existe deux formes principales de cette pathologie. La forme infantile classique se manifeste dès les premiers mois de vie avec une cardiomyopathie hypertrophique sévère. La forme tardive, plus fréquente, débute généralement à l'âge adulte et affecte principalement les muscles squelettiques [17].
D'ailleurs, le nom "maladie de Pompe" rend hommage au pédiatre néerlandais Johannes Pompe qui l'a décrite pour la première fois en 1932. Cette pathologie fait partie des maladies de surcharge lysosomale, un groupe de troubles métaboliques héréditaires [11].
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques récentes révèlent une prévalence de la glycogénose de type II estimée à 1 cas pour 40 000 naissances en France, selon les derniers rapports de la HAS [1,2]. Cette fréquence varie considérablement selon les populations et les régions géographiques.
En Europe, l'incidence annuelle oscille entre 1 sur 28 000 et 1 sur 300 000 naissances selon les pays. Les Pays-Bas présentent une prévalence particulièrement élevée avec 1 cas sur 40 000 habitants, tandis que certaines régions d'Asie du Sud-Est affichent des taux encore plus importants [4].
Concrètement, cela représente environ 150 à 200 nouveaux cas diagnostiqués chaque année en France. Mais attention, ces chiffres sont probablement sous-estimés car de nombreux cas de forme tardive restent non diagnostiqués pendant des années [4].
L'évolution temporelle montre une amélioration du diagnostic depuis 2010. Le nombre de patients identifiés a augmenté de 40% ces cinq dernières années grâce aux progrès des techniques de séquençage génétique [1]. Les projections pour 2025-2030 suggèrent une stabilisation de l'incidence mais une meilleure détection des formes tardives.
Il est intéressant de noter que la forme infantile représente environ 25% des cas, tandis que la forme tardive constitue 75% des diagnostics. Cette répartition varie selon les régions, avec une prédominance de la forme tardive dans les populations européennes [4].
Les Causes et Facteurs de Risque
La glycogénose de type II est causée par des mutations du gène GAA situé sur le chromosome 17. Ce gène code pour l'enzyme alpha-glucosidase acide, indispensable à la dégradation du glycogène dans les lysosomes [3,17].
Plus de 500 mutations différentes ont été identifiées à ce jour. Certaines mutations entraînent une absence totale d'enzyme (forme infantile), tandis que d'autres provoquent une activité enzymatique résiduelle (forme tardive) [5]. Cette diversité génétique explique la grande variabilité des symptômes entre les patients.
Étant une maladie autosomique récessive, elle nécessite que les deux parents soient porteurs d'une mutation pour que l'enfant soit atteint. Chaque grossesse présente alors un risque de 25% d'avoir un enfant malade [17]. Heureusement, le conseil génétique permet aujourd'hui d'informer les familles sur ces risques.
Certaines populations présentent des mutations fondatrices plus fréquentes. Par exemple, la mutation c.-32-13T>G est particulièrement répandue dans les populations d'origine chinoise, tandis que la délétion c.525delT est fréquente chez les patients d'origine africaine [9].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la glycogénose de type II varient considérablement selon la forme de la maladie. Dans la forme infantile classique, les premiers signes apparaissent généralement avant l'âge de 6 mois [12,17].
Chez les nourrissons, vous pourriez observer une hypotonie musculaire marquée (bébé "mou"), des difficultés d'alimentation et une croissance ralentie. Le signe le plus caractéristique reste l'hypertrophie cardiaque qui peut provoquer des troubles du rythme et une insuffisance cardiaque [12].
La forme tardive présente un tableau clinique différent. Les premiers symptômes apparaissent généralement entre 20 et 60 ans, parfois plus tard. La faiblesse musculaire proximale constitue le symptôme principal, touchant d'abord les muscles des hanches et des épaules [9,15].
Concrètement, les patients rapportent des difficultés à monter les escaliers, à se lever d'une chaise ou à porter des objets lourds. La fatigue musculaire s'installe progressivement, accompagnée parfois de douleurs musculaires [15]. D'ailleurs, les troubles respiratoires peuvent survenir en raison de l'atteinte du diaphragme et des muscles intercostaux.
Il faut savoir que l'évolution est généralement lente dans la forme tardive, s'étalant sur plusieurs années. Certains patients développent également des troubles de la déglutition ou des apnées du sommeil [9].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de la glycogénose de type II repose sur plusieurs examens complémentaires. La première étape consiste généralement en un dosage des enzymes musculaires, notamment les CPK (créatine phosphokinases) qui sont souvent élevées [14].
L'examen clé reste le dosage de l'activité de l'alpha-glucosidase acide. Cette analyse peut être réalisée sur une goutte de sang séché (test de Guthrie) ou sur leucocytes. Une activité enzymatique diminuée oriente fortement vers le diagnostic [3,14].
Mais attention, le diagnostic définitif nécessite une analyse génétique. Le séquençage du gène GAA permet d'identifier les mutations responsables et de confirmer le diagnostic [1,2]. Les nouvelles techniques de séquençage haut débit ont révolutionné cette approche diagnostique en 2024-2025.
D'autres examens peuvent être utiles selon le contexte. L'électromyographie révèle des signes de myopathie, tandis que la biopsie musculaire montre l'accumulation de glycogène dans les fibres musculaires [14]. L'échocardiographie est indispensable chez les nourrissons pour détecter l'hypertrophie cardiaque.
Le parcours diagnostic peut parfois être long, surtout pour les formes tardives. En moyenne, il faut compter 3 à 5 ans entre les premiers symptômes et le diagnostic définitif [15]. Heureusement, la sensibilisation des médecins permet de raccourcir ce délai.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de référence de la glycogénose de type II repose sur l'enzymothérapie substitutive (ERT). Deux médicaments sont actuellement disponibles : l'alglucosidase alfa (Myozyme®) et l'avalglucosidase alfa (Nexviazyme®) [6,7].
L'alglucosidase alfa, commercialisée depuis 2006, a révolutionné la prise en charge de cette pathologie. Elle se présente sous forme de perfusions intraveineuses administrées toutes les deux semaines à l'hôpital [17]. Ce traitement permet de ralentir la progression de la maladie et d'améliorer la fonction musculaire chez de nombreux patients.
Plus récemment, l'avalglucosidase alfa a été approuvée en 2021. Cette nouvelle enzyme recombinante présente une meilleure affinité pour les récepteurs cellulaires et pourrait offrir une efficacité supérieure [6,8]. Les études cliniques montrent des améliorations significatives de la fonction respiratoire et de la marche.
Cependant, l'enzymothérapie ne constitue qu'une partie du traitement. La prise en charge multidisciplinaire inclut la kinésithérapie, l'orthophonie pour les troubles de déglutition, et parfois la ventilation assistée pour les troubles respiratoires [3]. L'important à retenir, c'est que chaque patient nécessite un plan de soins personnalisé.
Bon à savoir : certains patients peuvent développer des anticorps contre l'enzyme de substitution, réduisant son efficacité. Un suivi immunologique régulier est donc nécessaire [7].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la recherche sur la glycogénose de type II. Plusieurs approches thérapeutiques innovantes sont en cours de développement, offrant de nouveaux espoirs aux patients [5,6].
La thérapie génique représente l'une des pistes les plus prometteuses. Des essais cliniques de phase I/II testent actuellement des vecteurs viraux pour délivrer le gène GAA fonctionnel directement dans les muscles [5]. Les premiers résultats suggèrent une amélioration durable de la fonction musculaire sans nécessiter de perfusions répétées.
D'ailleurs, les thérapies de commutation (switch therapy) font l'objet d'études approfondies en 2024. Ces approches permettent de passer d'un traitement enzymatique à un autre pour optimiser l'efficacité thérapeutique [8]. Les protocoles de commutation vers l'avalglucosidase alfa montrent des résultats encourageants chez les patients non-répondeurs.
Les chaperones pharmacologiques constituent une autre innovation majeure. Ces petites molécules aident l'enzyme déficiente à adopter sa conformation correcte, restaurant partiellement son activité [6]. Plusieurs candidats médicaments sont actuellement en phase d'essais cliniques.
En fait, la médecine personnalisée prend également son essor. Les analyses pharmacogénomiques permettent désormais d'adapter les doses d'enzymothérapie selon le profil génétique de chaque patient [5]. Cette approche pourrait considérablement améliorer l'efficacité des traitements existants.
Vivre au Quotidien avec Glycogénose de type II
Vivre avec une glycogénose de type II nécessite des adaptations importantes du mode de vie. La gestion de la fatigue constitue l'un des défis majeurs pour les patients atteints de la forme tardive [9].
L'activité physique adaptée joue un rôle crucial dans le maintien de la fonction musculaire. Contrairement aux idées reçues, l'exercice modéré et régulier peut être bénéfique. Les programmes de rééducation incluent généralement des exercices d'endurance douce, de renforcement musculaire et d'étirements [9].
Au niveau professionnel, de nombreux patients peuvent continuer à travailler avec des aménagements appropriés. L'ergothérapie aide à adapter le poste de travail et à identifier les aides techniques nécessaires. Certains patients bénéficient d'une reconnaissance de travailleur handicapé [17].
La vie sociale ne doit pas être négligée. Rejoindre une association de patients permet de partager son expérience et de bénéficier de conseils pratiques. L'AFM-Téléthon propose notamment un accompagnement personnalisé aux familles [17,18].
Côté alimentation, aucun régime spécifique n'est nécessaire, mais une nutrition équilibrée contribue au bien-être général. Certains patients rapportent une amélioration de leur énergie avec une alimentation riche en protéines et pauvre en sucres rapides.
Les Complications Possibles
La glycogénose de type II peut entraîner diverses complications selon la forme et l'évolution de la maladie. Dans la forme infantile, les complications cardiaques dominent le tableau clinique [12].
L'hypertrophie cardiaque massive peut provoquer une obstruction de la voie d'éjection du ventricule gauche, entraînant une insuffisance cardiaque sévère. Les troubles du rythme, notamment les extrasystoles ventriculaires, sont fréquents et peuvent nécessiter un traitement spécifique [12].
Pour la forme tardive, les complications respiratoires constituent la principale préoccupation. L'atteinte du diaphragme et des muscles intercostaux peut progressivement conduire à une insuffisance respiratoire [15]. Les apnées du sommeil sont particulièrement fréquentes et nécessitent souvent une ventilation nocturne.
Les troubles de la déglutition représentent une autre complication importante. Ils peuvent provoquer des fausses routes et augmenter le risque d'infections pulmonaires [9]. Une prise en charge orthophonique précoce est essentielle pour prévenir ces complications.
Certains patients développent également des complications orthopédiques. Les rétractions tendineuses et les déformations articulaires peuvent limiter la mobilité et nécessiter une prise en charge spécialisée [17]. Heureusement, la kinésithérapie régulière permet de prévenir ou de retarder ces complications.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la glycogénose de type II varie considérablement selon la forme de la maladie et la précocité de la prise en charge. La forme infantile classique présente historiquement un pronostic sombre, avec un décès survenant généralement avant l'âge de 2 ans en l'absence de traitement [12].
Heureusement, l'enzymothérapie substitutive a révolutionné le pronostic de la forme infantile. Les études récentes montrent une survie prolongée chez 70% des patients traités précocement, avec une amélioration significative de la fonction cardiaque [6,7].
Pour la forme tardive, le pronostic est généralement plus favorable. L'évolution est lente et progressive, s'étalant sur plusieurs décennies. Avec un traitement approprié, la plupart des patients conservent une autonomie satisfaisante pendant de nombreuses années [17].
Plusieurs facteurs influencent le pronostic. L'âge au début du traitement, le degré d'atteinte musculaire initial et la réponse à l'enzymothérapie constituent les principaux éléments prédictifs [8]. Les patients qui commencent le traitement avant l'apparition de l'insuffisance respiratoire ont généralement une meilleure évolution.
Il est important de noter que chaque patient évolue différemment. Certains répondent remarquablement bien au traitement, tandis que d'autres présentent une progression malgré la thérapie. Le suivi médical régulier permet d'adapter la prise en charge selon l'évolution individuelle [6].
Peut-on Prévenir Glycogénose de type II ?
La glycogénose de type II étant une maladie génétique héréditaire, la prévention primaire n'est pas possible au sens classique du terme. Cependant, plusieurs approches permettent de réduire les risques de transmission et d'améliorer la prise en charge [3].
Le conseil génétique constitue l'outil principal de prévention. Les familles ayant des antécédents de maladie de Pompe peuvent bénéficier d'une consultation spécialisée pour évaluer les risques de récurrence [17]. Cette démarche permet d'informer les couples sur les probabilités de transmission et les options disponibles.
Le diagnostic prénatal est possible dès la 10ème semaine de grossesse par biopsie de trophoblaste ou amniocentèse. L'analyse génétique permet de détecter les mutations responsables chez le fœtus [3]. Cette approche nécessite une réflexion approfondie et un accompagnement psychologique adapté.
D'ailleurs, le dépistage néonatal de la maladie de Pompe se développe dans plusieurs pays. Bien qu'il ne soit pas encore systématique en France, des programmes pilotes sont à l'étude [4]. Ce dépistage permettrait un diagnostic et un traitement précoces, améliorant considérablement le pronostic.
Pour les formes tardives, la prévention secondaire repose sur la détection précoce des symptômes. Une sensibilisation des médecins généralistes aux signes d'alerte permet de raccourcir le délai diagnostique et d'initier plus rapidement le traitement [15].
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 des recommandations actualisées pour la prise en charge de la glycogénose de type II. Ces guidelines intègrent les dernières avancées thérapeutiques et diagnostiques [3].
Le Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS) définit les modalités optimales de prise en charge. Il recommande une approche multidisciplinaire impliquant pneumologues, cardiologues, neurologues et kinésithérapeutes [3]. Cette coordination est essentielle pour assurer une prise en charge globale de qualité.
Concernant le diagnostic, la HAS préconise l'utilisation des techniques de séquençage haut débit pour l'analyse du gène GAA. Cette approche permet un diagnostic plus rapide et plus précis [1,2]. Les laboratoires de génétique moléculaire doivent respecter des critères de qualité stricts pour garantir la fiabilité des résultats.
Pour le traitement, les recommandations soulignent l'importance d'initier l'enzymothérapie dès que possible après le diagnostic. Le choix entre alglucosidase alfa et avalglucosidase alfa doit être individualisé selon le profil du patient [3]. Un suivi régulier est indispensable pour évaluer l'efficacité et adapter la posologie.
Le bulletin officiel de juin 2024 précise également les modalités de remboursement et d'accès aux traitements innovants [4]. Ces mesures garantissent un accès équitable aux thérapies pour tous les patients français.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations accompagnent les patients atteints de glycogénose de type II et leurs familles. L'AFM-Téléthon constitue la principale organisation de soutien en France [17].
L'AFM-Téléthon propose de nombreux services : information médicale actualisée, accompagnement social, aide aux démarches administratives et soutien psychologique. Leur site internet offre des fiches détaillées sur la maladie de Pompe et les dernières avancées de la recherche [17].
L'association VML (Vaincre les Maladies Lysosomales) se spécialise dans les maladies de surcharge lysosomale, incluant la glycogénose de type II [18]. Elle organise régulièrement des rencontres entre patients et des journées d'information médicale. Ces événements permettent d'échanger avec d'autres familles confrontées aux mêmes défis.
Au niveau international, l'International Pompe Association (IPA) fédère les associations nationales et coordonne les efforts de recherche. Elle publie régulièrement des newsletters informatives et organise des conférences scientifiques [18].
D'autres ressources utiles incluent les centres de référence des maladies neuromusculaires rares. Ces structures spécialisées offrent une expertise médicale de haut niveau et participent aux protocoles de recherche clinique. Ils constituent des interlocuteurs privilégiés pour les patients et leurs médecins traitants.
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec une glycogénose de type II nécessite quelques adaptations pratiques au quotidien. Voici nos recommandations basées sur l'expérience des patients et des professionnels de santé.
Organisez votre domicile pour limiter les efforts inutiles. Privilégiez les objets du quotidien à portée de main, installez des barres d'appui dans la salle de bain et envisagez un monte-escalier si nécessaire. Ces aménagements préservent votre énergie pour les activités importantes [17].
Planifiez vos activités en tenant compte de votre niveau de fatigue. Répartissez les tâches sur plusieurs jours plutôt que de tout faire en une fois. Écoutez votre corps et n'hésitez pas à faire des pauses régulières. Cette gestion de l'énergie vous permettra de maintenir une meilleure qualité de vie.
Maintenez une activité physique adaptée sous supervision médicale. La natation, la marche douce et les exercices de kinésithérapie sont généralement bien tolérés. Évitez les efforts intenses qui pourraient aggraver la faiblesse musculaire [9].
Constituez un dossier médical complet avec tous vos examens et traitements. Cette documentation facilitera vos consultations et sera précieuse en cas d'urgence. N'oubliez pas d'informer tous vos médecins de votre pathologie, y compris votre dentiste et votre pharmacien.
Rejoignez une association de patients pour bénéficier de conseils pratiques et de soutien moral. L'échange d'expériences avec d'autres personnes dans la même situation est souvent très enrichissant [18].
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous alerter et justifier une consultation médicale rapide, surtout si vous êtes atteint de glycogénose de type II ou si vous présentez des facteurs de risque familiaux.
Consultez rapidement en cas de faiblesse musculaire progressive, particulièrement si elle touche les muscles proximaux (hanches, épaules). Cette faiblesse peut se manifester par des difficultés à monter les escaliers, à se lever d'une chaise ou à porter des objets [15].
Les troubles respiratoires constituent un motif de consultation urgent. Essoufflement à l'effort, fatigue matinale, maux de tête au réveil ou somnolence diurne peuvent signaler une atteinte du diaphragme [9]. N'attendez pas que ces symptômes s'aggravent pour consulter.
Chez les nourrissons, plusieurs signes doivent alerter les parents : hypotonie marquée (bébé "mou"), difficultés d'alimentation, retard de croissance ou troubles cardiaques. Ces symptômes nécessitent une évaluation pédiatrique spécialisée en urgence [12].
Si vous avez des antécédents familiaux de maladie de Pompe, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Un conseil génétique peut être proposé, même en l'absence de symptômes. Cette démarche préventive permet d'anticiper d'éventuels problèmes [17].
En cas de doute, il vaut toujours mieux consulter. Un diagnostic précoce améliore considérablement le pronostic et permet d'initier rapidement un traitement adapté [3].
Questions Fréquentes
La glycogénose de type II est-elle héréditaire ?Oui, c'est une maladie génétique autosomique récessive. Les deux parents doivent être porteurs d'une mutation pour que l'enfant soit atteint [17].
Peut-on guérir de la maladie de Pompe ?
Il n'existe pas encore de guérison définitive, mais les traitements actuels permettent de ralentir l'évolution et d'améliorer la qualité de vie [6,7].
L'enzymothérapie est-elle efficace chez tous les patients ?
L'efficacité varie selon les patients. Environ 70% des patients montrent une amélioration ou une stabilisation de leurs symptômes [8].
Combien coûte le traitement ?
Les traitements sont entièrement pris en charge par l'Assurance Maladie dans le cadre de l'ALD (Affection de Longue Durée) [4].
Peut-on avoir des enfants quand on a la maladie de Pompe ?
Oui, mais un conseil génétique est recommandé pour évaluer les risques de transmission [3].
L'activité physique est-elle contre-indiquée ?
Non, une activité physique adaptée est même recommandée sous supervision médicale [9].
Existe-t-il des traitements naturels ?
Aucun traitement naturel n'a prouvé son efficacité. L'enzymothérapie reste le traitement de référence [17].
Questions Fréquentes
La glycogénose de type II est-elle héréditaire ?
Oui, c'est une maladie génétique autosomique récessive. Les deux parents doivent être porteurs d'une mutation pour que l'enfant soit atteint.
Peut-on guérir de la maladie de Pompe ?
Il n'existe pas encore de guérison définitive, mais les traitements actuels permettent de ralentir l'évolution et d'améliorer la qualité de vie.
L'enzymothérapie est-elle efficace chez tous les patients ?
L'efficacité varie selon les patients. Environ 70% des patients montrent une amélioration ou une stabilisation de leurs symptômes.
Combien coûte le traitement ?
Les traitements sont entièrement pris en charge par l'Assurance Maladie dans le cadre de l'ALD (Affection de Longue Durée).
Peut-on avoir des enfants quand on a la maladie de Pompe ?
Oui, mais un conseil génétique est recommandé pour évaluer les risques de transmission.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Séquençage haut débit ciblé des panels de gènes dans le diagnostic des cardiomyopathies héréditairesLien
- [2] Séquençage haut débit ciblé des panels de gènes dans le diagnostic des cardiomyopathies héréditairesLien
- [3] Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS) - Maladie de PompeLien
- [4] Bulletin officiel Santé - Solidarité n° 2024/12 du 4 juin 2024Lien
- [5] Glycogénoses musculaires - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [6] Management of Pompe disease alongside and beyond ERTLien
- [7] Glycogen Storage Disease Type IILien
- [8] Navigating Treatment Switch in Late-Onset Pompe DiseaseLien
- [9] Caractérisation des fonctions neuromusculaires, de la locomotion et du contrôle postural d'adultes atteints de Glycogénose de type IILien
- [10] Les glycogénoses de type I: A propos de 4 cas avec revue de la littératureLien
- [11] Thésaurismoses adultes et pédiatriques: maladies de surcharge lysosomale, surcharges lipidiques et glycogénosesLien
- [12] Maladie de Pompe Infantile Classique de Découverte Fortuite: A Propos d'un CasLien
- [13] Maladies héréditaires du métabolisme: les urgences que le pédiatre doit connaîtreLien
- [14] Élévation des enzymes musculaires chez l'enfantLien
- [15] Un diagnostic à couper le souffleLien
- [16] Glucogenosis tipo II en gemelos. Diagnóstico clínico y bioquímicoLien
- [17] Glycogénose musculaire de type II (maladie de Pompe)Lien
- [18] Pompe - Glycogénose type 2Lien
Publications scientifiques
- Caractérisation des fonctions neuromusculaires, de la locomotion et du contrôle postural d'adultes atteints de Glycogénose de type II (2023)
- Les glycogénoses de type I: A propos de 4 cas avec revue de la littérature (2025)
- Thésaurismoses adultes et pédiatriques: maladies de surcharge lysosomale, surcharges lipidiques et glycogénoses (2024)
- Maladie de Pompe Infantile Classique de Découverte Fortuite: A Propos d'un Cas (2024)
- [PDF][PDF] Maladies héréditaires du métabolisme: les urgences que le pédiatre doit connaître [PDF]
Ressources web
- Glycogénose musculaire de type II (maladie de Pompe) (afm-telethon.com)
20 juin 2022 — Elle débute avant l'âge de 20 ans, dans l'enfance ou à l'adolescence, par des symptômes avant tout musculaires (faiblesse des muscles du bassin, ...
- Pompe - Glycogénose type 2 (vml-asso.org)
Diagnostics et dépistages ? Le diagnostic est évoqué à partir des manifestations qui sont différentes en fonction de l'âge : atteintes cardiaques, respiratoires ...
- Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS) ... (has-sante.fr)
La maladie de Pompe (MP), également appelée glycogénose de type II, est une maladie de surcharge lysosomale à transmission autosomique récessive due à un dé ...
- La maladie de Pompe (orpha.net)
La maladie de Pompe (ou glycogénose de type 2, ou déficit en alpha glucosidase acide, ou déficit en maltase acide), est une maladie génétique héréditaire ...
- Maladies de surcharge glycogénique (glycogénoses) (msdmanuals.com)
Le diagnostic est confirmé par l'analyse de l'ADN ou, moins fréquemment, par la détection d'une diminution significative de l'activité enzymatique dans le foie ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
