Fièvre Hémorragique avec Syndrome Rénal : Guide Complet 2025 | Symptômes, Traitements
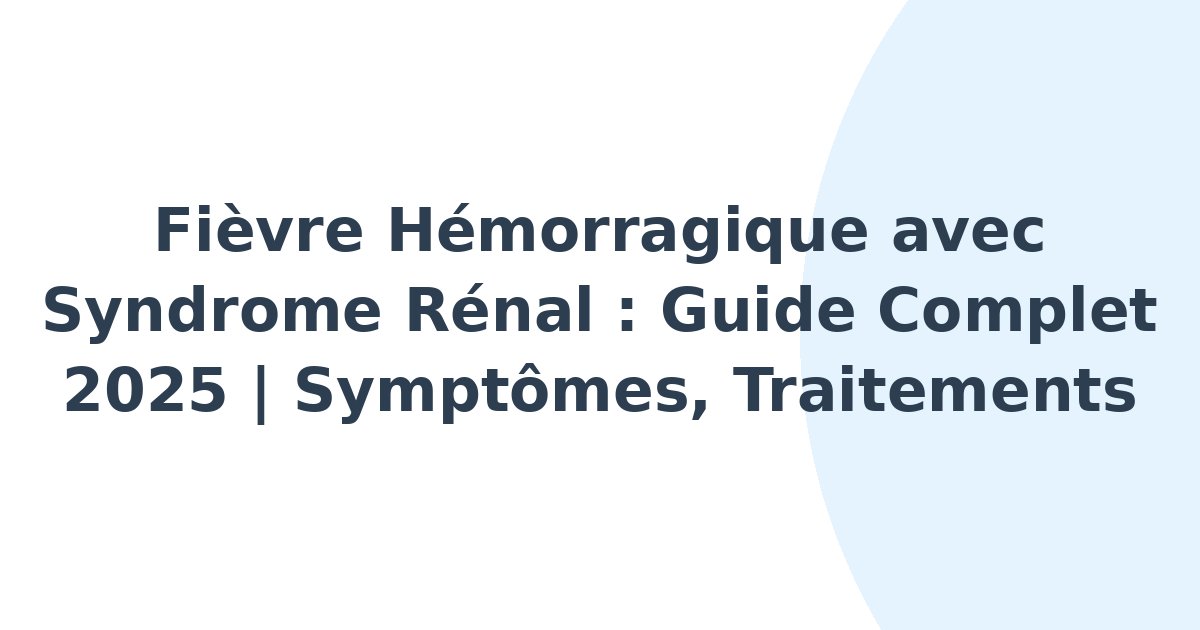
La fièvre hémorragique avec syndrome rénal (FHSR) est une maladie virale transmise par les rongeurs qui touche chaque année plusieurs centaines de personnes en France. Cette pathologie, causée principalement par l'hantavirus Puumala, se manifeste par une fièvre brutale accompagnée d'atteintes rénales et parfois hémorragiques. Bien que méconnue du grand public, elle représente un enjeu de santé publique croissant, notamment dans certaines régions forestières françaises.
Téléconsultation et Fièvre hémorragique avec syndrome rénal
Téléconsultation non recommandéeLa fièvre hémorragique avec syndrome rénal est une maladie virale grave nécessitant une hospitalisation immédiate et une surveillance médicale spécialisée. Le diagnostic repose sur des examens biologiques spécialisés et l'évolution peut être rapidement fatale sans prise en charge adaptée. La téléconsultation ne peut en aucun cas remplacer l'évaluation clinique et paraclinique indispensable.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil de l'anamnèse concernant l'exposition récente à des rongeurs ou leurs déjections, évaluation de la chronologie des symptômes fébriles et hémorragiques, analyse des facteurs de risque professionnels ou géographiques, orientation diagnostique préliminaire vers une structure spécialisée.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique complet pour rechercher les signes hémorragiques cutanéo-muqueux, évaluation de l'état hémodynamique et respiratoire, réalisation d'examens biologiques spécialisés (sérologie virale, numération plaquettaire, fonction rénale), surveillance en milieu hospitalier spécialisé.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Présence de signes hémorragiques visibles nécessitant une évaluation immédiate, syndrome fébrile aigu avec altération de l'état général, suspicion clinique de fièvre hémorragique virale, nécessité de réaliser des examens biologiques spécialisés en urgence.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Tout syndrome fébrile hémorragique aigu avec exposition aux rongeurs, détresse respiratoire ou hémodynamique associée, anurie ou oligurie sévère avec signes d'insuffisance rénale aiguë.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Fièvre élevée associée à des saignements spontanés (épistaxis, gingivorragies, pétéchies)
- Détresse respiratoire avec œdème pulmonaire aigu
- Choc hémorragique avec hypotension et tachycardie
- Anurie ou oligurie sévère avec signes d'insuffisance rénale aiguë
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Infectiologue — consultation en présentiel indispensable
La fièvre hémorragique avec syndrome rénal nécessite une prise en charge spécialisée en infectiologie avec hospitalisation immédiate. L'expertise infectiologique est indispensable pour le diagnostic différentiel, la confirmation virologique et la surveillance des complications potentiellement fatales.
Fièvre hémorragique avec syndrome rénal : Définition et Vue d'Ensemble
La fièvre hémorragique avec syndrome rénal appartient à la famille des maladies virales émergentes transmises par les rongeurs sauvages. Cette pathologie infectieuse se caractérise par une triade symptomatique associant fièvre élevée, atteinte rénale aiguë et manifestations hémorragiques variables [8].
En Europe, l'agent responsable est principalement l'hantavirus Puumala, porté par le campagnol roussâtre. Contrairement à d'autres formes d'hantavirus présentes en Asie ou en Amérique, la forme européenne présente généralement un pronostic plus favorable, avec un taux de mortalité inférieur à 1% [9].
Mais attention, cette maladie ne doit pas être prise à la légère. Les complications rénales peuvent parfois nécessiter une dialyse temporaire, et certains patients développent des séquelles à long terme. D'ailleurs, les innovations thérapeutiques récentes offrent de nouveaux espoirs de traitement [1,2].
L'important à retenir : cette pathologie touche principalement les personnes exposées professionnellement ou lors d'activités de loisir en milieu forestier. Les travailleurs forestiers, agriculteurs et randonneurs constituent les populations les plus à risque [6].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, la surveillance épidémiologique révèle une incidence annuelle d'environ 50 à 100 cas déclarés, mais les experts estiment que le nombre réel pourrait être 5 à 10 fois supérieur en raison des formes asymptomatiques ou mal diagnostiquées [8].
L'épidémie de 2021 dans le massif du Jura illustre parfaitement la dynamique de cette maladie. Cette année-là, plus de 40 cas ont été recensés dans cette seule région, représentant une augmentation de 300% par rapport aux années précédentes [3,4]. Cette flambée épidémique s'explique par des facteurs écologiques complexes liés à la prolifération des campagnols.
Géographiquement, certaines régions françaises sont particulièrement touchées. La Franche-Comté, l'Alsace, la Lorraine et les Ardennes concentrent près de 70% des cas nationaux [5]. Cette répartition géographique correspond aux zones de forte densité forestière où le campagnol roussâtre trouve des maladies optimales de développement.
Au niveau européen, la Finlande et la Suède enregistrent les incidences les plus élevées avec respectivement 1000 et 300 cas annuels. La Belgique et l'Allemagne présentent des profils épidémiologiques similaires à la France [9].
Concrètement, les données montrent une recrudescence cyclique tous les 3 à 4 ans, corrélée aux fluctuations des populations de rongeurs. Les projections pour 2025-2030 suggèrent une possible augmentation de l'incidence liée au réchauffement climatique et aux modifications des écosystèmes forestiers [5].
Les Causes et Facteurs de Risque
L'hantavirus Puumala constitue l'agent causal principal de la fièvre hémorragique avec syndrome rénal en Europe occidentale. Ce virus appartient à la famille des Bunyaviridae et présente une affinité particulière pour les cellules endothéliales des capillaires rénaux et pulmonaires [9].
La transmission s'effectue exclusivement par voie respiratoire, lors de l'inhalation d'aérosols contaminés par les excréments, l'urine ou la salive du campagnol roussâtre infecté. Contrairement aux idées reçues, il n'existe aucune transmission interhumaine documentée [8].
Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés par les études épidémiologiques récentes. L'exposition professionnelle concerne principalement les travailleurs forestiers, les bûcherons et les agents de l'ONF [6]. D'ailleurs, une étude de 2024 montre que ces professionnels présentent un risque 15 fois supérieur à la population générale.
Les activités de loisir représentent également un facteur de risque croissant. Le camping sauvage, la randonnée en forêt, le nettoyage de greniers ou de granges abandonnées exposent les particuliers au virus. La saisonnalité joue un rôle important : 80% des cas surviennent entre mai et octobre, période d'activité maximale des rongeurs [3,4].
Bon à savoir : certaines années, les maladies météorologiques favorables à la reproduction des campagnols (hivers doux, étés humides) augmentent significativement le risque d'exposition. C'est exactement ce qui s'est produit avant l'épidémie jurassienne de 2021 [5].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
La phase d'incubation de la fièvre hémorragique avec syndrome rénal varie généralement de 1 à 6 semaines après l'exposition. Cette période silencieuse peut parfois s'étendre jusqu'à 8 semaines, rendant difficile l'établissement du lien avec l'exposition initiale [9].
Les premiers symptômes ressemblent étrangement à ceux d'une grippe sévère. Vous pourriez ressentir une fièvre brutale dépassant souvent 39°C, accompagnée de frissons intenses, de maux de tête violents et de douleurs musculaires généralisées. Ces manifestations initiales durent typiquement 3 à 5 jours [8].
Mais c'est lors de la deuxième phase que la maladie révèle sa spécificité. L'atteinte rénale se manifeste par une diminution brutale de la production d'urine (oligurie), parfois jusqu'à l'arrêt complet (anurie). Parallèlement, vous pourriez observer un gonflement du visage et des membres inférieurs [9].
Les manifestations hémorragiques, bien que donnant son nom à la maladie, restent généralement modérées dans la forme européenne. Elles se limitent souvent à des saignements de nez, des ecchymoses spontanées ou des pétéchies cutanées. Les hémorragies massives demeurent exceptionnelles [8].
D'autres symptômes peuvent compléter ce tableau : troubles visuels temporaires, douleurs abdominales, nausées et vomissements. Certains patients décrivent également une sensation de soif intense et une fatigue extrême qui peut persister plusieurs semaines [3,4].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de la fièvre hémorragique avec syndrome rénal repose sur un faisceau d'arguments cliniques, biologiques et épidémiologiques. La première étape consiste à évoquer cette pathologie devant un tableau fébrile associé à une insuffisance rénale aiguë chez une personne exposée en milieu forestier [9].
Les examens biologiques révèlent des anomalies caractéristiques. L'analyse sanguine montre une élévation de la créatinine sérique, témoin de l'atteinte rénale, associée à une thrombopénie (diminution des plaquettes) et parfois une leucocytose. La protéinurie est constamment présente et peut être massive [8].
Concrètement, le diagnostic de certitude repose sur la sérologie spécifique. La recherche d'anticorps IgM et IgG dirigés contre l'hantavirus Puumala permet de confirmer l'infection. Ces anticorps apparaissent généralement dès les premiers jours de la maladie et persistent plusieurs mois .
Les innovations diagnostiques récentes incluent des tests rapides de détection antigénique et des techniques de PCR en temps réel. Ces nouveaux outils permettent un diagnostic plus précoce et une meilleure prise en charge thérapeutique . D'ailleurs, certains laboratoires proposent désormais des panels diagnostiques incluant plusieurs hantavirus.
L'imagerie médicale, bien que non spécifique, peut apporter des éléments utiles. L'échographie rénale montre souvent un gonflement des reins avec une hyperéchogénicité corticale. La radiographie thoracique peut révéler un œdème pulmonaire dans les formes sévères [9].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Actuellement, il n'existe pas de traitement antiviral spécifique contre l'hantavirus Puumala. La prise en charge repose donc sur un traitement symptomatique et de soutien, adapté à la sévérité des manifestations cliniques [8].
La gestion de l'insuffisance rénale aiguë constitue l'axe principal du traitement. Dans les formes modérées, une surveillance étroite de la fonction rénale et un équilibrage hydro-électrolytique suffisent souvent. Les patients doivent être hospitalisés pour une surveillance rapprochée de la diurèse et des paramètres biologiques [9].
Pour les formes sévères avec anurie prolongée, la dialyse peut s'avérer nécessaire. Heureusement, cette situation reste rare et la récupération de la fonction rénale est généralement complète. L'hémodialyse ou l'hémofiltration permettent d'éliminer les toxines urémiques en attendant la guérison spontanée [8].
Le traitement des manifestations hémorragiques fait appel aux mesures habituelles : transfusions plaquettaires si nécessaire, éviction des médicaments antiagrégants, surveillance des paramètres de coagulation. Mais rassurez-vous, les hémorragies graves demeurent exceptionnelles dans la forme européenne [9].
D'autres mesures de soutien complètent la prise en charge : antalgiques pour les douleurs, antiémétiques contre les nausées, repos au lit pendant la phase aiguë. L'important est de maintenir un équilibre hydrique optimal sans surcharger les reins défaillants [3,4].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les avancées récentes dans la recherche sur les hantavirus ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques prometteuses. Une étude majeure de 2024 démontre l'efficacité protectrice d'un vaccin inactivé contre l'infection à hantavirus, avec des résultats encourageants lors des essais cliniques de phase II [1].
Parallèlement, les recherches sur les mécanismes physiopathologiques révèlent des cibles thérapeutiques inédites. Une publication récente dans Nature Communications montre que l'infection par le virus Hantaan induit des modifications spécifiques de la muqueuse humaine, ouvrant la voie à de nouvelles stratégies d'intervention précoce [2].
Sur le plan diagnostique, la standardisation et validation de nouveaux tests représentent une avancée majeure. Les techniques d'évaluation comparative récemment développées permettent une détection plus rapide et plus fiable du virus, facilitant ainsi une prise en charge précoce .
Ces innovations s'inscrivent dans une démarche globale d'amélioration de la prise en charge. En effet, les retours d'expérience de l'épidémie jurassienne de 2021 ont permis d'optimiser les protocoles de soins, tant en milieu hospitalier qu'en ambulatoire [3,4].
L'important à retenir : bien que ces avancées soient prometteuses, elles nécessitent encore des validations complémentaires avant leur application clinique généralisée. Néanmoins, elles témoignent d'un intérêt croissant de la communauté scientifique pour cette pathologie émergente.
Vivre au Quotidien avec Fièvre hémorragique avec syndrome rénal
La convalescence après une fièvre hémorragique avec syndrome rénal nécessite patience et adaptation. La plupart des patients récupèrent complètement, mais cette guérison peut prendre plusieurs mois, particulièrement pour retrouver un niveau d'énergie normal [8].
Pendant la phase de récupération, vous pourriez ressentir une fatigue persistante qui peut durer 3 à 6 mois. Cette asthénie post-infectieuse est normale et ne doit pas vous inquiéter outre mesure. Il est important d'adapter votre rythme de vie et d'éviter les efforts physiques intenses pendant cette période [9].
La surveillance médicale régulière reste indispensable, même après la sortie d'hospitalisation. Des contrôles biologiques périodiques permettent de s'assurer de la normalisation progressive de la fonction rénale. Dans la grande majorité des cas, les reins récupèrent intégralement leur fonction [3,4].
Certains patients développent une hypertension artérielle transitoire qui peut nécessiter un traitement temporaire. Cette complication, généralement réversible, témoigne de la récupération progressive des structures rénales. Votre médecin adaptera la surveillance en fonction de votre évolution personnelle.
Sur le plan psychologique, il est normal de ressentir une certaine appréhension vis-à-vis des activités forestières. Un accompagnement peut parfois être utile pour retrouver confiance et reprendre progressivement vos activités habituelles. L'important est de ne pas vous isoler et de maintenir le lien avec vos proches [7].
Les Complications Possibles
Bien que la forme européenne de fièvre hémorragique avec syndrome rénal présente généralement un pronostic favorable, certaines complications peuvent survenir et nécessitent une surveillance attentive [9].
L'insuffisance rénale aiguë sévère représente la complication la plus fréquente et la plus préoccupante. Dans 10 à 15% des cas, elle nécessite le recours temporaire à la dialyse. Heureusement, cette situation reste généralement transitoire et la fonction rénale se normalise dans plus de 95% des cas [8].
Les complications cardiovasculaires incluent principalement l'hypertension artérielle et les troubles du rythme cardiaque. Ces manifestations résultent des déséquilibres électrolytiques et de la surcharge hydrique. Une surveillance cardiologique peut s'avérer nécessaire chez les patients présentant des antécédents cardiovasculaires [9].
Plus rarement, des complications neurologiques peuvent apparaître : céphalées persistantes, troubles visuels temporaires, voire convulsions dans les formes les plus sévères. Ces manifestations sont généralement réversibles mais nécessitent une prise en charge spécialisée [3,4].
Les séquelles à long terme demeurent exceptionnelles dans la forme européenne. Moins de 5% des patients conservent une insuffisance rénale chronique légère. La plupart récupèrent intégralement leur fonction rénale dans les 6 à 12 mois suivant l'infection [7].
Il est important de noter que les complications graves sont plus fréquentes chez les personnes âgées ou présentant des comorbidités. D'ailleurs, l'âge supérieur à 60 ans constitue un facteur de risque de complications reconnu [8].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la fièvre hémorragique avec syndrome rénal causée par l'hantavirus Puumala est généralement excellent, avec un taux de mortalité inférieur à 1% en Europe occidentale [9]. Cette donnée rassurante contraste nettement avec d'autres formes d'hantavirus présentes en Asie ou en Amérique.
La récupération complète constitue la règle dans plus de 95% des cas. La fonction rénale se normalise progressivement sur une période de 3 à 12 mois, sans laisser de séquelles significatives. Cette évolution favorable s'explique par le caractère généralement modéré de l'atteinte rénale dans la forme européenne [8].
Plusieurs facteurs influencent le pronostic. L'âge du patient joue un rôle déterminant : les personnes de moins de 40 ans récupèrent généralement plus rapidement et plus complètement. À l'inverse, les patients âgés de plus de 60 ans présentent un risque accru de complications et une convalescence plus prolongée [3,4].
La précocité du diagnostic et de la prise en charge améliore significativement le pronostic. Un traitement symptomatique adapté, initié rapidement, permet de prévenir les complications et d'accélérer la guérison. C'est pourquoi il est crucial de consulter rapidement en cas de symptômes évocateurs [7].
Bon à savoir : une fois guéri, vous développez une immunité durable contre l'hantavirus Puumala. Les cas de réinfection sont exceptionnels, ce qui constitue un élément rassurant pour les personnes professionnellement exposées [9].
Les données récentes de suivi à long terme confirment l'excellent pronostic de cette pathologie. Une étude portant sur les patients de l'épidémie jurassienne de 2021 montre que 98% d'entre eux ont récupéré une fonction rénale normale à deux ans [5].
Peut-on Prévenir Fièvre hémorragique avec syndrome rénal ?
La prévention de la fièvre hémorragique avec syndrome rénal repose essentiellement sur la réduction de l'exposition aux aérosols contaminés par les rongeurs infectés. Cette approche préventive s'avère d'autant plus importante qu'aucun vaccin n'est actuellement disponible en routine clinique [8].
Pour les professionnels exposés, des mesures de protection spécifiques sont recommandées. Le port d'un masque FFP2 ou FFP3 lors des travaux en milieu poussiéreux constitue la mesure la plus efficace. L'aération préalable des locaux fermés pendant au moins 30 minutes avant d'y pénétrer réduit significativement le risque [6].
Les activités de nettoyage nécessitent des précautions particulières. Évitez de balayer ou d'aspirer directement les déjections de rongeurs, car ces actions remettent en suspension les particules virales. Privilégiez l'humidification préalable avec une solution désinfectante, puis le nettoyage avec des lingettes jetables [8].
Pour les particuliers, certaines recommandations simples permettent de limiter l'exposition. Lors de randonnées en forêt, évitez de dormir à même le sol et utilisez des tentes fermées. Le camping sauvage dans des zones à forte densité de rongeurs doit être évité, particulièrement en automne [9].
La lutte contre les rongeurs autour des habitations constitue également une mesure préventive efficace. Éliminez les sources de nourriture accessibles (graines, fruits tombés), obturez les points d'entrée dans les bâtiments et maintenez une végétation rase autour des constructions [5].
D'ailleurs, les innovations récentes incluent le développement de répulsifs spécifiques et de pièges sélectifs qui pourraient améliorer la prévention dans les zones à risque [1]. Ces nouvelles approches font actuellement l'objet d'évaluations scientifiques rigoureuses.
Recommandations des Autorités de Santé
Le ministère de la Santé français a émis des recommandations spécifiques concernant la surveillance et la prévention de la fièvre hémorragique avec syndrome rénal, particulièrement après l'épidémie jurassienne de 2021 [8].
La déclaration obligatoire de cette maladie permet un suivi épidémiologique précis. Tout cas confirmé doit être signalé aux autorités sanitaires dans les 24 heures, facilitant ainsi la mise en place de mesures de prévention ciblées dans les zones à risque [3,4].
Santé publique France recommande une surveillance renforcée dans les régions forestières de l'Est de la France. Cette surveillance inclut le monitoring des populations de rongeurs et la sensibilisation des professionnels exposés. Des campagnes d'information sont régulièrement organisées auprès des travailleurs forestiers et des chasseurs [5].
Les recommandations professionnelles insistent sur l'importance de la formation des personnels de santé. La méconnaissance de cette pathologie peut retarder le diagnostic et compromettre la prise en charge. Des modules de formation continue sont proposés aux médecins généralistes des zones endémiques [7].
Au niveau européen, l'ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) coordonne la surveillance transfrontalière. Cette coopération permet d'anticiper les épidémies et de partager les bonnes pratiques entre pays membres [9].
L'important à retenir : ces recommandations évoluent régulièrement en fonction des nouvelles connaissances scientifiques et de l'évolution épidémiologique. Il est donc crucial de se tenir informé des dernières directives, particulièrement si vous exercez une profession à risque.
Ressources et Associations de Patients
Bien que la fièvre hémorragique avec syndrome rénal reste une maladie rare, plusieurs ressources peuvent vous accompagner dans votre parcours de soins et de récupération.
L'Association française des maladies rares (AFM-Téléthon) propose un accompagnement personnalisé pour les patients atteints de pathologies peu fréquentes. Leurs conseillers peuvent vous orienter vers les spécialistes compétents et vous informer sur vos droits sociaux [8].
Les centres de référence des maladies infectieuses rares, présents dans les CHU, constituent des ressources expertes. Ces centres disposent d'équipes pluridisciplinaires spécialisées dans la prise en charge des infections émergentes comme les hantavirus [9].
Sur le plan professionnel, les services de santé au travail peuvent vous accompagner dans votre retour à l'emploi. Ils évaluent les aménagements nécessaires et proposent des mesures de prévention adaptées à votre situation [6].
Les forums en ligne dédiés aux maladies infectieuses permettent d'échanger avec d'autres patients ayant vécu une expérience similaire. Ces espaces d'entraide, modérés par des professionnels de santé, offrent un soutien précieux pendant la convalescence.
N'hésitez pas à solliciter votre médecin traitant pour obtenir des informations complémentaires ou des contacts spécialisés. Il reste votre interlocuteur privilégié pour coordonner votre suivi médical et répondre à vos interrogations [7].
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre avec le risque ou les suites d'une fièvre hémorragique avec syndrome rénal, basés sur l'expérience clinique et les retours de patients.
Si vous travaillez en milieu forestier, constituez-vous une trousse de protection comprenant masques FFP2, gants jetables et solution désinfectante. Gardez toujours ces équipements à portée de main lors de vos interventions en milieu potentiellement contaminé [6].
Tenez un carnet d'exposition détaillant vos activités à risque : dates, lieux, nature des travaux effectués. Cette information s'avérera précieuse pour le médecin en cas de symptômes suspects. N'oubliez pas d'y noter également les mesures de protection utilisées [3,4].
Apprenez à reconnaître les signes d'alerte : fièvre élevée persistante, diminution de la quantité d'urine, gonflement du visage ou des jambes. En cas de doute, consultez rapidement plutôt que d'attendre. Un diagnostic précoce améliore significativement le pronostic [8].
Pendant la convalescence, respectez votre rythme et ne forcez pas la récupération. La fatigue post-infectieuse est normale et peut durer plusieurs mois. Organisez votre quotidien en conséquence et n'hésitez pas à demander de l'aide à vos proches [7].
Maintenez un suivi médical régulier même après guérison apparente. Les contrôles biologiques permettent de s'assurer de la normalisation complète de la fonction rénale. Cette surveillance est particulièrement importante les six premiers mois [9].
Quand Consulter un Médecin ?
Il est crucial de savoir quand consulter un médecin, car la précocité du diagnostic influence directement le pronostic de la fièvre hémorragique avec syndrome rénal [8].
Consultez en urgence si vous développez une fièvre élevée (>38,5°C) persistante plus de 48 heures, accompagnée d'une diminution notable de vos urines, après une exposition potentielle en milieu forestier dans les 6 semaines précédentes [9].
D'autres symptômes doivent vous alerter : maux de tête violents résistant aux antalgiques habituels, douleurs musculaires intenses, nausées et vomissements persistants, gonflement du visage ou des membres. Ces signes, isolés ou associés, justifient une consultation médicale rapide [3,4].
Si vous présentez des facteurs de risque (profession forestière, activités de plein air récentes, nettoyage de locaux poussiéreux), mentionnez-le systématiquement à votre médecin. Cette information orientera son diagnostic et accélérera la prise en charge [6].
Pendant la convalescence, consultez si vous observez une aggravation de votre état général, une réapparition de la fièvre, ou des troubles urinaires. Ces signes peuvent témoigner de complications nécessitant une prise en charge spécialisée [7].
N'hésitez jamais à contacter votre médecin en cas de doute. Cette pathologie étant rare, il est normal que vous vous posiez des questions. Votre médecin traitant reste votre meilleur interlocuteur pour évaluer votre situation et vous rassurer [8].
Questions Fréquentes
Peut-on attraper la maladie plusieurs fois ?
Non, une fois guéri, vous développez une immunité durable contre l'hantavirus Puumala. Les cas de réinfection sont exceptionnels.
La maladie est-elle contagieuse entre humains ?
Absolument pas. Il n'existe aucune transmission interhumaine documentée. Vous ne risquez pas de contaminer vos proches.
Combien de temps dure la convalescence ?
La récupération complète prend généralement 3 à 6 mois. La fatigue peut persister plus longtemps, mais elle s'améliore progressivement.
Y a-t-il des séquelles à long terme ?
Les séquelles sont exceptionnelles (<5% des cas). La plupart des patients récupèrent intégralement leur fonction rénale.
Le vaccin sera-t-il bientôt disponible ?
Des essais cliniques sont en cours, mais aucun vaccin n'est encore commercialisé. Les résultats préliminaires sont encourageants.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] The protective efficacy of inactivated vaccine against hantavirus infectionLien
- [2] Hantaan virus infection induces human mucosal changesLien
- [3] Standardization, validation, and comparative evaluation of diagnostic testsLien
- [4] Description de l'épidémie de fièvre hémorragique avec syndrome rénal dans le sud du massif jurassien en 2021: place de la prise en charge hospitalièreLien
- [5] Description de l'épidémie de fièvre hémorragique avec syndrome rénal dans le massif du Jura en 2021, et place de la prise en charge ambulatoireLien
- [6] Pics épidémiques de fièvre hémorragique à syndrome rénal et stabilité historique des foyersLien
- [9] Évaluation de l'exposition des travailleurs forestiers à l'hantavirus PuumalaLien
- [11] Néphropathie à Hantavirus: premier cas Auvergnat autochtoneLien
- [12] Hantavirus et fièvre hémorragique à syndrome rénal (FHSR)Lien
- [13] Infection à hantavirus - Maladies infectieusesLien
Publications scientifiques
- Description de l'épidémie de fièvre hémorragique avec syndrome rénal dans le sud du massif jurassien en 2021: place de la prise en charge hospitalière (2023)
- Description de l'épidémie de fièvre hémorragique avec syndrome rénal dans le massif du Jura en 2021, et place de la prise en charge ambulatoire (2023)
- Pics épidémiques de fièvre hémorragique à syndrome rénal et stabilité historique des foyers: les connaissances écologiques sont encore insuffisantes pour les … (2022)1 citations[PDF]
- Les orthohantavirus du nouveau monde (2023)2 citations
- Étude épidémiologique de la fièvre hémorragique de Crimée Congo (2023)[PDF]
Ressources web
- Hantavirus et fièvre hémorragique à syndrome rénal (FHSR) (sante.gouv.fr)
2 sept. 2012 — La maladie débute souvent par des symptômes ressemblant à ceux de la grippe : fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, douleurs abdominales ...
- Infection à hantavirus - Maladies infectieuses (msdmanuals.com)
18 févr. 2023 — La fièvre hémorragique avec syndrome rénal symptomatique évolue en cinq phases: fébrile, hypotensive, oligurique, polyurique et convalescente ( ...
- Fièvre hémorragique avec syndrome rénal (fr.wikipedia.org)
la phase diurétique : elle est caractérisée par diurèse de trois à six litres par jour, qui peut durer de quelques jours jusqu'à plusieurs semaines ;
- Infection à hantavirus (msdmanuals.com)
Chez certains patients atteints de fièvre hémorragique avec syndrome rénal, l'infection est modérée et asymptomatique. Chez d'autres, de vagues symptômes (tels ...
- Rapport FHSR(fievre hem) (santepubliquefrance.fr)
La fièvre hémorragique avec syndrome rénal est une infection virale se manifestant sous la forme d'un syndrome grippal algique accompagné de signes ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
