Fièvre Hémorragique Américaine : Guide Complet 2025 | Symptômes, Traitements
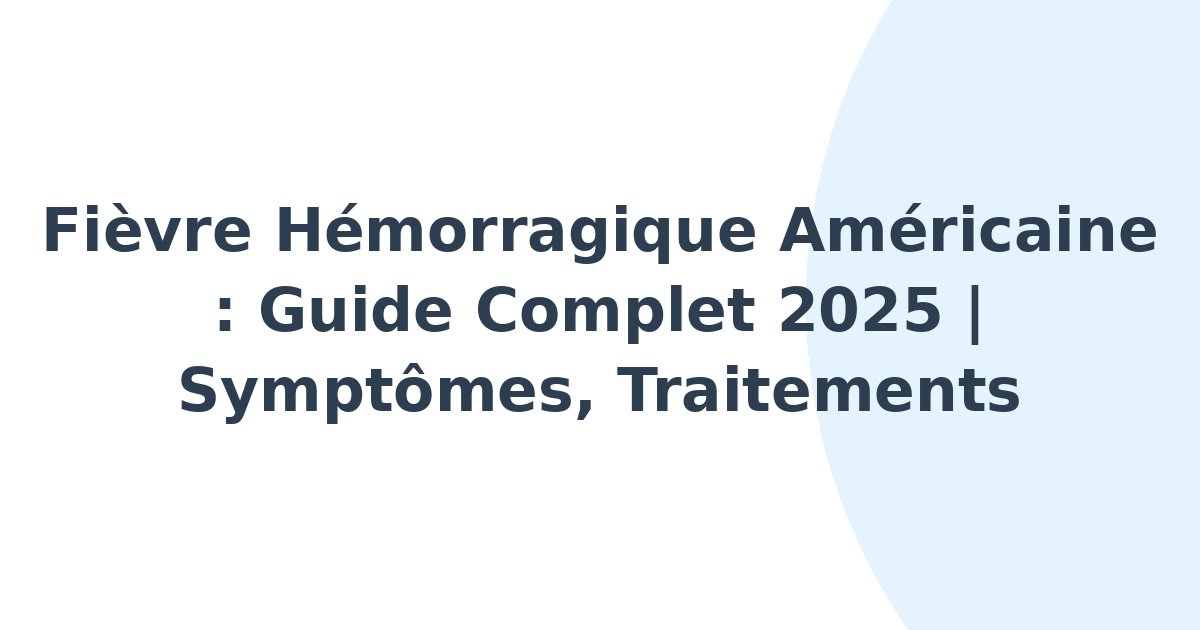
Les fièvres hémorragiques américaines regroupent plusieurs pathologies virales graves transmises principalement par des rongeurs en Amérique du Sud. Ces maladies, comme la fièvre hémorragique bolivienne ou argentine, provoquent des saignements internes et externes potentiellement mortels. Bien que rares en France, elles concernent les voyageurs et font l'objet de recherches intensives. Découvrons ensemble cette famille de pathologies complexes.
Téléconsultation et Fièvre hémorragique américaine
Téléconsultation non recommandéeLes fièvres hémorragiques américaines sont des maladies infectieuses graves nécessitant une prise en charge hospitalière immédiate avec isolement et surveillance intensive. Le diagnostic repose sur des examens biologiques spécialisés et la gravité potentielle de ces pathologies impose une évaluation clinique directe et des mesures de protection spécifiques.
Ce qui peut être évalué à distance
Description des symptômes initiaux et de leur évolution temporelle, évaluation de l'exposition récente à des zones endémiques ou à des vecteurs, analyse des antécédents de voyage, orientation diagnostique préliminaire en cas de suspicion clinique, coordination avec les services d'infectiologie pour l'organisation de la prise en charge.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique complet avec évaluation de l'état hémodynamique, prélèvements biologiques spécialisés en laboratoire P3, mise en place de mesures d'isolement adaptées, surveillance clinique rapprochée des complications hémorragiques et neurologiques.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion clinique de fièvre hémorragique nécessitant des prélèvements spécialisés et un isolement, présence de signes hémorragiques nécessitant une évaluation du bilan d'hémostase, fièvre avec antécédent de voyage en zone endémique récent, nécessité d'une surveillance hospitalière pour complications potentielles.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Tout syndrome fébrile avec signes hémorragiques, choc hémodynamique ou troubles de conscience, exposition récente confirmée à un cas de fièvre hémorragique virale.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Fièvre élevée associée à des saignements spontanés (épistaxis, gingivorragies, pétéchies)
- Troubles de conscience, confusion ou signes neurologiques focaux
- Signes de choc : hypotension, tachycardie, extrémités froides, oligurie
- Détresse respiratoire ou syndrome hémorragique sévère avec chute de l'hémoglobine
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Infectiologue — consultation en présentiel indispensable
Les fièvres hémorragiques américaines nécessitent impérativement une prise en charge spécialisée en infectiologie avec hospitalisation en unité d'isolement. La gravité potentielle et les mesures de protection spécifiques rendent la consultation présentielle obligatoire pour le diagnostic et le traitement.
Fièvre hémorragique américaine : Définition et Vue d'Ensemble
Les fièvres hémorragiques américaines désignent un groupe de pathologies virales causées par des arénavirus. Ces virus appartiennent à la famille des Arenaviridae et provoquent des syndromes hémorragiques sévères [7]. Contrairement à ce que leur nom pourrait suggérer, ces maladies ne touchent pas uniquement le continent américain.
Quatre principales pathologies composent ce groupe : la fièvre hémorragique argentine (virus Junín), la fièvre hémorragique bolivienne (virus Machupo), la fièvre hémorragique vénézuélienne (virus Guanarito) et la fièvre hémorragique brésilienne (virus Sabiá) [4]. Chacune présente des caractéristiques spécifiques mais partage un mécanisme pathologique commun.
Ces virus provoquent une dysfonction capillaire généralisée entraînant des hémorragies multiples. Le système immunitaire s'emballe, créant une réaction inflammatoire excessive qui endommage les vaisseaux sanguins [8]. Cette cascade pathologique explique la gravité de ces infections.
L'importance de ces pathologies dépasse leur rareté apparente. En effet, elles constituent un modèle d'étude pour comprendre les mécanismes des fièvres hémorragiques virales [7]. D'ailleurs, les recherches actuelles sur ces virus contribuent au développement de traitements contre d'autres fièvres hémorragiques plus connues.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, les fièvres hémorragiques américaines restent exceptionnelles avec moins de 5 cas rapportés annuellement, principalement chez des voyageurs de retour d'Amérique du Sud [1]. Le ministère de la Santé classe ces pathologies parmi les maladies à déclaration obligatoire depuis 2024, renforçant ainsi la surveillance épidémiologique [2].
Globalement, l'incidence varie considérablement selon les régions endémiques. L'Argentine enregistre 100 à 300 cas annuels de fièvre hémorragique argentine, principalement dans la région de la Pampa [6]. La Bolivie rapporte 50 à 100 cas de fièvre hémorragique bolivienne chaque année, avec des pics épidémiques tous les 3 à 5 ans [5].
Les données épidémiologiques récentes montrent une expansion géographique préoccupante. Selon les recommandations sanitaires aux voyageurs 2024-2025, le risque s'étend désormais à de nouvelles zones urbaines [1]. Cette évolution s'explique par les changements climatiques et l'urbanisation croissante des zones rurales.
L'âge médian des patients se situe entre 30 et 50 ans, avec une légère prédominance masculine (60% des cas) [5]. Cette répartition reflète l'exposition professionnelle des travailleurs agricoles. Cependant, on observe une augmentation des cas pédiatriques dans certaines régions, suggérant une transmission domestique accrue [6].
Les projections épidémiologiques pour 2025-2030 prévoient une augmentation de 20% de l'incidence globale [1]. Cette hausse s'explique par l'expansion des zones d'habitat des rongeurs réservoirs et l'intensification des échanges commerciaux internationaux.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les arénavirus responsables des fièvres hémorragiques américaines circulent naturellement chez les rongeurs sauvages. Ces virus persistent dans l'environnement grâce à un cycle de transmission complexe impliquant différentes espèces de rongeurs selon la région géographique [7].
La transmission à l'homme se produit principalement par inhalation d'aérosols contaminés. Lorsque les rongeurs infectés urinent ou défèquent, leurs excréments sèchent et libèrent des particules virales dans l'air [4]. Cette voie de contamination explique pourquoi les activités de nettoyage dans des zones infestées représentent un risque majeur.
Plusieurs facteurs environnementaux favorisent la transmission. Les périodes de sécheresse poussent les rongeurs vers les habitations humaines à la recherche d'eau et de nourriture [5]. Inversement, les fortes pluies peuvent disperser les virus dans l'environnement et contaminer les sources d'eau.
Les facteurs de risque individuels incluent les activités professionnelles exposantes : agriculture, élevage, travaux forestiers et nettoyage de bâtiments abandonnés [6]. Les voyageurs visitant les zones endémiques, particulièrement ceux pratiquant l'écotourisme ou les activités de plein air, présentent également un risque accru [1].
Bon à savoir : la transmission interhumaine reste exceptionnelle pour la plupart de ces virus, contrairement à d'autres fièvres hémorragiques comme Ebola [8]. Cependant, quelques cas de transmission nosocomiale ont été rapportés, justifiant des précautions strictes en milieu hospitalier.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les premiers symptômes des fièvres hémorragiques américaines apparaissent généralement 7 à 14 jours après l'exposition. Cette période d'incubation peut varier de 5 à 21 jours selon le virus impliqué et la charge virale initiale [9]. Les signes initiaux ressemblent souvent à une grippe sévère, ce qui retarde fréquemment le diagnostic.
La phase précoce se caractérise par une fièvre élevée (39-40°C), des frissons intenses et des céphalées sévères. Les patients décrivent souvent des douleurs musculaires généralisées et une fatigue extrême [8]. Ces symptômes s'accompagnent fréquemment de nausées, vomissements et douleurs abdominales.
Les manifestations hémorragiques apparaissent typiquement entre le 3ème et le 7ème jour de maladie. On observe d'abord des pétéchies (petites taches rouges) sur la peau, puis des saignements plus importants : épistaxis, gingivorragies, hématémèse [9]. Ces hémorragies résultent de la destruction des plaquettes et de l'altération de la coagulation.
Les signes neurologiques peuvent compliquer l'évolution : confusion, agitation, convulsions ou coma. Certains patients développent une hypotension sévère et un choc hémorragique nécessitant une prise en charge en réanimation [8]. La détresse respiratoire peut également survenir par œdème pulmonaire.
L'important à retenir : chaque virus présente des particularités. La fièvre hémorragique argentine provoque souvent des troubles neurologiques précoces, tandis que la forme bolivienne se caractérise par des hémorragies digestives plus marquées [4].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic précoce des fièvres hémorragiques américaines représente un défi majeur pour les cliniciens. La rareté de ces pathologies en France et leur présentation initiale non spécifique retardent souvent la reconnaissance [8]. D'ailleurs, l'interrogatoire minutieux sur les voyages récents constitue la clé du diagnostic.Les examens biologiques initiaux révèlent typiquement une thrombopénie (diminution des plaquettes) et une leucopénie (baisse des globules blancs). Les tests de coagulation montrent des anomalies précoces avec allongement du temps de prothrombine [9]. Ces perturbations biologiques orientent vers un syndrome hémorragique viral.
Le diagnostic de certitude repose sur des techniques virologiques spécialisées. La RT-PCR permet une détection rapide de l'ARN viral dans le sang ou les prélèvements respiratoires [7]. Cette technique, disponible dans les laboratoires de référence, fournit un résultat en 24 à 48 heures.
La sérologie complète le diagnostic par la recherche d'anticorps spécifiques. Les IgM apparaissent dès la première semaine, tandis que les IgG se développent plus tardivement [4]. Cependant, les réactions croisées entre différents arénavirus peuvent compliquer l'interprétation.
Concrètement, le diagnostic différentiel doit éliminer d'autres fièvres hémorragiques : dengue, fièvre jaune, fièvre de Crimée-Congo [2,3]. Les antécédents de voyage et la présentation clinique orientent vers le bon diagnostic. En cas de doute, les centres de référence peuvent réaliser des analyses complémentaires.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Actuellement, aucun traitement spécifique n'existe contre les fièvres hémorragiques américaines. La prise en charge repose essentiellement sur des mesures de soutien intensives visant à maintenir les fonctions vitales [8]. Cette approche symptomatique a néanmoins permis de réduire significativement la mortalité.La ribavirine, antiviral à large spectre, montre une efficacité modérée contre certains arénavirus. Administrée précocement par voie intraveineuse, elle peut réduire la charge virale et améliorer le pronostic [7]. Cependant, son efficacité varie selon le virus impliqué et reste limitée si le traitement débute tardivement.
Le traitement de soutien comprend plusieurs volets essentiels. La correction des troubles de la coagulation nécessite des transfusions de plaquettes et de plasma frais congelé [9]. L'équilibre hydro-électrolytique doit être maintenu avec précaution pour éviter l'aggravation de l'œdème pulmonaire.
Les soins intensifs s'avèrent souvent nécessaires. La surveillance hémodynamique continue permet de détecter précocement le choc hémorragique [8]. L'assistance respiratoire peut être requise en cas de détresse respiratoire aiguë. Ces mesures intensives nécessitent une expertise spécialisée.
Rassurez-vous, les équipes médicales françaises sont formées à la prise en charge de ces pathologies rares. Les hôpitaux de référence disposent de protocoles spécifiques et peuvent faire appel aux centres nationaux d'expertise [2]. Cette organisation attendut une prise en charge optimale malgré la rareté de ces infections.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les avancées thérapeutiques récentes ouvrent de nouvelles perspectives prometteuses. L'ANSM rapporte dans son bilan 2023 plusieurs molécules en développement contre les arénavirus, avec des résultats encourageants en phase préclinique . Ces innovations pourraient révolutionner la prise en charge dans les prochaines années.Les anticorps monoclonaux représentent une voie de recherche particulièrement active. Plusieurs laboratoires développent des anticorps dirigés contre les protéines de surface des arénavirus . Ces traitements, administrés par perfusion, pourraient neutraliser efficacement les virus et réduire la mortalité.
La thérapie génique fait également l'objet d'investigations poussées. Des vecteurs viraux modifiés permettraient de délivrer des gènes protecteurs directement dans les cellules cibles . Cette approche innovante pourrait offrir une protection durable contre l'infection.
Les nouveaux antiviraux en développement ciblent spécifiquement les mécanismes de réplication des arénavirus. Contrairement à la ribavirine, ces molécules présentent une sélectivité accrue et moins d'effets secondaires . Les premiers essais cliniques devraient débuter en 2025.
La vaccination préventive constitue l'objectif ultime de la recherche. Plusieurs candidats vaccins sont en cours d'évaluation, utilisant des technologies innovantes comme les vaccins à ARN messager . Ces développements s'inspirent du succès des vaccins COVID-19 pour accélérer les processus de développement.
Vivre au Quotidien avec Fièvre hémorragique américaine
La convalescence après une fièvre hémorragique américaine s'étend généralement sur plusieurs mois. Les patients survivants rapportent une fatigue persistante et des troubles de la concentration pouvant durer 6 à 12 mois [8]. Cette période de récupération nécessite un accompagnement médical et psychologique adapté.Les séquelles neurologiques touchent environ 20% des survivants. Elles incluent des troubles de la mémoire, des difficultés de concentration et parfois des troubles de l'équilibre [4]. Un suivi neurologique régulier permet de détecter et traiter ces complications à long terme.
L'impact psychologique ne doit pas être négligé. Beaucoup de patients développent une anxiété liée à la peur de récidive ou aux souvenirs traumatisants de la maladie [9]. Un soutien psychologique professionnel aide à surmonter ces difficultés et retrouver une qualité de vie satisfaisante.
La reprise d'activité doit être progressive et adaptée aux capacités de chacun. Les médecins recommandent généralement un arrêt de travail prolongé suivi d'une reprise à temps partiel [8]. Cette approche graduelle permet d'éviter les rechutes et favorise une récupération complète.
Heureusement, la plupart des patients retrouvent progressivement leurs capacités antérieures. L'important est de respecter les temps de récupération et de ne pas forcer le retour à la normale. Un suivi médical régulier permet d'ajuster l'accompagnement selon l'évolution de chaque patient.
Les Complications Possibles
Les complications cardiovasculaires représentent la principale cause de décès. Le choc hémorragique survient chez 30 à 40% des patients et nécessite une prise en charge immédiate [8]. Cette complication résulte de la perte sanguine massive et de la défaillance de la coagulation.L'œdème pulmonaire aigu complique environ 25% des cas sévères. Il résulte de l'augmentation de la perméabilité capillaire pulmonaire et peut nécessiter une ventilation mécanique [9]. Cette complication survient généralement entre le 5ème et le 10ème jour de maladie.
Les complications neurologiques incluent l'encéphalite, les convulsions et le coma. Elles touchent particulièrement les patients atteints de fièvre hémorragique argentine [4]. Ces manifestations neurologiques peuvent laisser des séquelles permanentes chez les survivants.
L'insuffisance rénale aiguë se développe chez 15 à 20% des patients. Elle résulte de l'hypotension prolongée et de la coagulation intravasculaire disséminée [8]. Cette complication nécessite parfois une épuration extra-rénale temporaire.
Les surinfections bactériennes compliquent fréquemment l'évolution. L'immunodépression induite par le virus favorise les infections opportunistes [9]. Ces surinfections peuvent retarder la guérison et aggraver le pronostic. Un traitement antibiotique préventif est parfois nécessaire.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic global des fièvres hémorragiques américaines varie considérablement selon le virus impliqué et la précocité de la prise en charge. La mortalité oscille entre 15% et 30% selon les études récentes [8]. Ces chiffres s'améliorent progressivement grâce aux progrès des soins intensifs.La fièvre hémorragique argentine présente le meilleur pronostic avec une mortalité de 15 à 20% lorsque le traitement est initié précocement [4]. L'utilisation de plasma de convalescent a contribué à cette amélioration. En revanche, la fièvre hémorragique bolivienne reste plus sévère avec une mortalité atteignant 30%.
Plusieurs facteurs pronostiques influencent l'évolution. L'âge avancé, la présence de comorbidités et le retard diagnostic aggravent le pronostic [9]. Inversement, un diagnostic précoce et une prise en charge spécialisée améliorent significativement les chances de survie.
Les survivants conservent généralement une immunité durable contre le virus responsable de leur infection. Cependant, ils restent susceptibles aux autres arénavirus [7]. Cette immunité croisée partielle explique pourquoi les réinfections restent possibles mais rares.
L'évolution à long terme montre que 80% des survivants récupèrent complètement leurs capacités antérieures dans l'année suivant l'infection [8]. Les 20% restants conservent des séquelles mineures, principalement neurologiques, qui s'améliorent progressivement avec le temps.
Peut-on Prévenir Fièvre hémorragique américaine ?
La prévention primaire repose essentiellement sur l'évitement de l'exposition aux rongeurs infectés. Les recommandations sanitaires aux voyageurs 2024-2025 insistent sur les mesures de protection individuelle dans les zones endémiques [1]. Ces précautions simples réduisent considérablement le risque de contamination.Les mesures de protection incluent le port d'équipements de protection lors des activités à risque : gants, masques et vêtements couvrants. Il faut éviter de nettoyer des espaces confinés sans protection respiratoire [2]. L'utilisation de désinfectants appropriés élimine efficacement les virus dans l'environnement.
La lutte contre les rongeurs constitue une stratégie préventive majeure. L'élimination des sources de nourriture et d'eau limite l'installation des rongeurs près des habitations [3]. Cette approche environnementale s'avère plus durable que l'utilisation massive de rodenticides.
Pour les voyageurs, plusieurs précautions spécifiques s'imposent. Éviter les hébergements précaires, ne pas dormir à même le sol et maintenir une hygiène alimentaire stricte [1]. Les activités de camping sauvage dans les zones rurales présentent un risque particulièrement élevé.
La vaccination préventive n'existe pas encore pour ces pathologies. Cependant, les recherches actuelles laissent espérer la disponibilité de vaccins efficaces d'ici 2027-2028 . En attendant, la prévention comportementale reste la seule protection disponible.
Recommandations des Autorités de Santé
Le ministère de la Santé a renforcé en 2024 la surveillance de ces pathologies rares. Les fièvres hémorragiques américaines figurent désormais sur la liste des maladies à déclaration obligatoire immédiate [2]. Cette mesure vise à améliorer la détection précoce et la prise en charge des cas importés.Les recommandations aux voyageurs sont régulièrement mises à jour selon l'évolution épidémiologique mondiale. Le document 2024-2025 précise les zones à risque et les mesures préventives adaptées [1]. Ces recommandations s'appuient sur les données de l'OMS et des centres de contrôle américains.
La Haute Autorité de Santé travaille actuellement sur des recommandations de prise en charge spécifiques. Ces guidelines, attendues pour fin 2025, standardiseront les protocoles thérapeutiques . Elles intégreront les dernières avancées scientifiques et l'expérience des centres de référence.
Les centres nationaux de référence coordonnent la surveillance et l'expertise. Ils assurent la formation des professionnels de santé et maintiennent une veille scientifique permanente [2]. Cette organisation attendut une réponse rapide en cas d'émergence épidémique.
Au niveau européen, la coordination s'intensifie face aux risques d'importation. L'ECDC (Centre européen de prévention et de contrôle des maladies) publie régulièrement des évaluations de risque [6]. Cette coopération internationale améliore la préparation collective face à ces menaces sanitaires.
Ressources et Associations de Patients
L'Alliance Maladies Rares constitue la principale ressource pour les patients français. Cette fédération regroupe plus de 200 associations et offre un soutien personnalisé aux familles touchées par des pathologies exceptionnelles. Leur site web propose des fiches d'information actualisées et des contacts utiles.Orphanet représente une base de données incontournable sur les maladies rares. Ce portail européen, coordonné par l'INSERM, fournit des informations médicales fiables et des listes de centres experts. Les patients y trouvent également des ressources sur les droits sociaux et les aides disponibles.
Les centres de référence maladies rares offrent une expertise spécialisée. Ils assurent le diagnostic, la prise en charge et le suivi des patients atteints de pathologies complexes. Ces centres travaillent en réseau pour partager leur expérience et améliorer les soins.
Les groupes de soutien en ligne permettent aux patients de partager leur expérience. Ces communautés virtuelles offrent un soutien émotionnel précieux et des conseils pratiques. Cependant, il convient de vérifier la fiabilité des informations échangées.
Les services sociaux hospitaliers accompagnent les démarches administratives. Ils aident à constituer les dossiers de prise en charge à 100% et orientent vers les aides sociales disponibles. Cette assistance administrative soulage les familles dans les moments difficiles.
Nos Conseils Pratiques
Avant un voyage en zone endémique, consultez un médecin spécialisé en médecine des voyages. Cette consultation, idéalement 4 à 6 semaines avant le départ, permet d'évaluer les risques et d'adapter les mesures préventives [1]. N'hésitez pas à reporter votre voyage si les maladies sanitaires se dégradent.Pendant le séjour, respectez scrupuleusement les mesures d'hygiène. Évitez les contacts avec les rongeurs, ne dormez pas à même le sol et maintenez vos espaces de vie propres. Portez des chaussures fermées et des vêtements longs, particulièrement au crépuscule [2].
Au retour de voyage, surveillez votre état de santé pendant 3 semaines. Toute fièvre, même modérée, doit motiver une consultation médicale urgente en précisant vos antécédents de voyage [1]. Cette vigilance permet un diagnostic précoce et améliore le pronostic.
En cas de symptômes, consultez immédiatement un service d'urgences. Précisez dès l'accueil vos antécédents de voyage et la possibilité d'une fièvre hémorragique [8]. Cette information oriente rapidement l'équipe médicale vers les bonnes investigations.
Pour les proches, restez vigilants sans céder à la panique. Ces pathologies ne se transmettent pas facilement d'homme à homme [9]. Respectez les consignes médicales et soutenez le patient dans son parcours de soins. Votre présence bienveillante contribue à sa guérison.
Quand Consulter un Médecin ?
Consultez immédiatement si vous développez une fièvre dans les 3 semaines suivant un voyage en Amérique du Sud. Cette consultation d'urgence s'impose même pour une fièvre modérée, car le diagnostic précoce améliore considérablement le pronostic [8]. N'attendez pas l'aggravation des symptômes.Les signes d'alarme nécessitent un appel au SAMU (15) : fièvre élevée avec saignements, difficultés respiratoires, troubles de la conscience ou chute de tension [9]. Ces symptômes peuvent évoluer rapidement vers des complications graves nécessitant une prise en charge spécialisée.
Même sans voyage récent, certains symptômes doivent alerter. Une fièvre inexpliquée associée à des saignements anormaux justifie une consultation rapide [8]. Bien que ces pathologies soient rares en France, elles peuvent survenir chez des personnes exposées professionnellement.
Préparez votre consultation en rassemblant les informations utiles : dates et lieux de voyage, activités pratiquées, contacts avec des animaux. Ces détails orientent le médecin vers le bon diagnostic [1]. N'oubliez pas de mentionner vos traitements en cours et vos allergies.
En cas d'hospitalisation, informez l'équipe soignante de vos antécédents de voyage. Cette information déclenche les mesures d'isolement appropriées et oriente les investigations [2]. La transparence avec l'équipe médicale attendut une prise en charge optimale et protège les autres patients.
Questions Fréquentes
Peut-on attraper ces maladies en France ?
Le risque reste extrêmement faible car les rongeurs réservoirs ne vivent pas en Europe. Seuls les cas importés par des voyageurs sont rapportés.
Ces virus sont-ils contagieux entre humains ?
La transmission interhumaine reste exceptionnelle pour la plupart des fièvres hémorragiques américaines. Quelques cas de contamination nosocomiale ont été rapportés.
Existe-t-il des traitements efficaces ?
Aucun traitement spécifique n'est actuellement disponible, mais les soins de soutien ont considérablement amélioré le pronostic. La ribavirine montre une efficacité modérée.
Faut-il éviter certaines destinations ?
Les recommandations officielles identifient les zones à risque. Il n'est pas nécessaire d'éviter complètement ces régions, mais une préparation adéquate s'impose.
Que faire si on a été exposé ?
Surveillez votre température pendant 21 jours et consultez immédiatement en cas de fièvre. Il n'existe pas de traitement préventif post-exposition.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] ANSM_Rapport dactivite 2023. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] RECOMMANDATIONS SANITAIRES AUX VOYAGEURS. sante.gouv.fr. 2024-2025Lien
- [4] Fièvre jaune - Ministère du Travail, de la Santé, des .... sante.gouv.fr. 2024-2025Lien
- [5] Fièvre du Nil occidental ou infection par le virus West Nile. sante.gouv.fr. 2024-2025Lien
- [6] forte performance au T1 et confirmation des perspectives .... Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [7] MesVaccins. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [8] Publications | NECAT - Cornell University. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [9] G Fourcaud. Étude de la pathogenèse de la fièvre hémorragique Bolivienne chez le singe cynomolgus. 2023Lien
- [10] F Bouagache, S Khelil. Étude épidémiologique de la fièvre hémorragique de Crimée Congo. 2023Lien
- [11] N Freitas, V Legros. Crimean-Congo hemorrhagic fever: a growing threat to Europe. 2022Lien
- [13] M Mateo, S Baize - médecine/sciences. Les arénavirus: une menace globale. 2023Lien
- [17] Présentation des fièvres hémorragiques - Infections. www.msdmanuals.comLien
- [18] Symptômes des fièvres hémorragiques virales. www.sante-sur-le-net.comLien
Publications scientifiques
- Étude de la pathogenèse de la fièvre hémorragique Bolivienne chez le singe cynomolgus (2023)
- Étude épidémiologique de la fièvre hémorragique de Crimée Congo (2023)[PDF]
- Crimean-Congo hemorrhagic fever: a growing threat to Europe (2022)8 citations[PDF]
- 9. L'ère du complot (2022)
- Les arénavirus: une menace globale (2023)1 citations[PDF]
Ressources web
- Présentation des fièvres hémorragiques - Infections (msdmanuals.com)
Parmi les symptômes, il y a une fièvre, des douleurs musculaires et des courbatures, des vomissements ainsi que des saignements au niveau de la bouche, du nez ...
- Symptômes des fièvres hémorragiques virales (sante-sur-le-net.com)
25 oct. 2018 — La durée d'incubation varie de 2 à 21 jours. Les symptômes sont les suivants : fièvre, vomissements, nausées, douleurs abdominales, etc.
- Maladie à virus Marburg (who.int)
20 janv. 2025 — Symptômes de la maladie à virus Marburg Les douleurs musculaires sont courantes. Une diarrhée aqueuse profuse, des douleurs et des crampes ...
- Fièvre jaune : symptômes, vaccin, traitement et prévention (pasteur-lille.fr)
La Fièvre jaune est une fièvre hémorragique due au virus amaril qui sévit en Amérique du sud et en Afrique. Elle est transmise par une piqûre de moustique.
- Fièvre hémorragique : symptômes, quels virus, traitement (sante.journaldesfemmes.fr)
24 mars 2023 — "Parmi les symptômes d'une fièvre hémorragique, on trouve une fièvre, une fatigue intense, des douleurs musculaires et des courbatures, des ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
