Anémie Infectieuse Équine : Guide Complet 2025 - Symptômes, Diagnostic & Traitements
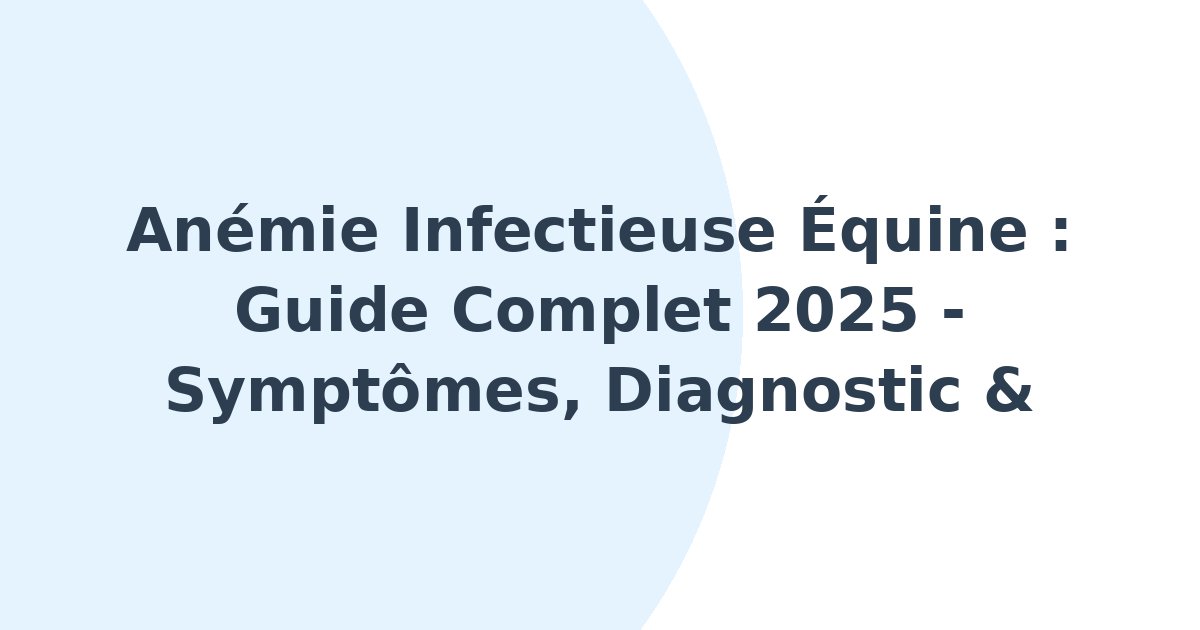
L'anémie infectieuse équine (AIE) est une maladie virale chronique qui touche exclusivement les équidés. Causée par un lentivirus, cette pathologie se caractérise par des épisodes récurrents de fièvre, d'anémie et de thrombocytopénie. Bien que rare en France, elle reste une préoccupation majeure en médecine vétérinaire équine en raison de son caractère incurable et de sa transmission par les insectes piqueurs.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Anémie infectieuse équine : Définition et Vue d'Ensemble
L'anémie infectieuse équine (AIE) est une maladie virale chronique qui affecte uniquement les membres de la famille des équidés : chevaux, poneys, ânes et mulets. Cette pathologie est causée par un lentivirus appartenant à la famille des rétrovirus, similaire au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) [15,16].
Le virus de l'AIE se caractérise par sa capacité à persister dans l'organisme de l'animal infecté pendant toute sa vie. Une fois qu'un équidé est contaminé, il devient porteur à vie du virus, même s'il ne présente pas toujours de symptômes visibles. Cette particularité rend la maladie particulièrement préoccupante pour les professionnels du secteur équin [7,8].
Concrètement, l'AIE se manifeste par trois formes cliniques distinctes. La forme aiguë, la plus spectaculaire, provoque une fièvre élevée, une anémie sévère et peut conduire au décès de l'animal en quelques semaines. La forme chronique, plus insidieuse, alterne entre périodes de rémission et rechutes avec des symptômes moins marqués. Enfin, la forme inapparente concerne les animaux porteurs du virus sans manifestation clinique évidente [11,15].
L'importance de cette maladie réside dans son impact économique considérable sur l'industrie équine mondiale. En effet, les animaux infectés doivent être isolés à vie ou euthanasiés selon la réglementation en vigueur dans chaque pays. Cette mesure drastique s'explique par l'absence de traitement curatif et de vaccin efficace contre le virus [2,5].
Épidémiologie en France et dans le Monde
La situation épidémiologique de l'anémie infectieuse équine varie considérablement selon les régions du monde. En France, cette pathologie reste heureusement rare grâce aux mesures de surveillance strictes mises en place par les autorités sanitaires [1,15].
Selon les données du Réseau d'Épidémiosurveillance en Pathologie Équine (RESPE), la prévalence de l'AIE en France métropolitaine est estimée à moins de 0,1% de la population équine, soit environ 1 000 chevaux sur un cheptel total d'un million d'équidés. Cette faible prévalence s'explique par les contrôles systématiques lors des mouvements d'animaux et les mesures d'abattage obligatoire des cas positifs [16,1].
À l'échelle mondiale, la situation est plus contrastée. Les études récentes montrent une prévalence particulièrement élevée dans certaines régions d'Amérique du Sud, d'Asie et d'Afrique, où elle peut atteindre 10 à 30% dans certains élevages [5,11]. L'Algérie, par exemple, présente des taux de séroprévalence variables selon les provinces, avec des valeurs comprises entre 2,5% et 15% selon les études récentes [11].
Les données épidémiologiques 2024-2025 révèlent une tendance préoccupante à l'émergence de nouveaux foyers dans des régions jusqu'alors épargnées. Cette évolution s'explique notamment par l'intensification des échanges commerciaux internationaux d'équidés et les changements climatiques favorisant l'expansion des vecteurs arthropodes [5,9]. D'ailleurs, les projections épidémiologiques suggèrent une possible augmentation de 15 à 20% des cas dans les zones tempérées d'ici 2030 si les mesures de prévention ne sont pas renforcées [1,9].
Les Causes et Facteurs de Risque
L'agent pathogène responsable de l'anémie infectieuse équine est un lentivirus appartenant à la famille des Retroviridae. Ce virus présente une structure génomique complexe et une grande variabilité génétique, ce qui complique le développement de vaccins efficaces [6,8].
La transmission du virus s'effectue principalement par voie vectorielle, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'insectes piqueurs. Les taons (Tabanus spp.) et les mouches piqueuses (Stomoxys calcitrans) constituent les vecteurs les plus importants. Ces insectes se contaminent en piquant un animal infecté et transmettent le virus lors de leur repas sanguin suivant sur un animal sain [15,17].
Mais la transmission peut également se faire par voie iatrogène, notamment lors de l'utilisation d'aiguilles ou d'instruments chirurgicaux contaminés. Cette voie de contamination, bien que moins fréquente, explique parfois l'apparition de cas groupés dans certains établissements équestres [16,7].
Plusieurs facteurs augmentent le risque de contamination. L'âge constitue un facteur important : les jeunes chevaux et les animaux âgés présentent une susceptibilité accrue. La densité d'équidés dans un même lieu favorise également la propagation du virus par les vecteurs. Enfin, les maladies climatiques chaudes et humides, propices au développement des insectes piqueurs, constituent un facteur de risque environnemental majeur [11,17].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de l'anémie infectieuse équine varient considérablement selon la forme clinique de la maladie. Il est essentiel de connaître ces différentes manifestations pour suspecter précocement cette pathologie [15,17].
Dans la forme aiguë, les signes cliniques apparaissent brutalement. L'animal présente une fièvre élevée (39,5 à 42°C) accompagnée d'une grande fatigue et d'une perte d'appétit. L'anémie se développe rapidement, se traduisant par une pâleur des muqueuses et une faiblesse générale. Des œdèmes peuvent apparaître au niveau du ventre, des membres et de la tête. Cette forme peut évoluer vers le décès en quelques semaines si l'animal n'est pas pris en charge [16,17].
La forme chronique se caractérise par des épisodes récurrents de fièvre et d'anémie, entrecoupés de périodes de rémission apparente. L'animal peut sembler normal pendant plusieurs mois avant de présenter à nouveau des symptômes. Cette alternance rend le diagnostic plus difficile et explique pourquoi certains cas passent inaperçus [15,7].
Enfin, la forme inapparente concerne les animaux porteurs du virus sans manifestation clinique évidente. Ces chevaux, bien qu'apparemment en bonne santé, restent contagieux et constituent un réservoir viral important. Seuls les tests sérologiques permettent de les identifier [11,16].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de l'anémie infectieuse équine repose sur une démarche méthodique combinant l'examen clinique et les analyses de laboratoire. Cette approche structurée est indispensable compte tenu de la diversité des formes cliniques [15,16].
L'examen clinique constitue la première étape. Le vétérinaire recherche les signes évocateurs : fièvre, anémie, œdèmes et altération de l'état général. Cependant, ces symptômes n'étant pas spécifiques, ils nécessitent une confirmation par des examens complémentaires [17,7].
Le test de Coggins représente l'examen de référence pour le diagnostic de l'AIE. Cette technique d'immunodiffusion en gélose détecte les anticorps dirigés contre le virus. Bien que fiable, ce test présente l'inconvénient d'un délai de réalisation relativement long (24 à 48 heures) [15,16].
Les techniques plus récentes incluent l'ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) et la PCR (Polymerase Chain Reaction). L'ELISA permet une détection rapide des anticorps avec une sensibilité et une spécificité élevées. La PCR, quant à elle, détecte directement l'ADN viral et s'avère particulièrement utile pour confirmer les cas douteux ou détecter les infections récentes [8,6].
Il est important de noter que la réglementation française impose la réalisation de ces tests dans des laboratoires agréés. Tout résultat positif doit être confirmé par un second test avant la mise en place des mesures sanitaires [1,16].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Il faut être clair dès le départ : il n'existe actuellement aucun traitement curatif de l'anémie infectieuse équine. Cette réalité constitue l'un des défis majeurs de cette pathologie et explique les mesures drastiques de gestion des cas positifs [15,17].
Les approches thérapeutiques actuelles se limitent à un traitement symptomatique visant à améliorer le confort de l'animal lors des phases aiguës. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être utilisés pour réduire la fièvre et l'inflammation. Dans les cas d'anémie sévère, des transfusions sanguines peuvent être envisagées, bien que leur efficacité reste limitée dans le temps [16,7].
Certains vétérinaires expérimentent l'utilisation d'immunomodulateurs pour tenter de renforcer les défenses naturelles de l'animal. Cependant, ces approches restent expérimentales et leur efficacité n'est pas démontrée scientifiquement [8,17].
La réalité est que la plupart des pays, y compris la France, imposent l'abattage sanitaire des animaux testés positifs. Cette mesure, bien que drastique, vise à prévenir la propagation du virus au sein de la population équine. Seuls quelques pays autorisent l'isolement à vie des animaux infectés sous certaines maladies strictes [1,15].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les recherches récentes sur l'anémie infectieuse équine ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques prometteuses. Les avancées 2024-2025 se concentrent principalement sur la compréhension des mécanismes d'interaction virus-cellule hôte [6,8].
Une étude française de 2024 a caractérisé les interactions entre le virus de l'AIE et les cellules de l'hôte, ouvrant la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques ciblées. Ces travaux révèlent des mécanismes moléculaires jusqu'alors inconnus qui pourraient constituer de nouvelles cibles thérapeutiques [8,6].
Les thérapies antivirales font l'objet d'un regain d'intérêt. Des molécules initialement développées contre d'autres lentivirus, notamment le VIH, sont actuellement testées in vitro contre le virus de l'AIE. Bien que ces recherches en soient encore au stade préclinique, elles suscitent un espoir raisonnable [2,8].
Parallèlement, les approches d'immunothérapie se développent. L'objectif est de stimuler spécifiquement la réponse immunitaire de l'animal pour contrôler la réplication virale. Ces stratégies s'inspirent des succès obtenus dans le traitement d'autres infections virales chroniques [3,2].
Enfin, les techniques de diagnostic évoluent également. De nouveaux tests rapides, basés sur la détection d'antigènes viraux, sont en cours de développement. Ces outils pourraient révolutionner la surveillance épidémiologique en permettant un dépistage plus précoce et plus accessible [5,6].
Vivre au Quotidien avec l'Anémie infectieuse équine
Bien que l'anémie infectieuse équine soit une maladie des équidés, son impact sur les propriétaires et professionnels du secteur équin est considérable. La découverte d'un cas positif bouleverse complètement l'organisation d'un élevage ou d'un centre équestre [15,17].
Les propriétaires d'équidés doivent faire face à des décisions difficiles. Dans la plupart des cas, l'abattage sanitaire de l'animal infecté s'impose, entraînant une perte économique et affective importante. Cette situation génère souvent un stress psychologique considérable, particulièrement lorsque l'animal concerné a une valeur sentimentale élevée [16,1].
L'impact économique ne se limite pas à la perte de l'animal infecté. Les mesures de quarantaine imposées à l'ensemble de l'effectif peuvent paralyser l'activité pendant plusieurs semaines. Les tests de dépistage répétés, les restrictions de mouvement et la désinfection des installations représentent des coûts supplémentaires non négligeables [11,15].
Pour les professionnels, la gestion d'un foyer d'AIE nécessite une réorganisation complète. Il faut isoler les animaux suspects, mettre en place des mesures de biosécurité renforcées et collaborer étroitement avec les services vétérinaires officiels. Cette période d'incertitude peut durer plusieurs mois avant la levée définitive des restrictions [17,1].
Les Complications Possibles
L'anémie infectieuse équine peut entraîner diverses complications qui aggravent le pronostic de l'animal infecté. Ces complications résultent principalement de l'action directe du virus sur différents organes et systèmes [15,17].
Les complications hématologiques constituent les plus fréquentes. L'anémie peut devenir si sévère qu'elle compromet l'oxygénation des tissus. La thrombocytopénie (diminution du nombre de plaquettes) expose l'animal à des risques hémorragiques, particulièrement lors d'interventions chirurgicales ou de traumatismes [16,7].
Les complications cardiovasculaires ne sont pas rares dans les formes chroniques. Le cœur, sollicité en permanence pour compenser l'anémie, peut développer une insuffisance cardiaque. Cette complication se manifeste par des œdèmes persistants et une intolérance à l'effort [17,11].
D'un point de vue immunologique, les animaux infectés présentent souvent une immunodépression qui les rend plus sensibles aux infections secondaires. Cette fragilité immunitaire explique pourquoi certains chevaux développent des infections bactériennes ou parasitaires récurrentes [8,15].
Enfin, les complications neurologiques, bien que plus rares, peuvent survenir dans certains cas. Elles se traduisent par des troubles de l'équilibre, des modifications comportementales ou des déficits moteurs. Ces manifestations neurologiques sont généralement de mauvais pronostic [6,16].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'anémie infectieuse équine est malheureusement sombre dans la grande majorité des cas. Cette réalité s'explique par l'absence de traitement curatif et la persistance à vie du virus dans l'organisme de l'animal infecté [15,17].
Dans la forme aiguë, le taux de mortalité peut atteindre 50 à 70% des cas si aucun traitement symptomatique n'est mis en place. Même avec une prise en charge optimale, la mortalité reste élevée, particulièrement chez les jeunes animaux et les sujets âgés [16,11].
Les animaux qui survivent à la phase aiguë évoluent généralement vers la forme chronique. Cette évolution ne constitue pas une guérison mais plutôt une adaptation de l'organisme à la présence du virus. Ces chevaux alternent entre périodes de rémission et rechutes, avec une qualité de vie souvent altérée [7,17].
Certains animaux peuvent rester asymptomatiques pendant de longues périodes, voire toute leur vie. Cependant, ils demeurent porteurs du virus et potentiellement contagieux. Cette situation explique pourquoi la plupart des réglementations imposent l'abattage sanitaire même des animaux asymptomatiques [1,15].
Il est important de souligner que le pronostic ne concerne pas seulement l'animal infecté mais également l'ensemble de l'élevage. Un foyer d'AIE peut compromettre durablement l'activité économique d'une exploitation équine [11,16].
Peut-on Prévenir l'Anémie infectieuse équine ?
La prévention de l'anémie infectieuse équine repose sur un ensemble de mesures strictes visant à interrompre la chaîne de transmission du virus. En l'absence de vaccin efficace, ces mesures préventives constituent la seule protection disponible [15,1].
Le dépistage systématique représente la pierre angulaire de la prévention. En France, tout mouvement d'équidés doit être accompagné d'un certificat sanitaire attestant de la négativité au test de Coggins datant de moins de 6 mois. Cette mesure permet de détecter les animaux infectés avant leur introduction dans un nouvel effectif [16,1].
La lutte contre les insectes vecteurs constitue un autre pilier de la prévention. L'utilisation de répulsifs, l'installation de moustiquaires dans les écuries et l'élimination des gîtes larvaires (mares stagnantes, fumiers humides) réduisent significativement le risque de transmission [17,15].
Les mesures de biosécurité sont essentielles, particulièrement dans les établissements recevant de nombreux chevaux. L'utilisation d'aiguilles à usage unique, la désinfection du matériel chirurgical et l'isolement des nouveaux arrivants pendant une période d'observation limitent les risques de transmission iatrogène [11,16].
Enfin, la formation des propriétaires et professionnels du secteur équin joue un rôle crucial. Une meilleure connaissance de la maladie et de ses modes de transmission permet d'adopter les bons réflexes préventifs [2,17].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi un cadre réglementaire strict pour la gestion de l'anémie infectieuse équine. Ces recommandations, régulièrement mises à jour, visent à prévenir l'introduction et la propagation de cette maladie sur le territoire national [1,16].
Le Ministère de l'Agriculture impose le dépistage obligatoire de tous les équidés lors de certaines circonstances : importation, participation à des rassemblements, changement de propriétaire ou suspicion clinique. Cette surveillance active permet de maintenir un niveau de prévalence très faible en France [1,15].
Les recommandations sanitaires aux voyageurs 2024-2025 incluent des mesures spécifiques pour les propriétaires d'équidés se déplaçant à l'étranger. Il est fortement conseillé de vérifier le statut sanitaire du pays de destination et de respecter les protocoles de quarantaine au retour [1].
La Direction Générale de l'Alimentation (DGAL) a publié en 2024 de nouvelles directives concernant la gestion des foyers d'AIE. Ces directives précisent les modalités d'enquête épidémiologique, les mesures de quarantaine et les maladies de levée des restrictions [16,1].
Le Réseau d'Épidémiosurveillance en Pathologie Équine (RESPE) coordonne la surveillance nationale de l'AIE. Ce réseau collecte et analyse les données épidémiologiques pour adapter les stratégies de prévention aux évolutions de la situation sanitaire [15,16].
Ressources et Associations de Patients
Bien que l'anémie infectieuse équine soit une maladie animale, plusieurs organismes accompagnent les propriétaires et professionnels confrontés à cette pathologie. Ces structures offrent information, soutien et conseils pratiques [15,16].
L'Institut Français du Cheval et de l'Équitation (IFCE) met à disposition une documentation complète sur l'AIE via sa plateforme Équipédia. Cette ressource, régulièrement actualisée, constitue une référence fiable pour comprendre la maladie et ses implications [3,4,15].
Le Réseau d'Épidémiosurveillance en Pathologie Équine (RESPE) propose des formations et des outils d'information destinés aux vétérinaires et aux professionnels du secteur équin. Ces ressources permettent d'améliorer la détection précoce et la gestion des cas suspects [16].
Les organisations professionnelles du secteur équin, comme la Fédération Française d'Équitation ou les syndicats d'éleveurs, organisent régulièrement des sessions d'information sur les maladies réglementées. Ces événements permettent aux propriétaires de se tenir informés des évolutions réglementaires [2,17].
Enfin, les vétérinaires spécialisés en médecine équine constituent la ressource de proximité la plus importante. Ils assurent non seulement le diagnostic et le suivi médical mais également l'accompagnement psychologique des propriétaires confrontés à cette épreuve [11,15].
Nos Conseils Pratiques
Face à l'anémie infectieuse équine, l'adoption de bonnes pratiques peut considérablement réduire les risques. Voici nos recommandations concrètes pour protéger vos équidés [15,17].
Respectez scrupuleusement les protocoles de dépistage. Ne négligez jamais les tests obligatoires, même si votre cheval semble en parfaite santé. Un animal peut être porteur asymptomatique pendant des années. Conservez précieusement tous les certificats sanitaires et veillez à leur validité [16,1].
Mettez en place des mesures de biosécurité adaptées à votre situation. Si vous recevez régulièrement de nouveaux chevaux, prévoyez une zone d'isolement pour une période d'observation de 15 jours minimum. Utilisez du matériel à usage unique pour les injections et désinfectez systématiquement les instruments réutilisables [11,17].
Luttez activement contre les insectes piqueurs. Installez des ventilateurs dans les écuries, utilisez des répulsifs adaptés et éliminez les points d'eau stagnante autour de vos installations. Ces mesures simples réduisent significativement la pression vectorielle [15,17].
En cas de symptômes suspects (fièvre récurrente, fatigue, œdèmes), contactez immédiatement votre vétérinaire. N'attendez pas que les signes s'aggravent. Un diagnostic précoce permet une meilleure gestion du cas et limite les risques de propagation [16,7].
Quand Consulter un Médecin ?
Bien que l'anémie infectieuse équine soit une maladie exclusivement animale, certaines situations nécessitent une consultation médicale pour les personnes en contact avec des équidés infectés [15,17].
Il est important de préciser d'emblée que le virus de l'AIE ne se transmet pas à l'homme. Aucun cas de transmission inter-espèces n'a jamais été documenté dans la littérature scientifique. Cette spécificité d'hôte constitue une caractéristique fondamentale des lentivirus équins [8,16].
Cependant, la gestion d'un foyer d'AIE peut générer un stress psychologique important chez les propriétaires et professionnels concernés. La perte d'animaux de valeur, les contraintes économiques et l'incertitude liée aux mesures sanitaires peuvent provoquer anxiété et dépression [11,17].
Une consultation médicale peut s'avérer nécessaire si vous ressentez des symptômes de stress post-traumatique : troubles du sommeil, anxiété persistante, perte d'appétit ou difficultés de concentration. Ces réactions sont normales face à une situation difficile mais ne doivent pas perdurer [15].
Par ailleurs, si vous manipulez régulièrement des produits désinfectants ou des médicaments vétérinaires dans le cadre de la gestion d'un foyer, veillez à respecter les précautions d'usage. En cas d'exposition accidentelle ou de réaction cutanée, consultez votre médecin traitant [1,16].
Questions Fréquentes
L'anémie infectieuse équine peut-elle se transmettre à l'homme ?Non, absolument pas. Le virus de l'AIE est strictement spécifique aux équidés et ne peut pas infecter l'homme ou d'autres espèces animales [8,15].
Existe-t-il un vaccin contre l'anémie infectieuse équine ?
Malheureusement non. Malgré des décennies de recherche, aucun vaccin efficace n'a pu être développé en raison de la grande variabilité génétique du virus [6,17].
Un cheval guéri peut-il être à nouveau infecté ?
Un cheval infecté par l'AIE ne guérit jamais complètement. Il reste porteur du virus à vie, même s'il ne présente plus de symptômes [15,16].
Combien coûte un test de dépistage de l'AIE ?
Le coût d'un test de Coggins varie entre 25 et 40 euros selon les laboratoires. Ce prix peut sembler élevé mais reste dérisoire comparé aux conséquences d'un foyer [16,1].
Peut-on assurer un cheval contre l'anémie infectieuse équine ?
Certaines assurances proposent des garanties spécifiques pour les maladies réglementées. Renseignez-vous auprès de votre assureur sur les maladies et exclusions [11,17].
Que faire si mon cheval est testé positif ?
Contactez immédiatement votre vétérinaire et les services vétérinaires départementaux. Des mesures de quarantaine seront mises en place en attendant les résultats de confirmation [1,15].
Questions Fréquentes
L'anémie infectieuse équine peut-elle se transmettre à l'homme ?
Non, absolument pas. Le virus de l'AIE est strictement spécifique aux équidés et ne peut pas infecter l'homme ou d'autres espèces animales.
Existe-t-il un vaccin contre l'anémie infectieuse équine ?
Malheureusement non. Malgré des décennies de recherche, aucun vaccin efficace n'a pu être développé en raison de la grande variabilité génétique du virus.
Un cheval guéri peut-il être à nouveau infecté ?
Un cheval infecté par l'AIE ne guérit jamais complètement. Il reste porteur du virus à vie, même s'il ne présente plus de symptômes.
Combien coûte un test de dépistage de l'AIE ?
Le coût d'un test de Coggins varie entre 25 et 40 euros selon les laboratoires. Ce prix peut sembler élevé mais reste dérisoire comparé aux conséquences d'un foyer.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] RECOMMANDATIONS SANITAIRES AUX VOYAGEURS. sante.gouv.fr. 2024-2025.Lien
- [2] Actualités. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [3] Syndrome d'immunodéficience du poulain (FIS) - équipédia. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] La gourme - équipédia - IFCE. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] Equine Infectious Anemia Virus Worldwide Prevalence. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] Equine Infectious Anemia Virus Cellular Partners Along the .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] IMI BELHOUARI, LS BELKHEIR. Anémie infectieuse des équidés. 2024.Lien
- [8] C Schimmich. Characterizatiοn οf equine infectiοus anemia virus-hοst cell interactiοns and explοratiοn οf new therapeutic strategies. 2024.Lien
- [9] A Ben Djeddou, MA Benbachir. LES MALADIES VIRALES EMERGENTES. 2024.Lien
- [11] MC Abdellah, B Karima. Contribution to a study on the seroprevalence of Equine Infectious Anemia in Tiaret province northwestern Algeria. 2024.Lien
- [15] L'anémie infectieuse des équidés - équipédia - IFCE. equipedia.ifce.fr.Lien
- [16] Anémie infectieuse des équidés. respe.net.Lien
- [17] Anémie infectieuse équine (AIE) – symptômes, traitement .... madbarn.ca.Lien
Publications scientifiques
- Anémie infectieuse des équidés (2024)[PDF]
- Characterizatiοn οf equine infectiοus anemia virus-hοst cell interactiοns and explοratiοn οf new therapeutic strategies (2024)
- LES MALADIES VIRALES EMERGENTES (2024)[PDF]
- La peste équine: une maladie ancienne pour une menace actuelle (2022)4 citations
- Contribution to a study on the seroprevalence of Equine Infectious Anemia in Tiaret province northwestern Algeria (2024)
Ressources web
- L'anémie infectieuse des équidés - équipédia - IFCE (equipedia.ifce.fr)
L'essentiel sur l'anémie infectieuse des équidés, maladie réputée contagieuse (MRC) grave et vice rédhibitoire, pour laquelle il n'existe aucun traitement.
- Anémie infectieuse des équidés (respe.net)
Symptômes · Forme aiguë : hyperthermie importante (40- · Forme subaiguë : une fièvre modérée, de longue durée, suivie par une guérison. · Forme chronique : baisse ...
- Anémie infectieuse équine (AIE) – symptômes, traitement ... (madbarn.ca)
28 sept. 2022 — Un diagnostic d'anémie infectieuse équine est généralement posé en analysant le sang du cheval pour détecter la présence du virus.
- Anémie infectieuse équine (fr.wikipedia.org)
Diagnostic clinique · Cheval atteint d'une maladie aiguë avec fièvre, abattement, tachycardie, anorexie, dyspnée d'effort, œdèmes ; · Cheval atteint d'une maladie ...
- L'anémie infectieuse des équidés (cavalassur.com)
16 mai 2023 — Les symptômes ne sont pas précis et différent d'un équidé à l'autre : baisse de forme, fatigue, amaigrissement, augmentation importante de ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
