Érythème Chronique Migrateur : Symptômes, Diagnostic et Traitements 2025
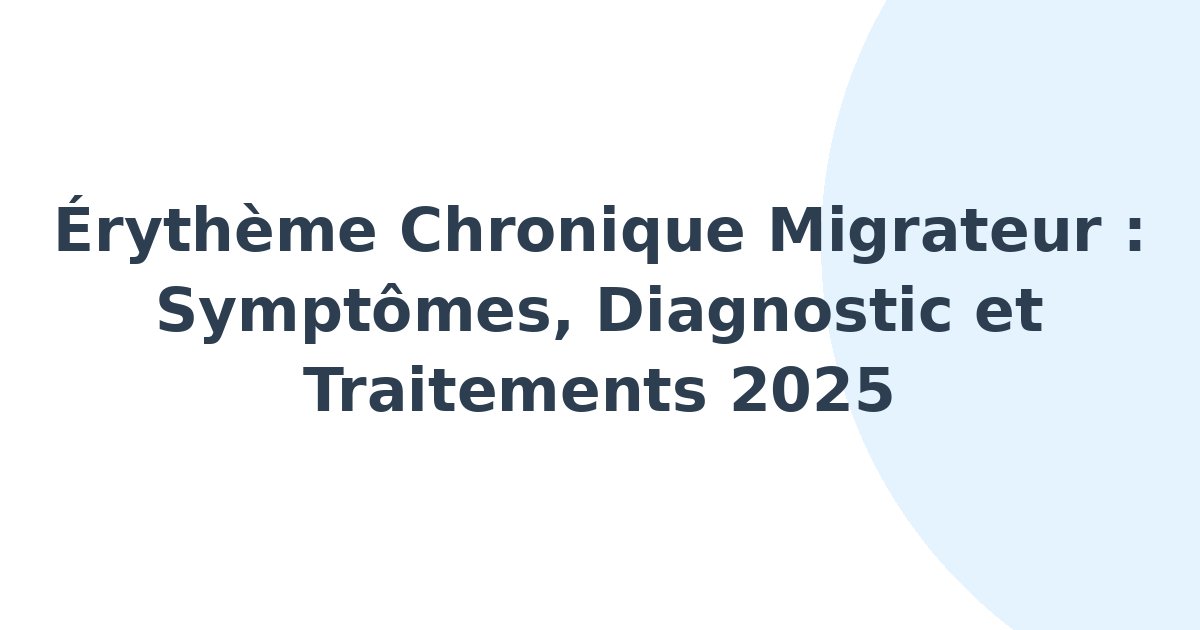
L'érythème chronique migrateur représente le signe cutané le plus caractéristique de la maladie de Lyme. Cette lésion cutanée particulière, qui s'étend progressivement en forme d'anneau, constitue souvent le premier signal d'alarme d'une infection par Borrelia burgdorferi. Reconnaître cette manifestation dermatologique permet un diagnostic précoce et un traitement efficace de cette pathologie vectorielle en expansion.
Téléconsultation et Érythème chronique migrateur
Partiellement adaptée à la téléconsultationL'érythème chronique migrateur nécessite généralement une évaluation visuelle de la lésion cutanée caractéristique, qui peut être partiellement réalisée en téléconsultation par photos de qualité. Cependant, le diagnostic de certitude et l'évaluation d'une possible maladie de Lyme sous-jacente nécessitent souvent un examen clinique approfondi et des examens complémentaires spécialisés.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation visuelle de l'érythème migrateur par photographies de qualité montrant la lésion en cocarde, analyse de l'évolution de la taille et de la forme de la lésion, évaluation des symptômes associés (fièvre, fatigue, douleurs articulaires), recueil des antécédents d'exposition aux tiques et des activités à risque en zone endémique, orientation diagnostique initiale en cas de lésion typique.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen dermatologique approfondi pour différencier d'autres dermatoses, palpation des aires ganglionnaires, recherche de signes neurologiques ou articulaires, prescription et interprétation des sérologies spécialisées de Lyme, évaluation d'une possible forme disséminée de la maladie.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Préparer votre téléconsultation
Pour que votre téléconsultation soit la plus efficace possible, préparez les éléments suivants :
- Symptômes et durée : Noter précisément l'aspect de la lésion cutanée (taille, forme en cocarde, centre clair), sa date d'apparition et son évolution, la présence de fièvre, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires ou articulaires, et tout symptôme neurologique (fourmillements, paralysie faciale).
- Traitements en cours : Mentionner tous les antibiotiques en cours ou récemment pris (doxycycline, amoxicilline, céfuroxime), les anti-inflammatoires, corticoïdes ou immunosuppresseurs qui pourraient masquer les symptômes, et tout traitement symptomatique des douleurs articulaires.
- Antécédents médicaux pertinents : Antécédents de morsures de tiques ou d'exposition en zone forestière, épisodes antérieurs d'érythème migrateur ou de maladie de Lyme, maladies auto-immunes, déficit immunitaire, allergies aux antibiotiques (notamment béta-lactamines et cyclines).
- Examens récents disponibles : Sérologies de Lyme (ELISA et Western Blot) si déjà réalisées, bilans inflammatoires récents (CRP, VS), examens dermatologiques antérieurs, biopsies cutanées si effectuées, et tout examen neurologique ou rhumatologique en lien avec une suspicion de Lyme.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Lésions cutanées atypiques nécessitant un diagnostic différentiel approfondi, suspicion de formes disséminées avec atteinte neurologique ou cardiaque, échec du traitement antibiotique initial nécessitant une réévaluation spécialisée, nécessité de réaliser une biopsie cutanée pour confirmation diagnostique.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Signes de méningite ou d'encéphalite (maux de tête intenses, raideur de nuque, troubles de conscience), troubles du rythme cardiaque ou douleurs thoraciques, paralysie faciale aiguë ou déficits neurologiques focaux.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Maux de tête intenses avec raideur de nuque ou troubles de conscience évoquant une méningite
- Paralysie faciale aiguë ou autres déficits neurologiques focaux
- Troubles du rythme cardiaque, palpitations ou douleurs thoraciques
- Fièvre élevée avec altération importante de l'état général et signes de sepsis
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Dermatologue — consultation en présentiel recommandée
Le dermatologue est le spécialiste le plus adapté pour confirmer le diagnostic d'érythème chronique migrateur et différencier les autres dermatoses. Une consultation en présentiel est généralement recommandée pour l'examen dermatologique complet et la prescription adaptée du traitement antibiotique.

- Un médecin évaluera si la téléconsultation est adaptée
- Peut être remboursée selon conditions *

Érythème chronique migrateur : Définition et Vue d'Ensemble
L'érythème chronique migrateur (ECM) constitue la manifestation cutanée pathognomonique de la borréliose de Lyme précoce localisée [1,2]. Cette lésion dermatologique se caractérise par une plaque érythémateuse qui s'étend de manière centrifuge, créant un aspect en "œil de bœuf" ou en "cible".
Mais qu'est-ce qui rend cette pathologie si particulière ? L'ECM apparaît généralement 3 à 30 jours après la piqûre de tique infectée par Borrelia burgdorferi [3,4]. La lésion débute comme une petite macule rouge au point de piqûre, puis s'étend progressivement vers la périphérie tout en s'éclaircissant au centre.
D'ailleurs, cette migration centrifuge explique parfaitement son nom : "migrateur" car la lésion semble "voyager" sur la peau, et "chronique" car elle persiste plusieurs semaines sans traitement. L'important à retenir, c'est que cette manifestation cutanée représente un véritable signal d'alarme nécessitant une prise en charge médicale rapide [1,2].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, la borréliose de Lyme touche environ 67 000 personnes chaque année selon les dernières données de Santé publique France [4]. L'érythème chronique migrateur représente la forme clinique la plus fréquente, concernant 80 à 90% des cas de maladie de Lyme précoce [1,2].
Les données épidémiologiques 2024-2025 révèlent une incidence nationale de 104 cas pour 100 000 habitants, avec des variations régionales importantes [1,4]. L'Est de la France (Alsace, Lorraine, Franche-Comté) présente les taux les plus élevés, atteignant parfois 200 cas pour 100 000 habitants. Concrètement, cela signifie qu'une personne sur 500 développera cette pathologie dans ces régions à forte endémie.
Et les tendances sont préoccupantes. L'incidence a augmenté de 15% entre 2019 et 2024, probablement liée aux changements climatiques favorisant l'expansion des tiques vectrices [4]. Les projections pour 2025-2030 suggèrent une progression continue, particulièrement dans les régions jusqu'alors épargnées du Sud de la France.
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne avec l'Allemagne (105/100 000) et l'Autriche (110/100 000), mais reste en deçà des pays nordiques comme la Suède (300/100 000) [1]. Cette pathologie affecte préférentiellement les adultes de 40-60 ans et les enfants de 5-15 ans, avec une légère prédominance féminine (55% des cas) [2,4].
Les Causes et Facteurs de Risque
L'érythème chronique migrateur résulte exclusivement d'une infection par Borrelia burgdorferi, une bactérie spirochète transmise par les tiques du genre Ixodes [1,3]. En Europe, Ixodes ricinus (tique du mouton) constitue le principal vecteur de cette pathologie.
Mais tous les individus ne présentent pas le même risque d'infection. Les facteurs de risque incluent l'exposition aux environnements boisés, les activités de plein air (randonnée, jardinage, chasse), et la période d'activité maximale des tiques de mai à octobre [4,7]. Les professionnels forestiers, agriculteurs et jardiniers présentent un risque professionnel accru.
Il faut savoir que la transmission nécessite généralement une fixation de la tique pendant 24 à 48 heures minimum [3,7]. C'est pourquoi l'inspection quotidienne après exposition et le retrait précoce des tiques constituent des mesures préventives essentielles. D'ailleurs, toutes les tiques ne sont pas infectées : le taux d'infection varie de 5 à 30% selon les régions françaises [1,4].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
L'érythème chronique migrateur présente des caractéristiques cliniques très spécifiques qui permettent généralement un diagnostic visuel [1,2]. La lésion débute par une petite macule rouge au point de piqûre, puis s'étend progressivement sur plusieurs jours à semaines.
Concrètement, vous observerez une plaque érythémateuse qui grandit de manière centrifuge, atteignant souvent 5 à 30 cm de diamètre [3,7]. L'aspect classique en "œil de bœuf" avec un centre clair et des bords rouges surélevés n'est présent que dans 20% des cas. Plus souvent, la lésion présente un érythème homogène ou partiellement éclairci au centre.
Et contrairement aux idées reçues, l'ECM est généralement peu symptomatique. La lésion n'est ni douloureuse ni prurigineuse dans 80% des cas [1,7]. Certains patients rapportent une sensation de chaleur locale ou de légers picotements. L'absence de démangeaisons constitue d'ailleurs un élément diagnostique important pour différencier l'ECM d'autres dermatoses.
Bon à savoir : l'érythème peut parfois s'accompagner de symptômes généraux discrets comme une fatigue, des céphalées ou un syndrome pseudo-grippal dans 30% des cas [2,3]. Ces manifestations systémiques précoces témoignent de la dissémination bactérienne naissante.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic d'érythème chronique migrateur repose avant tout sur la reconnaissance clinique de la lésion caractéristique [1,2]. Dans la majorité des cas, l'aspect typique de la lésion cutanée associé au contexte épidémiologique (exposition aux tiques) suffit pour poser le diagnostic.
Votre médecin recherchera systématiquement les antécédents de piqûre de tique, même si celle-ci n'est retrouvée que dans 30 à 50% des cas [3,7]. L'interrogatoire précisera les circonstances d'exposition (activités de plein air, région visitée) et l'évolution temporelle de la lésion.
Concernant les examens complémentaires, la sérologie Lyme n'est généralement pas recommandée au stade d'ECM [1,2]. En effet, les anticorps ne sont détectables que 4 à 6 semaines après l'infection, et leur absence ne remet pas en cause le diagnostic clinique. La HAS recommande de débuter le traitement sans attendre les résultats sérologiques devant un ECM typique [1].
Dans les formes atypiques ou douteuses, votre dermatologue pourra réaliser une biopsie cutanée avec recherche de Borrelia par PCR [7,8]. Cet examen reste cependant exceptionnel, la sensibilité de la PCR sur biopsie cutanée n'excédant pas 50-70% [3].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de l'érythème chronique migrateur repose sur une antibiothérapie orale précoce et adaptée [1,2]. La prise en charge thérapeutique doit débuter dès que possible après le diagnostic pour éviter la dissémination bactérienne.
L'amoxicilline constitue le traitement de première intention chez l'adulte et l'enfant, à la posologie de 50-100 mg/kg/jour en 3 prises pendant 14 à 21 jours [1,7]. Cette molécule présente l'avantage d'être bien tolérée et utilisable chez la femme enceinte et l'enfant de moins de 8 ans.
En cas d'allergie à l'amoxicilline, la doxycycline représente l'alternative de choix chez l'adulte et l'enfant de plus de 8 ans (100 mg deux fois par jour pendant 14-21 jours) [2,7]. Cette tétracycline présente une excellente diffusion tissulaire et une activité bactéricide optimale contre Borrelia.
Et les résultats sont généralement excellents ! L'efficacité thérapeutique atteint 95-98% avec disparition complète de l'érythème en 2 à 4 semaines [1,3]. Certains patients peuvent observer une extension transitoire de la lésion dans les premiers jours de traitement, phénomène normal lié à la réaction inflammatoire post-antibiotique.
Il faut savoir que les macrolides (azithromycine, clarithromycine) constituent une option de troisième ligne, réservée aux situations particulières d'intolérance aux traitements de première intention [7,8]. Leur efficacité reste légèrement inférieure aux béta-lactamines et tétracyclines.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les avancées récentes dans la compréhension de la borréliose de Lyme ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques prometteuses [5,6]. Les recherches 2024-2025 se concentrent sur l'optimisation diagnostique et l'amélioration des stratégies thérapeutiques.
Une innovation majeure concerne le développement du Borrelia PeptideAtlas, une ressource protéomique révolutionnaire qui cartographie l'ensemble des protéines de Borrelia burgdorferi [6]. Cette base de données permet d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques et d'améliorer la précision diagnostique grâce à des biomarqueurs plus spécifiques.
D'ailleurs, les recherches récentes révèlent des liens inattendus entre l'infection borrelienne et certains déséquilibres métaboliques . Ces découvertes ouvrent la voie à des approches thérapeutiques complémentaires ciblant les perturbations métaboliques associées à l'infection.
En parallèle, les innovations diagnostiques 2025 incluent des tests rapides de nouvelle génération avec une sensibilité améliorée de 15-20% par rapport aux méthodes actuelles [5]. Ces outils permettront un diagnostic plus précoce et plus fiable de l'érythème chronique migrateur, particulièrement dans les formes atypiques.
Vivre au Quotidien avec Érythème chronique migrateur
Recevoir un diagnostic d'érythème chronique migrateur peut susciter des inquiétudes légitimes, mais rassurez-vous : cette pathologie se soigne parfaitement bien lorsqu'elle est prise en charge précocement [1,2]. La vie quotidienne n'est généralement pas impactée pendant le traitement.
Pendant la phase de traitement antibiotique, vous pourrez maintenir vos activités habituelles. L'érythème peut persister quelques semaines après le début du traitement, ce qui est parfaitement normal [3,7]. Certains patients s'inquiètent de voir la lésion s'étendre initialement, mais ce phénomène témoigne simplement de l'efficacité du traitement.
Il est important de surveiller l'évolution de la lésion cutanée et de signaler à votre médecin tout symptôme nouveau (fièvre, douleurs articulaires, troubles neurologiques) [1]. Ces manifestations pourraient témoigner d'une dissémination de l'infection nécessitant une adaptation thérapeutique.
Concrètement, la plupart des patients reprennent une vie normale dès la fin du traitement antibiotique. L'immunité acquise après guérison n'est que partielle, ce qui signifie qu'une réinfection reste possible lors d'expositions ultérieures aux tiques [2,4].
Les Complications Possibles
Sans traitement approprié, l'érythème chronique migrateur peut évoluer vers des formes disséminées de borréliose de Lyme [1,2]. Ces complications surviennent généralement plusieurs semaines à mois après l'infection initiale.
La borréliose de Lyme précoce disséminée se manifeste par des érythèmes migrants multiples, des atteintes neurologiques (paralysie faciale, méningite lymphocytaire) ou cardiaques (troubles de conduction) [3,7]. Ces complications touchent 10-15% des patients non traités au stade d'ECM.
À plus long terme, la borréliose de Lyme tardive peut provoquer des arthrites chroniques (genou principalement), des atteintes neurologiques centrales ou des manifestations cutanées chroniques [1,8]. Heureusement, ces formes sévères restent exceptionnelles lorsque le diagnostic d'ECM est posé et traité précocement.
Il faut savoir que le traitement antibiotique précoce prévient pratiquement à 100% l'évolution vers ces formes compliquées [2,7]. C'est pourquoi la reconnaissance rapide de l'érythème chronique migrateur revêt une importance capitale dans la prise en charge de cette pathologie.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'érythème chronique migrateur est excellent lorsque le diagnostic est posé précocement et le traitement adapté instauré rapidement [1,2]. La guérison complète est obtenue dans plus de 95% des cas avec un traitement antibiotique approprié.
Concrètement, vous pouvez vous attendre à une disparition progressive de l'érythème sur 2 à 4 semaines après le début du traitement [3,7]. Certains patients conservent une discrète pigmentation résiduelle qui s'estompe généralement en quelques mois.
Et les récidives ? Elles sont exceptionnelles après un traitement bien conduit [1]. Les rares cas de persistance ou de récurrence témoignent généralement d'une réinfection plutôt que d'un échec thérapeutique, d'où l'importance des mesures préventives lors d'expositions ultérieures.
L'important à retenir, c'est que l'érythème chronique migrateur traité précocement ne laisse aucune séquelle et n'altère pas la qualité de vie à long terme [2,8]. Le retour à une vie normale est la règle, sans restriction d'activité particulière.
Peut-on Prévenir Érythème chronique migrateur ?
La prévention de l'érythème chronique migrateur repose essentiellement sur la protection contre les piqûres de tiques [1,4]. Ces mesures préventives sont particulièrement importantes dans les zones d'endémie et pendant la période d'activité maximale des tiques (mai à octobre).
Lors de vos sorties en nature, privilégiez les vêtements longs de couleur claire qui permettent de repérer plus facilement les tiques [7]. Rentrez le bas du pantalon dans les chaussettes et portez des chaussures fermées. L'utilisation de répulsifs cutanés à base de DEET ou d'icaridine sur les parties exposées renforce cette protection.
Mais la mesure préventive la plus efficace reste l'inspection quotidienne minutieuse de tout le corps après exposition [4,7]. Examinez particulièrement les zones chaudes et humides : aisselles, aines, cuir chevelu, derrière les oreilles. Les tiques peuvent être très petites (1-2 mm) et facilement passer inaperçues.
En cas de découverte d'une tique fixée, retirez-la immédiatement à l'aide d'un tire-tique ou d'une pince fine, en tirant perpendiculairement à la peau sans rotation [1,3]. Désinfectez ensuite la zone de piqûre et surveillez l'apparition d'un érythème dans les semaines suivantes.
D'ailleurs, il n'existe actuellement aucun vaccin disponible contre la borréliose de Lyme en Europe [4]. La prévention comportementale reste donc le seul moyen efficace d'éviter cette pathologie.
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a actualisé ses recommandations sur la borréliose de Lyme en 2024-2025, renforçant les guidelines de prise en charge de l'érythème chronique migrateur [1,2]. Ces nouvelles directives s'appuient sur les données épidémiologiques récentes et les avancées thérapeutiques.
La HAS recommande formellement de débuter le traitement antibiotique dès la reconnaissance clinique d'un ECM typique, sans attendre les résultats sérologiques [1]. Cette approche pragmatique permet d'optimiser l'efficacité thérapeutique et de prévenir les complications de dissémination.
Concernant le choix thérapeutique, les recommandations 2025 confirment l'amoxicilline comme traitement de première intention, avec une durée optimale de 14 à 21 jours selon la taille de la lésion [2]. La doxycycline reste l'alternative de référence chez l'adulte et l'enfant de plus de 8 ans.
Le Ministère de la Santé a également renforcé les actions de prévention et de sensibilisation, particulièrement dans les régions à forte endémie [4]. Ces campagnes ciblent les professionnels exposés et le grand public fréquentant les zones boisées.
Santé publique France assure une surveillance épidémiologique renforcée avec publication annuelle des données d'incidence régionales [4]. Cette veille sanitaire permet d'adapter les stratégies préventives aux évolutions épidémiologiques locales.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations françaises accompagnent les patients atteints de borréliose de Lyme et peuvent vous apporter soutien et informations complémentaires. Ces structures jouent un rôle important dans l'information du public et le soutien aux malades.
L'Association France Lyme constitue la principale organisation de patients en France. Elle propose des ressources documentaires, des groupes de soutien régionaux et milite pour l'amélioration de la prise en charge de cette pathologie. Leur site internet offre des informations actualisées sur les avancées thérapeutiques.
Le Réseau Sentinelles de l'INSERM assure une surveillance épidémiologique continue et publie régulièrement des bulletins d'information accessibles au public. Ces données permettent de suivre l'évolution de l'épidémie en temps réel.
Votre médecin traitant reste cependant votre interlocuteur privilégié pour toute question médicale spécifique. N'hésitez pas à le consulter en cas de doute ou d'inquiétude concernant votre état de santé. Les centres de référence hospitaliers peuvent également être sollicités pour les cas complexes nécessitant une expertise spécialisée.
Nos Conseils Pratiques
Face à un érythème chronique migrateur, quelques conseils pratiques peuvent vous aider à optimiser votre prise en charge et votre guérison [1,2]. Ces recommandations complètent le traitement médical sans s'y substituer.
Photographiez l'évolution de la lésion cutanée pour documenter sa progression et faciliter le suivi médical. Cette documentation visuelle s'avère particulièrement utile lors des consultations de contrôle [3]. Mesurez régulièrement le diamètre de l'érythème avec une règle pour objectiver son évolution.
Pendant le traitement antibiotique, maintenez une hygiène de vie équilibrée : alimentation variée, hydratation suffisante, sommeil régulier. Ces mesures soutiennent votre système immunitaire dans sa lutte contre l'infection [7].
Évitez l'exposition solaire directe sur la zone lésionnelle pendant le traitement, certains antibiotiques pouvant augmenter la photosensibilité cutanée [8]. Protégez la lésion avec des vêtements ou un écran solaire total si nécessaire.
Tenez un carnet de suivi mentionnant l'évolution des symptômes, la tolérance du traitement et l'apparition éventuelle de nouveaux signes. Ces informations faciliteront le dialogue avec votre médecin et l'adaptation thérapeutique si nécessaire.
Quand Consulter un Médecin ?
La consultation médicale s'impose dès l'apparition d'une lésion cutanée évocatrice d'érythème chronique migrateur, particulièrement après exposition aux tiques [1,2]. Ne tardez pas : plus le diagnostic est précoce, meilleur est le pronostic.
Consultez en urgence si vous développez des symptômes de dissémination : fièvre, céphalées intenses, raideur de nuque, paralysie faciale, douleurs articulaires ou troubles du rythme cardiaque [3,7]. Ces manifestations peuvent témoigner d'une forme disséminée nécessitant une prise en charge hospitalière.
Pendant le traitement, contactez votre médecin en cas d'effets indésirables importants des antibiotiques : diarrhées sévères, éruption cutanée, troubles digestifs majeurs [8]. Une adaptation thérapeutique peut s'avérer nécessaire.
Après guérison, une consultation de contrôle permet de vérifier la disparition complète de l'érythème et l'absence de complications tardives [1]. Cette visite rassure et clôture officiellement l'épisode infectieux.
En cas de nouvelle exposition aux tiques, n'hésitez pas à reconsulter même en l'absence de symptômes apparents. La réinfection reste possible et nécessite la même vigilance que lors du premier épisode [2,4].
Questions Fréquentes
L'érythème chronique migrateur est-il contagieux ?
Non, cette pathologie n'est pas contagieuse entre humains. La transmission nécessite obligatoirement le passage par une tique infectée.
Peut-on avoir plusieurs érythèmes chroniques migrateurs simultanément ?
Oui, les formes disséminées précoces peuvent présenter plusieurs lésions cutanées. Cela témoigne d'une dissémination hématogène de l'infection.
Le traitement antibiotique est-il toujours nécessaire ?
Absolument. Sans traitement, l'érythème chronique migrateur peut évoluer vers des formes compliquées de borréliose de Lyme.
Combien de temps faut-il pour guérir complètement ?
La disparition de l'érythème survient généralement en 2 à 4 semaines après le début du traitement antibiotique.
L'érythème chronique migrateur laisse-t-il des cicatrices ?
Non, cette lésion guérit sans laisser de cicatrice. Une discrète pigmentation résiduelle peut persister quelques mois.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Borréliose de Lyme et autres maladies vectorielles à tiques. HAS. 2024-2025.Lien
- [2] Borréliose de Lyme et autres maladies vectorielles à tiques. HAS. 2024-2025.Lien
- [3] Borréliose de Lyme. HAS.Lien
- [4] Maladie de Lyme - Ministère de la Santé. 2024-2025.Lien
- [5] Lyme disease. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] Ticking Down Sodium Levels—An Atypical Link Between. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] Borrelia PeptideAtlas: A proteome resource of common. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [16] Recommandations Lyme (maladie de). Vidal.Lien
- [17] Maladie de Lyme - Maladies infectieuses. MSD Manuals.Lien
Publications scientifiques
- Phytophotodermatitis (2023)
- Une réaction phototoxique (2023)
- [PDF][PDF] DOCTORAT EN MÉDECINE (2022)[PDF]
- Journée raphaëloise de dermatologie infectieuse (2022)
- Evaluation of clinicopathological features and associated conditions in erythema annulare centrifugum: a retrospective observational analysis of 63 patients (2024)2 citations[PDF]
Ressources web
- Recommandations Lyme (maladie de) (vidal.fr)
12 avr. 2022 — Une antibiothérapie précoce est recommandée en cas d'érythème migrantGrade A : doxycycline ou amoxicilline par voie orale pendant 14 jours (21 ...
- Borréliose de Lyme (has-sante.fr)
Stratégie diagnostique Le diagnostic d'érythème migrant est clinique, et peut être facilité à l'anamnèse par la notion de piqûre de tique récente (datant de ...
- Maladie de Lyme - Maladies infectieuses (msdmanuals.com)
Sans traitement, l'érythème migrant disparaît habituellement en 3 à 4 semaines. De nombreux patients atteints d'érythème migrant ont une lésion unique. ...
- Maladie de Lyme : Symptômes et traitement (canada.ca)
20 janv. 2025 — l'éruption cutanée*; la fièvre; les frissons; la fatigue; les maux de tête; les ganglions lymphatiques enflés; les douleurs musculaires et ...
- Morsure de tique et prévention de la maladie de Lyme (ameli.fr)
23 avr. 2025 — De la fièvre, des maux de tête, une fatigue, des douleurs musculaires ou articulaires...peuvent être associés. Le traitement antibiotique est ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
