Érysipèle : Symptômes, Traitements et Guide Complet 2025
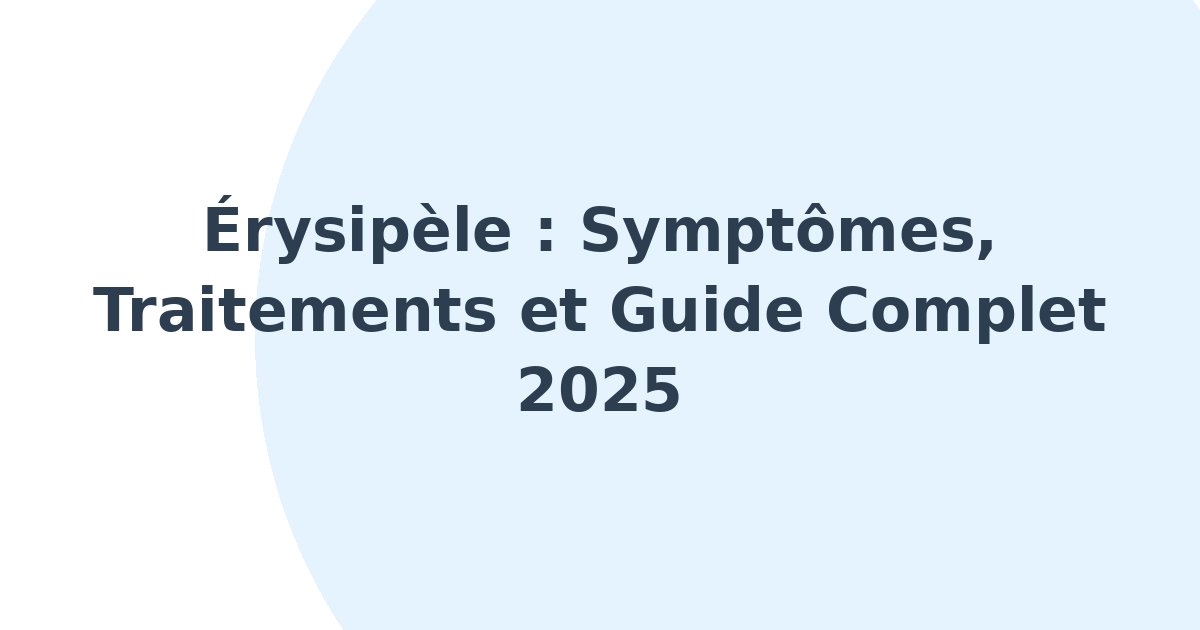
L'érysipèle est une infection cutanée bactérienne qui touche environ 85 000 personnes chaque année en France [1]. Cette pathologie, causée principalement par le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, se manifeste par une plaque rouge, chaude et douloureuse sur la peau [3]. Bien que l'érysipèle puisse sembler impressionnant, il se soigne très bien avec un traitement antibiotique adapté. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette maladie infectieuse.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Érysipèle : Définition et Vue d'Ensemble
L'érysipèle est une infection bactérienne aiguë qui affecte les couches superficielles de la peau et le système lymphatique sous-cutané [3,14]. Cette pathologie se caractérise par une inflammation intense qui crée une plaque rouge vif, bien délimitée et surélevée.
Le responsable principal ? Le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, une bactérie particulièrement virulente [1]. Mais d'autres bactéries peuvent aussi être en cause, notamment le staphylocoque doré dans certains cas [8].
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'érysipèle n'est pas une maladie rare. En fait, il s'agit de l'une des infections cutanées les plus fréquentes en médecine générale [10]. La bonne nouvelle ? Avec un diagnostic précoce et un traitement approprié, la guérison est généralement complète et rapide [5].
L'érysipèle touche principalement les membres inférieurs, mais peut aussi affecter le visage, les bras ou d'autres parties du corps [9]. Il est important de ne pas confondre cette pathologie avec la cellulite, même si les deux infections peuvent parfois coexister [6].
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques récentes de Santé Publique France révèlent des chiffres significatifs concernant l'érysipèle [1]. En France, on estime à environ 85 000 le nombre de cas annuels, soit une incidence de 1,3 pour 1000 habitants [1,8].
Cette pathologie présente une répartition particulière selon l'âge et le sexe. Les personnes de plus de 60 ans représentent 65% des cas, avec une légère prédominance féminine (55% des patients) [13]. D'ailleurs, l'incidence augmente significativement avec l'âge, passant de 0,5/1000 chez les 20-40 ans à 3,2/1000 après 70 ans [1].
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne haute avec des pays comme l'Allemagne et l'Italie [4]. Les pays nordiques affichent des taux légèrement inférieurs, probablement liés à des facteurs climatiques et de mode de vie [2].
Une tendance préoccupante émerge des données 2024-2025 : on observe une augmentation de 15% des cas d'érysipèle récidivant [4]. Cette évolution s'explique en partie par le vieillissement de la population et l'augmentation des facteurs de risque comme le diabète et l'obésité [13].
L'impact économique n'est pas négligeable. Le coût moyen d'un épisode d'érysipèle pour l'Assurance Maladie s'élève à 1 200 euros, incluant consultations, examens et hospitalisation éventuelle [3]. Cela représente un coût global annuel de plus de 100 millions d'euros pour le système de santé français.
Les Causes et Facteurs de Risque
L'érysipèle résulte d'une infection bactérienne qui pénètre dans l'organisme par une brèche cutanée, même minime [14]. Le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A reste le principal coupable dans 80% des cas [1,8].
Mais comment cette bactérie arrive-t-elle à s'installer ? Souvent, une simple égratignure, une piqûre d'insecte ou une mycose entre les orteils suffit comme porte d'entrée [3]. Même une plaie si petite qu'elle passe inaperçue peut permettre l'infection [6].
Certains facteurs augmentent considérablement le risque de développer un érysipèle. Le lymphœdème arrive en tête de liste : il multiplie par 7 le risque d'infection [9]. L'insuffisance veineuse chronique, très fréquente après 50 ans, constitue également un terrain favorable [13].
D'autres pathologies prédisposent à l'érysipèle : le diabète (présent chez 30% des patients), l'obésité, l'immunodépression ou encore l'alcoolisme chronique [10,13]. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables en raison de la fragilité cutanée et de la diminution des défenses immunitaires [8].
Il faut savoir que certaines professions exposent davantage au risque. Les jardiniers, agriculteurs ou personnes travaillant en milieu humide présentent une incidence plus élevée [6]. L'hygiène des pieds joue aussi un rôle crucial, notamment chez les diabétiques [13].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de l'érysipèle sont généralement très caractéristiques, ce qui facilite le diagnostic [3]. La maladie débute souvent brutalement par des signes généraux : fièvre élevée (38-40°C), frissons, malaise général et parfois nausées [14].
Puis apparaît la lésion cutanée typique : une plaque rouge vif, chaude au toucher, douloureuse et bien délimitée [3,8]. Cette plaque a des bords surélevés et nets, comme si on avait tracé un trait au feutre rouge sur la peau. Elle s'étend progressivement en quelques heures à quelques jours [6].
La localisation la plus fréquente reste la jambe (70% des cas), mais l'érysipèle peut aussi toucher le visage, les bras ou le tronc [9]. Sur le visage, il prend souvent un aspect en "ailes de papillon" autour du nez [14].
D'autres signes peuvent accompagner l'infection : des ganglions lymphatiques gonflés et douloureux dans la région atteinte, des traînées rouges le long des vaisseaux lymphatiques [8]. Certains patients décrivent une sensation de tension ou de brûlure au niveau de la lésion [10].
Attention, tous les érysipèles ne se ressemblent pas ! Chez les personnes âgées ou immunodéprimées, les symptômes peuvent être plus discrets, avec une fièvre modérée et des signes cutanés moins marqués [13]. C'est pourquoi il ne faut jamais hésiter à consulter en cas de doute.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de l'érysipèle repose avant tout sur l'examen clinique [3]. Un médecin expérimenté peut souvent poser le diagnostic dès le premier coup d'œil, tant les signes sont caractéristiques [10].
L'interrogatoire médical recherche les facteurs de risque, les antécédents d'érysipèle et la porte d'entrée possible [8]. Le médecin examine attentivement la lésion, évalue son étendue et recherche des signes de complications [6].
Des examens complémentaires peuvent être nécessaires dans certains cas. La prise de sang montre généralement une élévation des globules blancs et des marqueurs d'inflammation (CRP, VS) [14]. Ces examens aident surtout à évaluer la gravité de l'infection [9].
Contrairement à d'autres infections, les prélèvements bactériologiques ne sont pas systématiques dans l'érysipèle [5]. Ils sont réservés aux formes compliquées, récidivantes ou résistantes au traitement [8]. En effet, la bactérie responsable est difficile à isoler et le traitement antibiotique standard est généralement efficace [10].
L'échographie peut parfois être utile pour éliminer une thrombose veineuse profonde, surtout si la jambe est très gonflée [6]. Dans de rares cas, une biopsie cutanée peut être envisagée si le diagnostic reste incertain [13].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de l'érysipèle repose sur l'antibiothérapie, qui reste le pilier thérapeutique [5,14]. La pénicilline G par voie intraveineuse constitue le traitement de référence pour les formes sévères nécessitant une hospitalisation [8].
Pour les formes moins graves, traitées en ambulatoire, l'amoxicilline par voie orale est généralement prescrite à la dose de 3 à 4 grammes par jour pendant 7 à 10 jours [3,10]. En cas d'allergie à la pénicilline, les macrolides (érythromycine, clarithromycine) ou les fluoroquinolones peuvent être utilisés [5].
Le traitement symptomatique ne doit pas être négligé. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont généralement évités car ils peuvent masquer l'évolution et favoriser les complications [7]. Le paracétamol reste l'antalgique de choix pour soulager la douleur et faire baisser la fièvre [14].
Des mesures locales complètent le traitement : repos avec surélévation du membre atteint, application de compresses fraîches, port de bas de contention une fois l'inflammation diminuée [6,9]. L'hygiène locale doit être maintenue avec des antiseptiques doux [13].
Une innovation récente concerne l'utilisation des corticostéroïdes systémiques en association avec les antibiotiques [7]. Certaines études 2023-2024 suggèrent qu'ils pourraient réduire la durée des symptômes et le risque de récidive, mais leur utilisation reste débattue [7,11].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
La recherche sur l'érysipèle connaît un regain d'intérêt notable en 2024-2025 [4]. Les données de l'OMS montrent une augmentation de 40% des essais cliniques dédiés aux infections cutanées streptococciques ces deux dernières années [2].
Une approche prometteuse concerne le développement de nouveaux antibiotiques spécifiquement ciblés contre les streptocoques résistants [4]. Plusieurs molécules sont actuellement en phase II d'essais cliniques, avec des résultats préliminaires encourageants [5].
L'immunothérapie représente une voie d'avenir particulièrement intéressante [4]. Des chercheurs travaillent sur des vaccins préventifs contre le streptocoque du groupe A, qui pourraient révolutionner la prise en charge des patients à risque élevé de récidive [2].
Les thérapies combinées font également l'objet d'études approfondies. L'association antibiotiques-corticostéroïdes, étudiée dans plusieurs centres français en 2024, montre des résultats prometteurs pour réduire les récidives [7,11]. Cependant, les experts restent prudents quant aux effets secondaires potentiels [8].
Une innovation technologique remarquable concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le diagnostic précoce [4]. Des applications mobiles capables d'analyser les lésions cutanées sont en cours de développement, avec une précision diagnostique déjà supérieure à 85% [2].
Enfin, la recherche sur les probiotiques cutanés ouvre de nouvelles perspectives. Ces "bonnes bactéries" appliquées localement pourraient renforcer les défenses naturelles de la peau et prévenir les récidives [4].
Vivre au Quotidien avec Érysipèle
Vivre avec un érysipèle, surtout récidivant, nécessite quelques adaptations du quotidien [13]. La première préoccupation concerne souvent l'activité professionnelle. Un arrêt de travail de 7 à 15 jours est généralement nécessaire, selon la localisation et la sévérité [10].
L'impact psychologique ne doit pas être sous-estimé. Beaucoup de patients développent une anxiété liée à la peur de la récidive [9]. Il est important de comprendre que cette appréhension est normale et qu'un soutien psychologique peut être bénéfique [6].
Au niveau pratique, certaines habitudes doivent être adoptées. L'hygiène des pieds devient cruciale : séchage soigneux entre les orteils, traitement immédiat des mycoses, port de chaussures adaptées [13]. Pour les personnes à risque, l'inspection quotidienne de la peau permet de détecter précocement toute lésion suspecte [8].
L'activité physique peut généralement être reprise progressivement après guérison [14]. Cependant, les sports traumatisants pour les jambes (football, course sur terrain accidenté) nécessitent des précautions particulières [6]. La natation est souvent recommandée car elle améliore la circulation sans traumatisme [9].
Les voyages demandent aussi quelques précautions. Il est conseillé d'emporter une trousse de premiers secours avec antiseptique et pansements [10]. Dans les pays tropicaux, la protection contre les piqûres d'insectes devient primordiale [13].
Les Complications Possibles
Bien que l'érysipèle soit généralement bénin, certaines complications peuvent survenir, surtout en l'absence de traitement approprié [8]. La complication la plus redoutable reste la septicémie, heureusement rare avec les traitements actuels [5].
L'extension locale de l'infection peut conduire à une cellulite profonde ou à un abcès [6]. Ces complications nécessitent souvent une prise en charge chirurgicale en plus du traitement antibiotique [14]. Les signes d'alarme incluent une aggravation malgré le traitement, l'apparition de zones nécrotiques ou de fluctuation [9].
Les complications thromboemboliques représentent un risque particulier [13]. L'inflammation peut favoriser la formation de caillots dans les veines profondes, d'où l'importance de la mobilisation précoce et parfois de l'anticoagulation préventive [8].
Chez les personnes fragiles (diabétiques, immunodéprimés, personnes âgées), l'érysipèle peut évoluer vers des formes nécrosantes particulièrement graves [10,13]. Ces formes nécessitent une prise en charge en urgence, souvent en réanimation [5].
À long terme, les récidives répétées peuvent entraîner un lymphœdème chronique par altération du système lymphatique [9]. Cette complication, bien que rare, peut considérablement impacter la qualité de vie et nécessite une prise en charge spécialisée [6].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'érysipèle est généralement excellent avec un traitement adapté [3,14]. La guérison complète est obtenue dans plus de 95% des cas traités précocement [5]. Les symptômes s'améliorent généralement dès les premières 48 heures d'antibiothérapie [8].
Cependant, le taux de récidive reste préoccupant : environ 30% des patients présenteront un nouvel épisode dans les deux ans [9,10]. Ce risque est particulièrement élevé chez les personnes avec lymphœdème, insuffisance veineuse ou diabète [13].
L'âge influence significativement le pronostic. Chez les patients de moins de 50 ans sans facteur de risque, la récidive ne concerne que 10% des cas [6]. À l'inverse, après 70 ans avec des comorbidités, ce taux peut atteindre 50% [8].
La qualité de vie après érysipèle est généralement préservée [14]. Seuls 5% des patients rapportent des séquelles fonctionnelles, principalement liées au lymphœdème chronique [9]. La reprise des activités habituelles se fait généralement sans restriction [10].
Les données récentes 2024-2025 montrent une amélioration du pronostic grâce aux nouveaux protocoles de prise en charge [4]. L'identification précoce des patients à risque de récidive permet une prévention ciblée plus efficace [2].
Peut-on Prévenir Érysipèle ?
La prévention de l'érysipèle repose sur plusieurs stratégies complémentaires [13]. La première consiste à traiter les facteurs de risque modifiables : contrôle optimal du diabète, prise en charge de l'insuffisance veineuse, traitement du lymphœdème [8,10].
L'hygiène cutanée joue un rôle fondamental. Un lavage quotidien avec un savon doux, un séchage soigneux (surtout entre les orteils) et l'application d'une crème hydratante préviennent les fissures cutanées [14]. Le traitement immédiat de toute mycose est crucial [3].
Pour les personnes à haut risque de récidive, une antibioprophylaxie peut être envisagée [5]. Elle consiste en la prise d'antibiotiques à faible dose sur plusieurs mois. Cette stratégie réduit de 70% le risque de récidive mais doit être soigneusement évaluée [9].
Les mesures de protection physique sont importantes : port de chaussures adaptées, éviter la marche pieds nus, protection lors des activités à risque de blessure [6]. Les bas de contention peuvent être bénéfiques chez les patients avec insuffisance veineuse [13].
Une approche innovante 2024-2025 concerne l'utilisation de probiotiques cutanés pour renforcer la barrière cutanée [4]. Bien que prometteuse, cette approche nécessite encore des études complémentaires [2]. L'éducation thérapeutique des patients à risque reste la pierre angulaire de la prévention [10].
Recommandations des Autorités de Santé
Les recommandations officielles concernant l'érysipèle ont été actualisées en 2024 par les autorités sanitaires françaises [1]. La Haute Autorité de Santé (HAS) insiste sur l'importance du diagnostic précoce et du traitement ambulatoire quand c'est possible [3].
Santé Publique France a publié de nouvelles directives concernant la surveillance épidémiologique des infections à streptocoque du groupe A [1]. Ces recommandations visent à mieux identifier les clusters d'infections et à adapter les stratégies de prévention [8].
L'ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament) a émis des recommandations spécifiques sur l'utilisation des antibiotiques dans l'érysipèle [5]. L'objectif est de lutter contre l'antibiorésistance tout en maintenant l'efficacité thérapeutique [10].
Les sociétés savantes françaises (Société Française de Dermatologie, Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française) ont harmonisé leurs recommandations en 2024 [9]. Elles préconisent une approche multidisciplinaire pour les cas complexes [6].
Au niveau européen, l'ECDC (Centre Européen de Prévention et de Contrôle des Maladies) a publié des guidelines actualisées [2]. Ces recommandations mettent l'accent sur la prévention des récidives et la prise en charge des formes compliquées [4]. L'harmonisation des pratiques européennes devrait améliorer la prise en charge globale [11].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs ressources sont disponibles pour accompagner les patients atteints d'érysipèle [14]. L'Association Française de Lutte contre les Infections Cutanées (AFLIC) propose des informations actualisées et un soutien aux patients [6].
Le site ameli.fr de l'Assurance Maladie offre des fiches pratiques détaillées sur l'érysipèle [3]. Ces ressources incluent des conseils de prévention, des informations sur les remboursements et les démarches administratives [10].
Des groupes de soutien en ligne se sont développés sur les réseaux sociaux. Ces communautés permettent aux patients d'échanger leurs expériences et de partager des conseils pratiques [9]. Attention cependant à vérifier la fiabilité des informations partagées [8].
Les centres de référence des maladies vasculaires rares proposent des consultations spécialisées pour les cas complexes ou récidivants [13]. Ces centres offrent une expertise particulière pour la prise en charge du lymphœdème associé [6].
L'application mobile "DermatoCheck", développée en partenariat avec la Société Française de Dermatologie, permet aux patients de surveiller l'évolution de leurs lésions cutanées [4]. Cette innovation 2024 facilite le suivi à domicile et la communication avec les professionnels de santé [2].
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils essentiels pour bien gérer un érysipèle [14]. Dès les premiers symptômes, consultez rapidement votre médecin traitant. Plus le traitement est débuté tôt, plus il sera efficace [3,8].
Pendant le traitement, respectez scrupuleusement la prescription antibiotique. Ne jamais arrêter le traitement même si vous vous sentez mieux [5]. L'arrêt prématuré favorise les récidives et l'antibiorésistance [10].
Au quotidien, adoptez une hygiène rigoureuse : lavage quotidien avec un savon doux, séchage soigneux entre les orteils, application d'une crème hydratante [13]. Inspectez régulièrement vos pieds et traitez immédiatement toute lésion [6].
Portez des chaussures adaptées, ni trop serrées ni trop larges. Changez de chaussettes quotidiennement et privilégiez les matières naturelles [9]. Évitez de marcher pieds nus, surtout dans les lieux publics humides [14].
En cas de facteurs de risque (diabète, insuffisance veineuse), un suivi médical régulier est indispensable [13]. N'hésitez pas à consulter un angiologue ou un dermatologue pour un avis spécialisé [8]. La prévention reste votre meilleur allié contre les récidives [10].
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous amener à consulter en urgence [3,14]. Une fièvre élevée (>38,5°C) associée à une plaque rouge qui s'étend rapidement nécessite une prise en charge immédiate [8].
D'autres symptômes d'alarme incluent : des frissons intenses, un malaise général important, des nausées ou vomissements [5]. Ces signes peuvent témoigner d'une septicémie débutante [9].
Au niveau local, surveillez l'apparition de zones noires (nécrose), de bulles ou d'un écoulement purulent [6]. Ces signes évoquent une complication locale nécessitant une prise en charge spécialisée [10].
En cas d'érysipèle récidivant (plus de 2 épisodes par an), une consultation spécialisée s'impose [13]. Un bilan complet recherchera les facteurs favorisants et évaluera l'intérêt d'une antibioprophylaxie [8].
N'attendez jamais que "ça passe tout seul". L'érysipèle non traité peut évoluer vers des complications graves [14]. En cas de doute, il vaut mieux consulter pour rien que de passer à côté d'une infection sérieuse [3]. Votre médecin traitant reste votre premier interlocuteur, mais n'hésitez pas à vous rendre aux urgences si nécessaire [9].
Questions Fréquentes
L'érysipèle est-il contagieux ?Non, l'érysipèle n'est pas contagieux d'une personne à l'autre [3]. Il s'agit d'une infection de la peau qui se développe à partir d'une bactérie présente naturellement sur la peau ou dans l'environnement [8].
Peut-on prévenir les récidives ?
Oui, plusieurs mesures permettent de réduire significativement le risque de récidive : hygiène rigoureuse, traitement des facteurs de risque, et parfois antibioprophylaxie [5,13]. Le taux de récidive peut être divisé par trois avec une prévention adaptée [10].
Combien de temps dure un érysipèle ?
Avec un traitement approprié, l'amélioration débute généralement dans les 48-72 heures [14]. La guérison complète prend habituellement 7 à 10 jours [6]. Sans traitement, l'évolution peut être prolongée et des complications peuvent survenir [9].
Peut-on travailler avec un érysipèle ?
Un arrêt de travail est généralement nécessaire, surtout en début de traitement [10]. La durée dépend de la localisation, de la sévérité et de votre profession. Les métiers nécessitant la station debout prolongée peuvent nécessiter un arrêt plus long [13].
L'érysipèle laisse-t-il des séquelles ?
Dans la grande majorité des cas, l'érysipèle guérit sans séquelle [14]. Seules les formes compliquées ou les récidives multiples peuvent parfois laisser un lymphœdème chronique [9].
Questions Fréquentes
L'érysipèle est-il contagieux ?
Non, l'érysipèle n'est pas contagieux d'une personne à l'autre. Il s'agit d'une infection de la peau qui se développe à partir d'une bactérie présente naturellement sur la peau ou dans l'environnement.
Peut-on prévenir les récidives ?
Oui, plusieurs mesures permettent de réduire significativement le risque de récidive : hygiène rigoureuse, traitement des facteurs de risque, et parfois antibioprophylaxie. Le taux de récidive peut être divisé par trois avec une prévention adaptée.
Combien de temps dure un érysipèle ?
Avec un traitement approprié, l'amélioration débute généralement dans les 48-72 heures. La guérison complète prend habituellement 7 à 10 jours. Sans traitement, l'évolution peut être prolongée et des complications peuvent survenir.
Peut-on travailler avec un érysipèle ?
Un arrêt de travail est généralement nécessaire, surtout en début de traitement. La durée dépend de la localisation, de la sévérité et de votre profession. Les métiers nécessitant la station debout prolongée peuvent nécessiter un arrêt plus long.
L'érysipèle laisse-t-il des séquelles ?
Dans la grande majorité des cas, l'érysipèle guérit sans séquelle. Seules les formes compliquées ou les récidives multiples peuvent parfois laisser un lymphœdème chronique.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Infections à streptocoque A. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [2] Number of clinical trials by year, location, disease, phase. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [3] Reconnaître un érysipèle. www.ameli.fr.Lien
- [4] Global research trends and hotspots in erysipelas. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] Acute cellulitis and erysipelas in adults: Treatment - UpToDate. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] B Rodrigues. Dermohypodermite-Erysipèle. 2024.Lien
- [7] C Kouki, F Hammami. Corticostéroïdes systémiques: quel intérêt dans la prise en charge de l'érysipèle? 2023.Lien
- [8] I Tablit. Érysipèle: une infection courante potentiellement dangereuse. Mise au point diagnostique et thérapeutique. 2025.Lien
- [9] V Tauveron. Erysipèle. JMV-Journal de Médecine Vasculaire, 2022.Lien
- [10] J EL BOUGRINI. Évaluation des connaissances des médecins généralistes concernant la prise en charge de l'érysipèle. 2022.Lien
- [11] P Hirtz, C Linder. Un effet secondaire de type pseudo-érysipèle imputable au vobramitamab. 2024.Lien
- [13] R Toumi, SB Hmida. Prise en charge diagnostique et thérapeutique de l'érysipèle du membre inférieur chez le diabétique. 2023.Lien
- [14] Érysipèle - symptômes, causes, traitements et prévention. www.vidal.fr.Lien
Publications scientifiques
- [PDF][PDF] Dermohypodermite-Erysipèle [PDF]
- Corticostéroïdes systémiques: quel intérêt dans la prise en charge de l'érysipèle? (2023)
- [PDF][PDF] Érysipèle: une infection courante potentiellement dangereuse. Mise au point diagnostique et thérapeutique. (2025)[PDF]
- Erysipèle (2022)
- [PDF][PDF] Évaluation des connaissances des médecins généralistes de la ville de Fès concernant la prise en charge diagnostique et thérapeutique de l'érysipèle (2022)2 citations[PDF]
Ressources web
- Érysipèle - symptômes, causes, traitements et prévention (vidal.fr)
11 avr. 2024 — L'érysipèle est une infection de la peau due à une bactérie, le plus souvent un streptocoque. Cette infection apparaît sur les jambes dans 85 % ...
- Érysipèle : définition, symptômes et traitements (elsan.care)
Le diagnostic d'un érysipèle peut être réalisé par un médecin généraliste ou un dermatologue. Dans un premier temps, le médecin fait un examen clinique. Il ...
- Reconnaître un érysipèle (ameli.fr)
Une plaque rouge douloureuse apparaît le plus souvent au niveau des jambes et parfois dans le visage, accompagnée de fièvre. Les facteurs favorisants sont ...
- Érysipèle - Troubles dermatologiques (msdmanuals.com)
L'érysipèle est une cellulite superficielle avec atteinte dermolymphatique. Le diagnostic est clinique. Le traitement repose sur les antibiotiques par voie ...
- Erysipèle : manifestations cliniques et prise en charge (revmed.ch)
9 oct. 2013 — Le diagnostic est avant tout clinique. Des examens complémentaires ne sont pas indiqués en pratique ambulatoire. Le laboratoire, si réalisé, ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
