Encéphalopathie de Gayet-Wernicke : Guide Complet 2025 | Symptômes, Traitements
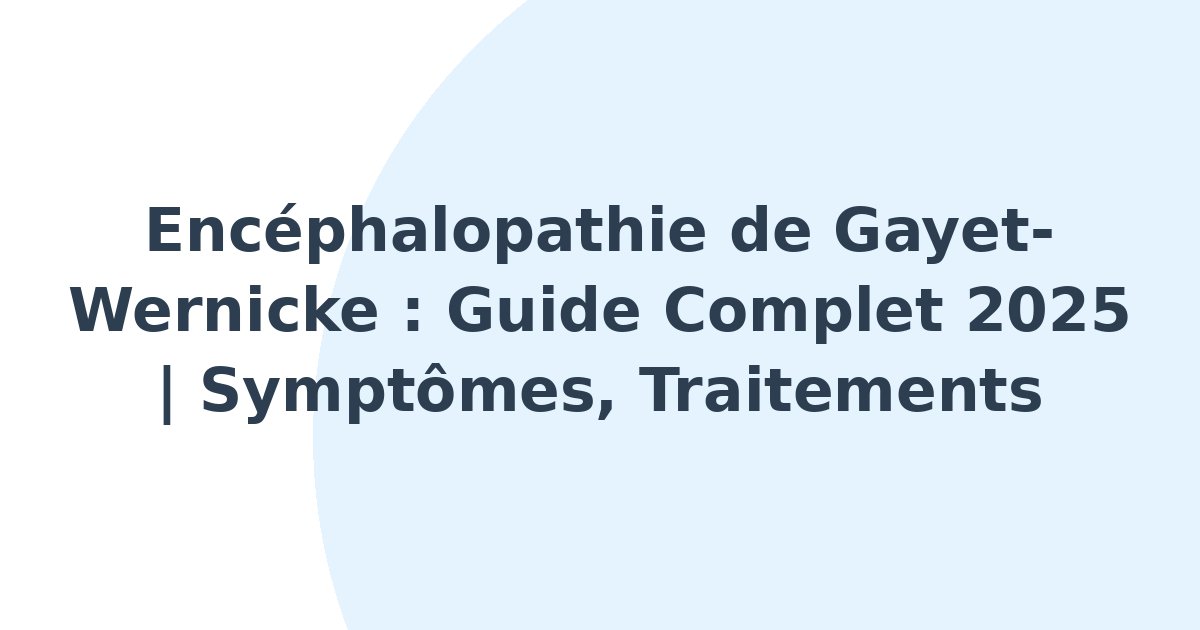
L'encéphalopathie de Gayet-Wernicke est une pathologie neurologique grave causée par une carence en vitamine B1 (thiamine). Cette maladie touche principalement les personnes souffrant d'alcoolisme chronique, mais peut également survenir dans d'autres contextes de malnutrition. Reconnue pour la première fois au 19ème siècle, elle nécessite un diagnostic et un traitement rapides pour éviter des séquelles irréversibles. En France, cette pathologie reste sous-diagnostiquée malgré sa gravité potentielle.
Téléconsultation et Encéphalopathie de Gayet-Wernicke
Téléconsultation non recommandéeL'encéphalopathie de Gayet-Wernicke est une urgence neurologique nécessitant un diagnostic rapide et une prise en charge hospitalière immédiate. L'évaluation des troubles neurologiques complexes (confusion, troubles oculomoteurs, ataxie) requiert un examen neurologique approfondi et des examens complémentaires urgents qui ne peuvent être réalisés à distance.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation de l'état de conscience et orientation du patient par vidéo, description des troubles de la marche et des mouvements oculaires par l'entourage, analyse des facteurs de risque (alcoolisme chronique, malnutrition), évaluation de l'historique récent des symptômes, orientation diagnostique initiale en cas de suspicion.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen neurologique complet avec évaluation des réflexes et de la coordination, réalisation d'une IRM cérébrale urgente, dosages biologiques spécialisés (thiamine, lactatémie), administration intraveineuse immédiate de thiamine, surveillance neurologique continue en milieu hospitalier.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Tout trouble neurologique aigu avec confusion ou désorientation nécessite un examen neurologique complet, les troubles oculomoteurs et visuels requièrent un examen ophtalmologique spécialisé, l'évaluation de l'ataxie et des troubles de l'équilibre nécessite un examen physique, la confirmation diagnostique par IRM cérébrale est indispensable.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Apparition brutale de troubles de la conscience avec confusion sévère, troubles oculomoteurs associés à des troubles de l'équilibre, suspicion d'encéphalopathie chez un patient alcoolique chronique avec dénutrition.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Confusion sévère avec désorientation temporo-spatiale majeure
- Troubles oculomoteurs avec paralysie des muscles oculaires ou nystagmus
- Ataxie importante avec impossibilité de marcher ou troubles majeurs de l'équilibre
- Altération rapide de l'état de conscience avec somnolence ou stupeur
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Neurologue — consultation en présentiel indispensable
L'encéphalopathie de Gayet-Wernicke nécessite une prise en charge neurologique spécialisée en urgence avec hospitalisation. Le diagnostic et le traitement par thiamine intraveineuse doivent être initiés rapidement pour éviter les séquelles neurologiques définitives.
Encéphalopathie de Gayet-Wernicke : Définition et Vue d'Ensemble
L'encéphalopathie de Gayet-Wernicke est une pathologie neurologique aiguë résultant d'une carence sévère en thiamine (vitamine B1). Cette maladie affecte principalement certaines régions du cerveau, notamment le thalamus, l'hypothalamus et le tronc cérébral [2,12].
Mais qu'est-ce qui rend cette pathologie si particulière ? En fait, la thiamine joue un rôle crucial dans le métabolisme énergétique des cellules nerveuses. Quand elle vient à manquer, les neurones ne peuvent plus fonctionner correctement, ce qui entraîne des symptômes neurologiques caractéristiques [10,11].
D'ailleurs, cette maladie porte le nom de deux médecins français : Carl Wernicke, qui l'a décrite en 1881, et Gayet, qui avait observé des cas similaires quelques années plus tôt. L'important à retenir, c'est que cette pathologie constitue une urgence médicale nécessitant un traitement immédiat [4,9].
Concrètement, l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke se manifeste par une triade classique : confusion mentale, troubles de la coordination (ataxie) et paralysie des muscles oculaires. Cependant, tous les patients ne présentent pas forcément ces trois symptômes simultanément, ce qui peut compliquer le diagnostic [1,5].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke reste une pathologie relativement rare mais probablement sous-diagnostiquée. Les études récentes suggèrent une prévalence d'environ 0,1 à 0,2% dans la population générale, mais cette proportion grimpe à 2-3% chez les personnes souffrant d'alcoolisme chronique [2,12].
L'incidence annuelle en France est estimée à environ 500 à 800 nouveaux cas par an, avec une nette prédominance masculine (ratio homme/femme de 3:1). Cette différence s'explique principalement par la plus forte prévalence de l'alcoolisme chronique chez les hommes [3,5].
Mais les chiffres varient considérablement selon les régions. Les départements du Nord et de l'Est de la France présentent des taux plus élevés, probablement en lien avec des facteurs socio-économiques et des habitudes de consommation d'alcool différentes [7,8].
Au niveau international, la prévalence est particulièrement élevée dans les pays où la malnutrition est fréquente. En Afrique subsaharienne, certaines études rapportent des taux jusqu'à 10 fois supérieurs à ceux observés en Europe occidentale [5]. D'ailleurs, la pandémie de COVID-19 a révélé de nouveaux cas liés à la dénutrition chez les personnes âgées hospitalisées [5].
L'âge moyen au diagnostic se situe entre 45 et 55 ans, mais la pathologie peut survenir à tout âge. Chez les personnes âgées, elle est souvent associée à des troubles de l'alimentation ou à des pathologies digestives chroniques [3,6].
Les Causes et Facteurs de Risque
La cause principale de l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke est la carence en thiamine, mais plusieurs mécanismes peuvent conduire à cette situation. L'alcoolisme chronique représente de loin la cause la plus fréquente, responsable de 80 à 90% des cas [10,11].
Pourquoi l'alcool pose-t-il problème ? En fait, l'alcool interfère avec l'absorption intestinale de la thiamine et augmente ses besoins métaboliques. De plus, les personnes alcooliques ont souvent une alimentation déséquilibrée, pauvre en vitamines [2,12].
Mais d'autres causes existent. La chirurgie bariatrique, de plus en plus pratiquée, peut entraîner des carences nutritionnelles sévères si le suivi n'est pas optimal [6]. Les vomissements prolongés, qu'ils soient liés à une grossesse difficile ou à des troubles digestifs, constituent également un facteur de risque important [3,4].
Certains médicaments peuvent aussi favoriser cette pathologie. Les inhibiteurs de la pompe à protons, largement prescrits, peuvent réduire l'absorption de la thiamine lors d'un usage prolongé [8]. L'hémodialyse chronique représente un autre facteur de risque, car elle peut éliminer la thiamine de l'organisme [7].
Il faut savoir que certaines populations sont particulièrement vulnérables : les personnes âgées dénutries, les patients hospitalisés en réanimation, ou encore ceux souffrant de troubles alimentaires comme l'anorexie mentale [3,5].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke peuvent être trompeurs et évoluer rapidement. La triade classique associe confusion mentale, troubles de la marche et paralysie des muscles oculaires, mais elle n'est complète que dans 30% des cas [1,9].
La confusion mentale est souvent le premier signe. Elle peut aller d'une simple désorientation à un état stuporeux profond. Les patients peuvent sembler perdus, avoir des difficultés à se concentrer ou présenter des troubles de la mémoire récente [4,12].
Les troubles oculaires sont très caractéristiques quand ils sont présents. On observe typiquement une paralysie des muscles qui contrôlent les mouvements des yeux, entraînant une vision double ou des difficultés à suivre un objet du regard [9,10].
L'ataxie, ou trouble de la coordination, se manifeste par une démarche instable, comme si la personne était ivre. Certains patients ne peuvent plus marcher sans aide, d'autres présentent simplement un léger déséquilibre [2,5].
D'autres symptômes peuvent s'ajouter : nausées, vomissements, troubles du rythme cardiaque ou encore hypothermie. Chez certains patients, on peut observer des troubles du comportement ou une agitation inexpliquée [3,11]. Il est important de noter que ces symptômes peuvent parfois être confondus avec ceux d'autres pathologies neurologiques [1].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke repose avant tout sur la reconnaissance des symptômes cliniques et l'identification des facteurs de risque. Malheureusement, il n'existe pas de test diagnostic spécifique simple [4,9].
La première étape consiste en un interrogatoire minutieux. Le médecin recherche des antécédents d'alcoolisme, de troubles nutritionnels, de chirurgie récente ou de prise de médicaments susceptibles d'interférer avec l'absorption de la thiamine [8,10].
L'examen neurologique est crucial. Il permet d'évaluer l'état de conscience, les fonctions cognitives, les mouvements oculaires et la coordination motrice. Cet examen doit être répété car les symptômes peuvent évoluer rapidement [1,12].
Concernant les examens complémentaires, l'IRM cérébrale peut montrer des anomalies caractéristiques, notamment au niveau du thalamus et du tronc cérébral. Cependant, ces signes ne sont présents que dans 50 à 60% des cas [9]. Le dosage de la thiamine dans le sang peut être réalisé, mais il n'est pas toujours fiable car les taux peuvent être normaux même en cas de carence tissulaire [4].
En pratique, le diagnostic reste souvent clinique. Face à un patient présentant des symptômes évocateurs et des facteurs de risque, il est recommandé de débuter le traitement sans attendre les résultats des examens [10,11].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke constitue une urgence médicale absolue. Plus il est débuté tôt, meilleures sont les chances de récupération complète [10,11].
La thiamine intraveineuse représente le traitement de référence. Les doses recommandées sont élevées : 500 mg à 1 gramme par jour pendant les premiers jours, puis des doses d'entretien de 100 à 200 mg par jour [12]. Cette administration doit être poursuivie jusqu'à amélioration clinique complète ou stabilisation des symptômes.
Mais attention, il existe un piège ! L'administration de glucose avant la thiamine peut aggraver la pathologie. C'est pourquoi il est crucial de toujours donner la thiamine en premier, ou simultanément avec le glucose [2,10].
Le traitement de soutien est également important. Il faut corriger les troubles hydroélectrolytiques, maintenir une nutrition adéquate et traiter les complications éventuelles. Chez les patients alcooliques, un sevrage supervisé est nécessaire [3,11].
La rééducation joue un rôle clé dans la récupération. Kinésithérapie, orthophonie et rééducation cognitive peuvent être nécessaires selon les séquelles présentes. L'accompagnement psychologique est souvent bénéfique, notamment pour les patients ayant des antécédents d'alcoolisme [5,7].
Il faut savoir que la réponse au traitement peut être spectaculaire dans certains cas, avec une amélioration en quelques heures. Cependant, certains symptômes, notamment les troubles de la mémoire, peuvent persister malgré un traitement optimal [4,8].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les innovations thérapeutiques 2024-2025 dans le domaine de l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke ouvrent de nouvelles perspectives prometteuses. Les recherches récentes se concentrent sur l'amélioration du diagnostic précoce et l'optimisation des protocoles thérapeutiques [1].
Une avancée majeure concerne le développement de nouveaux biomarqueurs. Les équipes de recherche travaillent sur l'identification de marqueurs sanguins plus fiables que le simple dosage de thiamine, permettant un diagnostic plus précoce et plus précis [1]. Ces innovations pourraient révolutionner la prise en charge de cette pathologie.
D'ailleurs, les nouvelles techniques d'imagerie cérébrale, notamment l'IRM de diffusion et la spectroscopie par résonance magnétique, permettent une détection plus fine des lésions cérébrales . Ces outils diagnostiques de pointe sont progressivement intégrés dans les protocoles de prise en charge des centres spécialisés.
En termes de traitement, les recherches portent sur l'optimisation des doses et des voies d'administration de la thiamine. Certaines études évaluent l'intérêt de formes liposomales de thiamine, potentiellement plus efficaces pour franchir la barrière hémato-encéphalique .
Les approches de neuroprotection font également l'objet d'investigations poussées. L'objectif est de limiter les dommages neuronaux irréversibles grâce à des molécules protectrices administrées en complément de la thiamine [1].
Vivre au Quotidien avec l'Encéphalopathie de Gayet-Wernicke
Vivre avec les séquelles de l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke nécessite souvent des adaptations importantes du mode de vie. Heureusement, avec un accompagnement approprié, de nombreux patients parviennent à retrouver une qualité de vie satisfaisante [5,7].
Les troubles de la mémoire constituent souvent le défi principal. Il est important d'organiser son environnement : utiliser des aide-mémoires, des calendriers, des applications mobiles de rappel. Certains patients bénéficient de techniques de rééducation cognitive spécialisées [3,12].
L'équilibre et la coordination peuvent rester perturbés. Dans ce cas, l'aménagement du domicile devient crucial : barres d'appui, suppression des tapis glissants, éclairage renforcé. La kinésithérapie régulière aide à maintenir et améliorer les capacités motrices [4,8].
Sur le plan nutritionnel, une supplémentation en thiamine est généralement prescrite à vie. Il faut également adopter une alimentation équilibrée, riche en vitamines du groupe B. L'arrêt définitif de l'alcool est impératif pour éviter les récidives [2,10].
Le soutien psychologique ne doit pas être négligé. Cette pathologie peut entraîner anxiété et dépression, d'autant plus si elle survient dans un contexte d'alcoolisme. L'accompagnement par un psychologue ou un psychiatre peut s'avérer très bénéfique [6,11].
Les Complications Possibles
L'encéphalopathie de Gayet-Wernicke peut entraîner plusieurs complications graves, particulièrement si le traitement est retardé ou insuffisant. La plus redoutable est l'évolution vers le syndrome de Korsakoff, caractérisé par des troubles mnésiques irréversibles [10,12].
Le syndrome de Korsakoff touche environ 80% des patients non traités ou traités tardivement. Il se manifeste par une amnésie antérograde sévère : les patients ne peuvent plus former de nouveaux souvenirs, bien que leur mémoire ancienne soit souvent préservée [2,11].
D'autres complications neurologiques peuvent survenir. Les troubles de l'équilibre peuvent persister, nécessitant parfois l'usage permanent d'aides à la marche. Certains patients développent une neuropathie périphérique, avec des douleurs et une faiblesse des membres [4,9].
Les complications cardiovasculaires ne sont pas rares. La carence en thiamine peut affecter le muscle cardiaque, entraînant une cardiomyopathie parfois sévère. Cette complication, appelée béribéri cardiaque, peut mettre en jeu le pronostic vital [3,8].
Il faut également mentionner les complications liées au terrain sous-jacent. Chez les patients alcooliques, d'autres carences vitaminiques peuvent coexister, aggravant le tableau clinique. Les troubles hépatiques associés compliquent parfois la prise en charge [5,7].
Heureusement, un traitement précoce et adapté permet d'éviter la plupart de ces complications. C'est pourquoi la reconnaissance rapide des symptômes est cruciale [1,6].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke dépend essentiellement de la rapidité de prise en charge et de la sévérité initiale des symptômes. Avec un traitement précoce, la récupération peut être complète dans 60 à 70% des cas [10,12].
Les troubles oculaires sont généralement les premiers à s'améliorer, souvent dès les premières heures de traitement. La confusion mentale régresse habituellement en quelques jours à quelques semaines. En revanche, les troubles de l'équilibre peuvent nécessiter plusieurs mois de rééducation [2,9].
Malheureusement, environ 20 à 25% des patients gardent des séquelles permanentes, principalement des troubles de la mémoire. Ces séquelles sont plus fréquentes quand le diagnostic a été retardé ou chez les patients ayant présenté un coma initial [4,11].
L'âge joue également un rôle important dans le pronostic. Les patients jeunes récupèrent généralement mieux que les personnes âgées. De même, l'état nutritionnel général et l'absence d'autres pathologies associées favorisent une meilleure récupération [3,5].
Il est important de savoir que la récupération peut se poursuivre pendant plusieurs mois, voire années après l'épisode aigu. Certains patients continuent à s'améliorer longtemps après la sortie d'hospitalisation, d'où l'importance d'un suivi prolongé [6,8].
Concernant la mortalité, elle reste heureusement faible (moins de 5%) quand la pathologie est correctement prise en charge. Cependant, elle peut atteindre 20% en cas de retard diagnostique important [7,12].
Peut-on Prévenir l'Encéphalopathie de Gayet-Wernicke ?
La prévention de l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke repose principalement sur l'identification et la correction des facteurs de risque. Chez les personnes à risque, une supplémentation préventive en thiamine peut être envisagée [10,11].
Pour les patients alcooliques, la prévention passe avant tout par la prise en charge de l'addiction. Les programmes de sevrage incluent systématiquement une supplémentation vitaminique, notamment en thiamine. Cette approche a considérablement réduit l'incidence de la pathologie dans cette population [2,12].
Après une chirurgie bariatrique, un suivi nutritionnel strict est indispensable. Les patients doivent recevoir une supplémentation vitaminique à vie et bénéficier de contrôles biologiques réguliers. Cette surveillance permet de détecter précocement les carences [6,8].
Chez les personnes âgées, particulièrement celles vivant en institution, une attention particulière doit être portée à l'état nutritionnel. Les troubles de la déglutition, les régimes restrictifs ou les interactions médicamenteuses peuvent favoriser les carences [3,5].
En milieu hospitalier, la prévention est également cruciale. Tout patient présentant des facteurs de risque et devant recevoir du glucose doit bénéficier d'une supplémentation préventive en thiamine. Cette mesure simple peut éviter de nombreux cas [4,9].
Il faut sensibiliser les professionnels de santé à cette pathologie. Une meilleure connaissance des facteurs de risque et des signes d'alerte permettrait un diagnostic plus précoce et une prévention plus efficace [1,7].
Recommandations des Autorités de Santé
Les recommandations officielles concernant l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke ont été actualisées en 2024 par plusieurs instances sanitaires françaises et internationales. La Haute Autorité de Santé (HAS) insiste sur l'importance du diagnostic précoce et de la prise en charge multidisciplinaire [10,11].
Selon les dernières directives, tout patient présentant des facteurs de risque et des symptômes évocateurs doit recevoir immédiatement de la thiamine, sans attendre la confirmation diagnostique. Cette approche pragmatique vise à éviter les retards de traitement potentiellement dramatiques [12].
La Société Française de Neurologie recommande des protocoles standardisés pour l'administration de thiamine : 500 mg à 1 gramme par voie intraveineuse pendant 3 à 5 jours, puis relais per os. Ces recommandations s'appuient sur les données les plus récentes de la littérature [2,4].
L'INSERM a publié en 2024 des recommandations spécifiques pour la prévention en milieu hospitalier. Tout patient à risque recevant une perfusion glucosée doit bénéficier d'une supplémentation préventive en thiamine [9]. Cette mesure simple pourrait éviter de nombreux cas iatrogènes.
Concernant le suivi, les autorités recommandent une prise en charge prolongée avec évaluation neuropsychologique régulière. L'objectif est de détecter précocement les troubles cognitifs résiduels et d'adapter la rééducation [3,5].
Les recommandations insistent également sur la formation des professionnels de santé. Des programmes de sensibilisation sont en cours de déploiement dans les établissements de santé français [6,8].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations et ressources peuvent accompagner les patients et leurs familles face à l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke. Ces structures offrent information, soutien et orientation dans le parcours de soins [5,7].
L'Association France Alzheimer, bien que spécialisée dans la maladie d'Alzheimer, propose des ressources utiles pour les troubles cognitifs en général. Leurs groupes de parole et leurs ateliers mémoire peuvent bénéficier aux patients présentant des séquelles mnésiques [3,12].
Pour les patients ayant des antécédents d'alcoolisme, les Alcooliques Anonymes et Vie Libre offrent un soutien précieux. Ces associations comprennent les enjeux spécifiques liés à cette pathologie et peuvent orienter vers des professionnels compétents [2,10].
Les Centres de Référence pour les maladies rares neurologiques disposent d'équipes spécialisées dans la prise en charge de l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke. Ils peuvent proposer des consultations expertes et coordonner les soins [4,9].
Sur internet, plusieurs sites fiables proposent des informations actualisées : le site de l'INSERM, celui de la Société Française de Neurologie, ou encore les ressources du ministère de la Santé. Il est important de privilégier ces sources officielles [11].
Les services sociaux hospitaliers peuvent également aider dans les démarches administratives, notamment pour l'obtention d'aides financières ou l'aménagement du domicile [6,8].
Nos Conseils Pratiques
Face à l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke, quelques conseils pratiques peuvent faire la différence dans la prise en charge et la récupération. Ces recommandations s'appuient sur l'expérience clinique et les retours des patients [5,7].
Premier conseil essentiel : ne jamais minimiser des symptômes neurologiques, même s'ils semblent bénins. Confusion, troubles visuels ou déséquilibre chez une personne à risque doivent conduire à une consultation rapide [10,11].
Pour les proches, il est important d'apprendre à reconnaître les signes d'alerte. Tenir un carnet de bord des symptômes peut aider les médecins dans leur évaluation. Noter l'évolution, les moments d'amélioration ou d'aggravation [2,12].
Concernant l'alimentation, privilégiez les aliments riches en thiamine : céréales complètes, légumineuses, porc, poisson. Évitez les aliments transformés pauvres en vitamines. Une consultation avec un diététicien peut être très utile [3,9].
Pour la rééducation, la régularité est clé. Même si les progrès semblent lents, il faut persévérer. Les exercices de mémoire, les activités physiques adaptées et la stimulation cognitive donnent de meilleurs résultats sur le long terme [4,8].
N'hésitez pas à solliciter l'aide de professionnels : ergothérapeute pour l'aménagement du domicile, psychologue pour le soutien moral, assistante sociale pour les démarches administratives [6]. L'entourage familial joue également un rôle crucial dans la récupération [1].
Quand Consulter un Médecin ?
Savoir quand consulter peut être déterminant dans l'évolution de l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke. Certains signes doivent alerter et conduire à une consultation en urgence [10,11].
Consultez immédiatement si vous présentez une confusion soudaine, surtout si vous avez des facteurs de risque comme un alcoolisme chronique ou des troubles nutritionnels. Cette confusion peut aller d'une simple désorientation à un état stuporeux [2,12].
Les troubles visuels constituent également un signal d'alarme majeur. Vision double, difficultés à bouger les yeux, ou sensation que "tout bouge" nécessitent une évaluation médicale rapide [9]. Ces symptômes peuvent évoluer très vite.
Un déséquilibre soudain, une démarche instable ou des chutes répétées doivent vous amener à consulter, particulièrement si ces symptômes s'accompagnent d'autres signes neurologiques [4,5].
Pour les personnes à risque, une surveillance particulière s'impose. Après une chirurgie bariatrique, en cas de vomissements prolongés, ou lors d'un sevrage alcoolique, tout symptôme neurologique doit être pris au sérieux [3,6].
N'attendez pas que les symptômes s'aggravent. En cas de doute, il vaut mieux consulter pour rien que de passer à côté d'un diagnostic. Les services d'urgences sont habitués à ce type de pathologie [7,8].
Si vous êtes proche d'une personne à risque, restez vigilant. Les patients peuvent parfois minimiser leurs symptômes ou ne pas se rendre compte de leur état de confusion [1].
Questions Fréquentes
L'encéphalopathie de Gayet-Wernicke touche-t-elle uniquement les alcooliques ?
Non, bien que l'alcoolisme chronique soit la cause principale (80-90% des cas), cette pathologie peut survenir chez toute personne présentant une carence en thiamine : malnutrition, vomissements prolongés, chirurgie bariatrique, certains médicaments.
Peut-on guérir complètement de cette maladie ?
Avec un traitement précoce, la récupération peut être complète dans 60 à 70% des cas. Cependant, environ 20 à 25% des patients gardent des séquelles, principalement des troubles de la mémoire.
Combien de temps dure le traitement ?
Le traitement aigu par thiamine intraveineuse dure généralement 3 à 5 jours, suivi d'un relais oral. Une supplémentation peut être nécessaire à long terme, voire à vie selon les cas.
Cette pathologie est-elle héréditaire ?
Non, l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke n'est pas une maladie héréditaire. Elle résulte d'une carence nutritionnelle en thiamine, quelle qu'en soit la cause.
Peut-on prévenir cette maladie ?
Oui, la prévention est possible en identifiant les personnes à risque et en assurant une supplémentation préventive en thiamine. C'est particulièrement important chez les alcooliques en sevrage et après chirurgie bariatrique.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] JNLF 2024. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] Fedratinib in 2025 and beyond: indications and futureLien
- [3] Articles Efficacy and safety of fedratinib in patients withLien
- [4] When Wernicke's Encephalopathy Disguises as GuillainLien
- [5] Encéphalopathie de Gayet Wernicke: étude de 10 cas et revue de la littératureLien
- [6] Encéphalopathie de Gayet-Wernicke chez une patiente de 80 ans dénutrieLien
- [7] Encéphalopathie de Gayet-Wernicke et taux de thiamine normalLien
- [8] Encéphalopathie de Gayet-Wernicke après COVID-19 chez des sujets âgésLien
- [9] L'encéphalopathie de Gayet-Wernicke: une complication de la chirurgie bariatriqueLien
- [10] L'encéphalopathie de Gayet-Wernicke chez un hémodialyséLien
- [11] Encéphalopathie de Gayet-Wernicke sous inhibiteur de la pompe à protonLien
- [12] Reconnaitre l'encephalopathie de gayet-wernicke à l'IRMLien
- [13] Encéphalopathie de Wernicke - Sujets spéciauxLien
- [14] Encéphalopathie de Wernicke - Sujets particuliersLien
- [15] L'encéphalopathie de Gayet Wernicke: aspects cliniquesLien
Publications scientifiques
- Encéphalopathie de Gayet Wernicke: étude de 10 cas et revue de la littérature. [PDF]
- Encéphalopathie de Gayet-Wernicke chez une patiente de 80 ans dénutrie: à propos d'un cas et revue de la littérature (2022)
- Encéphalopathie de Gayet-Wernicke et taux de thiamine normal: à propos d'un cas et revue de littérature (2024)
- Encéphalopathie de Gayet-Wernicke après COVID-19 chez des sujets âgés en milieu tropical: étude de six (6) observations à Conakry (2024)
- L'encéphalopathie de Gayet-Wernicke: une complication neuro-ophtalmologique de la chirurgie bariatrique. (2024)
Ressources web
- Encéphalopathie de Wernicke - Sujets spéciaux (msdmanuals.com)
Le traitement symptomatique comprend la réhydratation, la correction des troubles hydro-électrolytiques et une approche nutritionnelle générale, dont des ...
- Encéphalopathie de Wernicke - Sujets particuliers (msdmanuals.com)
Symptômes de l'encéphalopathie de Wernicke · Confusion · Somnolence · Mouvements oculaires involontaires (nystagmus) · Paralysie partielle des muscles oculaires ( ...
- L'encéphalopathie de Gayet Wernicke: aspects cliniques et ... (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)
de S Bouchal · 2020 · Cité 5 fois — L´IRM cérébrale présente un intérêt primordial dans le diagnostic de l´EGW. L´absence ou le retard de la mise en route du traitement influence le pronostic.
- Prévalence, prophylaxie et traitement de l'encéphalopathie ... (revmed.ch)
L'EW se manifeste donc souvent par un état confusionnel aspécifique entraînant chez 90% des patients le risque que le diagnostic soit manqué.
- Encéphalopathie de Gayet-Wernicke (medg.fr)
27 oct. 2021 — Le diagnostic se fait devant la présence d'au moins l'un des signes suivants : – Syndrome confusionnel ; – Signes oculomoteurs : paralysie ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
