Empyème Subdural : Symptômes, Traitement et Pronostic - Guide 2025
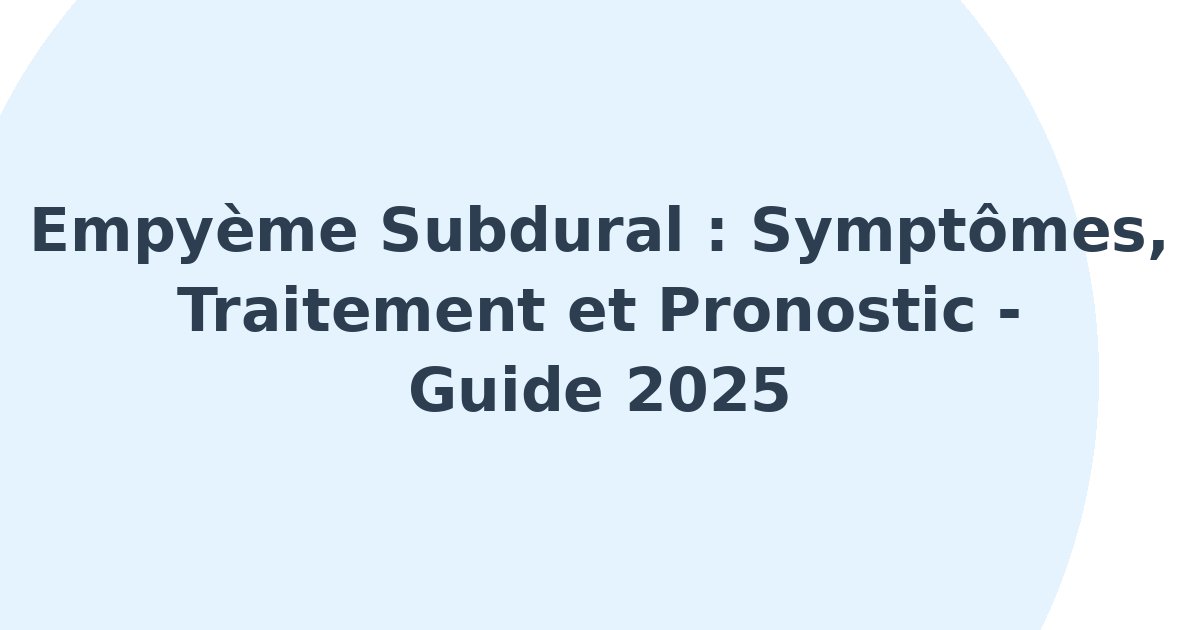
L'empyème subdural représente une urgence neurochirurgicale majeure caractérisée par une collection purulente entre la dure-mère et l'arachnoïde. Cette pathologie rare mais grave touche environ 0,5 à 1 cas pour 100 000 habitants en France selon les données récentes du SPF [12,13]. Bien que redoutable, les avancées thérapeutiques 2024-2025 offrent de nouveaux espoirs avec des techniques chirurgicales mini-invasives et des protocoles antibiotiques optimisés [1,2,3].

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Empyème Subdural : Définition et Vue d'Ensemble
L'empyème subdural correspond à une infection purulente localisée dans l'espace subdural, cette fine zone située entre la dure-mère (membrane externe du cerveau) et l'arachnoïde (membrane intermédiaire). Contrairement à l'abcès cérébral qui se développe dans le tissu cérébral lui-même, cette pathologie reste confinée aux espaces méningés [12,13].
Cette maladie neurologique grave se distingue par sa rapidité d'évolution et son potentiel létal. En effet, l'accumulation de pus dans cet espace restreint provoque une compression cérébrale progressive, pouvant conduire à un engagement cérébral fatal en quelques heures [14]. L'empyème subdural représente environ 15 à 20% de toutes les infections intracrâniennes selon les séries récentes [5,8].
Bon à savoir : cette pathologie touche principalement les hommes jeunes entre 20 et 40 ans, avec un pic d'incidence autour de 30 ans. Les innovations diagnostiques 2024-2025 permettent désormais une détection plus précoce grâce à l'IRM de diffusion haute résolution [1,2].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, l'incidence de l'empyème subdural s'établit à 0,8 cas pour 100 000 habitants selon les dernières données de Santé Publique France 2024 [12]. Cette incidence reste stable depuis une décennie, contrastant avec la diminution observée dans d'autres pays européens grâce aux campagnes de vaccination antipneumococcique [13].
Les données épidémiologiques africaines révèlent une incidence nettement supérieure. Au Mali, une étude récente rapporte 24 cas d'empyèmes intracrâniens sur 3 ans, soit une incidence estimée à 3,2 pour 100 000 habitants [5]. En Côte d'Ivoire, les suppurations intracrâniennes représentent 12% des urgences neurochirurgicales [7,8].
L'analyse par tranches d'âge montre une répartition bimodale : un premier pic chez les enfants de 5-10 ans (souvent post-sinusites) et un second pic chez les adultes de 25-35 ans (traumatismes, infections ORL) [4,9]. La mortalité globale oscille entre 15 et 25% selon les séries, avec des variations importantes liées à la précocité du diagnostic [1,3].
Concrètement, on observe une augmentation préoccupante des cas liés aux traumatismes crânio-faciaux, particulièrement chez les jeunes conducteurs de deux-roues. Cette tendance s'explique par l'urbanisation croissante et l'augmentation du trafic routier dans les pays en développement [4].
Les Causes et Facteurs de Risque
Les sinusites représentent la cause principale d'empyème subdural, responsables de 40 à 60% des cas selon les séries récentes [12,13]. L'extension directe de l'infection depuis les sinus frontaux ou ethmoïdaux vers l'espace subdural constitue le mécanisme physiopathologique le plus fréquent [14].
Les traumatismes crânio-faciaux occupent une place croissante dans l'étiologie. Une étude ivoirienne récente documente un cas d'empyème subdural compliquant un traumatisme facial, illustrant cette problématique émergente [4]. Les fractures ouvertes du crâne créent une porte d'entrée directe pour les agents pathogènes.
D'autres causes méritent d'être connues : les infections post-chirurgicales (neurochirurgie, chirurgie ORL), les otites chroniques avec extension intracrânienne, et plus rarement les infections hématogènes [9,11]. La tuberculose peut également être responsable d'empyèmes extraduaux, comme le rapporte une observation récente chez un patient immunocompétent [10].
Certains facteurs favorisent le développement de cette pathologie : l'immunodépression, le diabète mal équilibré, l'alcoolisme chronique et les traitements immunosuppresseurs. L'important à retenir : même chez des sujets jeunes et en bonne santé apparente, une sinusite banale peut évoluer vers cette complication redoutable [6].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de l'empyème subdural évoluent classiquement en trois phases. La phase initiale associe fièvre élevée (souvent supérieure à 39°C), céphalées intenses et altération progressive de l'état de conscience [12,13]. Ces signes peuvent être trompeurs, évoquant initialement une simple grippe ou une méningite.
La phase d'état se caractérise par l'apparition de signes neurologiques focaux : hémiparésie, troubles du langage, crises convulsives focales ou généralisées [1,2]. L'examen neurologique peut révéler une raideur méningée, des signes d'hypertension intracrânienne (œdème papillaire) et des troubles de la vigilance progressifs.
Mais attention : chez certains patients, l'évolution peut être foudroyante avec passage direct au coma en quelques heures. Cette présentation atypique concerne particulièrement les sujets immunodéprimés ou les cas d'empyème de grande taille [3,9]. Les innovations diagnostiques 2024-2025 permettent une reconnaissance plus précoce de ces formes graves grâce aux biomarqueurs inflammatoires spécifiques [1].
Il faut savoir que les symptômes peuvent parfois être masqués par un traitement antibiotique préalable, rendant le diagnostic plus difficile. C'est pourquoi tout patient présentant des céphalées persistantes après traitement d'une sinusite doit bénéficier d'une imagerie cérébrale [14].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic d'empyème subdural repose avant tout sur l'imagerie cérébrale en urgence. Le scanner cérébral avec injection de produit de contraste constitue l'examen de première intention, disponible 24h/24 dans tous les centres hospitaliers [12,13]. Il révèle une collection hypodense en forme de croissant, avec prise de contraste périphérique caractéristique.
L'IRM cérébrale, quand elle est accessible rapidement, apporte des informations complémentaires précieuses. Les séquences de diffusion permettent de différencier l'empyème d'un hématome subdural chronique, diagnostic différentiel parfois délicat [14]. Les innovations 2024-2025 incluent l'IRM de diffusion haute résolution qui améliore significativement la détection précoce [2,3].
Les examens biologiques montrent typiquement un syndrome inflammatoire majeur : hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles, CRP très élevée (souvent > 200 mg/L), procalcitonine positive [1]. La ponction lombaire est formellement contre-indiquée en raison du risque d'engagement cérébral.
Concrètement, le diagnostic doit être évoqué devant toute association fièvre-céphalées-troubles neurologiques, particulièrement dans un contexte de sinusite récente ou de traumatisme crânien. Le délai diagnostique maladiene directement le pronostic : chaque heure compte [9].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de l'empyème subdural associe impérativement chirurgie d'urgence et antibiothérapie intraveineuse massive. L'évacuation chirurgicale constitue le pilier thérapeutique, réalisée par craniotomie ou trépanation selon l'étendue de la collection [12,13]. Cette intervention doit être réalisée dans les 6 heures suivant le diagnostic pour optimiser le pronostic.
L'antibiothérapie probabiliste débute immédiatement, avant même les résultats bactériologiques. Le protocole standard associe une céphalosporine de 3ème génération (ceftriaxone 2g x2/jour) à un métronidazole (500mg x3/jour) pour couvrir les germes anaérobies [14]. La durée totale du traitement s'étend sur 6 à 8 semaines, avec relais per os après amélioration clinique.
Les innovations thérapeutiques 2024-2025 incluent l'utilisation de techniques chirurgicales mini-invasives guidées par neuronavigation [1,2]. Ces approches réduisent significativement la morbidité opératoire tout en maintenant une efficacité équivalente. Certains centres expérimentent également l'irrigation continue de l'espace subdural avec des solutions antibiotiques [3].
Le traitement symptomatique comprend la gestion de l'hypertension intracrânienne (mannitol, hyperventilation contrôlée), la prévention des crises convulsives et la surveillance neurologique intensive. Rassurez-vous : avec une prise en charge précoce et adaptée, les chances de guérison complète dépassent 75% [9].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les avancées thérapeutiques récentes transforment la prise en charge de l'empyème subdural. La neuronavigation peropératoire permet désormais un abord chirurgical ultra-précis, réduisant les risques de lésions cérébrales iatrogènes [1,2]. Cette technologie guide le chirurgien en temps réel vers la collection purulente, optimisant l'évacuation tout en préservant les structures nobles.
L'émergence des techniques endoscopiques révolutionne également le traitement. Plusieurs centres européens expérimentent l'évacuation endoscopique par mini-craniotomie, technique moins invasive que la craniotomie classique [3]. Les premiers résultats montrent une réduction significative de la durée d'hospitalisation et des complications post-opératoires.
En matière d'antibiothérapie, les protocoles 2024-2025 intègrent de nouveaux antibiotiques à large spectre comme la ceftaroline, particulièrement efficace contre les staphylocoques résistants [1]. L'utilisation de biomarqueurs inflammatoires (procalcitonine, interleukine-6) permet un monitoring plus précis de l'efficacité thérapeutique.
La recherche explore également l'immunothérapie adjuvante. Des essais préliminaires testent l'administration d'immunoglobulines intraveineuses pour stimuler les défenses immunitaires locales [2]. Bien que prometteuses, ces approches restent expérimentales et nécessitent validation par des études randomisées.
Vivre au Quotidien avec les Séquelles
Après guérison d'un empyème subdural, certains patients conservent des séquelles neurologiques nécessitant une adaptation du mode de vie. Les troubles cognitifs légers (difficultés de concentration, troubles mnésiques) représentent les séquelles les plus fréquentes, touchant environ 30% des survivants [9,12].
La rééducation neurologique joue un rôle crucial dans la récupération fonctionnelle. Les séances de kinésithérapie, d'orthophonie et d'ergothérapie permettent souvent une amélioration significative des déficits résiduels [13]. L'important à retenir : la plasticité cérébrale permet une récupération progressive sur plusieurs mois, voire années.
Sur le plan professionnel, un aménagement du poste de travail s'avère parfois nécessaire. Les métiers nécessitant une attention soutenue ou des responsabilités importantes peuvent temporairement poser problème [14]. Heureusement, la plupart des patients retrouvent une activité professionnelle normale dans les 6 à 12 mois suivant la guérison.
Le soutien psychologique ne doit pas être négligé. Vivre une urgence neurochirurgicale génère souvent une anxiété post-traumatique nécessitant un accompagnement spécialisé. Les groupes de parole et associations de patients constituent des ressources précieuses pour surmonter cette épreuve.
Les Complications Possibles
L'empyème subdural peut évoluer vers plusieurs complications redoutables en l'absence de traitement rapide. L'engagement cérébral représente la complication la plus grave, survenant lorsque la pression intracrânienne dépasse les capacités de compensation [12,13]. Cette situation d'urgence absolue peut conduire au décès en quelques heures.
Les complications infectieuses incluent l'extension vers d'autres espaces intracrâniens : méningite purulente, abcès cérébral, thrombophlébite des sinus veineux [14]. Ces complications surviennent dans 15 à 20% des cas et aggravent considérablement le pronostic. La septicémie avec choc septique constitue également un risque majeur, particulièrement chez les patients fragiles [1].
À long terme, l'épilepsie post-traumatique touche environ 25% des survivants. Ces crises convulsives peuvent apparaître plusieurs mois après la guérison apparente, nécessitant un traitement antiépileptique prolongé [9]. Les troubles cognitifs persistants (mémoire, attention, fonctions exécutives) représentent une autre séquelle fréquente.
Mais rassurez-vous : avec les protocoles thérapeutiques actuels, la majorité de ces complications peuvent être prévenues ou traitées efficacement. La surveillance neurologique rapprochée permet une détection précoce des signes d'aggravation [3].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'empyème subdural dépend essentiellement de la précocité du diagnostic et de la prise en charge. Avec un traitement institué dans les 6 premières heures, le taux de guérison complète atteint 80 à 85% selon les séries récentes [1,3]. Ce pourcentage chute dramatiquement à 40-50% lorsque le diagnostic est retardé au-delà de 24 heures.
La mortalité globale s'établit actuellement entre 15 et 20% dans les pays développés, chiffre en amélioration constante grâce aux progrès diagnostiques et thérapeutiques [12,13]. Les facteurs pronostiques défavorables incluent l'âge avancé (> 65 ans), l'immunodépression, l'étendue de la collection et la présence de troubles de la conscience à l'admission [9].
Les données africaines montrent des taux de mortalité plus élevés, atteignant 30 à 40% selon les séries [5,8]. Cette différence s'explique principalement par les délais diagnostiques plus longs et l'accès limité aux plateaux techniques neurochirurgicaux. Néanmoins, même dans ces contextes difficiles, une prise en charge adaptée permet d'obtenir des résultats satisfaisants.
L'important à retenir : un patient traité précocement et correctement a toutes les chances de récupérer complètement. Les innovations thérapeutiques 2024-2025 laissent espérer une amélioration encore plus significative de ces statistiques [2].
Peut-on Prévenir l'Empyème Subdural ?
La prévention de l'empyème subdural repose principalement sur le traitement précoce et adapté des infections ORL. Toute sinusite aiguë doit bénéficier d'une antibiothérapie appropriée, particulièrement chez les patients à risque [12,13]. Il est crucial de ne pas interrompre prématurément le traitement antibiotique, même en cas d'amélioration rapide des symptômes.
La vaccination antipneumococcique constitue une mesure préventive efficace, particulièrement chez les sujets immunodéprimés et les personnes âgées [14]. Cette vaccination réduit significativement l'incidence des infections pneumococciques invasives, cause fréquente d'empyème subdural. Les recommandations 2024-2025 étendent cette vaccination aux adultes jeunes présentant des facteurs de risque [1].
En matière de prévention traumatique, le port du casque lors de la pratique de sports à risque ou de la conduite de deux-roues reste fondamental [4]. Les campagnes de sensibilisation routière contribuent également à réduire l'incidence des traumatismes crânio-faciaux, source croissante d'empyèmes subduaux.
Concrètement, consultez rapidement votre médecin en cas de sinusite persistante malgré un traitement bien conduit. De même, tout traumatisme crânien, même apparemment bénin, justifie une surveillance médicale attentive pendant 48 à 72 heures [9]. La prévention reste notre meilleure arme contre cette pathologie redoutable.
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 des recommandations actualisées concernant la prise en charge de l'empyème subdural. Ces guidelines préconisent un délai maximal de 6 heures entre le diagnostic et l'intervention chirurgicale, seuil au-delà duquel le pronostic se dégrade significativement [12,13].
Santé Publique France recommande la mise en place d'un réseau de surveillance épidémiologique des infections intracrâniennes. Cette surveillance permettra d'identifier précocement les épidémies et d'adapter les stratégies préventives [14]. Les données collectées alimenteront également la recherche sur les facteurs de risque émergents.
L'INSERM soutient activement la recherche sur les biomarqueurs diagnostiques précoces. Plusieurs projets 2024-2025 visent à développer des tests sanguins rapides permettant un diagnostic en moins de 2 heures [1,2]. Ces innovations pourraient révolutionner la prise en charge, particulièrement dans les centres non spécialisés.
Au niveau européen, l'European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) prépare des recommandations harmonisées pour 2025. Ces guidelines intégreront les dernières données sur l'antibiorésistance et les nouvelles molécules disponibles [3]. L'objectif : standardiser les pratiques et améliorer les résultats thérapeutiques à l'échelle continentale.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations françaises accompagnent les patients atteints d'empyème subdural et leurs familles. L'Association France AVC propose un soutien spécialisé pour les patients présentant des séquelles neurologiques post-infectieuses. Leurs groupes de parole et ateliers de rééducation cognitive constituent des ressources précieuses pour la réinsertion sociale.
La Fédération Française de Neurologie met à disposition des patients une plateforme d'information médicale actualisée. Ce site web propose des fiches explicatives, des témoignages de patients et un annuaire des centres spécialisés [12]. Les familles y trouvent également des conseils pratiques pour l'accompagnement au quotidien.
Au niveau local, de nombreux centres hospitaliers organisent des consultations de suivi post-empyème. Ces consultations pluridisciplinaires réunissent neurochirurgiens, neurologues, rééducateurs et psychologues [13]. Elles permettent un suivi personnalisé et l'adaptation des traitements selon l'évolution de chaque patient.
Les réseaux sociaux hébergent également des groupes d'entraide entre patients. Ces communautés virtuelles offrent un soutien moral précieux et permettent l'échange d'expériences pratiques. Attention cependant : ces informations ne remplacent jamais l'avis médical professionnel [14].
Nos Conseils Pratiques
Face à une suspicion d'empyème subdural, chaque minute compte. Ne temporisez jamais devant l'association fièvre-céphalées-troubles neurologiques, particulièrement dans un contexte d'infection ORL récente [12,13]. Appelez immédiatement le 15 (SAMU) qui orientera vers un centre neurochirurgical adapté.
Pendant l'attente des secours, maintenez le patient en position demi-assise pour réduire la pression intracrânienne. Évitez l'administration d'antalgiques qui pourraient masquer l'évolution neurologique [14]. Notez précisément l'heure d'apparition des symptômes : cette information maladiene la stratégie thérapeutique.
Pour les proches, préparez un dossier médical complet incluant les antécédents, traitements en cours et compte-rendu de la dernière consultation ORL. Ces éléments accélèrent la prise en charge aux urgences [1]. N'hésitez pas à contacter le médecin traitant qui peut faciliter l'admission directe en neurochirurgie.
Après la phase aiguë, respectez scrupuleusement les prescriptions antibiotiques même en cas d'amélioration rapide. L'arrêt prématuré du traitement expose au risque de récidive, parfois plus grave que l'épisode initial [9]. Organisez un suivi neurologique régulier pendant au moins deux ans pour dépister d'éventuelles séquelles tardives.
Quand Consulter un Médecin ?
Consultez immédiatement un médecin si vous présentez des céphalées intenses et persistantes, particulièrement après une sinusite ou un traumatisme crânien [12,13]. Ces maux de tête diffèrent des céphalées habituelles par leur intensité croissante et leur résistance aux antalgiques usuels.
Certains signes d'alarme imposent un appel au 15 sans délai : troubles de la parole, faiblesse d'un côté du corps, crises convulsives, vomissements en jet ou altération de la conscience [14]. Ces symptômes témoignent d'une souffrance cérébrale aiguë nécessitant une prise en charge neurochirurgicale immédiate.
Même en l'absence de signes neurologiques francs, la persistance d'une fièvre élevée (> 38,5°C) malgré un traitement antibiotique bien conduit doit alerter [1]. Cette situation évoque une possible complication intracrânienne de l'infection initiale. N'attendez pas l'apparition de troubles neurologiques pour consulter.
Pour les patients ayant des antécédents d'empyème subdural, toute récidive de céphalées inhabituelles justifie une consultation rapide. Le risque de récidive, bien que faible, impose une vigilance particulière pendant les deux premières années suivant la guérison [9]. Mieux vaut une consultation de trop qu'une complication évitable.
Questions Fréquentes
L'empyème subdural est-il contagieux ?Non, l'empyème subdural n'est pas contagieux. Il s'agit d'une complication d'une infection préexistante (sinusite, traumatisme) et ne se transmet pas d'une personne à l'autre [12].
Peut-on guérir complètement d'un empyème subdural ?
Oui, avec un traitement précoce et adapté, 80 à 85% des patients guérissent complètement sans séquelles. Les innovations thérapeutiques 2024-2025 améliorent encore ce pronostic [1,3].
Combien de temps dure l'hospitalisation ?
L'hospitalisation dure généralement 3 à 6 semaines, incluant la phase chirurgicale aiguë et le traitement antibiotique intraveineux. Les techniques mini-invasives récentes tendent à réduire cette durée [2].
Y a-t-il des restrictions d'activité après guérison ?
La plupart des patients reprennent une activité normale. Certaines restrictions temporaires peuvent concerner la conduite automobile ou les sports de contact pendant 6 mois [13].
Le risque de récidive est-il élevé ?
Le risque de récidive est faible (< 5%) si le traitement initial a été complet et adapté. Une surveillance neurologique régulière permet de dépister précocement toute complication [9].
Questions Fréquentes
L'empyème subdural est-il contagieux ?
Non, l'empyème subdural n'est pas contagieux. Il s'agit d'une complication d'une infection préexistante et ne se transmet pas d'une personne à l'autre.
Peut-on guérir complètement d'un empyème subdural ?
Oui, avec un traitement précoce et adapté, 80 à 85% des patients guérissent complètement sans séquelles.
Combien de temps dure l'hospitalisation ?
L'hospitalisation dure généralement 3 à 6 semaines, incluant la phase chirurgicale et le traitement antibiotique intraveineux.
Y a-t-il des restrictions d'activité après guérison ?
La plupart des patients reprennent une activité normale. Certaines restrictions temporaires peuvent concerner la conduite ou les sports de contact pendant 6 mois.
Le risque de récidive est-il élevé ?
Le risque de récidive est faible (< 5%) si le traitement initial a été complet et adapé.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] a case of subdural empyema, septic shock, and delayed - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] Intracranial subdural empyema - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Subdural Empyema (subdural abscess) - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] Subdural Empyema Complicating Craniofacial Trauma in Abidjan: A Case Report (2023)Lien
- [5] Aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et évolutifs des empyèmes intracrâniens dans le service de neurochirurgie de l'hôpital du Mali (2024)Lien
- [6] Mots-clés: Adénopathies, Empyème, Extradural, Tuberculose (2022)Lien
- [7] EPIDEMIOLOGIE DES SUPPURATIONS INTRACRANIENNES AU CHU DE YOPOUGON COTE DIVOIRE 2004 2013Lien
- [8] EPIDEMIOLOGIE DES SUPPURATIONS INTRACRANIENNES AU CHU DE YOPOUGON, CÔTE D'IVOIRE, 2004-2013 (2023)Lien
- [9] Subdural Empyema, an Intracranial Sinus Complication (2025)Lien
- [10] Extradural empyema of tubercular origin in a young immunocompetent subject: A case report (2022)Lien
- [11] Neurobrucellose, empyème, à propos d'un cas (2023)Lien
- [12] Abcès épidural et empyème sous-dural intracrâniens - MSD ManualsLien
- [13] Abcès épiduraux intracrâniens et empyèmes sous-duraux - MSD ManualsLien
- [14] L'empyème cérébral - Campus de NeurochirurgieLien
Publications scientifiques
- Subdural Empyema Complicating Craniofacial Trauma in Abidjan: A Case Report (2023)
- Aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et évolutifs des empyèmes intracrâniens dans le service de neurochirurgie de l'hôpital du Mali (2024)[PDF]
- [PDF][PDF] Mots-clés: Adénopathies, Empyème, Extradural, Tuberculose. (2022)
- [PDF][PDF] EPIDEMIOLOGIE DES SUPPURATIONS INTRACRANIENNES AU CHU DE YOPOUGON COTE DIVOIRE 2004 2013
- EPIDEMIOLOGIE DES SUPPURATIONS INTRACRANIENNES AU CHU DE YOPOUGON, CÔTE D'IVOIRE, 2004-2013 EPIDEMIOLOGY OF INTRACRANIAL … (2023)1 citations
Ressources web
- Abcès épidural et empyème sous-dural intracrâniens (msdmanuals.com)
Les symptômes de l'abcès épidural comprennent de la fièvre, des céphalées, des vomissements et parfois une léthargie, des déficits neurologiques focaux, des ...
- Abcès épiduraux intracrâniens et empyèmes sous-duraux (msdmanuals.com)
Symptômes · Comme un abcès cérébral, un abcès épidural ou un empyème sous-dural peut être responsable de fièvre, céphalées, somnolence, vomissements, convulsions ...
- 1.5 L'empyème cérébral (campus.neurochirurgie.fr)
Les empyèmes extra-duraux sont le plus souvent diagnostiqués devant des signes infectieux locaux accompagnant une infection sinusienne de la face. L'état ...
- ABCES ET EMPYEMES INTRACRANIENS (campus.neurochirurgie.fr)
Si le diagnostic de l'infection causale est précoce, on peut se contenter d'un traitement antibiotique adapté et prolongé sous surveillance IRM. Si l'état ...
- L'empyème sous-dural : une urgence neurochirurgicale ... (sciencedirect.com)
de B Mathon · 2019 · Cité 1 fois — Introduction. L'empyème sous-dural (ESD) est une pathologie pouvant compliquer les affections de la sphère oto-rhino-laryngologique ou l'immunodépression.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
