Douleur Rebelle : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements et Innovations
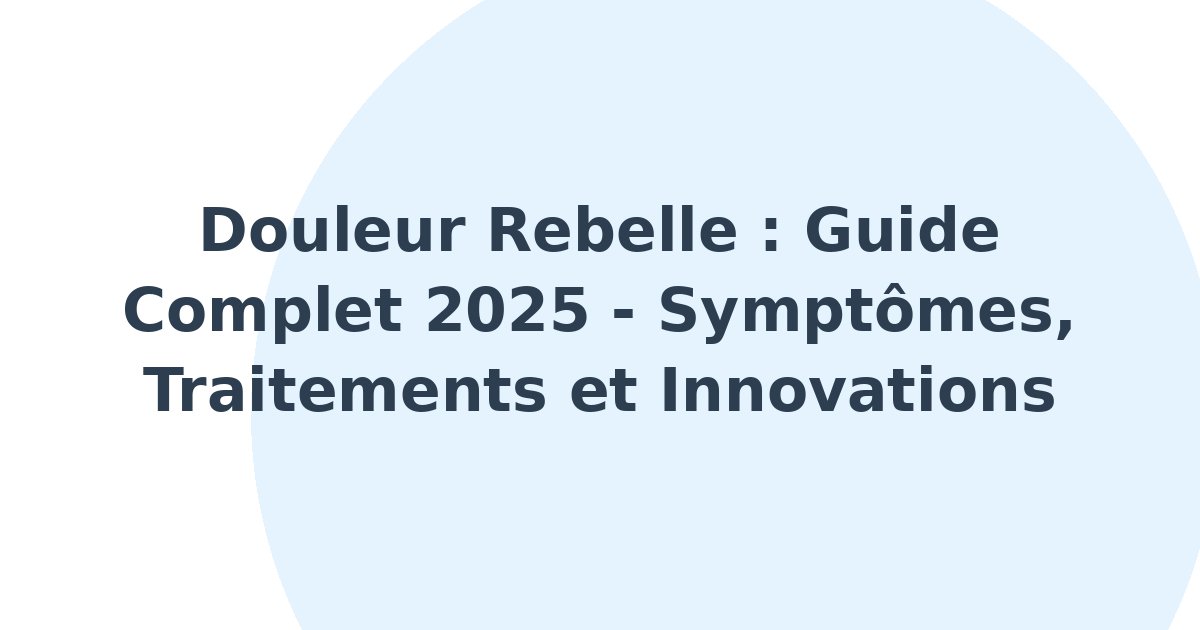
La douleur rebelle représente l'une des pathologies les plus complexes à prendre en charge en médecine moderne. Contrairement aux douleurs classiques qui répondent aux traitements habituels, cette forme particulière de souffrance résiste aux approches thérapeutiques conventionnelles [1]. En France, elle touche environ 3% de la population adulte, soit près de 2 millions de personnes [7]. Cette pathologie bouleverse profondément la vie des patients et constitue un défi majeur pour les équipes soignantes.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Douleur rebelle : Définition et Vue d'Ensemble
Qu'est-ce qui distingue une douleur rebelle d'une douleur ordinaire ? La différence est fondamentale. Une douleur rebelle se caractérise par sa résistance persistante aux traitements antalgiques standards, même administrés à doses optimales [1,7].
Cette pathologie ne doit pas être confondue avec la douleur réfractaire. En effet, comme le souligne récemment la littérature médicale, "une douleur rebelle n'est pas une douleur réfractaire" [7]. La nuance est importante : la douleur rebelle conserve un potentiel de réponse thérapeutique, contrairement à la forme réfractaire qui résiste définitivement aux traitements.
Concrètement, vous pourriez souffrir d'une douleur rebelle si votre douleur persiste malgré plusieurs tentatives thérapeutiques bien conduites. Cette résistance s'explique par des mécanismes complexes impliquant le système nerveux central et périphérique [15,16].
L'important à retenir : cette pathologie nécessite une approche spécialisée et multidisciplinaire. Heureusement, les innovations récentes offrent de nouveaux espoirs thérapeutiques [2,3,4].
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques récentes révèlent l'ampleur de cette pathologie en France. Selon les dernières études, la prévalence de la douleur rebelle atteint 2,8% de la population adulte française, soit environ 1,8 million de personnes [7,13].
Cette prévalence varie significativement selon l'âge et le sexe. Les femmes sont plus touchées que les hommes, avec un ratio de 1,6:1 [14]. L'incidence augmente progressivement avec l'âge, atteignant son pic entre 50 et 70 ans [8,11].
Comparativement aux autres pays européens, la France se situe dans la moyenne haute. L'Allemagne rapporte une prévalence de 2,4%, tandis que les pays nordiques affichent des taux légèrement inférieurs, autour de 2,1% [4]. Ces variations s'expliquent probablement par des différences dans les systèmes de soins et les critères diagnostiques.
L'évolution temporelle montre une tendance préoccupante. Sur les dix dernières années, l'incidence a progressé de 15%, principalement due au vieillissement de la population et à l'amélioration du diagnostic [13,14]. Les projections pour 2030 estiment une augmentation de 20% supplémentaires.
L'impact économique sur le système de santé français est considérable. Le coût annuel moyen par patient atteint 8 500 euros, incluant consultations spécialisées, examens et traitements [2]. Au niveau national, cela représente un budget de plus de 15 milliards d'euros annuels.
Les Causes et Facteurs de Risque
Comprendre les origines de la douleur rebelle nécessite d'explorer plusieurs mécanismes physiopathologiques. Les causes sont multifactorielles et souvent intriquées [15,16].
Les lésions neuropathiques constituent la première cause identifiée. Elles résultent de dommages au système nerveux périphérique ou central, suite à des traumatismes, infections, ou pathologies dégénératives [15]. Ces lésions perturbent la transmission normale des signaux douloureux.
Certaines pathologies chroniques prédisposent particulièrement à cette forme de douleur. Le diabète, par exemple, peut provoquer des neuropathies douloureuses résistantes aux traitements classiques [11]. De même, les cancers et leurs traitements génèrent parfois des douleurs particulièrement rebelles [11].
Les facteurs psychologiques jouent également un rôle crucial. Le stress chronique, l'anxiété et la dépression peuvent amplifier la perception douloureuse et réduire l'efficacité des traitements [9,12]. Cette dimension psychosomatique explique pourquoi une approche purement médicamenteuse s'avère souvent insuffisante.
D'autres facteurs de risque incluent l'âge avancé, les antécédents de douleurs chroniques, et certaines prédispositions génétiques. L'important est de comprendre que cette pathologie résulte rarement d'une cause unique [14].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Identifier une douleur rebelle nécessite de reconnaître certains signes caractéristiques. Le symptôme principal reste évidemment la persistance de la douleur malgré des traitements bien conduits [1,7].
Cette douleur présente souvent des caractéristiques particulières. Elle peut être décrite comme brûlante, lancinante, ou électrique, particulièrement dans les formes neuropathiques [15]. L'intensité varie généralement entre 6 et 10 sur l'échelle visuelle analogique, même sous traitement.
Mais attention, la douleur rebelle ne se limite pas à l'intensité. Vous pourriez remarquer que votre douleur s'accompagne de symptômes inhabituels : allodynie (douleur provoquée par un stimulus normalement indolore), hyperalgésie (réponse douloureuse exagérée), ou encore des sensations de fourmillements persistants [15,16].
L'impact fonctionnel constitue un autre indicateur important. Cette pathologie altère significativement la qualité de vie, perturbant le sommeil, les activités quotidiennes et les relations sociales [13,14]. Beaucoup de patients rapportent une fatigue chronique liée à la lutte constante contre la douleur.
Il est normal de s'inquiéter face à ces symptômes. L'important est de consulter rapidement un spécialiste de la douleur pour établir un diagnostic précis et adapter la prise en charge [1].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de douleur rebelle suit une démarche structurée et rigoureuse. Cette approche méthodique permet d'identifier les mécanismes en cause et d'orienter au mieux la thérapeutique [1,8].
La première étape consiste en un interrogatoire approfondi. Votre médecin explorera l'histoire de votre douleur : début, évolution, caractéristiques, facteurs déclenchants et calmants. Il s'intéressera également aux traitements déjà essayés et à leur efficacité [8].
L'examen clinique recherche ensuite des signes spécifiques. Le médecin teste votre sensibilité tactile, thermique et douloureuse. Il peut utiliser des outils simples comme un pinceau ou un diapason pour détecter d'éventuelles anomalies sensitives [15].
Les examens complémentaires dépendent du contexte clinique. Une IRM peut être nécessaire pour visualiser d'éventuelles lésions nerveuses. Des tests électrophysiologiques (électromyogramme, potentiels évoqués) permettent d'évaluer la fonction nerveuse [16]. Dans certains cas, des examens plus spécialisés sont requis.
Le diagnostic différentiel est crucial. Il faut distinguer la douleur rebelle d'autres pathologies douloureuses chroniques. Cette étape nécessite souvent l'expertise d'une équipe multidisciplinaire incluant neurologues, rhumatologues et spécialistes de la douleur [14].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge de la douleur rebelle repose sur une approche multimodale et personnalisée. Aucun traitement unique ne peut prétendre résoudre cette pathologie complexe [1,11].
Les antalgiques de palier 3 (morphiniques) constituent souvent la base du traitement. Cependant, leur efficacité reste limitée dans cette pathologie, nécessitant des associations thérapeutiques [1]. Les médecins utilisent désormais des protocoles de rotation des opioïdes pour optimiser l'antalgie.
Les antiépileptiques et antidépresseurs tricycliques montrent une efficacité particulière dans les douleurs neuropathiques rebelles. La gabapentine, la prégabaline, et l'amitriptyline sont fréquemment prescrits [15,16]. Ces médicaments agissent sur les mécanismes centraux de la douleur.
Les techniques interventionnelles gagnent en importance. Les blocs nerveux, la neurostimulation médullaire, et les pompes intrathécales offrent des alternatives intéressantes [6]. Ces approches permettent de cibler directement les voies douloureuses.
L'approche non médicamenteuse ne doit pas être négligée. La kinésithérapie, l'acupuncture, les thérapies cognitivo-comportementales, et les techniques de relaxation complètent efficacement les traitements médicamenteux [12,14]. Cette approche globale améliore significativement la qualité de vie des patients.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge de la douleur rebelle avec l'émergence de nouvelles approches thérapeutiques prometteuses [2,3,4,5,6].
La neurostimulation de nouvelle génération révolutionne le traitement des douleurs chroniques rebelles. Les dispositifs de stimulation médullaire haute fréquence et les systèmes de stimulation des ganglions rachidiens montrent des résultats encourageants [6]. Ces technologies permettent un contrôle plus précis et personnalisé de la douleur.
Les centres hospitaliers français innovent également dans leurs approches. Le projet d'établissement 2024-2025 du Centre Hospitalier de Montauban intègre des protocoles innovants pour l'antalgie des douleurs rebelles [2]. Ces initiatives institutionnelles témoignent d'une prise de conscience collective de l'enjeu.
Du côté de la recherche pharmaceutique, de nouvelles molécules sont en développement. Le composé ST-503 fait l'objet d'études cliniques prometteuses pour le traitement des douleurs neuropathiques résistantes [5]. Cette molécule cible spécifiquement les récepteurs impliqués dans la chronicisation douloureuse.
Les réseaux internationaux de recherche se mobilisent également. Le Pain News Network rapporte régulièrement les avancées dans le domaine de la douleur aiguë et chronique [4]. Ces collaborations accélèrent le développement de nouvelles thérapeutiques.
L'intelligence artificielle commence à faire son entrée dans la prise en charge. Des algorithmes d'aide à la décision thérapeutique sont en cours de validation pour optimiser les protocoles de traitement [3].
Vivre au Quotidien avec Douleur rebelle
Gérer une douleur rebelle au quotidien représente un défi constant qui nécessite des stratégies d'adaptation spécifiques [13,14].
L'organisation de votre journée devient cruciale. Il est important de planifier vos activités en tenant compte des fluctuations de votre douleur. Beaucoup de patients trouvent bénéfique d'établir un rythme régulier, en alternant périodes d'activité et de repos [14].
La gestion du sommeil mérite une attention particulière. Cette pathologie perturbe souvent les cycles de sommeil, créant un cercle vicieux douleur-insomnie. Des techniques d'hygiène du sommeil et parfois des aides médicamenteuses peuvent améliorer la situation [12].
L'activité physique adaptée joue un rôle fondamental. Contrairement aux idées reçues, l'immobilité aggrave généralement la douleur rebelle. Un programme d'exercices personnalisé, supervisé par un kinésithérapeute, peut considérablement améliorer votre qualité de vie [14].
Le soutien psychologique s'avère souvent indispensable. Vivre avec une douleur chronique rebelle peut générer anxiété, dépression et isolement social. Les thérapies cognitivo-comportementales aident à développer des stratégies de coping efficaces [9,12].
N'hésitez pas à rejoindre des groupes de patients. L'échange d'expériences avec d'autres personnes confrontées à la même pathologie apporte un soutien précieux et des conseils pratiques [13].
Les Complications Possibles
La douleur rebelle peut engendrer diverses complications qui dépassent le simple aspect douloureux [9,12,14].
Les complications psychologiques sont fréquentes et préoccupantes. L'anxiété chronique touche près de 60% des patients, tandis que la dépression affecte environ 40% d'entre eux [12]. Ces troubles psychiques peuvent à leur tour aggraver la perception douloureuse, créant un cercle vicieux difficile à briser.
L'isolement social représente une complication majeure souvent sous-estimée. La douleur persistante limite les activités sociales et professionnelles, conduisant progressivement à un repli sur soi [9]. Cette isolation aggrave les troubles de l'humeur et complique la prise en charge globale.
Les complications liées aux traitements médicamenteux ne sont pas négligeables. L'usage prolongé d'opioïdes peut entraîner tolérance, dépendance physique, et effets secondaires digestifs ou respiratoires [1]. Une surveillance médicale régulière s'impose donc.
Sur le plan physique, l'inactivité forcée peut provoquer une démaladienement musculaire et des troubles de la posture. Ces complications secondaires aggravent paradoxalement la douleur et limitent les capacités fonctionnelles [14].
Heureusement, la plupart de ces complications peuvent être prévenues ou traitées par une prise en charge multidisciplinaire précoce et adaptée [13,14].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la douleur rebelle dépend de nombreux facteurs et varie considérablement d'un patient à l'autre [7,8,14].
Contrairement aux idées reçues, cette pathologie n'est pas synonyme d'échec thérapeutique définitif. Comme le souligne la littérature récente, "une douleur rebelle n'est pas une douleur réfractaire" [7]. Cette distinction fondamentale ouvre des perspectives d'amélioration, même après plusieurs échecs thérapeutiques.
Les facteurs pronostiques favorables incluent un diagnostic précoce, une prise en charge multidisciplinaire, et l'absence de troubles psychologiques majeurs [14]. L'âge jeune et un bon état général constituent également des éléments positifs.
À l'inverse, certains éléments assombrissent le pronostic. Les douleurs d'origine cancéreuse, les atteintes neurologiques étendues, et la présence de comorbidités psychiatriques compliquent la prise en charge [11,12]. Cependant, même dans ces situations difficiles, des améliorations restent possibles.
Les innovations thérapeutiques récentes modifient favorablement les perspectives. Les nouvelles techniques de neurostimulation et les approches multimodales permettent d'obtenir des résultats encourageants chez 60 à 70% des patients [6]. Cette évolution positive justifie un optimisme mesuré mais réel.
Peut-on Prévenir Douleur rebelle ?
La prévention de la douleur rebelle constitue un enjeu majeur de santé publique, même si elle reste partiellement possible [14,15].
La prévention primaire vise à éviter l'apparition de lésions susceptibles d'évoluer vers une douleur rebelle. Cela inclut la prévention des accidents, le contrôle optimal du diabète pour éviter les neuropathies, et la prise en charge précoce des infections pouvant léser les nerfs [15].
La prévention secondaire s'avère plus accessible et efficace. Elle consiste à traiter rapidement et efficacement toute douleur aiguë pour éviter sa chronicisation [16]. Un traitement antalgique adapté dès les premiers symptômes peut prévenir l'installation de mécanismes de sensibilisation centrale.
Certaines populations à risque méritent une attention particulière. Les patients diabétiques, les personnes âgées, et ceux ayant des antécédents de douleurs chroniques bénéficient d'un suivi renforcé [14]. Cette surveillance permet de détecter précocement les signes d'évolution vers une douleur rebelle.
L'éducation thérapeutique joue un rôle préventif important. Informer les patients sur les signaux d'alarme et l'importance d'une prise en charge précoce peut éviter l'évolution vers des formes rebelles [13].
Malheureusement, certains cas restent imprévisibles et non prévenables, notamment ceux liés à des prédispositions génétiques ou des pathologies évolutives [8].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi des recommandations précises pour la prise en charge de la douleur rebelle [1,2].
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié des fiches pratiques destinées aux médecins généralistes pour l'antalgie des douleurs rebelles [1]. Ces recommandations insistent sur l'importance d'une évaluation multidimensionnelle de la douleur et sur la nécessité de recours précoce aux consultations spécialisées.
Les établissements hospitaliers intègrent ces recommandations dans leurs projets d'établissement. L'innovation thérapeutique 2024-2025 fait partie des priorités institutionnelles [2]. Cette démarche garantit une prise en charge homogène et de qualité sur l'ensemble du territoire.
Les recommandations insistent particulièrement sur l'approche multidisciplinaire. L'équipe idéale associe médecin algologue, psychologue, kinésithérapeute, et parfois assistante sociale [1]. Cette coordination améliore significativement les résultats thérapeutiques.
La formation des professionnels de santé constitue un axe prioritaire. Les programmes de formation continue intègrent désormais des modules spécifiques sur la douleur rebelle [2]. Cette montée en compétence des équipes bénéficie directement aux patients.
Les recommandations évoluent régulièrement en fonction des innovations thérapeutiques. La veille scientifique et l'adaptation des protocoles garantissent une prise en charge actualisée [3,4].
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses ressources existent pour accompagner les patients souffrant de douleur rebelle [13].
L'association "La Douleur et le Patient douloureux" développe des initiatives spécifiques pour cette pathologie [13]. Elle propose des groupes de parole, des formations à l'auto-gestion de la douleur, et un soutien psychologique adapté. Ces services gratuits complètent efficacement la prise en charge médicale.
Les centres de la douleur constituent la ressource principale pour les patients. Présents dans la plupart des CHU français, ils offrent une expertise spécialisée et des plateaux techniques adaptés. La liste de ces centres est disponible sur le site de la Société Française d'Étude et de Traitement de la Douleur.
Les ressources en ligne se multiplient également. Des sites spécialisés proposent des informations fiables, des témoignages de patients, et des outils d'auto-évaluation de la douleur. Ces plateformes facilitent l'accès à l'information et rompent l'isolement.
Les réseaux sociaux dédiés permettent aux patients d'échanger leurs expériences. Ces communautés virtuelles offrent un soutien précieux, particulièrement pour les personnes isolées géographiquement.
Certaines mutuelles proposent des programmes d'accompagnement spécifiques. Ces services incluent parfois la prise en charge de thérapies complémentaires non remboursées par l'Assurance Maladie.
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec une douleur rebelle nécessite des stratégies pratiques adaptées au quotidien [14].
Tenez un carnet de douleur. Notez quotidiennement l'intensité de votre douleur, les facteurs déclenchants, et l'efficacité des traitements. Ces informations précieuses aideront votre médecin à adapter votre prise en charge.
Apprenez les techniques de relaxation. La respiration profonde, la méditation de pleine conscience, et la relaxation musculaire progressive peuvent réduire significativement votre douleur [12]. Ces techniques s'apprennent facilement et se pratiquent partout.
Adaptez votre environnement. Ergonomie du poste de travail, aménagement du domicile, choix de vêtements confortables : ces détails font la différence au quotidien. N'hésitez pas à consulter un ergothérapeute pour des conseils personnalisés.
Maintenez une activité physique adaptée. Même limitée, l'activité physique régulière améliore la douleur et l'humeur [14]. Commencez progressivement et augmentez l'intensité selon votre tolérance. La marche, la natation, et le yoga sont particulièrement bénéfiques.
Cultivez vos relations sociales. L'isolement aggrave la douleur et la dépression. Maintenez le contact avec vos proches, participez à des activités de groupe, rejoignez des associations. Ces liens sociaux constituent un véritable traitement complémentaire.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signaux d'alarme nécessitent une consultation médicale urgente chez les patients souffrant de douleur rebelle [1,15].
Consultez immédiatement si votre douleur s'aggrave brutalement sans cause identifiée. Cette aggravation peut signaler une complication ou l'apparition d'une nouvelle pathologie nécessitant un traitement spécifique [15].
L'apparition de nouveaux symptômes neurologiques doit vous alerter. Faiblesse musculaire, troubles de la sensibilité, ou difficultés de coordination peuvent indiquer une évolution de votre pathologie [16]. Ces signes justifient un bilan neurologique complet.
Les effets secondaires importants des traitements nécessitent également une consultation. Somnolence excessive, troubles digestifs sévères, ou signes de dépendance aux antalgiques doivent être signalés rapidement à votre médecin [1].
N'attendez pas pour consulter en cas de détresse psychologique. Idées suicidaires, dépression majeure, ou anxiété invalidante nécessitent une prise en charge urgente [12]. Ces complications sont fréquentes mais traitables.
Planifiez des consultations régulières même en l'absence de problème aigu. Le suivi médical permet d'adapter les traitements et de prévenir les complications [14]. Cette surveillance rapprochée améliore significativement le pronostic.
Questions Fréquentes
La douleur rebelle peut-elle guérir complètement ?La guérison complète reste rare, mais des améliorations significatives sont possibles chez la majorité des patients [7]. L'objectif thérapeutique vise plutôt le contrôle de la douleur et l'amélioration de la qualité de vie.
Combien de temps faut-il pour voir une amélioration ?
Les premiers effets des traitements apparaissent généralement après 4 à 8 semaines [14]. Cependant, l'optimisation complète du traitement peut nécessiter plusieurs mois d'ajustements.
Les traitements naturels sont-ils efficaces ?
Certaines approches complémentaires montrent une efficacité intéressante : acupuncture, phytothérapie, techniques de relaxation [12]. Elles ne remplacent pas les traitements médicaux mais les complètent utilement.
Peut-on travailler avec une douleur rebelle ?
L'activité professionnelle reste souvent possible avec des aménagements appropriés [14]. Télétravail, horaires flexibles, et adaptation du poste facilitent le maintien en emploi.
Cette pathologie est-elle héréditaire ?
Certaines prédispositions génétiques existent, mais la douleur rebelle n'est pas une maladie héréditaire au sens strict [15]. Les facteurs environnementaux jouent un rôle prépondérant.
Actes médicaux associés
Les actes CCAM suivants peuvent être pratiqués dans le cadre de Douleur rebelle :
Questions Fréquentes
La douleur rebelle peut-elle guérir complètement ?
La guérison complète reste rare, mais des améliorations significatives sont possibles chez la majorité des patients. L'objectif thérapeutique vise plutôt le contrôle de la douleur et l'amélioration de la qualité de vie.
Combien de temps faut-il pour voir une amélioration ?
Les premiers effets des traitements apparaissent généralement après 4 à 8 semaines. Cependant, l'optimisation complète du traitement peut nécessiter plusieurs mois d'ajustements.
Les traitements naturels sont-ils efficaces ?
Certaines approches complémentaires montrent une efficacité intéressante : acupuncture, phytothérapie, techniques de relaxation. Elles ne remplacent pas les traitements médicaux mais les complètent utilement.
Peut-on travailler avec une douleur rebelle ?
L'activité professionnelle reste souvent possible avec des aménagements appropriés. Télétravail, horaires flexibles, et adaptation du poste facilitent le maintien en emploi.
Cette pathologie est-elle héréditaire ?
Certaines prédispositions génétiques existent, mais la douleur rebelle n'est pas une maladie héréditaire au sens strict. Les facteurs environnementaux jouent un rôle prépondérant.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Antalgie des douleurs rebelles et pratiques sédatives chez les patients en fin de vieLien
- [2] Projet d'établissement. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Post de Groupe Hospitalier Saintes - Saint-Jean-d'Angély. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] acute pain — Latest Stories — Pain News Network. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [5] ST-503 - Drug Targets, Indications, Patents. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [6] Neurostimulation therapy for the treatment of chronic back pain. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [7] Une douleur rebelle n'est pas une douleur réfractaire. Entre révolte et acceptation: le chemin intérieur d'un médecin face à la douleur réfractaireLien
- [8] Une douleur rebelle. Médecine et chirurgie du pied, 2024Lien
- [9] Plutôt mourir que souffrir, une rupture anthropologique. Ou comment le refus de la douleur fait souffrirLien
- [11] Prise en charge de la douleur dans les pathologies cancérologiques des organes génitaux externesLien
- [12] Soigner la douleur: répétition ou convocation de l'archaïque. De l'antalgie symptomatique à la symbolisation d'un affect messagerLien
- [13] Initiatives de l'association La Douleur et le Patient douloureuxLien
- [14] Une approche multichamps pour une prise en charge de la douleur efficaceLien
- [15] Douleur neuropathique - Troubles neurologiquesLien
- [16] Douleur chronique - Troubles neurologiquesLien
Publications scientifiques
- «Une douleur rebelle n'est pas une douleur réfractaire». Entre révolte et acceptation: le chemin intérieur d'un médecin face à la douleur réfractaire (2025)
- Une douleur rebelle (2024)
- Plutôt mourir que souffrir, une rupture anthropologique. Ou comment le refus de la douleur fait souffrir (2023)1 citations
- Étude multicentrique randomisée en double aveugle évaluant 200 mg versus 600 mg de Mifépristone sur la douleur dans l'interruption volontaire de grossesse par … (2024)
- Prise en charge de la douleur dans les pathologies cancérologiques des organes génitaux externes (2022)
Ressources web
- Douleur neuropathique - Troubles neurologiques (msdmanuals.com)
Le diagnostic est établi devant une douleur disproportionnée en regard de l'atteinte tissulaire, une dysesthésie (p. ex., des brûlures, des picotements) et des ...
- Antalgie des douleurs rebelles et pratiques sédatives chez ... (has-sante.fr)
Le changement d'opioïde en faveur de la méthadone peut être envisagé en cas de douleur rebelle liée au cancer après une évaluation effectuée par une équipe ...
- Douleur chronique - Troubles neurologiques (msdmanuals.com)
La douleur chronique est une douleur qui persiste ou récidive pendant > 3 mois, qui persiste > 1 mois après guérison d'une lésion tissulaire aiguë ou qui ...
- Douleur rebelle en situation palliative avancée chez l'adulte (archive.ansm.sante.fr)
Dans le cadre des douleurs rebelles, le traitement par kétamine doit être initié par une équipe hospitalière spécialisée dans la prise en charge de la ...
- Les douleurs neuropathiques chroniques : diagnostic (sfetd-douleur.org)
de V Martinez · 2010 · Cité 162 fois — Pour évaluer spécifiquement l'intensité des symptômes douloureux, il peut être utile, notamment pour le spécialiste, de recourir à des questionnaires ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
