Dicrocoeliose : Guide Complet 2025 - Symptômes, Diagnostic et Traitements
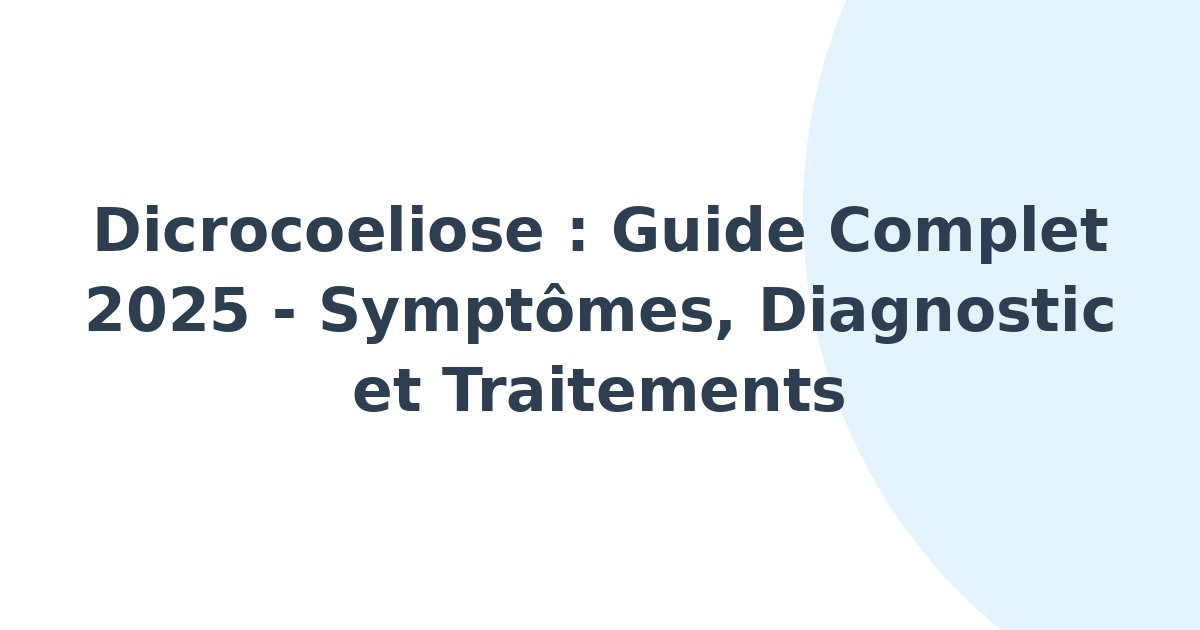
La dicrocoeliose est une parasitose hépatique causée par Dicrocoelium dendriticum, communément appelée petite douve du foie. Cette maladie touche principalement les ruminants mais peut également affecter l'homme [1,2]. En France, cette pathologie reste méconnue du grand public malgré son impact économique significatif sur l'élevage [4]. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette infection parasitaire, ses manifestations cliniques et les innovations thérapeutiques récentes.
Téléconsultation et Dicrocoeliose
Partiellement adaptée à la téléconsultationLa dicrocœliose étant une parasitose rare nécessitant des examens biologiques spécialisés pour confirmation diagnostique, la téléconsultation peut permettre une orientation initiale et l'évaluation des symptômes. Cependant, le diagnostic définitif repose sur l'identification des œufs parasitaires dans les selles, nécessitant des examens complémentaires en laboratoire.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation des symptômes digestifs (douleurs abdominales, troubles du transit), analyse de l'exposition à risque (consommation de végétaux sauvages, séjour en zone endémique), évaluation de l'intensité des symptômes généraux, orientation diagnostique initiale face à des troubles hépatobiliaires inexpliqués, suivi de l'évolution sous traitement antiparasitaire.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique pour recherche d'hépatomégalie ou de sensibilité abdominale, prescription et interprétation des examens parasitologiques des selles, réalisation d'examens d'imagerie hépatobiliaire si nécessaire, confirmation diagnostique par identification microscopique des œufs de Dicrocoelium dendriticum.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Préparer votre téléconsultation
Pour que votre téléconsultation soit la plus efficace possible, préparez les éléments suivants :
- Symptômes et durée : Noter précisément les douleurs abdominales (localisation, intensité, relation avec les repas), les troubles digestifs (diarrhées, constipation, ballonnements), la fatigue, les éventuels épisodes fébriles, et depuis combien de temps ces symptômes sont présents.
- Traitements en cours : Mentionner tous les traitements antiparasitaires précédents (albendazole, triclabendazole), les anti-inflammatoires, les traitements symptomatiques digestifs, et tout traitement hépatique en cours.
- Antécédents médicaux pertinents : Antécédents de parasitoses, maladies hépatiques, séjours en zones d'endémie (Moyen-Orient, Europe de l'Est), habitudes alimentaires (consommation de cresson, pissenlit ou autres végétaux sauvages), contact avec des animaux d'élevage.
- Examens récents disponibles : Résultats des examens parasitologiques des selles récents, bilan hépatique (transaminases, bilirubine, phosphatases alcalines), échographie abdominale, scanner ou IRM hépatobiliaire si réalisés.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion de complications hépatobiliaires nécessitant un examen clinique approfondi, nécessité de prescrire des examens parasitologiques spécialisés avec technique de concentration, évaluation d'une hépatomégalie ou d'une cholestase, surveillance rapprochée de l'efficacité thérapeutique nécessitant des contrôles biologiques réguliers.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Apparition de signes de cholangite (fièvre, ictère, douleurs), développement d'une insuffisance hépatique aiguë, complications biliaires sévères avec obstruction.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Ictère (jaunisse) avec fièvre et frissons évoquant une cholangite
- Douleurs abdominales intenses et persistantes dans l'hypochondre droit
- Vomissements incoercibles avec impossibilité de s'alimenter
- Altération importante de l'état général avec amaigrissement rapide
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Gastro-entérologue ou médecin spécialisé en maladies infectieuses et tropicales — consultation en présentiel recommandée
La dicrocœliose étant une parasitose rare, l'expertise d'un gastro-entérologue ou d'un infectiologue est souvent nécessaire pour le diagnostic et la prise en charge. Une consultation en présentiel est généralement recommandée pour l'examen clinique et la prescription d'examens spécialisés.

- Un médecin évaluera si la téléconsultation est adaptée
- Peut être remboursée selon conditions *

Dicrocoeliose : Définition et Vue d'Ensemble
La dicrocoeliose est une maladie parasitaire provoquée par un petit ver plat appelé Dicrocoelium dendriticum [2]. Ce parasite, mesurant entre 6 et 10 millimètres, s'installe dans les voies biliaires du foie de ses hôtes [3].
Contrairement à d'autres parasitoses hépatiques, la dicrocoeliose présente un cycle de vie complexe impliquant trois hôtes différents. D'abord, les œufs sont ingérés par des escargots terrestres, puis les larves migrent vers des fourmis avant d'infecter l'hôte définitif [1,2]. Cette particularité explique pourquoi la maladie est plus fréquente dans certaines régions géographiques.
Chez l'homme, la dicrocoeliose reste généralement asymptomatique ou provoque des symptômes légers [3]. Mais attention, dans certains cas, elle peut entraîner des complications hépatiques plus sérieuses. L'important à retenir : cette pathologie est souvent sous-diagnostiquée car ses manifestations peuvent être confondues avec d'autres troubles digestifs.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, la prévalence de la dicrocoeliose varie considérablement selon les régions. Les données récentes de 2024 montrent que les zones méditerranéennes et les régions d'élevage intensif sont les plus touchées [4,6]. Dans le sud de la France, jusqu'à 15% des troupeaux ovins peuvent être infectés [7].
Au niveau européen, cette parasitose représente un enjeu économique majeur. Les pertes annuelles liées aux saisies d'organes à l'abattoir atteignent plusieurs millions d'euros [4,5]. D'ailleurs, une étude récente menée à l'abattoir de Farcha révèle que la dicrocoeliose constitue l'une des principales causes de saisie hépatique chez les ruminants [4].
Concernant l'infection humaine, les cas restent sporadiques en France. Cependant, certaines régions du Moyen-Orient, notamment le Liban, rapportent des prévalences plus élevées avec le syndrome de Halzoun [1]. Cette forme particulière de la maladie touche principalement les populations consommant des abats crus ou mal cuits.
L'évolution épidémiologique sur les dix dernières années montre une stabilisation de la prévalence animale, mais une meilleure détection grâce aux nouvelles techniques diagnostiques [2,3]. Les projections pour 2025-2030 suggèrent une possible augmentation des cas humains liée aux changements climatiques favorisant les hôtes intermédiaires.
Les Causes et Facteurs de Risque
La contamination par Dicrocoelium dendriticum résulte d'un processus complexe impliquant l'environnement et les habitudes alimentaires [2]. Le principal facteur de risque chez l'homme reste la consommation d'abats crus ou insuffisamment cuits, particulièrement le foie [1,3].
Les professionnels de l'élevage constituent une population à risque accru. En effet, leur exposition quotidienne aux animaux infectés et aux environnements contaminés augmente significativement les chances de contamination [4]. Les vétérinaires et les employés d'abattoirs doivent être particulièrement vigilants [5].
Certaines pratiques culinaires traditionnelles favorisent également la transmission. Le syndrome de Halzoun, observé au Moyen-Orient, résulte de la consommation de foie de mouton cru lors de rituels ou de repas festifs [1]. Heureusement, ces pratiques restent rares en France métropolitaine.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
La symptomatologie de la dicrocoeliose humaine reste souvent discrète, ce qui complique le diagnostic [3]. Dans la majorité des cas, l'infection passe totalement inaperçue. Mais quand des signes apparaissent, ils touchent principalement le système digestif.
Les symptômes les plus fréquents incluent des douleurs abdominales diffuses, particulièrement dans la région de l'hypocondre droit [1,2]. Vous pourriez également ressentir une sensation de pesanteur après les repas ou des troubles digestifs légers. Ces manifestations, bien que gênantes, restent généralement bénignes.
Dans certains cas plus rares, la dicrocoeliose peut provoquer une cholangite ou une inflammation des voies biliaires [3]. Cette complication se manifeste par une jaunisse, de la fièvre et des douleurs plus intenses. Il est important de consulter rapidement si ces symptômes apparaissent.
Le syndrome de Halzoun présente des particularités cliniques spécifiques [1]. Les patients développent une sensation de corps étranger dans la gorge, accompagnée parfois de difficultés à déglutir. Cette forme aiguë nécessite une prise en charge médicale immédiate.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de la dicrocoeliose repose principalement sur l'identification des œufs parasitaires dans les selles [2,3]. Cette recherche, appelée examen coprologique, constitue l'examen de référence. Cependant, il faut savoir que les œufs de Dicrocoelium dendriticum peuvent être confondus avec ceux d'autres parasites.
L'anamnèse joue un rôle crucial dans l'orientation diagnostique. Votre médecin vous questionnera sur vos habitudes alimentaires, vos voyages récents et votre exposition professionnelle [1]. Ces informations permettent d'évaluer le risque de contamination et d'orienter les examens complémentaires.
Les examens d'imagerie, notamment l'échographie hépatique, peuvent révéler des anomalies des voies biliaires [3]. Mais attention, ces signes ne sont pas spécifiques de la dicrocoeliose. L'IRM ou le scanner peuvent être nécessaires pour éliminer d'autres pathologies hépatiques.
Les analyses sanguines montrent parfois une éosinophilie modérée et une élévation des enzymes hépatiques [2]. Ces anomalies, bien que non spécifiques, orientent vers une parasitose hépatique. D'ailleurs, les nouveaux tests sérologiques développés en 2024 promettent d'améliorer la précision diagnostique [1].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de la dicrocoeliose repose sur l'utilisation d'antiparasitaires spécifiques [2,3]. Le praziquantel constitue le médicament de première intention, avec une efficacité démontrée dans la plupart des cas. La posologie habituelle est de 25 mg/kg en dose unique, à répéter si nécessaire.
L'albendazole représente une alternative thérapeutique intéressante, particulièrement en cas de résistance au praziquantel [3]. Ce médicament, administré pendant 7 à 10 jours, montre une bonne tolérance chez la plupart des patients. Cependant, il nécessite une surveillance hépatique régulière.
Pour le syndrome de Halzoun, le traitement peut nécessiter une approche plus complexe [1]. L'extraction mécanique des parasites adultes de la cavité buccale peut être nécessaire, suivie d'un traitement antiparasitaire classique. Cette procédure doit être réalisée par un spécialiste expérimenté.
Il est rassurant de savoir que la plupart des patients répondent bien au traitement. Les symptômes disparaissent généralement en quelques semaines, et les contrôles coprologiques confirment l'élimination du parasite [2,3]. Néanmoins, un suivi médical reste indispensable pour s'assurer de la guérison complète.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les innovations thérapeutiques récentes ouvrent de nouvelles perspectives dans la prise en charge de la dicrocoeliose [1,2]. Une étude publiée en 2024 sur le syndrome de Halzoun au Liban révèle des approches génétiques prometteuses pour comprendre la susceptibilité individuelle à l'infection [1].
Les recherches actuelles se concentrent sur le développement de nouveaux antiparasitaires plus efficaces et mieux tolérés [2,3]. Plusieurs molécules sont en phase d'évaluation préclinique, avec des résultats encourageants sur les modèles animaux. Ces innovations pourraient révolutionner le traitement dans les prochaines années.
D'un autre côté, les techniques diagnostiques évoluent rapidement. Les tests moléculaires par PCR permettent désormais une identification plus précise et plus rapide du parasite [2]. Cette avancée technologique améliore considérablement la prise en charge des patients.
La recherche sur la résistance aux anthelminthiques constitue également un axe majeur . Les études récentes chez les camélidés du Nouveau Monde apportent des éclairages précieux sur les mécanismes de résistance, applicables à la médecine humaine .
Vivre au Quotidien avec Dicrocoeliose
Vivre avec une dicrocoeliose ne bouleverse généralement pas le quotidien, surtout avec un traitement adapté [2,3]. La plupart des patients mènent une vie normale pendant et après le traitement. Il est important de maintenir une alimentation équilibrée et d'éviter les aliments susceptibles d'aggraver les troubles digestifs.
Pendant la phase de traitement, certaines précautions s'imposent. Vous devriez éviter la consommation d'alcool qui pourrait interférer avec les médicaments antiparasitaires [3]. De même, il est recommandé de surveiller l'apparition d'effets secondaires et de signaler tout symptôme inhabituel à votre médecin.
L'hygiène alimentaire revêt une importance particulière pour éviter les réinfections [1,2]. Concrètement, cela signifie bien cuire tous les abats, se laver les mains régulièrement et éviter la consommation de produits d'origine douteuse. Ces mesures simples réduisent considérablement le risque de récidive.
Le soutien psychologique peut s'avérer utile pour certains patients, particulièrement ceux développant une anxiété liée à l'alimentation [3]. Rassurez-vous, cette réaction est normale et temporaire. La plupart des personnes retrouvent rapidement confiance après la guérison.
Les Complications Possibles
Bien que la dicrocoeliose soit généralement bénigne, certaines complications peuvent survenir en l'absence de traitement [2,3]. La cholangite représente la complication la plus fréquente, résultant de l'inflammation des voies biliaires par les parasites adultes. Cette pathologie se manifeste par une triade classique : fièvre, jaunisse et douleurs abdominales intenses.
L'obstruction biliaire constitue une autre complication possible, particulièrement en cas d'infestation massive [3]. Les parasites peuvent former des amas dans les canaux biliaires, entravant l'écoulement de la bile. Cette situation nécessite parfois une intervention endoscopique pour libérer les voies biliaires.
Plus rarement, la dicrocoeliose peut évoluer vers une fibrose hépatique [2]. Cette complication survient généralement après plusieurs années d'infection non traitée. Heureusement, avec les moyens diagnostiques actuels, de telles évolutions restent exceptionnelles dans les pays développés.
Le syndrome de Halzoun présente ses propres risques de complications [1]. L'œdème laryngé peut compromettre la respiration, nécessitant parfois une prise en charge en urgence. Cette forme particulière justifie une surveillance médicale étroite.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la dicrocoeliose est excellent dans l'immense majorité des cas [2,3]. Avec un diagnostic précoce et un traitement approprié, la guérison complète est la règle. Les patients retrouvent généralement un état de santé normal en quelques semaines, sans séquelles à long terme.
Les facteurs pronostiques favorables incluent un diagnostic rapide, l'absence de complications et une bonne observance thérapeutique [3]. L'âge du patient et son état de santé général influencent également l'évolution. Les personnes jeunes et en bonne santé présentent logiquement une meilleure récupération.
Même en cas de complications, le pronostic reste généralement favorable [1,2]. La cholangite répond bien au traitement antibiotique associé aux antiparasitaires. Les obstructions biliaires peuvent nécessiter des gestes techniques, mais l'évolution reste positive dans la plupart des cas.
Il est rassurant de savoir que les récidives sont rares après un traitement bien conduit [3]. La surveillance post-thérapeutique permet de s'assurer de l'élimination complète du parasite. Cette approche attendut un pronostic optimal à long terme.
Peut-on Prévenir Dicrocoeliose ?
La prévention de la dicrocoeliose repose principalement sur des mesures d'hygiène alimentaire simples mais efficaces [1,2]. La cuisson complète des abats, particulièrement du foie, constitue la mesure préventive la plus importante. Une température de 70°C maintenue pendant au moins 10 minutes attendut la destruction des parasites.
Les professionnels de l'élevage doivent adopter des mesures de protection spécifiques [4,5]. Le port d'équipements de protection individuelle lors de la manipulation d'animaux infectés réduit significativement le risque de contamination. De même, le lavage soigneux des mains après contact avec les animaux reste indispensable.
Au niveau collectif, la surveillance vétérinaire des troupeaux joue un rôle crucial [4,6]. Les programmes de dépistage systématique permettent d'identifier et de traiter les animaux infectés avant l'abattage. Cette approche préventive protège à la fois la santé animale et humaine.
L'éducation sanitaire de la population constitue également un enjeu majeur [7]. Informer sur les risques liés à la consommation d'abats crus ou mal cuits permet de réduire l'incidence de la maladie. Ces campagnes de sensibilisation sont particulièrement importantes dans les régions à forte prévalence.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises et européennes ont établi des recommandations précises concernant la dicrocoeliose [6,7,8]. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires classe cette parasitose parmi les maladies à déclaration obligatoire chez les animaux [8]. Cette surveillance permet un suivi épidémiologique rigoureux.
Les recommandations de l'Alliance Élevage soulignent l'importance du diagnostic précoce et du traitement systématique des animaux infectés [6]. Ces mesures visent à réduire la pression parasitaire dans l'environnement et à limiter les risques de transmission à l'homme. D'ailleurs, les protocoles de traitement ont été actualisés en 2024 pour tenir compte des nouvelles données scientifiques.
Concernant la sécurité alimentaire, les autorités recommandent une inspection systématique des abats à l'abattage [4,5]. Les organes présentant des lésions caractéristiques doivent être systématiquement écartés de la consommation humaine. Cette mesure préventive s'avère particulièrement efficace pour réduire l'incidence humaine.
Les professionnels de santé reçoivent régulièrement des mises à jour sur les protocoles diagnostiques et thérapeutiques [7]. Ces formations continues attendussent une prise en charge optimale des patients et une surveillance épidémiologique de qualité. L'important à retenir : ces recommandations évoluent constamment avec les avancées scientifiques.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs ressources sont disponibles pour accompagner les patients atteints de dicrocoeliose [6,7]. Les Groupements de Défense Sanitaire (GDS) proposent des informations actualisées sur cette parasitose et ses implications [7]. Ces organismes constituent une source fiable d'information pour les professionnels et le grand public.
L'Alliance Élevage met à disposition des documents pédagogiques détaillés sur la dicrocoeliose [6]. Ces ressources, régulièrement mises à jour, expliquent de manière accessible les mécanismes de la maladie et les moyens de prévention. Vous y trouverez également des conseils pratiques pour l'hygiène alimentaire.
Au niveau européen, les autorités suisses proposent des guides complets sur les douves du foie [8]. Ces documents, disponibles en français, offrent une perspective internationale sur la gestion de cette parasitose. Ils constituent une référence précieuse pour comprendre les enjeux sanitaires globaux.
Bien que spécifiques aux professionnels de l'élevage, ces ressources contiennent des informations utiles pour tous. N'hésitez pas à consulter votre médecin traitant pour obtenir des conseils personnalisés adaptés à votre situation particulière.
Nos Conseils Pratiques
Pour prévenir efficacement la dicrocoeliose, adoptez quelques réflexes simples au quotidien [1,2]. Cuisez toujours soigneusement les abats, en particulier le foie, jusqu'à ce qu'ils perdent leur couleur rosée. Cette précaution élimine tout risque de contamination parasitaire.
Si vous travaillez dans l'élevage ou l'industrie agroalimentaire, respectez scrupuleusement les protocoles d'hygiène [4,5]. Portez des gants lors de la manipulation d'organes animaux et lavez-vous les mains avec un savon antiseptique après chaque contact. Ces gestes protègent efficacement contre de nombreuses parasitoses.
Lors de vos voyages, soyez particulièrement vigilant concernant l'alimentation locale [1]. Évitez la consommation d'abats crus ou de préparations traditionnelles à base de foie non cuit. Cette recommandation s'applique particulièrement aux régions méditerranéennes et du Moyen-Orient.
En cas de symptômes digestifs persistants, n'hésitez pas à consulter votre médecin [3]. Mentionnez vos habitudes alimentaires et vos expositions professionnelles pour orienter le diagnostic. Un dépistage précoce facilite grandement le traitement et améliore le pronostic.
Quand Consulter un Médecin ?
Consultez rapidement votre médecin si vous présentez des douleurs abdominales persistantes, particulièrement localisées dans la région du foie [2,3]. Ces symptômes, bien que non spécifiques, peuvent signaler une parasitose hépatique nécessitant une prise en charge médicale.
Une consultation en urgence s'impose en cas d'apparition de jaunisse, de fièvre élevée ou de douleurs abdominales intenses [1,3]. Ces signes peuvent indiquer une complication de type cholangite nécessitant un traitement immédiat. N'attendez pas que les symptômes s'aggravent.
Si vous avez été exposé à des facteurs de risque (consommation d'abats crus, voyage en zone endémique, exposition professionnelle), signalez-le à votre médecin même en l'absence de symptômes [1,2]. Un dépistage préventif peut être justifié dans certaines situations.
Pour le syndrome de Halzoun, toute sensation de corps étranger dans la gorge après consommation d'abats justifie une consultation immédiate [1]. Cette forme particulière de la maladie peut évoluer rapidement vers des complications respiratoires graves.
Questions Fréquentes
La dicrocoeliose est-elle contagieuse entre humains ?
Non, la dicrocoeliose ne se transmet pas directement d'une personne à l'autre. La contamination nécessite l'ingestion d'aliments contaminés par le parasite.
Peut-on guérir complètement de cette maladie ?
Oui, avec un traitement approprié, la guérison est complète dans la quasi-totalité des cas. Les récidives sont rares après un traitement bien conduit.
Les animaux domestiques peuvent-ils transmettre la maladie ?
Les chiens et chats ne sont généralement pas concernés par cette parasitose. Le risque de transmission provient principalement des ruminants d'élevage.
Combien de temps dure le traitement ?
Le traitement standard dure généralement de 1 à 10 jours selon le médicament utilisé. Votre médecin adaptera la durée selon votre cas particulier.
Peut-on prévenir la maladie par la vaccination ?
Actuellement, aucun vaccin n'existe contre la dicrocoeliose. La prévention repose uniquement sur les mesures d'hygiène alimentaire.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Halzoun syndrome in Lebanon: Clinical and genetic analysis of a parasitic infectionLien
- [2] Dicrocoelium dendriticum - an overview of the small liver flukeLien
- [3] A review of dicrocoeliosis of ruminants including recent advances in diagnosis and treatmentLien
- [4] Motifs de saisies parasitaires et pertes économiques associées chez les ruminants à l'Abattoir Frigorifique de FarchaLien
- [5] Etude micro et macroscopique des lésions hépatiques au niveau d'abattoir de Tiaret chez les bovinsLien
- [6] Anthelminthikaresistenzen bei NeuweltkamelenLien
- [7] Zum Verhalten von Leberenzymaktivitäten bei erkrankten NeuweltkamelenLien
- [12] La dicrocoeliose - Maladie parasitaire du foie due à la petite douveLien
- [13] La petite douve du foie - Groupement de Défense Sanitaire de la CreuseLien
- [14] Douves du foie : dicrocoeliose / fasciolose - Office fédéral de la sécurité alimentaireLien
Publications scientifiques
- Motifs de saisies parasitaires et pertes économiques associées chez les ruminants à l'Abattoir Frigorifique de Farcha (AFF) de 2013 à 2018 (2025)
- Etude micro et macroscopique des l esions h epatiques au niveau d'abattoir de tiaret chez les bovins (2023)[PDF]
- [PDF][PDF] Anthelminthikaresistenzen bei Neuweltkamelen (2022)
- [PDF][PDF] Zum Verhalten von Leberenzymaktivitäten bei erkrankten Neuweltkamelen (2022)
- Etude bibliographique sur les parasites des bovins (2022)[PDF]
Ressources web
- LA DICROCOELIOSE Maladie parasitaire du foie due à la ... (alliance-elevage.com)
30 nov. 2019 — Les symptômes de l'infestation par la petite douve sont plus discrets qu'avec la grande douve. La pathogénicité de Dicrocoelium repose ...
- La petite douve du foie – 10 février 2017 (gdscreuse.fr)
10 févr. 2017 — Les symptômes tels que diarrhée, amaigrissement et toison altérée amènent à suspecter la dicrocoeliose. ... Le traitement de la dicrocoeliose. La ...
- Douves du foie : dicrocoeliose / fasciolose (blv.admin.ch)
27 avr. 2016 — En cas d'infestation par la petite douve (dicrocoeliose), il peut présenter des troubles digestifs et des ballonnements, plus rarement de la ...
- LA DICROCEOLIOSE (fac.umc.edu.dz)
La Dicrocoeliose est rencontrées dans des régions sèches à cycle polyxène avec 2 hôtes intermédiaires. -Ponte des œufs. Les œufs pondus sont asymétriques ...
- Parasitisme caprins - Groupement de Défense Sanitaire de la ... (gds72.fr)
En l'absence de symptômes spécifiques, toute suspicion est à confirmer par des analyses. Le diagnostic repose sur la mise en évidence des œufs de Dicrocoelium ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
