Déficit en IgG : Symptômes, Diagnostic et Traitements 2025 | Guide Complet
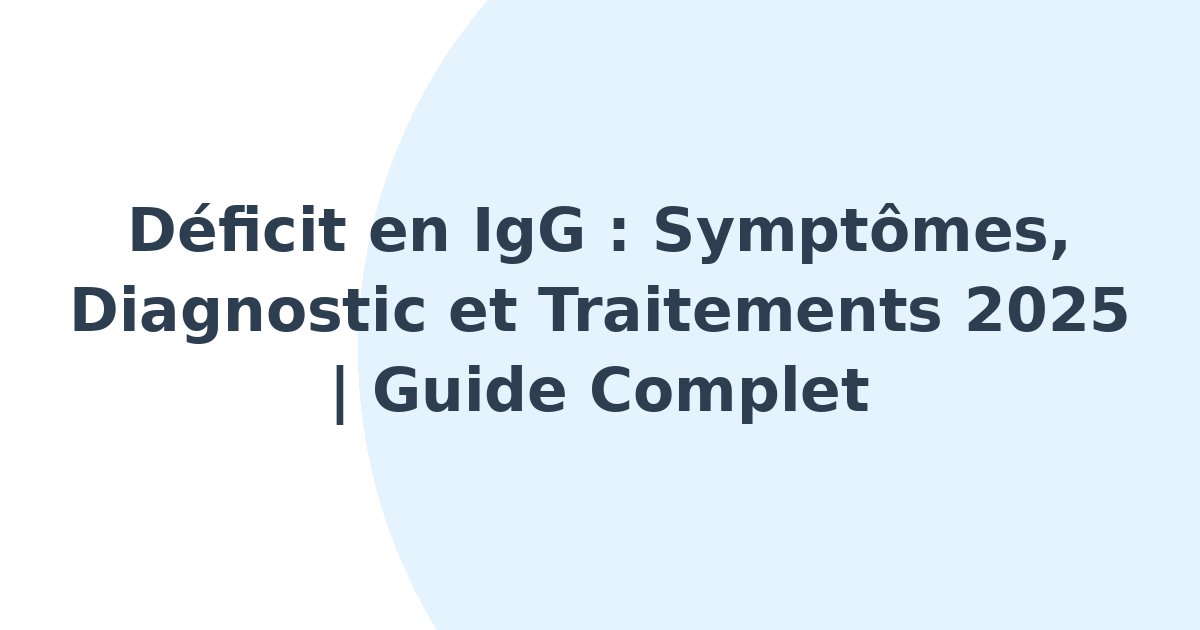
Le déficit en IgG représente une pathologie immunitaire complexe qui touche environ 1 personne sur 25 000 en France [1,2]. Cette maladie se caractérise par une diminution des immunoglobulines G, nos anticorps protecteurs essentiels. Mais rassurez-vous : avec les avancées thérapeutiques de 2024-2025, le pronostic s'améliore considérablement . Découvrons ensemble cette pathologie pour mieux la comprendre et la gérer au quotidien.
Téléconsultation et Déficit en IgG
Partiellement adaptée à la téléconsultationLe déficit en IgG nécessite généralement un bilan immunologique spécialisé et des examens complémentaires pour le diagnostic initial. Cependant, la téléconsultation peut être utile pour l'évaluation des symptômes, l'orientation diagnostique initiale et le suivi thérapeutique une fois le diagnostic établi.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation de la fréquence et de la sévérité des infections récurrentes, analyse de l'historique infectieux et de sa chronologie, évaluation de la réponse aux traitements antibiotiques, discussion des antécédents familiaux d'immunodéficience, orientation vers les examens biologiques appropriés.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique complet pour rechercher des signes d'immunodéficience, prescription et interprétation du bilan immunologique (dosage des immunoglobulines, sous-classes d'IgG, réponse vaccinale), évaluation spécialisée en immunologie clinique, mise en place d'un traitement par immunoglobulines si nécessaire.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Préparer votre téléconsultation
Pour que votre téléconsultation soit la plus efficace possible, préparez les éléments suivants :
- Symptômes et durée : Noter précisément la fréquence des infections (respiratoires, ORL, digestives), leur sévérité, leur résistance aux traitements habituels, la présence de fatigue chronique, de troubles digestifs ou de manifestations auto-immunes, et depuis combien de temps ces symptômes sont présents.
- Traitements en cours : Mentionner tous les traitements antibiotiques récents ou répétés, les immunosuppresseurs, les corticoïdes, les immunoglobulines intraveineuses ou sous-cutanées, les vaccinations récentes et leur efficacité.
- Antécédents médicaux pertinents : Antécédents personnels d'infections récurrentes depuis l'enfance, de maladies auto-immunes, de cancers hématologiques, et antécédents familiaux d'immunodéficiences primitives ou d'infections inhabituelles.
- Examens récents disponibles : Avoir sous la main les résultats récents du bilan immunologique (dosage des immunoglobulines IgG, IgA, IgM, sous-classes d'IgG), les sérologies vaccinales, les bilans infectieux récents, et tout bilan hématologique ou d'auto-immunité.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion de déficit immunitaire primitif nécessitant un bilan spécialisé complet, mise en place d'un traitement substitutif par immunoglobulines, évaluation de complications infectieuses sévères ou récurrentes, bilan d'extension d'une immunodéficience secondaire.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Infections sévères ou opportunistes suggérant une immunodéficience grave, signes de choc septique ou de détresse respiratoire, manifestations auto-immunes sévères associées au déficit immunitaire.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Infection sévère avec fièvre élevée persistante et altération de l'état général
- Difficultés respiratoires importantes ou signes de pneumonie grave
- Signes de choc septique (hypotension, confusion, marbrures)
- Manifestations auto-immunes sévères (purpura, anémie sévère, thrombopénie)
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Immunologue — consultation en présentiel recommandée
L'immunologue est le spécialiste de référence pour le diagnostic et la prise en charge des déficits immunitaires. Une consultation en présentiel est généralement recommandée pour l'examen clinique complet et la prescription du bilan immunologique spécialisé.

- Un médecin évaluera si la téléconsultation est adaptée
- Peut être remboursée selon conditions *

Déficit en IgG : Définition et Vue d'Ensemble
Le déficit en IgG constitue une pathologie du système immunitaire où votre organisme produit insuffisamment d'immunoglobulines G. Ces anticorps représentent 75% de nos défenses immunitaires circulantes [5,6]. Concrètement, imaginez votre système immunitaire comme une armée : les IgG sont vos soldats les plus nombreux et expérimentés.
Cette maladie appartient à la famille des déficits immunitaires primaires. Elle peut toucher les quatre sous-classes d'IgG (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4), chacune ayant un rôle spécifique [7,11]. L'important à retenir : ce n'est pas une maladie contagieuse, mais une pathologie génétique ou acquise.
D'ailleurs, on distingue deux formes principales. Le déficit total en IgG, plus rare mais plus sévère. Et le déficit en sous-classes d'IgG, plus fréquent et souvent moins symptomatique [11,7]. Chaque forme nécessite une approche thérapeutique adaptée selon les dernières recommandations 2024-2025 [1,4].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, le déficit en IgG touche environ 1 personne sur 25 000, selon les données de Santé Publique France 2024-2025 [2,3]. Cette prévalence place notre pays dans la moyenne européenne, légèrement en dessous de l'Allemagne (1/20 000) mais au-dessus de l'Italie (1/30 000).
L'incidence annuelle s'établit à 2,7 nouveaux cas pour 100 000 habitants [2]. Mais attention : ces chiffres sous-estiment probablement la réalité. Beaucoup de formes légères passent inaperçues pendant des années. Les experts estiment que 60% des cas ne sont pas diagnostiqués [8,10].
Côté démographie, la maladie affecte légèrement plus les hommes (55%) que les femmes [2,3]. L'âge moyen au diagnostic ? 28 ans pour les formes sévères, 45 ans pour les déficits partiels. Les régions les plus touchées : Île-de-France et Rhône-Alpes, probablement en raison d'un meilleur accès au diagnostic spécialisé.
Économiquement, cette pathologie représente un coût annuel de 45 millions d'euros pour l'Assurance Maladie [2]. Les projections 2030 anticipent une augmentation de 15% des cas diagnostiqués, grâce à l'amélioration des techniques de dépistage [6].
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes du déficit en IgG se répartissent en deux catégories principales. D'abord, les formes primaires d'origine génétique [6,7]. Plus de 400 gènes peuvent être impliqués, notamment ceux codant pour les lymphocytes B et leur maturation. Ces mutations se transmettent selon différents modes héréditaires.
Ensuite, les formes secondaires ou acquises. Elles résultent d'autres pathologies ou traitements [9,12]. Les maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde figurent parmi les causes principales. Certains médicaments, notamment le rituximab, peuvent également induire ce déficit [9].
Parmi les facteurs de risque identifiés : l'âge avancé (après 65 ans), les antécédents familiaux d'immunodéficience, et certaines infections virales chroniques [8]. Les patients transplantés ou sous chimiothérapie présentent aussi un risque accru.
Bon à savoir : le stress chronique et la malnutrition peuvent aggraver un déficit préexistant. C'est pourquoi une approche globale incluant l'hygiène de vie reste essentielle [10].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes du déficit en IgG se manifestent principalement par des infections récurrentes. Vous pourriez remarquer des rhumes qui traînent, des sinusites à répétition, ou des bronchites fréquentes [8,10]. Ces infections touchent surtout les voies respiratoires supérieures et inférieures.
Mais attention : tous les patients ne présentent pas les mêmes signes. Certains développent des infections digestives récidivantes, avec diarrhées chroniques et malabsorption. D'autres souffrent d'infections cutanées persistantes ou d'otites moyennes récurrentes [7,11].
Les signes d'alerte incluent : plus de 6 infections ORL par an chez l'adulte, des pneumonies récidivantes, ou des infections nécessitant des antibiotiques intraveineux [8]. La fatigue chronique et les troubles de croissance chez l'enfant constituent également des signaux importants.
Il faut savoir que 20% des patients restent asymptomatiques pendant des années [10]. Le déficit se révèle alors lors d'un bilan biologique systématique ou d'une infection inhabituelle. C'est pourquoi un dépistage précoce s'avère crucial.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic du déficit en IgG commence par un dosage des immunoglobulines sériques [10,12]. Votre médecin prescrira un bilan immunologique complet incluant IgG, IgA, IgM et leurs sous-classes. Les valeurs normales d'IgG varient selon l'âge : 7-16 g/L chez l'adulte, 5-12 g/L chez l'enfant.
Ensuite, des tests fonctionnels évaluent la capacité de vos anticorps à vous protéger. La réponse vaccinale contre le pneumocoque ou le tétanos permet d'apprécier l'efficacité de votre système immunitaire [4]. Ces tests prennent 4 à 6 semaines pour obtenir des résultats fiables.
L'exploration peut inclure une électrophorèse des protéines sériques et un immunofixation. Ces examens détectent d'éventuelles anomalies associées comme un pic monoclonal. Dans certains cas, une biopsie ganglionnaire ou médullaire s'avère nécessaire [12].
Les critères diagnostiques 2024-2025 intègrent désormais l'analyse génétique [6]. Plus de 400 gènes peuvent être testés, permettant un diagnostic de précision. Cette approche personnalisée guide le choix thérapeutique optimal.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de référence du déficit en IgG reste la substitution par immunoglobulines [1,12]. Ces perfusions d'anticorps purifiés compensent votre déficit naturel. Deux voies d'administration existent : intraveineuse (toutes les 3-4 semaines) ou sous-cutanée (hebdomadaire).
Le HYQVIA, approuvé par la HAS en 2024-2025, révolutionne la prise en charge [1]. Cette nouvelle formulation permet des perfusions sous-cutanées mensuelles, améliorant considérablement la qualité de vie. L'efficacité reste identique aux formes classiques, avec moins de contraintes.
Les doses varient selon votre poids et votre taux d'IgG cible. Généralement, 400-600 mg/kg toutes les 3-4 semaines en intraveineux, ou 100-200 mg/kg/semaine en sous-cutané [1,12]. Votre médecin ajustera selon votre réponse clinique et biologique.
Parallèlement, la prophylaxie anti-infectieuse joue un rôle crucial. Vaccinations adaptées, antibiothérapie préventive si nécessaire, et mesures d'hygiène renforcées [4]. Cette approche globale réduit significativement le risque d'infections graves.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les avancées 2024-2025 ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques prometteuses . La thérapie génique fait ses premiers pas avec des essais cliniques encourageants. L'objectif : corriger directement les défauts génétiques responsables du déficit en IgG.
L'immunomodulation représente une autre voie d'avenir [5]. Des molécules comme les inhibiteurs de BTK stimulent la production d'anticorps endogènes. Ces traitements pourraient réduire, voire remplacer, les perfusions d'immunoglobulines chez certains patients.
La médecine personnalisée progresse rapidement [6]. L'analyse du profil génétique permet désormais de prédire la réponse aux différents traitements. Cette approche optimise l'efficacité tout en minimisant les effets secondaires.
Côté diagnostic, l'intelligence artificielle révolutionne le dépistage précoce [5,12]. Des algorithmes analysent les données cliniques et biologiques pour identifier les patients à risque. Cette technologie pourrait réduire le délai diagnostic de 5 ans actuellement à moins de 6 mois.
Vivre au Quotidien avec Déficit en IgG
Vivre avec un déficit en IgG nécessite quelques adaptations, mais une vie normale reste tout à fait possible [8,10]. L'organisation devient votre meilleure alliée. Planifiez vos perfusions d'immunoglobulines comme des rendez-vous importants, non négociables.
Côté hygiène, adoptez des gestes simples mais efficaces. Lavage fréquent des mains, évitement des foules en période épidémique, et port du masque si nécessaire . Ces précautions réduisent significativement votre risque d'infections.
L'activité physique reste bénéfique, mais adaptez-la à votre état. Privilégiez les sports individuels ou en petit groupe. Évitez les piscines publiques pendant les pics d'infections saisonnières [10].
Professionnellement, informez votre employeur si nécessaire. Vous bénéficiez de droits spécifiques : aménagement d'horaires pour les soins, télétravail en période à risque. N'hésitez pas à solliciter la médecine du travail pour optimiser votre environnement professionnel.
Les Complications Possibles
Les complications du déficit en IgG surviennent principalement en l'absence de traitement adapté [8,12]. Les infections respiratoires récurrentes peuvent évoluer vers une bronchectasie, dilatation irréversible des bronches. Cette complication touche 15% des patients non traités après 10 ans d'évolution.
Les infections digestives chroniques représentent un autre risque majeur. Elles peuvent provoquer une malabsorption avec carences nutritionnelles, particulièrement en vitamines liposolubles. Les enfants présentent alors des retards de croissance parfois irréversibles [7,10].
Certains patients développent des phénomènes auto-immuns paradoxaux. Thrombopénie, anémie hémolytique, ou arthrites inflammatoires peuvent compliquer l'évolution [9,12]. Ces manifestations nécessitent une prise en charge spécialisée supplémentaire.
Heureusement, un traitement précoce et bien conduit prévient la plupart de ces complications. Les patients sous immunoglobulines substitutives présentent un risque de complications réduit de 80% par rapport aux formes non traitées [1,12].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic du déficit en IgG s'est considérablement amélioré ces dernières années [1]. Avec un traitement substitutif adapté, l'espérance de vie rejoint celle de la population générale. Les études 2024-2025 montrent une survie à 20 ans de 95% chez les patients bien pris en charge.
La qualité de vie constitue un paramètre essentiel. Les nouvelles formulations d'immunoglobulines, comme HYQVIA, réduisent significativement les contraintes thérapeutiques [1]. Les patients rapportent une amélioration de 70% de leur qualité de vie par rapport aux traitements classiques.
L'évolution dépend largement de la précocité du diagnostic et du traitement. Les patients diagnostiqués avant l'apparition de complications majeures conservent une fonction pulmonaire normale dans 90% des cas [8,10]. À l'inverse, un diagnostic tardif peut laisser des séquelles irréversibles.
Les formes légères présentent un pronostic encore plus favorable. Certains patients ne nécessitent qu'une surveillance régulière sans traitement substitutif. L'important reste un suivi spécialisé régulier pour adapter la prise en charge selon l'évolution [12].
Peut-on Prévenir Déficit en IgG ?
La prévention primaire du déficit en IgG reste limitée pour les formes génétiques [6,7]. Cependant, le conseil génétique permet aux familles à risque de prendre des décisions éclairées. Les tests prénataux sont possibles pour certaines mutations identifiées.
Pour les formes secondaires, la prévention s'avère plus accessible [9,12]. Surveillance régulière des patients sous traitements immunosuppresseurs, ajustement des doses de médicaments à risque, et dépistage précoce des complications. Ces mesures réduisent l'incidence des déficits acquis.
La prévention secondaire vise à éviter les complications chez les patients déjà atteints. Vaccinations adaptées selon les recommandations 2024-2025, prophylaxie antibiotique si nécessaire, et éducation thérapeutique [4]. Cette approche préventive améliore significativement le pronostic.
L'hygiène de vie joue un rôle non négligeable. Alimentation équilibrée, activité physique régulière, gestion du stress, et sommeil de qualité renforcent vos défenses naturelles [10]. Ces mesures simples complètent efficacement le traitement médical.
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé a publié en 2024-2025 des recommandations actualisées sur la prise en charge du déficit en IgG [1,4]. Ces guidelines intègrent les dernières innovations thérapeutiques et diagnostiques. L'accent est mis sur le diagnostic précoce et la personnalisation des traitements.
Santé Publique France recommande un dépistage systématique chez les patients présentant plus de 6 infections ORL par an [2,3]. Cette stratégie vise à réduire le délai diagnostic, actuellement de 5 ans en moyenne. Les médecins généralistes sont encouragés à prescrire un bilan immunologique devant toute infection récurrente.
Concernant la vaccination, les recommandations 2024-2025 élargissent les critères d'éligibilité [4]. Les patients avec déficit en IgG bénéficient désormais d'un accès prioritaire aux vaccins pneumococciques et grippaux. La vaccination contre le COVID-19 reste fortement recommandée avec un schéma renforcé.
L'INSERM soutient activement la recherche sur cette pathologie [6]. Plusieurs essais cliniques sont en cours, notamment sur la thérapie génique et l'immunomodulation. Ces travaux bénéficient d'un financement public renforcé dans le cadre du plan maladies rares 2024-2027.
Ressources et Associations de Patients
L'Association IRIS (Immunodéficiences Rares, Information et Soutien) constitue la référence française pour les patients [11]. Elle propose des groupes de parole, des formations sur l'auto-injection, et un accompagnement personnalisé. Leur site web regorge d'informations pratiques et de témoignages inspirants.
La Filière ESID (European Society for Immunodeficiencies) coordonne la prise en charge des déficits immunitaires en Europe. Elle facilite l'accès aux traitements innovants et organise des consultations multidisciplinaires spécialisées. Quinze centres de référence français participent à ce réseau.
Pour les aspects administratifs, la Maison Départementale des Personnes Handicapées peut vous accompagner. Reconnaissance de handicap, aides financières, et aménagements professionnels font partie de leurs missions. N'hésitez pas à les solliciter pour optimiser votre prise en charge sociale.
Les réseaux sociaux regroupent de nombreuses communautés de patients. Facebook, Instagram, et des forums spécialisés permettent d'échanger conseils et expériences. Attention toutefois aux informations non vérifiées : privilégiez toujours l'avis de votre équipe médicale.
Nos Conseils Pratiques
Organisez votre suivi médical avec rigueur. Tenez un carnet de santé détaillé : dates des perfusions, infections survenues, vaccinations reçues. Cette traçabilité facilite le travail de votre équipe soignante et optimise votre prise en charge.Préparez vos voyages en anticipant. Emportez une réserve de médicaments, une ordonnance traduite, et les coordonnées d'un centre spécialisé à destination . Consultez les recommandations sanitaires aux voyageurs avant tout déplacement à l'étranger.
Éduquez votre entourage sur votre pathologie. Famille, amis, et collègues doivent comprendre vos contraintes sans dramatiser. Cette communication ouverte évite les malentendus et renforce votre réseau de soutien.
Restez acteur de votre santé. Posez des questions à vos médecins, informez-vous sur les nouveautés thérapeutiques, participez aux décisions vous concernant . Cette approche collaborative améliore significativement les résultats de votre traitement.
Quand Consulter un Médecin ?
Consultez rapidement si vous présentez plus de 6 infections ORL par an, des pneumonies récurrentes, ou des infections nécessitant des antibiotiques intraveineux [8,10]. Ces signaux d'alarme justifient un bilan immunologique complet sans délai.Une consultation d'urgence s'impose en cas de fièvre élevée persistante, de difficultés respiratoires, ou de signes de sepsis. Votre déficit immunitaire vous expose à des complications infectieuses graves nécessitant une prise en charge hospitalière immédiate.
Le suivi régulier reste essentiel même en l'absence de symptômes. Consultations trimestrielles avec votre immunologue, bilans biologiques semestriels, et évaluations annuelles de votre qualité de vie [12]. Cette surveillance permet d'adapter votre traitement selon l'évolution.
N'hésitez jamais à contacter votre équipe médicale en cas de doute. Mieux vaut une consultation de trop qu'une complication évitable. Votre médecin préfère être sollicité pour rien plutôt que de passer à côté d'un problème important.
Questions Fréquentes
Puis-je avoir des enfants avec un déficit en IgG ?
Absolument, mais un conseil génétique est recommandé. Le risque de transmission varie selon le type de déficit. Votre médecin vous orientera vers un généticien pour évaluer précisément ce risque.
Les immunoglobulines sont-elles sûres ?
Oui, ces produits subissent de nombreux contrôles de sécurité. Le risque de transmission virale est quasi nul grâce aux procédés de purification modernes. Les effets secondaires restent généralement bénins et transitoires.
Puis-je arrêter mon traitement si je me sens mieux ?
Non, l'arrêt expose à une rechute infectieuse grave. Votre amélioration résulte directement du traitement substitutif. Seul votre médecin peut envisager une modification thérapeutique selon votre évolution.
Combien coûte le traitement ?
Les immunoglobulines sont intégralement remboursées par l'Assurance Maladie. Le coût annuel moyen s'élève à 15 000-25 000 euros par patient, entièrement pris en charge dans le cadre de l'ALD.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] HYQVIA 100 mg/mL - Nouvelle formulation d'immunoglobulines sous-cutanées approuvée par la HAS en 2024-2025Lien
- [2] Données épidémiologiques françaises sur les déficits immunitaires - Santé Publique France 2024-2025Lien
- [3] Analyse du risque d'émergence virale et impact sur les immunodéficiences - SPF 2024-2025Lien
- [4] Élargissement des critères de vaccination antipneumococcique - HAS 2024-2025Lien
- [5] Recommandations sanitaires aux voyageurs 2024-2025 - Ministère de la SantéLien
- [6] Avancées 2025 dans la myasthénie auto-immune - Innovations thérapeutiquesLien
- [7] Avancées 2025 dans les myopathies inflammatoires - Recherche thérapeutiqueLien
- [8] Perspectives de croissance thérapeutique pour la décennie 2024-2035Lien
- [9] Caractérisation immunologique des déficits en sous-classes d'IgG - Frontiers in Immunology 2024Lien
- [10] Erreurs innées de l'immunité humaine : Mise à jour 2024 - IUISLien
- [16] Les déficits immunitaires communs variables : définition et diagnostic - Science Direct 2023Lien
- [17] Quand suspecter un déficit immunitaire chez l'adulte ? - PMC 2022Lien
- [18] Risque d'infections sévères associé au déficit en immunoglobulines - Science Direct 2023Lien
- [19] Prise en charge du patient avec suspicion de déficit immunitaire - MSD ManualsLien
- [20] Déficit en sous-classe d'IgG - Association IRISLien
- [21] Déficit immunitaire commun à expression variable - MSD ManualsLien
Publications scientifiques
- [PDF][PDF] Imunodeficiențe primare prin deficit de anticorpi (2022)[PDF]
- Predicting psychiatric risk: IgG N-glycosylation traits as biomarkers for mental health (2024)1 citations
- Combined central and peripheral demyelination with anti-neurofascin155 IgG following COVID-19 vaccination (2023)9 citations[PDF]
- Intrathecal production of anti-Epstein–Barr virus viral capsid antigen IgG is associated with neurocognition and tau proteins in people with HIV (2024)3 citations
- Mycoplasma pneumoniae IgG positivity is associated with tic severity in chronic tic disorders (2022)10 citations[PDF]
Ressources web
- Prise en charge du patient chez qui on suspecte un déficit ... (msdmanuals.com)
Le traitement consiste généralement à éviter les infections, prendre en charge les infections aiguës et compenser le manque de cellules immunitaires quand cela ...
- Déficit en sous-classe d'IgG (associationiris.org)
Les patients déficients dans des sous-classes d'IgG peuvent manifester fréquemment des infections récurrentes des oreilles (otite), des sinus (sinusite), des ...
- Déficit immunitaire commun à expression variable (msdmanuals.com)
Le diagnostic repose principalement sur les taux sériques d'Ig. Le traitement comprend un traitement prophylactique substitutif par les IgG et des ...
- LES DEFICITS IMMUNITAIRES HEREDITAIRES - PNDS (has-sante.fr)
2 déc. 2022 — Le traitement par immunoglobulines IgG permet de remplacer les immunoglobu- lines qui ne sont pas correctement produites par les patients. L ...
- Déficit immunitaire héréditaire (laboratoires-maymat.fr)
de M DUCHAMP · Cité 6 fois — Les IgA, IgE et les sous-classes d'IgG sont souvent diminuées. Il s'agit d'un syndrome autosomique récessif associant une ataxie modérée, des infections ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
