Agammaglobulinémie : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements et Innovations
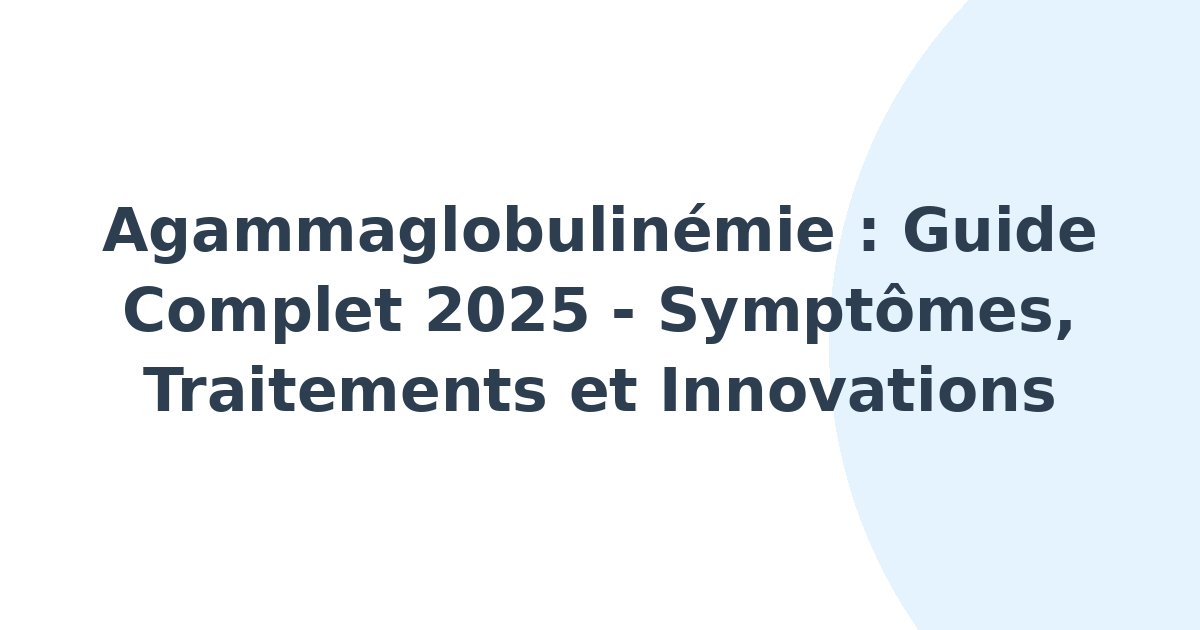
L'agammaglobulinémie est une maladie rare du système immunitaire qui touche environ 1 personne sur 100 000 en France [14,15]. Cette pathologie se caractérise par une absence quasi-totale d'anticorps dans le sang, rendant l'organisme particulièrement vulnérable aux infections. Bien que rare, cette maladie nécessite une prise en charge spécialisée et un suivi médical régulier pour permettre aux patients de mener une vie normale.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Agammaglobulinémie : Définition et Vue d'Ensemble
L'agammaglobulinémie est un déficit immunitaire primitif sévère qui se manifeste par une production insuffisante ou nulle d'anticorps. Concrètement, votre système immunitaire ne fabrique pas assez d'immunoglobulines, ces protéines essentielles qui nous protègent contre les infections [14,15].
Cette pathologie appartient à la famille des déficits immunitaires humoraux primitifs, qui représentent environ 50% de tous les déficits immunitaires [7]. L'important à retenir, c'est que cette maladie est présente dès la naissance, même si les symptômes n'apparaissent souvent qu'après les premiers mois de vie.
Il existe principalement deux formes d'agammaglobulinémie. La forme liée au chromosome X, appelée maladie de Bruton, touche quasi exclusivement les garçons et représente 85% des cas [14]. D'autres formes plus rares, autosomiques récessives, peuvent affecter les filles comme les garçons [6].
Bon à savoir : le terme "agammaglobulinémie" signifie littéralement "absence de gammaglobulines". En réalité, les patients ont généralement un taux d'anticorps très bas plutôt qu'une absence totale, d'où le terme parfois utilisé d'"hypogammaglobulinémie sévère" [15].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, l'agammaglobulinémie touche environ 1 naissance sur 100 000 à 200 000, selon les données du registre français des déficits immunitaires primitifs [7]. Cette prévalence place notre pays dans la moyenne européenne, avec des variations régionales notables.
Les données épidémiologiques récentes montrent une incidence stable depuis 2020, avec environ 30 à 40 nouveaux cas diagnostiqués chaque année en France [7]. Cependant, les experts estiment qu'un nombre significatif de cas reste non diagnostiqué, particulièrement chez les adultes.
Au niveau mondial, la prévalence varie considérablement selon les régions. Les pays nordiques rapportent des taux légèrement plus élevés (1/80 000), tandis que certaines régions d'Afrique subsaharienne présentent des chiffres probablement sous-estimés en raison du manque d'accès au diagnostic [14,15].
L'âge au diagnostic s'est considérablement amélioré ces dernières années. En 2024, l'âge médian au diagnostic en France est de 18 mois, contre 3 ans il y a une décennie [7]. Cette amélioration s'explique par une meilleure sensibilisation des pédiatres et l'introduction du dépistage néonatal dans certaines régions.
Concernant la répartition par sexe, 95% des cas concernent des garçons en raison de la transmission liée au chromosome X [14]. Les formes autosomiques récessives, plus rares, touchent équitablement les deux sexes et représentent environ 5% des cas [6].
Les Causes et Facteurs de Risque
L'agammaglobulinémie est causée par des mutations génétiques qui empêchent la maturation normale des lymphocytes B, ces cellules responsables de la production d'anticorps [14,15]. Dans 85% des cas, la mutation affecte le gène BTK situé sur le chromosome X, d'où le nom de "maladie de Bruton".
Cette transmission liée à l'X explique pourquoi la maladie touche principalement les garçons. Les mères porteuses de la mutation ont 50% de risque de transmettre la maladie à chaque grossesse masculine [14]. Heureusement, les filles qui héritent de la mutation sont généralement porteuses saines.
D'autres gènes peuvent être impliqués dans les formes autosomiques récessives, notamment IGHM, CD79A, ou BLNK [6]. Ces formes, bien que plus rares, présentent un tableau clinique similaire mais peuvent toucher les deux sexes.
Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une maladie "attrapée" mais bien d'une pathologie génétique héréditaire. Aucun facteur environnemental, aucune infection pendant la grossesse, aucun comportement parental n'est responsable de cette maladie [15].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les premiers signes d'agammaglobulinémie apparaissent généralement entre 6 et 18 mois, lorsque les anticorps maternels transmis pendant la grossesse commencent à disparaître [14,15]. Le symptôme le plus caractéristique ? Des infections bactériennes récurrentes et sévères.
Vous pourriez observer chez votre enfant des otites à répétition, des pneumonies fréquentes, ou des sinusites chroniques qui résistent aux traitements antibiotiques habituels [7]. Ces infections touchent principalement les voies respiratoires et peuvent être causées par des bactéries comme le pneumocoque ou l'Haemophilus.
D'autres signes doivent alerter : des diarrhées chroniques, des retards de croissance, ou des infections cutanées récidivantes [8]. Certains enfants développent également des arthrites septiques ou des méningites bactériennes, complications plus graves qui nécessitent une hospitalisation urgente.
Il faut savoir que les infections virales courantes (rhumes, gastro-entérites virales) sont généralement bien tolérées, car elles sont combattues par d'autres mécanismes immunitaires [14]. Cette particularité peut d'ailleurs orienter le diagnostic.
Chez l'adulte, le diagnostic tardif peut se révéler par des bronchectasies (dilatations des bronches) secondaires aux infections respiratoires répétées, ou par des complications digestives chroniques [7,8].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic d'agammaglobulinémie commence souvent par une suspicion clinique devant des infections récurrentes. Votre médecin prescrira d'abord un dosage des immunoglobulines dans le sang, examen clé qui révèle des taux très bas d'IgG, IgA et IgM [14,15].
Concrètement, on considère le diagnostic d'agammaglobulinémie lorsque le taux d'IgG est inférieur à 2 g/L (normal : 7-16 g/L) et que les autres immunoglobulines sont également effondrées [15]. Mais attention, un seul dosage ne suffit pas : il faut confirmer ces résultats à plusieurs reprises.
L'étape suivante consiste à analyser les lymphocytes B par cytométrie en flux. Dans l'agammaglobulinémie, ces cellules sont quasi absentes du sang (moins de 2% des lymphocytes) [14]. Cette absence de lymphocytes B est un signe très évocateur de la maladie.
Le test génétique permet ensuite de confirmer le diagnostic en identifiant la mutation responsable. Pour la forme liée à l'X, on recherche les mutations du gène BTK [14]. Ce test est crucial car il permet le conseil génétique familial.
D'autres examens peuvent être nécessaires : radiographies pulmonaires pour détecter d'éventuelles séquelles d'infections, bilan hépatique, ou encore recherche d'auto-anticorps [7]. L'important est d'établir un bilan complet avant de débuter le traitement.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de référence de l'agammaglobulinémie repose sur les perfusions d'immunoglobulines polyvalentes, qui remplacent les anticorps manquants [10,13]. Ces perfusions, administrées toutes les 3 à 4 semaines, permettent de maintenir un taux d'IgG protecteur dans le sang.
Deux voies d'administration sont possibles : intraveineuse (IgIV) ou sous-cutanée (IgSC). Les immunoglobulines sous-cutanées gagnent en popularité car elles peuvent être administrées à domicile, offrant plus d'autonomie aux patients [10]. La dose habituelle varie entre 400 et 600 mg/kg toutes les 3-4 semaines.
En parallèle, la prophylaxie antibiotique peut être nécessaire chez certains patients présentant des infections récurrentes malgré un traitement substitutif optimal [7]. Les antibiotiques les plus utilisés sont l'amoxicilline ou le cotrimoxazole.
La prise en charge des complications est également cruciale. Les bronchectasies nécessitent une kinésithérapie respiratoire régulière et parfois des cures d'antibiotiques [7]. Les troubles digestifs peuvent bénéficier de traitements spécifiques selon leur nature [8].
Il est important de noter que certains vaccins vivants sont contre-indiqués chez ces patients (ROR, varicelle, BCG), tandis que les vaccins inactivés restent recommandés même s'ils sont moins efficaces [10].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la prise en charge de l'agammaglobulinémie avec plusieurs innovations prometteuses. Les nouvelles recommandations de prophylaxie post-exposition ont été mises à jour, optimisant la protection des patients immunodéprimés [1].
Une avancée majeure concerne les immunoglobulines de nouvelle génération. L'essai clinique de phase 2-3 mené par Grifols montre un impact positif significatif de ces nouvelles formulations, avec une durée d'action prolongée et moins d'effets secondaires [4]. Ces innovations pourraient révolutionner le quotidien des patients.
Les thérapies géniques représentent l'espoir le plus prometteur pour l'avenir. Plusieurs essais cliniques sont en cours pour corriger directement les mutations responsables de la maladie [11]. Bien que ces approches soient encore expérimentales, les premiers résultats sont encourageants.
En 2025, de nouveaux référentiels de prise en charge ont été publiés, intégrant les dernières données scientifiques et les retours d'expérience des centres experts [2,3]. Ces recommandations mettent l'accent sur une approche personnalisée du traitement.
La recherche sur les biomarqueurs prédictifs progresse également, permettant d'anticiper les complications et d'adapter les traitements de manière plus précise [5]. Cette médecine de précision ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques.
Vivre au Quotidien avec Agammaglobulinémie
Vivre avec une agammaglobulinémie nécessite quelques adaptations, mais ne doit pas empêcher de mener une vie épanouie. L'essentiel est de maintenir une hygiène rigoureuse : lavage fréquent des mains, évitement des foules pendant les épidémies, et attention particulière aux blessures cutanées [16].
Côté alimentation, aucun régime spécifique n'est nécessaire, mais il convient d'éviter les aliments à risque infectieux comme les fromages au lait cru ou les œufs peu cuits [16]. Une alimentation équilibrée riche en vitamines et minéraux soutient le système immunitaire résiduel.
L'activité physique est non seulement possible mais recommandée ! Elle améliore la fonction respiratoire et le bien-être général [16]. Seuls les sports de contact violent sont déconseillés en raison du risque de blessures.
Pour les voyages, une préparation s'impose : vérification des vaccinations possibles, emport d'une trousse de premiers secours, et information du médecin traitant sur la destination [16]. Certaines zones tropicales nécessitent des précautions particulières.
Au niveau professionnel, la plupart des métiers restent accessibles. Seules les professions exposant à des risques infectieux majeurs (laboratoires de microbiologie, certains métiers de santé) peuvent nécessiter des aménagements [7].
Les Complications Possibles
Bien que le traitement substitutif soit très efficace, certaines complications peuvent survenir chez les patients atteints d'agammaglobulinémie. Les bronchectasies représentent la complication respiratoire la plus fréquente, résultant d'infections pulmonaires répétées avant le diagnostic ou en cas de traitement insuffisant [7].
Au niveau digestif, des entéropathies inflammatoires peuvent se développer, se manifestant par des diarrhées chroniques, des douleurs abdominales et parfois une malabsorption [8]. Ces complications digestives nécessitent une prise en charge spécialisée en gastro-entérologie.
Plus rarement, des complications neurologiques peuvent survenir. Les méningites aseptiques liées aux perfusions d'immunoglobulines, bien que rares, ont été rapportées et nécessitent une surveillance attentive [13]. Ces réactions sont généralement réversibles à l'arrêt du traitement.
Certains patients développent des maladies auto-inflammatoires associées, compliquant le tableau clinique [6]. Ces manifestations peuvent inclure des arthrites, des éruptions cutanées ou des fièvres récurrentes inexpliquées.
Il est important de noter que ces complications restent l'exception plutôt que la règle. Un suivi médical régulier et un traitement bien conduit permettent de les prévenir dans la majorité des cas [7,8].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'agammaglobulinémie s'est considérablement amélioré ces dernières décennies grâce aux progrès thérapeutiques. Avec un traitement substitutif bien conduit, l'espérance de vie des patients se rapproche désormais de celle de la population générale [14,15].
Les études récentes montrent que 90% des patients diagnostiqués et traités précocement mènent une vie normale sans complications majeures [7]. L'âge au diagnostic reste un facteur pronostique crucial : plus le diagnostic est précoce, meilleur est le pronostic à long terme.
La qualité de vie des patients s'est également nettement améliorée. Les nouvelles formulations d'immunoglobulines, notamment par voie sous-cutanée, permettent une meilleure autonomie et moins de contraintes [10]. Beaucoup de patients peuvent ainsi poursuivre leurs études, exercer leur profession et fonder une famille.
Cependant, certains défis persistent. Les patients restent plus susceptibles aux infections sévères et doivent maintenir une vigilance constante [16]. Le risque de complications pulmonaires chroniques existe, particulièrement en cas de diagnostic tardif.
L'avenir s'annonce prometteur avec les thérapies géniques en développement qui pourraient, à terme, offrir une guérison définitive [11]. En attendant, un suivi médical régulier et une bonne observance thérapeutique garantissent un excellent pronostic.
Peut-on Prévenir Agammaglobulinémie ?
L'agammaglobulinémie étant une maladie génétique, il n'existe pas de prévention primaire à proprement parler. Cependant, le conseil génétique joue un rôle crucial pour les familles concernées [14,15].
Pour les couples ayant déjà un enfant atteint ou une histoire familiale de la maladie, un diagnostic prénatal est possible dès la 10e semaine de grossesse. Ce diagnostic repose sur l'analyse génétique du fœtus et permet aux parents de prendre des décisions éclairées [14].
Le diagnostic préimplantatoire (DPI) représente une autre option pour les couples à risque. Cette technique permet de sélectionner des embryons non porteurs de la mutation avant l'implantation lors d'une fécondation in vitro [15].
Une fois le diagnostic posé, la prévention se concentre sur les complications. Un traitement substitutif précoce et bien conduit prévient la survenue d'infections graves et leurs séquelles [7]. La vaccination des proches avec les vaccins recommandés protège indirectement le patient.
L'éducation thérapeutique des patients et de leur famille constitue également un pilier de la prévention secondaire. Savoir reconnaître les signes d'infection, connaître les gestes d'hygiène appropriés et maintenir un suivi médical régulier sont autant d'éléments préventifs essentiels [16].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont publié en 2024-2025 des recommandations actualisées pour la prise en charge de l'agammaglobulinémie. La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise un diagnostic précoce par dosage systématique des immunoglobulines devant toute infection récurrente chez l'enfant [2,3].
Concernant le traitement, les nouvelles recommandations privilégient les immunoglobulines sous-cutanées en première intention pour leur facilité d'administration et leur meilleure tolérance [1,2]. La dose recommandée est de 400-600 mg/kg toutes les 3-4 semaines, ajustée selon le taux d'IgG résiduel.
Le suivi médical doit être multidisciplinaire, associant immunologue, pneumologue, gastro-entérologue et médecin traitant selon les besoins [3]. Un bilan annuel complet est recommandé, incluant fonction pulmonaire, imagerie thoracique et bilan biologique étendu.
Les recommandations 2025 insistent particulièrement sur l'éducation thérapeutique des patients et de leur famille [2]. Cette approche permet une meilleure autonomie et une réduction des complications évitables.
Enfin, les autorités recommandent l'inscription des patients dans le registre national des déficits immunitaires pour améliorer la surveillance épidémiologique et faciliter la recherche clinique [3].
Ressources et Associations de Patients
L'Association IRIS (Immunodéficiences Rares, Information et Soutien) constitue la principale ressource pour les patients français atteints d'agammaglobulinémie [16]. Cette association propose un soutien psychologique, des informations médicales actualisées et organise des rencontres entre patients.
Au niveau européen, l'ESID (European Society for Immunodeficiencies) fournit des ressources scientifiques et des recommandations de prise en charge. Leur site web propose des fiches d'information traduites en français et des annuaires de centres experts.
Les centres de référence pour les déficits immunitaires héréditaires sont répartis sur tout le territoire français. Ces centres, labellisés par le ministère de la Santé, garantissent une expertise spécialisée et coordonnent les soins avec les équipes locales [16].
Pour les aspects sociaux, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) peut accompagner les démarches de reconnaissance du handicap et d'aides financières. L'agammaglobulinémie peut ouvrir droit à l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé (AEEH) ou à l'Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Enfin, de nombreux forums en ligne permettent l'échange d'expériences entre patients et familles. Ces espaces de discussion, modérés par des professionnels de santé, constituent un soutien précieux au quotidien.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos recommandations essentielles pour bien vivre avec une agammaglobulinémie. Premièrement, respectez scrupuleusement le calendrier de vos perfusions d'immunoglobulines. Un retard même de quelques jours peut compromettre votre protection immunitaire [10].
Adoptez une hygiène irréprochable : lavez-vous les mains fréquemment, désinfectez les surfaces de contact et évitez les foules pendant les épidémies. Portez un masque dans les transports en commun et les lieux publics fermés [16].
Constituez une trousse de premiers secours adaptée : thermomètre, antiseptiques, pansements stériles et coordonnées de votre médecin référent. En voyage, emportez toujours une lettre de votre médecin expliquant votre pathologie en anglais.
Surveillez attentivement les signes d'infection : fièvre persistante, toux productive, douleurs inhabituelles ou fatigue excessive doivent vous amener à consulter rapidement. N'attendez jamais que "ça passe tout seul" [7].
Maintenez un carnet de suivi détaillé : notez vos perfusions, vos épisodes infectieux, vos traitements et vos résultats d'examens. Ces informations sont précieuses pour votre équipe médicale et facilitent le suivi à long terme.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous amener à consulter en urgence. Une fièvre supérieure à 38,5°C persistant plus de 24 heures nécessite une consultation immédiate, même si elle semble bénigne [7]. Chez les patients immunodéprimés, toute fièvre peut signaler une infection grave.
Les difficultés respiratoires, même légères, constituent un motif de consultation urgent. Essoufflement inhabituel, douleurs thoraciques ou toux avec expectorations purulentes doivent alerter [7]. Ces symptômes peuvent révéler une pneumonie débutante.
Au niveau digestif, des diarrhées persistantes (plus de 3 jours), des vomissements répétés ou des douleurs abdominales intenses justifient une évaluation médicale [8]. Ces symptômes peuvent signaler une infection digestive ou une complication inflammatoire.
N'hésitez pas à consulter pour des infections apparemment bénignes qui traînent : otite qui ne guérit pas, plaie qui cicatrise mal, ou ganglions qui augmentent de volume. Votre système immunitaire affaibli nécessite parfois une aide antibiotique précoce.
Enfin, tout changement dans votre état général - fatigue inhabituelle, perte d'appétit, amaigrissement - mérite une consultation. Ces signes peuvent révéler une infection chronique ou une complication de votre maladie [7].
Questions Fréquentes
Mon enfant peut-il aller à la crèche avec une agammaglobulinémie ?Oui, avec des précautions. Informez l'équipe de la crèche de la pathologie et assurez-vous que les vaccinations des autres enfants sont à jour. Évitez les périodes d'épidémies importantes [16].
Puis-je avoir des enfants si j'ai une agammaglobulinémie ?
Absolument ! Les femmes porteuses peuvent avoir des grossesses normales. Pour les hommes atteints, un conseil génétique est recommandé car toutes leurs filles seront porteuses [14].
Les immunoglobulines ont-elles des effets secondaires ?
Les effets secondaires sont généralement mineurs : maux de tête, fatigue ou réactions locales. Les réactions graves sont exceptionnelles avec les produits actuels [10,13].
Combien coûte le traitement ?
Le traitement est intégralement pris en charge par l'Assurance Maladie dans le cadre de l'ALD (Affection de Longue Durée). Les patients n'ont aucun frais à leur charge [16].
Peut-on guérir de l'agammaglobulinémie ?
Actuellement, il n'existe pas de guérison définitive, mais les thérapies géniques en développement sont très prometteuses. Le traitement substitutif permet une vie quasi normale [11].
Questions Fréquentes
Mon enfant peut-il aller à la crèche avec une agammaglobulinémie ?
Oui, avec des précautions. Informez l'équipe de la crèche de la pathologie et assurez-vous que les vaccinations des autres enfants sont à jour. Évitez les périodes d'épidémies importantes.
Puis-je avoir des enfants si j'ai une agammaglobulinémie ?
Absolument ! Les femmes porteuses peuvent avoir des grossesses normales. Pour les hommes atteints, un conseil génétique est recommandé car toutes leurs filles seront porteuses.
Les immunoglobulines ont-elles des effets secondaires ?
Les effets secondaires sont généralement mineurs : maux de tête, fatigue ou réactions locales. Les réactions graves sont exceptionnelles avec les produits actuels.
Combien coûte le traitement ?
Le traitement est intégralement pris en charge par l'Assurance Maladie dans le cadre de l'ALD. Les patients n'ont aucun frais à leur charge.
Peut-on guérir de l'agammaglobulinémie ?
Actuellement, il n'existe pas de guérison définitive, mais les thérapies géniques en développement sont très prometteuses. Le traitement substitutif permet une vie quasi normale.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Recommandations mises à jour sur la prophylaxie post-exposition - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] Référentiels, recommandations & consensus - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Breizh CoCoA 2024 - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] Grifols Phase 2-3 trial shows positive impact of immunoglobulin therapyLien
- [5] 2025 update on clinical trials in immune thrombocytopeniaLien
- [6] Maladie auto-inflammatoire associée à une agammaglobulinémie: revue de la littératureLien
- [7] Les différentes facettes des déficits immunitaires primitifs chez l'adulteLien
- [8] Entéropathies inflammatoires associées aux déficits immunitaires humoraux primitifsLien
- [10] Vaccination et immunoglobulinesLien
- [11] Les cellules CAR-T ont-elles tenu leurs promesses dans le traitement des leucémies aiguës en 2024?Lien
- [13] Méningite et méningoencéphalite aseptiques: complications neurologiques rares des immunoglobulines polyvalentesLien
- [14] Agammaglobulinémie liée à l'X - Troubles immunitairesLien
- [15] Agammaglobulinémie liée à l'X - ImmunologieLien
- [16] Agammaglobulinémie liée à l'X - Association IRISLien
Publications scientifiques
- [CITATION][C] Maladie auto-inflammatoire associée à une agammaglobulinémie: revue de la littérature (À propos de 2 cas familiaux) (2023)
- Les différentes facettes des déficits immunitaires primitifs chez l'adulte. Expérience d'un service de pneumologie du centre d'Alger (2025)
- Entéropathies inflammatoires associées aux déficits immunitaires humoraux primitifs (2025)
- Entéropathies exsudatives: A propos de 6 cas (2023)
- [PDF][PDF] Vaccination et immunoglobulines (2024)[PDF]
Ressources web
- Agammaglobulinémie liée à l'X - Troubles immunitaires (msdmanuals.com)
Le déficit se caractérise par l'absence de lymphocytes B (type de lymphocytes) ainsi que de très faibles taux ou l'absence d'anticorps (immunoglobulines).
- Agammaglobulinémie liée à l'X - Immunologie (msdmanuals.com)
Le diagnostic repose sur la mesure des taux d'immunoglobulines et la cytométrie de flux lymphocytaire. Le traitement comprend le remplacement des ...
- Agammaglobulinémie liée à l'X (associationiris.org)
DIAGNOSTIC. En cas de suspicion d'agammaglobulinémie liée à l'X, on peut établir un diagnostic au moyen de différents tests. Dans cette maladie, les taux de ...
- Orphanet: Agammaglobulinémie liée à l'X - Maladies rares (orpha.net)
Le diagnostic de l'agammaglobulinémie liée à l'X doit être considéré chez des patients de sexe masculin présentant une otite moyenne, une pneumonie, une ...
- Agammaglobulinémie de Bruton : symptômes, causes et ... (medicoverhospitals.in)
Le traitement peut inclure des perfusions régulières d'immunoglobulines intraveineuses (IVIG) pour fournir des anticorps, ainsi que des antibiotiques ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
