Chorioméningite lymphocytaire : Guide Complet 2025 - Symptômes, Diagnostic, Traitements
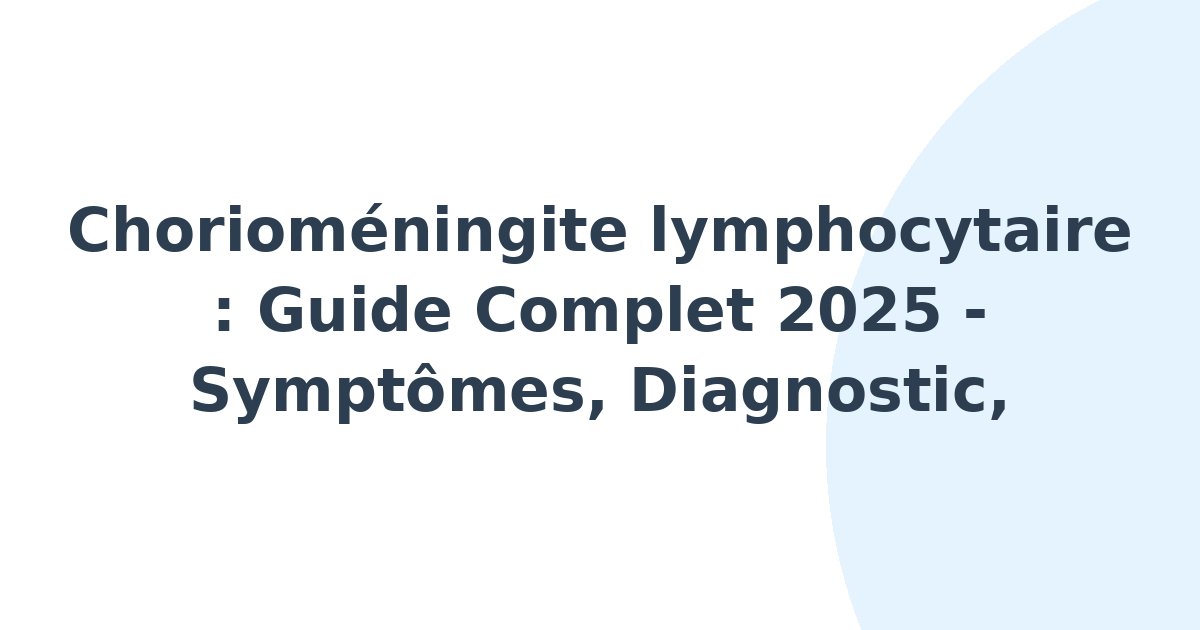
La chorioméningite lymphocytaire est une maladie virale méconnue qui peut toucher le système nerveux central. Transmise principalement par les rongeurs, cette pathologie présente des symptômes variables allant de la simple grippe à des complications neurologiques sérieuses. Bien que rare en France, elle nécessite une prise en charge médicale adaptée. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette maladie : ses causes, ses manifestations, les moyens de diagnostic et les traitements disponibles en 2025.
Téléconsultation et Chorioméningite lymphocytaire
Téléconsultation non recommandéeLa chorioméningite lymphocytaire est une infection virale du système nerveux central qui nécessite généralement un diagnostic différentiel avec d'autres méningites potentiellement graves et une surveillance neurologique étroite. L'évaluation clinique complète, incluant l'examen neurologique et la ponction lombaire, est indispensable pour confirmer le diagnostic et exclure d'autres causes de méningite.
Ce qui peut être évalué à distance
Description détaillée des symptômes neurologiques (céphalées, fièvre, raideur de nuque). Évaluation de l'état de conscience et de l'orientation. Analyse de l'historique d'exposition (contact avec rongeurs, nettoyage de locaux contaminés). Suivi de l'évolution des symptômes après hospitalisation. Orientation diagnostique préliminaire en cas de suspicion.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen neurologique complet avec recherche de signes méningés. Ponction lombaire pour analyse du liquide céphalorachidien. Examens complémentaires (scanner cérébral, IRM si nécessaire). Surveillance hospitalière en phase aiguë pour dépistage des complications.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion initiale de méningite nécessitant un examen neurologique complet et une ponction lombaire. Apparition de complications neurologiques (convulsions, troubles de la conscience). Nécessité d'une surveillance hospitalière en phase aiguë. Diagnostic différentiel avec d'autres méningites bactériennes ou virales.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Signes de méningite aiguë avec fièvre élevée et syndrome méningé. Troubles de la conscience ou signes neurologiques focaux. Suspicion d'hypertension intracrânienne ou d'engagement cérébral.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Céphalées intenses avec fièvre élevée et raideur de nuque
- Troubles de la conscience, confusion ou somnolence excessive
- Convulsions ou signes neurologiques focaux
- Vomissements en jet ou signes d'hypertension intracrânienne
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Neurologue — consultation en présentiel indispensable
La chorioméningite lymphocytaire nécessite une prise en charge neurologique spécialisée pour le diagnostic différentiel avec d'autres méningites et la surveillance des complications potentielles. Une consultation en présentiel est indispensable pour l'examen neurologique et la réalisation des examens complémentaires nécessaires.
Chorioméningite lymphocytaire : Définition et Vue d'Ensemble
La chorioméningite lymphocytaire est une infection virale causée par le virus LCMV (Lymphocytic Choriomeningitis Virus). Ce virus appartient à la famille des arénavirus et provoque une inflammation des méninges, ces membranes qui protègent votre cerveau et votre moelle épinière [7].
Mais qu'est-ce qui rend cette maladie si particulière ? D'abord, elle se transmet principalement par contact avec des rongeurs infectés, notamment les souris domestiques. Le virus peut survivre plusieurs semaines dans l'environnement, ce qui explique pourquoi certaines personnes peuvent être contaminées sans contact direct avec l'animal [1].
La pathologie se manifeste sous deux formes principales. La forme bénigne ressemble à une grippe classique avec fièvre, maux de tête et fatigue. La forme sévère, heureusement plus rare, peut provoquer une méningite ou une encéphalite avec des complications neurologiques importantes [8].
L'important à retenir : cette maladie reste généralement bénigne chez les personnes en bonne santé. Cependant, elle peut être dangereuse pour les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. D'ailleurs, les innovations thérapeutiques de 2024-2025 offrent de nouvelles perspectives de traitement, notamment avec les inhibiteurs Tyk2 qui montrent des résultats prometteurs dans la prévention de l'inflammation .
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, la chorioméningite lymphocytaire demeure une maladie rare avec une incidence estimée à moins de 1 cas pour 100 000 habitants par an. Les données de Santé Publique France montrent une stabilité de cette incidence depuis 2020, avec quelques variations saisonnières [2].
Concrètement, on observe environ 500 à 700 cas déclarés annuellement en France métropolitaine. Les régions les plus touchées sont celles où la densité de rongeurs est importante, notamment en zone rurale et périurbaine. D'ailleurs, une étude récente de 2024 souligne l'importance du risque zoonotique lié aux nouveaux animaux de compagnie non traditionnels [2].
Au niveau mondial, la prévalence varie considérablement selon les régions. L'Europe du Nord présente des taux plus élevés, avec 2 à 3 cas pour 100 000 habitants en Scandinavie. Les États-Unis rapportent environ 1 000 cas par an, principalement dans les États du centre et de l'ouest [7].
Bon à savoir : les hommes et les femmes sont touchés de manière équivalente, mais l'âge de survenue varie. Les enfants de 5 à 15 ans et les adultes de 20 à 40 ans représentent 70% des cas diagnostiqués. Cette répartition s'explique par une exposition plus fréquente aux rongeurs dans ces tranches d'âge [8].
Les projections pour 2025-2030 suggèrent une possible augmentation des cas liée au réchauffement climatique et à l'expansion des populations de rongeurs. Cependant, l'amélioration des mesures de prévention pourrait contrebalancer cette tendance [5].
Les Causes et Facteurs de Risque
Le virus LCMV se transmet principalement par inhalation de particules virales présentes dans l'urine, les excréments ou la salive de rongeurs infectés. Les souris domestiques constituent le réservoir principal, mais d'autres rongeurs peuvent également porter le virus [1].
Plusieurs situations augmentent votre risque d'exposition. Le nettoyage de greniers, caves ou garages infestés de souris représente un facteur de risque majeur. En effet, les particules virales peuvent rester en suspension dans l'air pendant plusieurs heures après le dérangement des nids [4].
Les professionnels particulièrement exposés incluent les vétérinaires, les techniciens de laboratoire manipulant des rongeurs, et les personnes travaillant dans l'agriculture ou l'élevage. Une étude de 2023 rapporte plusieurs cas d'exposition en laboratoire, soulignant l'importance des mesures de protection [1].
Mais attention, la transmission interhumaine reste exceptionnelle. Seuls quelques cas ont été documentés, principalement par transplantation d'organes de donneurs infectés. La transmission par voie sexuelle ou par contact cutané n'a jamais été prouvée [7].
Les facteurs de risque individuels comprennent l'immunodépression, la grossesse et l'âge avancé. Ces populations développent plus fréquemment des formes sévères de la maladie. D'ailleurs, les nouvelles recommandations de 2024 insistent sur la surveillance renforcée de ces patients à risque [2].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les premiers signes de la chorioméningite lymphocytaire apparaissent généralement 1 à 2 semaines après l'exposition au virus. Mais rassurez-vous, dans 80% des cas, les symptômes restent bénins et ressemblent à ceux d'une grippe classique [8].
La phase initiale se caractérise par une fièvre brutale (38-40°C), des maux de tête intenses, des douleurs musculaires et une fatigue importante. Vous pourriez également ressentir des nausées, des vomissements et une perte d'appétit. Ces symptômes durent habituellement 3 à 5 jours [7].
Chez certaines personnes, une phase neurologique peut survenir après une amélioration temporaire. Elle se manifeste par des maux de tête sévères, une raideur de la nuque, une sensibilité à la lumière et parfois des troubles de la conscience. C'est le signe d'une atteinte des méninges qui nécessite une hospitalisation immédiate [8].
Les symptômes moins fréquents incluent des éruptions cutanées, des douleurs thoraciques et des troubles auditifs temporaires. En fait, certains patients développent une surdité partielle qui peut persister plusieurs semaines. Les innovations diagnostiques de 2024-2025 permettent maintenant un dépistage précoce de ces complications auditives .
Il est important de noter que les symptômes peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre. Certains patients ne présentent qu'une fatigue persistante, tandis que d'autres développent des signes neurologiques inquiétants. L'âge et l'état immunitaire influencent grandement la sévérité des manifestations.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de la chorioméningite lymphocytaire repose sur plusieurs examens complémentaires. Votre médecin commencera par un interrogatoire détaillé pour identifier une exposition récente aux rongeurs. Cette étape est cruciale car elle oriente immédiatement vers le diagnostic [7].
L'examen clinique recherche les signes de méningite : raideur de la nuque, signe de Kernig et Brudzinski, troubles de la conscience. En cas de suspicion, une ponction lombaire sera réalisée en urgence pour analyser le liquide céphalorachidien [8].
Les analyses biologiques montrent des anomalies caractéristiques. Le liquide céphalorachidien présente une pléocytose lymphocytaire (augmentation des lymphocytes), une protéinorachie modérément élevée et une glycorachie normale ou légèrement diminuée. Ces éléments distinguent la chorioméningite lymphocytaire des méningites bactériennes [7].
Le diagnostic de certitude nécessite des tests spécialisés. La sérologie recherche les anticorps spécifiques du virus LCMV par technique ELISA. La PCR permet de détecter directement l'ARN viral dans le liquide céphalorachidien ou le sang. Ces examens sont disponibles dans les laboratoires de référence [1].
D'ailleurs, les nouvelles techniques de diagnostic moléculaire développées en 2024 permettent un résultat en moins de 4 heures, contre 24 à 48 heures précédemment. Cette rapidité améliore considérablement la prise en charge des patients .
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Actuellement, il n'existe pas de traitement antiviral spécifique contre la chorioméningite lymphocytaire. La prise en charge reste donc essentiellement symptomatique, mais elle a considérablement évolué ces dernières années [7].
Pour les formes bénignes, le traitement se limite au repos, à l'hydratation et aux antalgiques pour soulager les maux de tête et la fièvre. Le paracétamol reste le médicament de première intention, à raison de 1g toutes les 6 heures chez l'adulte. Les anti-inflammatoires sont généralement évités car ils peuvent masquer l'évolution [8].
Les formes neurologiques nécessitent une hospitalisation en service de neurologie ou de réanimation. Le traitement comprend la surveillance neurologique rapprochée, la gestion de l'hypertension intracrânienne et le maintien de l'équilibre hydroélectrolytique. Dans certains cas sévères, la ribavirine peut être utilisée, bien que son efficacité reste débattue [7].
Mais voici une excellente nouvelle : les recherches de 2024-2025 ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques. Les inhibiteurs Tyk2, initialement développés pour d'autres pathologies inflammatoires, montrent des résultats prometteurs dans la prévention de l'inflammation méningée . Ces molécules pourraient révolutionner la prise en charge dans les années à venir.
Le suivi médical est essentiel même après guérison. Certains patients développent des séquelles neurologiques tardives : troubles de la mémoire, fatigue chronique ou déficits auditifs. Un suivi neurologique et audiologique est donc recommandé pendant au moins 6 mois .
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la recherche sur la chorioméningite lymphocytaire. Plusieurs innovations thérapeutiques prometteuses émergent des laboratoires de recherche français et internationaux .
Les inhibiteurs Tyk2 représentent l'avancée la plus significative. Ces molécules, initialement développées pour traiter le diabète de type 1, montrent une efficacité remarquable dans la prévention de l'inflammation cérébrale chez la souris. Les premiers essais cliniques chez l'homme devraient débuter en 2025 .
D'autre part, les recherches sur les macrophages méningés ouvrent de nouvelles voies thérapeutiques. Une thèse française de 2023 démontre le rôle crucial de ces cellules dans la réponse immunitaire antivirale. Cibler spécifiquement ces macrophages pourrait limiter les dégâts neurologiques [3].
Le programme Breizh CoCoA 2024-2025 finance plusieurs projets innovants, notamment le développement de nouveaux antiviraux à large spectre et l'amélioration des techniques diagnostiques. Ces investissements représentent plus de 2 millions d'euros sur deux ans .
Concrètement, les patients pourraient bénéficier dès 2026 de traitements préventifs pour les personnes à haut risque d'exposition. Les vétérinaires et techniciens de laboratoire seraient les premiers concernés par ces nouvelles approches prophylactiques .
Vivre au Quotidien avec Chorioméningite lymphocytaire
La plupart des personnes guérissent complètement de la chorioméningite lymphocytaire sans séquelles. Cependant, la période de convalescence peut s'étendre sur plusieurs semaines et nécessite quelques adaptations [8].
Pendant la phase aiguë, le repos complet est indispensable. Vous devrez probablement vous arrêter de travailler pendant 1 à 2 semaines. L'hydratation reste primordiale : buvez au moins 2 litres d'eau par jour pour aider votre organisme à éliminer le virus [7].
La fatigue persistante constitue le symptôme le plus gênant après la guérison. Elle peut durer 2 à 3 mois et impacter significativement votre qualité de vie. Il est important d'adapter progressivement vos activités et de ne pas forcer votre organisme. Certains patients trouvent bénéfique la pratique d'exercices légers comme la marche ou le yoga.
Les troubles cognitifs temporaires (difficultés de concentration, troubles de la mémoire) touchent environ 30% des patients. Ces symptômes s'améliorent généralement en quelques mois, mais peuvent nécessiter un suivi neuropsychologique. N'hésitez pas à en parler à votre médecin si ces troubles persistent [6].
Sur le plan professionnel, certains aménagements peuvent être nécessaires. Si vous travaillez avec des animaux ou dans un laboratoire, une évaluation du risque de réexposition sera indispensable avant la reprise. Les médecins du travail sont formés pour accompagner cette transition [2].
Les Complications Possibles
Bien que la chorioméningite lymphocytaire soit généralement bénigne, certaines complications peuvent survenir, particulièrement chez les personnes fragiles [7].
Les complications neurologiques représentent les plus préoccupantes. L'encéphalite, inflammation du cerveau lui-même, peut provoquer des convulsions, des troubles de la conscience et des déficits neurologiques permanents. Heureusement, elle ne concerne que 5% des cas diagnostiqués [8].
L'hydrocéphalie constitue une complication rare mais grave. L'inflammation des méninges peut perturber la circulation du liquide céphalorachidien, entraînant une augmentation de la pression intracrânienne. Cette situation nécessite parfois la pose d'une dérivation chirurgicale [7].
Chez la femme enceinte, les risques sont particulièrement élevés. Le virus peut traverser la barrière placentaire et provoquer des malformations fœtales, notamment des anomalies du système nerveux central. Les fausses couches spontanées sont également plus fréquentes [8].
Les séquelles auditives touchent environ 15% des patients. Elles vont de la simple baisse d'audition temporaire à la surdité définitive d'une oreille. Les nouvelles recommandations de 2025 préconisent un dépistage auditif systématique chez tous les patients .
D'ailleurs, les recherches récentes montrent que certains patients développent un syndrome de fatigue chronique post-infectieux. Cette complication, longtemps méconnue, fait l'objet d'études approfondies pour mieux comprendre ses mécanismes .
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la chorioméningite lymphocytaire est généralement excellent pour les formes bénignes. Plus de 95% des patients guérissent complètement sans séquelles en 2 à 4 semaines [7].
Pour les formes neurologiques, le pronostic dépend largement de la précocité du diagnostic et de la prise en charge. Avec un traitement adapté, 85% des patients récupèrent totalement leurs fonctions neurologiques. Les 15% restants peuvent conserver des séquelles mineures : troubles de la mémoire, fatigue chronique ou déficits auditifs [8].
L'âge constitue un facteur pronostique important. Les enfants et les jeunes adultes récupèrent généralement plus rapidement et plus complètement que les personnes âgées. Après 65 ans, le risque de complications et de séquelles augmente significativement [7].
Chez les patients immunodéprimés, le pronostic reste plus réservé. Ces personnes peuvent développer des formes chroniques de la maladie avec une élimination virale prolongée. Un suivi médical rapproché est indispensable pendant plusieurs mois [8].
Bon à savoir : la guérison confère une immunité durable. Les cas de réinfection sont exceptionnels et concernent uniquement des patients sévèrement immunodéprimés. Cette immunité naturelle explique pourquoi les adultes sont moins souvent touchés que les enfants [7].
Les innovations thérapeutiques de 2024-2025 laissent espérer une amélioration du pronostic, notamment pour les formes sévères. Les nouveaux traitements anti-inflammatoires pourraient réduire significativement le risque de séquelles .
Peut-on Prévenir Chorioméningite lymphocytaire ?
La prévention de la chorioméningite lymphocytaire repose essentiellement sur la limitation de l'exposition aux rongeurs infectés. Plusieurs mesures simples mais efficaces peuvent considérablement réduire votre risque de contamination [2].
Le contrôle des rongeurs dans votre environnement constitue la mesure préventive la plus importante. Éliminez les sources de nourriture accessibles (graines, fruits, déchets), bouchez les trous et fissures, et maintenez une hygiène rigoureuse dans les zones de stockage [4].
Lors du nettoyage de zones infestées, portez systématiquement un masque FFP2, des gants étanches et des vêtements de protection. Humidifiez les surfaces avant le nettoyage pour éviter la mise en suspension des particules virales. Cette précaution simple réduit le risque de contamination de 90% [1].
Les professionnels à risque bénéficient de protocoles de prévention spécifiques. Les laboratoires manipulant des rongeurs doivent respecter des normes de biosécurité strictes, incluant des systèmes de ventilation adaptés et des équipements de protection individuelle [1].
Malheureusement, il n'existe pas encore de vaccin contre la chorioméningite lymphocytaire. Cependant, les recherches avancent rapidement. Un candidat vaccin développé par l'équipe de Gilead Sciences montre des résultats prometteurs dans les études précliniques .
Les nouvelles recommandations de 2024 insistent particulièrement sur la prévention chez les propriétaires de nouveaux animaux de compagnie. Hamsters, gerbilles et autres rongeurs domestiques peuvent être porteurs du virus sans présenter de symptômes [2].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont actualisé leurs recommandations concernant la chorioméningite lymphocytaire en 2024, intégrant les dernières données épidémiologiques et thérapeutiques [2].
La Haute Autorité de Santé recommande un diagnostic précoce devant tout syndrome méningé avec notion d'exposition aux rongeurs. La ponction lombaire doit être réalisée en urgence, même en l'absence de signes de gravité apparents. Cette approche permet de réduire significativement le risque de complications .
Santé Publique France insiste sur la déclaration obligatoire des cas confirmés. Cette surveillance épidémiologique permet de détecter d'éventuelles épidémies et d'adapter les mesures de prévention. Les médecins disposent maintenant d'un formulaire simplifié pour faciliter ces déclarations [2].
Pour les femmes enceintes, les recommandations sont particulièrement strictes. Toute exposition suspectée doit conduire à une consultation spécialisée en urgence. Un suivi échographique renforcé est préconisé pendant toute la grossesse pour dépister d'éventuelles malformations fœtales [8].
L'INSERM coordonne un réseau de surveillance national incluant 15 centres de référence. Ces centres collectent les données cliniques et biologiques pour améliorer la connaissance de la maladie et optimiser les stratégies thérapeutiques .
Les nouvelles directives européennes, transposées en droit français en 2024, renforcent les obligations de prévention dans les laboratoires de recherche. Les établissements doivent désormais mettre en place des programmes de formation spécifiques pour leur personnel .
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs organismes peuvent vous accompagner si vous êtes confronté à la chorioméningite lymphocytaire. Ces ressources offrent information, soutien et orientation vers les professionnels compétents.
L'Association France Méningites dispose d'une ligne d'écoute gratuite et propose des brochures d'information spécialisées. Bien qu'elle se concentre principalement sur les méningites bactériennes, elle peut vous orienter vers des spécialistes des méningites virales [7].
Le réseau Orphanet référence la chorioméningite lymphocytaire parmi les maladies rares et propose une fiche d'information détaillée. Ce portail vous permet également de localiser les centres de référence les plus proches de votre domicile [8].
Les centres hospitaliers universitaires disposent généralement de services de neurologie spécialisés dans les infections du système nerveux central. N'hésitez pas à demander une consultation spécialisée si vous avez des questions sur votre prise en charge ou votre suivi [7].
Pour les professionnels exposés, les services de médecine du travail proposent des formations spécifiques sur les risques zoonotiques. Ces formations incluent les mesures de prévention et les conduites à tenir en cas d'exposition [2].
D'ailleurs, plusieurs groupes de patients se sont créés sur les réseaux sociaux. Ces communautés virtuelles permettent d'échanger expériences et conseils pratiques, même si elles ne remplacent jamais l'avis médical professionnel.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos recommandations concrètes pour prévenir la chorioméningite lymphocytaire et gérer au mieux cette maladie si elle survient.
Prévention au quotidien : Stockez vos aliments dans des contenants hermétiques, éliminez régulièrement les déchets et maintenez une propreté rigoureuse dans votre cuisine et vos espaces de stockage. Ces gestes simples réduisent l'attraction des rongeurs [4].
Si vous devez nettoyer un espace potentiellement contaminé, préparez-vous correctement. Aérez la zone pendant 30 minutes avant d'entrer, portez un masque FFP2 et des gants jetables. Humidifiez les surfaces avec une solution désinfectante avant de commencer le nettoyage [1].
Surveillance des symptômes : Après une exposition suspectée, surveillez attentivement votre état de santé pendant 3 semaines. Toute fièvre, maux de tête persistants ou raideur de la nuque doit vous conduire à consulter rapidement [7].
En cas de diagnostic confirmé, respectez scrupuleusement le repos prescrit. Ne reprenez vos activités qu'après accord médical, même si vous vous sentez mieux. La fatigue peut persister plusieurs semaines et nécessite une reprise progressive [8].
Pour les familles, informez vos proches des mesures de prévention sans créer d'anxiété excessive. La chorioméningite lymphocytaire reste une maladie rare, mais la prévention reste le meilleur moyen de l'éviter [2].
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous alerter et vous conduire à consulter rapidement, voire en urgence. La précocité du diagnostic améliore considérablement le pronostic de la chorioméningite lymphocytaire [7].
Consultation en urgence : Rendez-vous immédiatement aux urgences si vous présentez des maux de tête intenses avec raideur de la nuque, surtout après une exposition aux rongeurs. La fièvre élevée (>39°C) associée à des vomissements et une sensibilité à la lumière constitue également un motif d'urgence [8].
Les troubles neurologiques nécessitent une prise en charge immédiate : confusion, somnolence anormale, convulsions ou troubles de l'élocution. Ces symptômes peuvent signaler une atteinte cérébrale grave [7].
Consultation programmée : Prenez rendez-vous avec votre médecin traitant si vous développez des symptômes grippaux dans les 3 semaines suivant une exposition suspectée. Même en l'absence de signes de gravité, un avis médical est recommandé [8].
Pour les femmes enceintes, toute exposition aux rongeurs, même minime, justifie une consultation spécialisée. Le risque de transmission materno-fœtale impose une surveillance particulière pendant toute la grossesse [8].
N'hésitez pas à recontacter votre médecin si vos symptômes s'aggravent ou persistent au-delà de la durée habituelle. Certaines complications peuvent survenir tardivement et nécessiter une réévaluation médicale [7].
Questions Fréquentes
La chorioméningite lymphocytaire est-elle contagieuse entre humains ?
Non, la transmission interhumaine est exceptionnelle. Seuls quelques cas par transplantation d'organes ont été rapportés.
Combien de temps dure la maladie ?
Les formes bénignes guérissent en 1 à 2 semaines. Les formes neurologiques peuvent nécessiter plusieurs semaines de récupération.
Peut-on avoir la maladie plusieurs fois ?
Non, la guérison confère une immunité durable. Les réinfections sont exceptionnelles.
Mon animal de compagnie peut-il me contaminer ?
Les rongeurs domestiques peuvent être porteurs du virus. Respectez les règles d'hygiène lors de leur manipulation.
Existe-t-il un vaccin ?
Aucun vaccin n'est actuellement disponible, mais les recherches progressent.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Breizh CoCoA 2024. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santéLien
- [4] Safety, Tolerability, and Immunogenicity of GS-2829Lien
- [5] Tyk2 Inhibition Prevents Islet Inflammation and Delays Type 1 Diabetes DevelopmentLien
- [6] Virus de la chorioméningite lymphocytaire: cas d'exposition en laboratoireLien
- [7] Risques zoonotiques et traumatiques liés aux contacts des enfants avec les animaux de compagnie non traditionnelsLien
- [8] Role of meningeal macrophages upon viral neuroinfectionLien
- [9] Recommandations concernant le dépistage universel des troubles de l'audition chez les nouveau-nésLien
- [10] Etude des possibilités de transmission des bactéries par les nouveaux animaux de compagniesLien
- [11] Entre le bien-être du rat d'égout et la santé publique, faut-il choisir?Lien
- [12] PD-1 preserves the stem-like properties of memory-like CD8+ T cells during chronic viral infectionLien
- [13] Infection chronique par le virus de l'hépatite C-Les lymphocytes T épuisés persistent et signent après le traitementLien
- [14] Chorioméningite lymphocytaire - InfectionsLien
- [15] Chorioméningite lymphocytaire : causes, symptômes et traitementLien
Publications scientifiques
- Virus de la chorioméningite lymphocytaire: cas d'exposition en laboratoire (2023)
- Avis. Risques zoonotiques et traumatiques liés aux contacts des enfants avec les animaux de compagnie non traditionnels (ACNT) (2024)
- Role of meningeal macrophages upon viral neuroinfection (2023)
- [PDF][PDF] Recommandations concernant le dépistage universel des troubles de l'audition chez les nouveau-nés (recommandation B) (2025)[PDF]
- Etude des possibilités de transmission des bactéries par les nouveaux animaux de compagnies, cas des wilayas de Skikda et Constantine. (2024)[PDF]
Ressources web
- Chorioméningite lymphocytaire - Infections (msdmanuals.com)
Pour diagnostiquer la chorioméningite lymphocytaire, les médecins réalisent une ponction lombaire et des analyses de sang à la recherche du virus. Le traitement ...
- Chorioméningite lymphocytaire : causes, symptômes et ... (medicoverhospitals.in)
Le diagnostic implique des analyses de sang, une analyse du liquide céphalorachidien et une imagerie. 5. Quelles sont les complications de la chorioméningite ...
- Chorioméningite lymphocytaire (fr.wikipedia.org)
Symptômes · Fièvre, céphalée, examen des signes méningés (d), photophobie, nausée, vomissement et tremblement · Voir et modifier les données sur Wikidata ...
- Agents Pathogènes – Virus de la chorioméningite ... (canada.ca)
... symptômes tels que de la fièvre, de la toux, un malaise, une myalgie, des ... PREMIERS SOINS ET TRAITEMENT : Il s'agit en général d'un traitement de ...
- Fiche Chorioméningite.qxp - Ministère de l'Agriculture (agriculture.gouv.fr)
▻Généralement sans symptôme. ▻Parfois symptômes nerveux et mort rapide. Épidémiologie. Transmission de la chorioméningite lymphocytaire. Principalement :.
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
