Arrêt Cardiaque : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements & Prévention
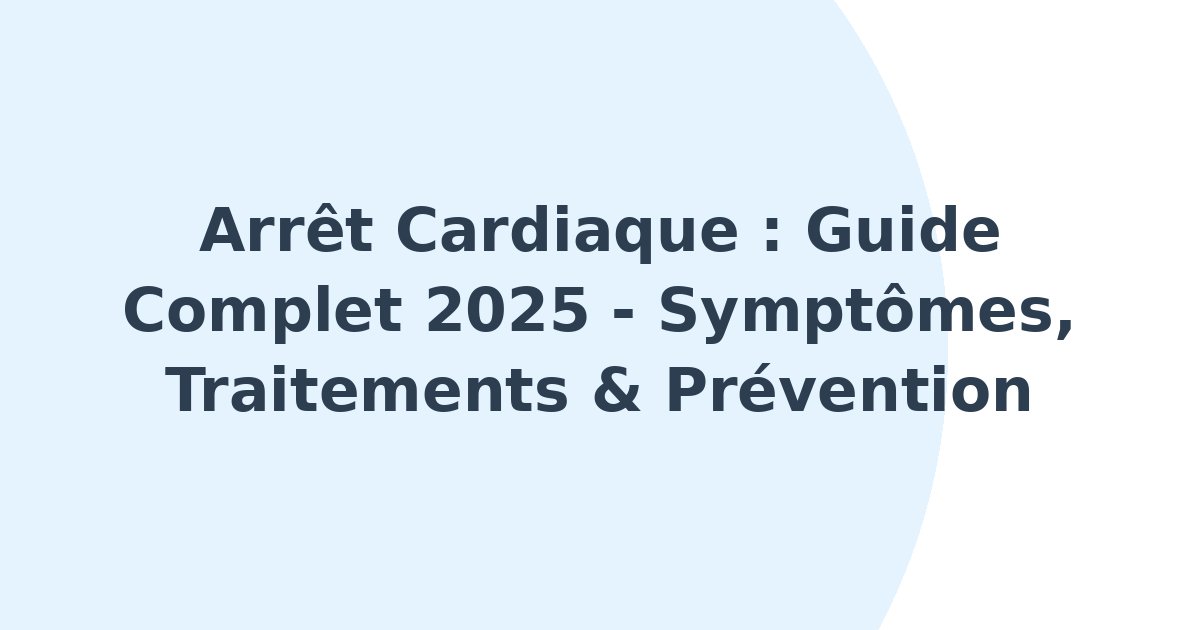
L'arrêt cardiaque représente l'une des urgences médicales les plus critiques. En France, cette pathologie touche environ 50 000 personnes chaque année selon Santé Publique France [1,2]. Contrairement aux idées reçues, l'arrêt cardiaque peut survenir chez des personnes apparemment en bonne santé. Comprendre cette pathologie, ses signes d'alerte et les gestes qui sauvent peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort.
Téléconsultation et Arrêt cardiaque
Téléconsultation non recommandéeL'arrêt cardiaque constitue une urgence vitale absolue nécessitant une réanimation cardio-pulmonaire immédiate et des soins intensifs spécialisés. La téléconsultation ne peut en aucun cas remplacer la prise en charge d'urgence indispensable, mais peut éventuellement servir pour un suivi post-réanimation ou une évaluation préventive du risque cardiovasculaire.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation des antécédents cardiovasculaires et facteurs de risque. Analyse de l'historique des épisodes cardiaques antérieurs. Discussion sur l'observance des traitements cardioprotecteurs prescrits. Évaluation du contexte familial et génétique. Orientation vers une consultation cardiologique spécialisée.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Réanimation cardio-pulmonaire immédiate et défibrillation. Examens cardiaques complets (ECG, échocardiographie, coronarographie). Surveillance en unité de soins intensifs. Implantation éventuelle de dispositifs cardiaques (défibrillateur, pacemaker).
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Tout épisode d'arrêt cardiaque récent nécessitant un bilan cardiologique complet. Évaluation de l'indication à l'implantation d'un défibrillateur automatique. Surveillance post-réanimation et ajustement thérapeutique complexe. Bilan d'une cardiomyopathie sous-jacente ou d'une cardiopathie ischémique.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Tout arrêt cardiaque en cours ou récent (moins de 48h). Signes de récidive imminente avec troubles du rythme graves. Dysfonctionnement d'un dispositif cardiaque implanté.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Perte de connaissance brutale avec absence de pouls
- Arrêt respiratoire associé à une perte de connaissance
- Convulsions ou rigidité suivant une perte de connaissance
- Cyanose (coloration bleutée) des lèvres ou du visage
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Cardiologue — consultation en présentiel indispensable
L'arrêt cardiaque nécessite impérativement une prise en charge cardiologique spécialisée en présentiel pour réaliser les examens diagnostiques indispensables et adapter le traitement préventif. La téléconsultation ne peut servir qu'en complément pour le suivi à distance.
Arrêt cardiaque : Définition et Vue d'Ensemble
L'arrêt cardiaque correspond à l'interruption brutale et inattendue de l'activité du cœur. Contrairement à l'infarctus du myocarde, il ne s'agit pas d'un problème de circulation sanguine mais d'un dysfonctionnement électrique [15]. Le cœur cesse littéralement de battre efficacement.
Cette pathologie se caractérise par l'absence de pouls et de respiration normale. En quelques minutes seulement, le cerveau et les autres organes vitaux ne reçoivent plus d'oxygène. C'est pourquoi chaque seconde compte dans la prise en charge [3].
Il faut distinguer l'arrêt cardiaque de l'arrêt cardio-respiratoire. Dans le premier cas, seul le cœur s'arrête initialement. Dans le second, cœur et respiration cessent simultanément. Mais attention : sans intervention rapide, un arrêt cardiaque évolue toujours vers un arrêt cardio-respiratoire complet [11].
L'important à retenir ? L'arrêt cardiaque peut toucher n'importe qui, à n'importe quel âge. Même si certains facteurs augmentent les risques, cette pathologie reste imprévisible. D'ailleurs, environ 80% des arrêts cardiaques surviennent au domicile, souvent devant des proches non formés aux gestes de secours [7].
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les chiffres de l'arrêt cardiaque en France sont préoccupants. Selon les dernières données de Santé Publique France, environ 50 000 personnes sont victimes d'un arrêt cardiaque chaque année dans notre pays [1,2]. Cela représente plus de 130 cas par jour, soit un arrêt cardiaque toutes les 10 minutes.
L'incidence varie considérablement selon l'âge et le sexe. Les hommes sont plus touchés que les femmes, avec un ratio de 2:1. L'âge moyen des victimes se situe autour de 65 ans, mais 15% des cas concernent des personnes de moins de 50 ans [4,5]. Ces données montrent que personne n'est à l'abri.
Comparé aux autres pays européens, la France se situe dans la moyenne. L'Allemagne enregistre environ 65 000 cas annuels, tandis que le Royaume-Uni en compte 30 000. Rapporté à la population, ces chiffres sont similaires [4]. En revanche, les pays nordiques affichent de meilleurs taux de survie grâce à une formation plus large de la population aux gestes de secours.
L'évolution sur les dix dernières années montre une légère augmentation de l'incidence, probablement liée au vieillissement de la population. Mais heureusement, le taux de survie s'améliore progressivement grâce aux progrès de la réanimation et à la multiplication des défibrillateurs automatiques dans l'espace public [1,2].
En termes d'impact économique, l'arrêt cardiaque représente un coût considérable pour le système de santé français. Entre les interventions d'urgence, les hospitalisations prolongées et les soins de réadaptation, chaque cas coûte en moyenne 45 000 euros selon le Ministère de la Santé [4,5].
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes de l'arrêt cardiaque sont multiples et parfois surprenantes. La maladie coronarienne reste la principale responsable, impliquée dans 70% des cas [3,15]. Mais d'autres pathologies cardiaques peuvent également déclencher un arrêt : cardiomyopathies, troubles du rythme, malformations congénitales.
Certains facteurs de risque sont bien identifiés. L'âge avancé, le sexe masculin, les antécédents familiaux constituent des éléments non modifiables. En revanche, vous pouvez agir sur d'autres facteurs : tabagisme, hypertension artérielle, diabète, obésité, sédentarité [4,5].
Il faut savoir que certaines situations particulières augmentent temporairement le risque. L'effort physique intense chez une personne non entraînée, le stress émotionnel majeur, certains médicaments ou drogues peuvent déclencher un arrêt cardiaque [16]. C'est pourquoi il est important d'adapter progressivement son activité physique.
Chez les jeunes, les causes diffèrent. Les cardiomyopathies hypertrophiques, les syndromes de mort subite héréditaires ou les commotions thoraciques lors d'activités sportives sont plus fréquemment en cause [13]. D'où l'importance du dépistage cardiologique avant la pratique sportive intensive.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Reconnaître un arrêt cardiaque peut sauver une vie. Les signes sont généralement évidents : la personne s'effondre brutalement, perd connaissance et ne répond plus aux stimulations [3,15]. Elle ne respire plus normalement ou présente des mouvements respiratoires inefficaces appelés "gasping".
Mais attention, certains signes précurseurs peuvent parfois alerter. Des douleurs thoraciques intenses, un essoufflement soudain, des palpitations importantes ou des malaises répétés doivent vous inquiéter [3]. Ces symptômes ne précèdent pas toujours un arrêt cardiaque, mais ils méritent une consultation urgente.
Concrètement, comment vérifier si une personne est en arrêt cardiaque ? Secouez doucement ses épaules en lui parlant fort. Si elle ne réagit pas, vérifiez sa respiration en observant son thorax pendant 10 secondes maximum. Absence de réaction et respiration anormale = arrêt cardiaque probable [7].
Ne perdez pas de temps à chercher le pouls si vous n'êtes pas formé. Cette vérification est difficile et peut retarder les secours. En cas de doute, mieux vaut commencer immédiatement la réanimation cardio-pulmonaire [9].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic d'arrêt cardiaque est avant tout clinique et doit être posé en quelques secondes. Les équipes de secours utilisent un protocole standardisé : vérification de la conscience, de la respiration, puis recherche du pouls [11,15]. Chaque étape ne doit pas dépasser 10 secondes.
Une fois la réanimation entreprise, l'électrocardiogramme devient l'examen clé. Il permet d'identifier le type d'arrêt cardiaque : fibrillation ventriculaire, tachycardie ventriculaire, asystolie ou activité électrique sans pouls. Cette distinction guide le traitement immédiat [8,11].
Parallèlement, les équipes médicales recherchent les causes réversibles grâce à la règle des "4H et 4T" : Hypoxie, Hypovolémie, Hyperkaliémie, Hypothermie, Thrombose coronaire, Thrombose pulmonaire, Tamponnade, Tension pneumothorax [15]. Cette approche systématique améliore les chances de succès.
En milieu hospitalier, d'autres examens peuvent être nécessaires : échographie cardiaque, scanner thoracique, bilan biologique complet. Mais l'important reste de ne jamais retarder la réanimation pour réaliser des examens [11].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de l'arrêt cardiaque repose sur la "chaîne de survie" : reconnaissance précoce, alerte rapide, réanimation cardio-pulmonaire et défibrillation [7,9]. Chaque maillon est crucial et doit s'enchaîner sans délai.
La réanimation cardio-pulmonaire (RCP) constitue le traitement de base. Elle associe compressions thoraciques et ventilation artificielle selon un rythme précis : 30 compressions pour 2 insufflations [7]. Les compressions doivent être profondes (5-6 cm), rapides (100-120/min) et permettre un relâchement complet du thorax.
Le défibrillateur automatisé externe (DAE) peut corriger certains troubles du rythme. Cet appareil analyse automatiquement le rythme cardiaque et délivre un choc électrique si nécessaire. Son utilisation est simple et accessible à tous [6,7]. D'ailleurs, la loi française autorise toute personne à utiliser un DAE, même sans formation spécifique.
En milieu médical, d'autres traitements sont disponibles : médicaments (adrénaline, amiodarone), intubation, assistance circulatoire mécanique. L'ECMO (oxygénation par membrane extracorporelle) représente une technique de pointe pour les cas les plus graves [8,12]. Cette technologie peut maintenir la circulation sanguine pendant plusieurs heures, le temps de traiter la cause de l'arrêt.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Les dernières recommandations internationales, mises à jour en 2024, intègrent de nouvelles approches thérapeutiques prometteuses [6]. Ces innovations visent à améliorer le taux de survie et la qualité de vie des survivants.
L'une des avancées majeures concerne l'utilisation de l'hypothermie thérapeutique contrôlée. Cette technique, qui consiste à refroidir le patient à 32-34°C pendant 12 à 24 heures, protège le cerveau des lésions liées au manque d'oxygène . Les résultats des derniers essais cliniques montrent une amélioration significative du pronostic neurologique.
La recherche française n'est pas en reste. Les travaux présentés lors des JESFC 2025 révèlent des progrès considérables dans la formation par simulation [7]. Cette approche permet d'améliorer la rétention des compétences chez les professionnels de santé et les secouristes. Concrètement, les équipes formées par simulation obtiennent de meilleurs résultats lors d'arrêts cardiaques réels.
L'intelligence artificielle fait également son entrée dans ce domaine. Des algorithmes prédictifs peuvent désormais identifier les patients à risque d'arrêt cardiaque plusieurs heures avant l'événement . Cette technologie, testée dans plusieurs hôpitaux français, pourrait révolutionner la prévention.
Enfin, les nouvelles techniques d'assistance circulatoire mécanique se démocratisent. L'ECMO portable permet désormais d'intervenir directement sur le lieu de l'arrêt cardiaque, augmentant considérablement les chances de survie [8,12].
Vivre au Quotidien avec les Séquelles d'un Arrêt Cardiaque
Survivre à un arrêt cardiaque représente un véritable défi, mais c'est possible. Environ 5 à 10% des victimes d'arrêt cardiaque extrahospitalier survivent et rentrent chez elles [1,2]. Ces chiffres, bien qu'encourageants, cachent une réalité complexe : la récupération peut être longue et difficile.
Les séquelles neurologiques constituent la principale préoccupation. Le manque d'oxygène au cerveau peut entraîner des troubles de la mémoire, de la concentration ou des fonctions exécutives [9,11]. Heureusement, le cerveau possède une remarquable capacité d'adaptation. Avec une rééducation appropriée, de nombreux patients récupèrent une grande partie de leurs capacités.
L'aspect psychologique ne doit pas être négligé. Beaucoup de survivants développent une anxiété liée à la peur de récidive. Certains évitent les activités physiques ou sociales par crainte. Un accompagnement psychologique spécialisé s'avère souvent nécessaire pour retrouver confiance en soi [10].
Côté cardiaque, un suivi régulier est indispensable. La cause de l'arrêt doit être identifiée et traitée pour éviter la récidive. Cela peut nécessiter la pose d'un défibrillateur implantable, un traitement médicamenteux ou parfois une intervention chirurgicale [16]. Rassurez-vous, ces traitements permettent généralement de reprendre une vie normale.
Les Complications Possibles
L'arrêt cardiaque peut entraîner diverses complications, même après une réanimation réussie. Les lésions cérébrales anoxiques représentent la complication la plus redoutée [11,15]. Elles résultent du manque d'oxygène au cerveau et peuvent aller de troubles légers à un coma profond.
Les complications cardiaques sont également fréquentes. Le syndrome post-arrêt cardiaque associe dysfonction myocardique, instabilité hémodynamique et troubles du rythme [11]. Cette pathologie nécessite une surveillance intensive pendant les premières 48 heures.
D'autres organes peuvent être touchés. Les reins, le foie et les poumons souffrent également du manque d'oxygène. Une défaillance multiviscérale peut se développer, compliquant la prise en charge [15]. Heureusement, ces dysfonctions sont souvent réversibles avec un traitement adapté.
Les complications liées à la réanimation elle-même existent aussi. Fractures costales, pneumothorax, lésions hépatiques peuvent survenir lors des compressions thoraciques [9]. Mais ne vous inquiétez pas : ces complications sont généralement mineures comparées au bénéfice vital de la réanimation.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'arrêt cardiaque dépend de nombreux facteurs. Le plus important reste le délai de prise en charge : chaque minute qui passe réduit les chances de survie de 7 à 10% [7,9]. C'est pourquoi la rapidité d'intervention est cruciale.
Le lieu de survenue influence également le pronostic. Les arrêts cardiaques intrahospitaliers ont un meilleur pronostic que ceux survenant à domicile [11]. En effet, les équipes médicales peuvent intervenir immédiatement, et les moyens de réanimation sont directement disponibles.
Le type de trouble du rythme initial joue un rôle déterminant. La fibrillation ventriculaire et la tachycardie ventriculaire ont un meilleur pronostic que l'asystolie ou l'activité électrique sans pouls [15]. Ces rythmes "choquables" répondent mieux à la défibrillation.
L'âge et les antécédents médicaux influencent aussi les chances de récupération. Les patients jeunes et sans comorbidités ont logiquement un meilleur pronostic [16]. Mais attention : l'âge seul ne doit jamais faire renoncer à la réanimation. De nombreuses personnes âgées récupèrent parfaitement.
Globalement, le taux de survie à la sortie d'hôpital varie de 2 à 15% selon les études [1,2]. Ces chiffres peuvent paraître décourageants, mais ils s'améliorent régulièrement grâce aux progrès de la réanimation et à la formation du grand public.
Peut-on Prévenir l'Arrêt Cardiaque ?
La prévention de l'arrêt cardiaque passe d'abord par la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaires. Contrôler votre tension artérielle, votre cholestérol et votre diabète réduit significativement le risque [4,5]. Ces mesures simples peuvent diviser par deux votre risque d'accident cardiaque.
L'arrêt du tabac constitue la mesure préventive la plus efficace. Le tabagisme multiplie par 3 le risque d'arrêt cardiaque [4]. Mais la bonne nouvelle ? Ce risque diminue rapidement après l'arrêt : 50% de réduction dès la première année, retour au niveau d'un non-fumeur après 5 ans.
L'activité physique régulière protège également le cœur. 30 minutes de marche rapide 5 fois par semaine suffisent à réduire significativement le risque [5]. Attention cependant : si vous reprenez le sport après 40 ans, consultez votre médecin pour un bilan cardiaque préalable.
Chez les personnes à haut risque, des traitements préventifs spécifiques existent. Le défibrillateur implantable peut être proposé aux patients avec une fraction d'éjection altérée ou des antécédents de troubles du rythme graves [16]. Cette prévention "secondaire" sauve de nombreuses vies.
Enfin, la formation aux gestes de secours constitue une prévention collective essentielle. Plus il y a de personnes formées dans la population, plus les chances de survie augmentent [7]. C'est un investissement pour toute la société.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont publié des recommandations claires concernant l'arrêt cardiaque. La Haute Autorité de Santé (HAS) insiste sur l'importance de la formation du grand public aux gestes de secours [1,2]. L'objectif : former 20% de la population française d'ici 2030.
Le Ministère de la Santé a lancé un plan national de lutte contre l'arrêt cardiaque [4,5]. Ce programme prévoit l'installation de 120 000 défibrillateurs supplémentaires dans les lieux publics d'ici 2025. Chaque commune de plus de 1000 habitants devra être équipée.
Santé Publique France recommande un dépistage cardiologique systématique chez les sportifs de haut niveau [1,2]. Cette mesure vise à identifier les pathologies cardiaques silencieuses pouvant provoquer un arrêt cardiaque à l'effort. Un électrocardiogramme et une échographie cardiaque sont préconisés.
Les nouvelles recommandations 2024-2025 intègrent également l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la prédiction des arrêts cardiaques . Plusieurs hôpitaux français testent actuellement ces systèmes d'alerte précoce.
Concernant la formation professionnelle, toutes les équipes soignantes doivent désormais être certifiées en réanimation cardio-pulmonaire . Cette certification doit être renouvelée tous les deux ans pour maintenir les compétences à jour.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations accompagnent les victimes d'arrêt cardiaque et leurs familles. L'Association pour la Recherche en Cardiologie (ARCFA) propose un soutien psychologique et des groupes de parole. Ces rencontres permettent d'échanger avec d'autres personnes ayant vécu la même épreuve.
La Fédération Française de Cardiologie organise régulièrement des formations aux gestes de secours. Ces sessions gratuites s'adressent au grand public et durent généralement 2 heures. Vous y apprendrez la réanimation cardio-pulmonaire et l'utilisation d'un défibrillateur [7].
Pour les professionnels de santé, la Société Française d'Anesthésie et de Réanimation (SFAR) propose des formations continues spécialisées. Ces programmes intègrent les dernières innovations thérapeutiques et les nouvelles recommandations .
Au niveau européen, l'European Resuscitation Council publie régulièrement des guidelines mises à jour. Ces recommandations font référence dans le monde entier et guident les pratiques professionnelles [6].
N'hésitez pas à contacter votre cardiologue ou votre médecin traitant pour obtenir des informations personnalisées. Ils pourront vous orienter vers les ressources les plus adaptées à votre situation.
Nos Conseils Pratiques
Face à un arrêt cardiaque, chaque geste compte. Voici nos conseils pratiques pour bien réagir. D'abord, gardez votre calme et évaluez rapidement la situation. Vérifiez que l'environnement est sûr avant d'approcher la victime [7,9].
Si la personne ne répond pas et ne respire pas normalement, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112. Donnez votre localisation précise et décrivez la situation clairement. N'hésitez pas à demander qu'on vous envoie un défibrillateur si disponible dans les environs.
Commencez immédiatement la réanimation cardio-pulmonaire. Placez vos mains au centre du thorax, bras tendus, et effectuez des compressions profondes et rapides. Alternez 30 compressions et 2 insufflations si vous savez faire [7]. Sinon, contentez-vous des compressions continues.
Utilisez le défibrillateur dès qu'il arrive. Ces appareils sont conçus pour être utilisés par tous, même sans formation. Suivez simplement les instructions vocales. L'appareil analyse automatiquement le rythme cardiaque et vous indique s'il faut choquer ou non [6].
Continuez la réanimation jusqu'à l'arrivée des secours, même si vous êtes fatigué. Relayez-vous avec d'autres personnes présentes si possible. Ne vous arrêtez que si la victime reprend conscience ou si les secours prennent le relais [9].
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous alerter et vous pousser à consulter rapidement. Des douleurs thoraciques intenses, surtout si elles irradient vers le bras gauche, la mâchoire ou le dos, nécessitent une consultation urgente [3]. Ne prenez aucun risque avec ces symptômes.
L'essoufflement anormal à l'effort ou au repos doit également vous inquiéter. Si vous ne pouvez plus monter un étage sans être essoufflé alors que c'était facile avant, consultez votre médecin [3,16]. Ce symptôme peut révéler une insuffisance cardiaque débutante.
Les palpitations fréquentes ou prolongées méritent un avis médical. Surtout si elles s'accompagnent de malaises, de vertiges ou de douleurs thoraciques [16]. Un simple électrocardiogramme peut détecter des troubles du rythme dangereux.
Si vous avez des antécédents familiaux de mort subite ou d'arrêt cardiaque, parlez-en à votre médecin. Un bilan cardiologique préventif peut être recommandé, surtout avant de reprendre une activité sportive [4,5].
Enfin, n'hésitez pas à consulter si vous ressentez une anxiété importante liée à votre cœur. Cette peur peut être le signe d'un problème sous-jacent ou nécessiter un accompagnement psychologique [10].
Questions Fréquentes
L'arrêt cardiaque est-il la même chose qu'une crise cardiaque ?
Non, ce sont deux pathologies différentes. La crise cardiaque (infarctus) est un problème de circulation sanguine dans le cœur, tandis que l'arrêt cardiaque est un dysfonctionnement électrique qui stoppe les battements.
Peut-on survivre à un arrêt cardiaque ?
Oui, mais les chances dépendent de la rapidité des secours. Avec une prise en charge immédiate, le taux de survie peut atteindre 50%. Sans intervention, il est proche de zéro.
Faut-il une formation pour utiliser un défibrillateur ?
Non, ces appareils sont conçus pour être utilisés par tous. Ils donnent des instructions vocales claires et analysent automatiquement le rythme cardiaque. N'hésitez jamais à l'utiliser.
L'arrêt cardiaque peut-il toucher les jeunes ?
Oui, même si c'est plus rare. Chez les jeunes, les causes sont souvent génétiques : cardiomyopathies, syndromes de mort subite héréditaires. D'où l'importance du dépistage chez les sportifs.
Que faire si on a peur de mal faire lors de la réanimation ?
Il vaut mieux mal faire que ne rien faire du tout. Une réanimation imparfaite donne plus de chances de survie que l'absence d'intervention. Les complications de la réanimation sont mineures comparées au bénéfice vital.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Grandes causes de mortalité en France en 2022 et tendances - Santé Publique FranceLien
- [2] Grandes causes de mortalité en France en 2022 et tendances - Santé Publique FranceLien
- [3] Reconnaître un infarctus (ou crise cardiaque) et agir - Ameli.frLien
- [4] Maladies cardiovasculaires - Ministère du Travail, de la SantéLien
- [5] Maladies cardiovasculaires - Ministère du Travail, de la SantéLien
- [6] Le programme des JESFC 2025 - Innovation thérapeutiqueLien
- [7] AFRICARDIO 2025 - Innovation thérapeutiqueLien
- [8] Articles du bulletin - Innovation thérapeutiqueLien
- [9] Evaluating the current breadth of randomized control trials - Innovation thérapeutiqueLien
- [10] 2024 update of the Utstein Out-of-Hospital Cardiac Arrest - Innovation thérapeutiqueLien
- [11] Rétention des compétences suite à l'apprentissage par simulation dans le syndrome coronarien aigu versus arrêt cardiaqueLien
- [12] Intérêts de l'ECMO veino-artérielle lors d'un arrêt cardiaque extrahospitalierLien
- [13] Histoire de la prise en charge de l'arrêt cardiaque - Médecine Intensive RéanimationLien
- [14] La communication de crise lors d'un arrêt cardiaque - Le SympoLien
- [15] Les spécificités de l'arrêt cardiaque intra-hospitalier et sa prise en chargeLien
- [16] ECMO au cours de l'arrêt cardiaque réfractaire de l'enfant - Médecine Intensive RéanimationLien
- [17] Hémangiome infantile hépatique focal compliqué d'un arrêt cardiaqueLien
- [18] Arrêt cardiaque: le clap de fin pour l'adrénaline? - Médecine Intensive RéanimationLien
- [19] Arrêt cardiaque - Réanimation - MSD ManualsLien
- [20] Arrêt cardiaque soudain - Institut de cardiologie de l'Université d'OttawaLien
Publications scientifiques
- Rétention des compétences suite à l'apprentissage par simulation dans le syndrome coronarien aigu versus arrêt cardiaque (2022)4 citations[PDF]
- Intérêts de l'ECMO veino-artérielle lors d'un arrêt cardiaque extrahospitalier (2023)
- Histoire de la prise en charge de l'arrêt cardiaque (2023)1 citations
- La communication de crise lors d'un arrêt cardiaque. (2024)
- Les spécificités de l'arrêt cardiaque intra-hospitalier et sa prise en charge. (2022)1 citations
Ressources web
- Reconnaître un infarctus (ou crise cardiaque) et agir au ... (ameli.fr)
un malaise ;; un essoufflement soudain ;; une fatigue inexpliquée ;; des sensations inhabituelles dans le bras gauche. Ces symptômes durent souvent plus de cinq ...
- Arrêt cardiaque - Réanimation - Édition professionnelle du ... (msdmanuals.com)
Le diagnostic d'un arrêt cardiaque repose sur la constatation clinique d'une apnée, de l'absence de pouls et d'une inconscience. · Le patient est évalué à la ...
- Arrêt cardiaque soudain | Institut de cardiologie de l' ... (ottawaheart.ca)
Symptômes · des étourdissements · des palpitations cardiaques (pouvant être annonciatrices d'arythmie) · des douleurs à la poitrine.
- Infarctus du myocarde - symptômes, causes, traitements et ... (vidal.fr)
4 mars 2024 — Les symptômes de l'infarctus sont une douleur de la poitrine qui dure plus de 20 à 30 minutes. Elle irradie derrière le sternum, dans le dos, ...
- Symptômes, diagnostic et évolution des troubles du rythme ... (ameli.fr)
En cas d'arrêt cardiaque, il faut agir vite ! · la personne perd connaissance, tombe et ne réagit pas quand on lui parle ou quand on la stimule ; · sa respiration ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
