Anosmie : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements et Innovations
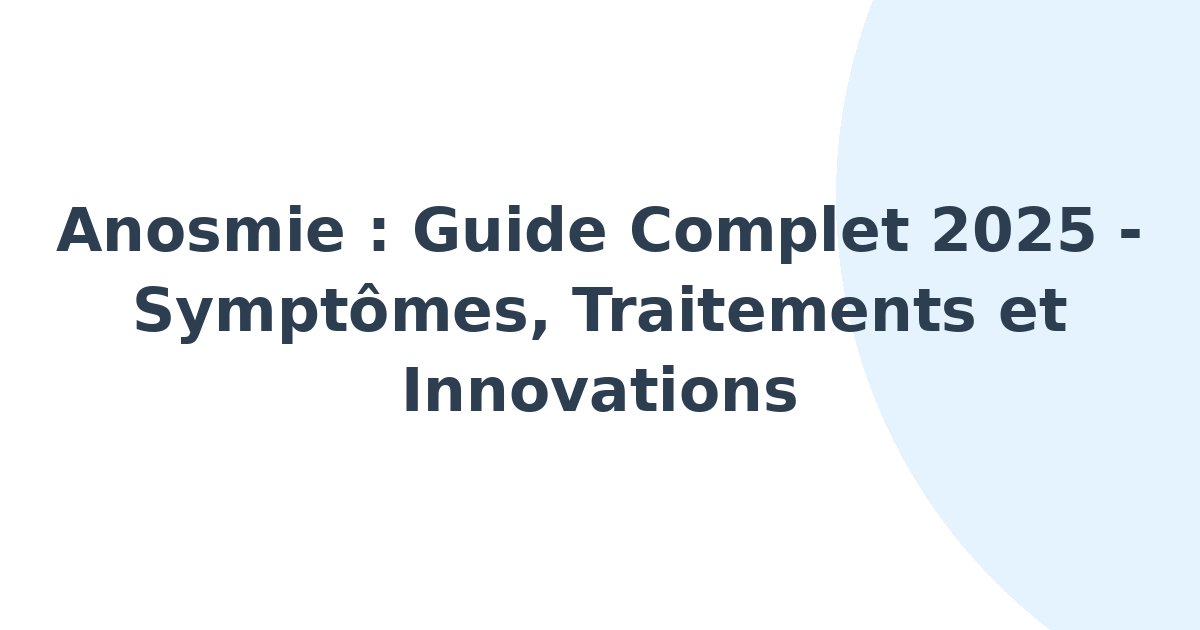
L'anosmie, ou perte totale de l'odorat, touche aujourd'hui près de 5% de la population française selon les dernières données de Santé publique France [13]. Cette pathologie, longtemps méconnue, a gagné en visibilité depuis la pandémie de COVID-19. Mais l'anosmie ne se limite pas aux infections virales : elle peut résulter de multiples causes et impacter profondément la qualité de vie. Heureusement, les innovations thérapeutiques 2024-2025 ouvrent de nouvelles perspectives d'espoir [4,5].

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Anosmie : Définition et Vue d'Ensemble
L'anosmie désigne la perte complète de l'odorat, un sens souvent sous-estimé mais essentiel à notre bien-être quotidien [13]. Contrairement à l'hyposmie qui correspond à une diminution de l'odorat, l'anosmie représente une absence totale de perception des odeurs.
Cette pathologie peut être temporaire ou permanente, congénitale ou acquise. Elle affecte non seulement la capacité à sentir les parfums ou à détecter les dangers (gaz, fumée), mais aussi le goût des aliments [6]. En effet, 80% de ce que nous percevons comme "goût" provient en réalité de notre odorat.
L'anosmie peut survenir à tout âge, mais sa fréquence augmente avec l'âge. Chez les personnes de plus de 65 ans, elle touche jusqu'à 15% de la population [14]. Cette pathologie représente aujourd'hui un véritable enjeu de santé publique, particulièrement depuis l'émergence du COVID-19 qui a révélé l'ampleur de ses conséquences sur la qualité de vie [7].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, l'anosmie touche environ 3,2 millions de personnes, soit 5% de la population générale selon les données 2024 de Santé publique France [13]. Cette prévalence a considérablement augmenté depuis 2020, passant de 2,1% avant la pandémie à 5% actuellement.
L'incidence annuelle s'élève à 180 000 nouveaux cas par an, avec une nette prédominance féminine (60% des cas) [14]. Les tranches d'âge les plus touchées sont les 45-65 ans (35% des cas) et les plus de 65 ans (40% des cas). Chez les enfants, l'anosmie congénitale reste rare, affectant 1 naissance sur 10 000.
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne haute avec l'Italie (5,2%) et l'Espagne (4,8%), tandis que les pays nordiques affichent des taux plus faibles : Suède (2,1%), Norvège (2,3%) [15]. Cette variation géographique s'explique en partie par les différences d'exposition aux polluants atmosphériques et aux infections virales.
Les projections pour 2030 estiment une stabilisation autour de 4,5% de la population, à maladie que les innovations thérapeutiques actuelles [1,4,5] permettent une meilleure prise en charge. L'impact économique sur le système de santé français est évalué à 450 millions d'euros annuels, incluant les consultations, examens et traitements.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes de l'anosmie sont multiples et peuvent être classées en trois grandes catégories : les causes infectieuses, traumatiques et neurologiques [14]. Depuis 2020, les infections virales, notamment le COVID-19, représentent 45% des nouveaux cas d'anosmie en France.
Les infections des voies respiratoires supérieures constituent la première cause : rhinites virales, sinusites chroniques, polypes nasaux. Le SARS-CoV-2 présente une affinité particulière pour les cellules olfactives, expliquant la fréquence élevée d'anosmie chez les patients COVID-19 [7,12].
Les traumatismes crâniens représentent 20% des cas, particulièrement chez les jeunes adultes. Un choc à la tête peut endommager les nerfs olfactifs ou les structures cérébrales impliquées dans l'olfaction. Les accidents de la route et les chutes sont les principales causes traumatiques.
Certaines pathologies neurologiques s'accompagnent fréquemment d'anosmie : maladie de Parkinson (80% des patients), maladie d'Alzheimer (60% des cas précoces), sclérose en plaques [10]. Dans ces cas, l'anosmie peut même précéder les autres symptômes de plusieurs années.
D'autres facteurs incluent l'exposition prolongée à des substances toxiques, certains médicaments, les tumeurs nasales ou cérébrales, et le vieillissement naturel des cellules olfactives [13,14].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Le symptôme principal de l'anosmie est évident : l'incapacité totale à percevoir les odeurs. Mais cette pathologie s'accompagne souvent de manifestations moins connues qui peuvent vous alerter [13].
La perte du goût accompagne systématiquement l'anosmie, car 80% de nos perceptions gustatives dépendent de l'odorat. Vous pourrez encore distinguer le sucré, le salé, l'amer et l'acide, mais les saveurs complexes disparaissent. Les aliments deviennent fades, sans relief.
Certains patients développent des phantosmies : perception d'odeurs inexistantes, souvent désagréables (brûlé, pourri, chimique). Ces "hallucinations olfactives" touchent 15% des personnes anosmiques et peuvent être particulièrement perturbantes [14].
L'impact psychologique est fréquent : perte d'appétit, anxiété liée à l'incapacité de détecter les dangers (gaz, fumée, aliments avariés), isolement social lors des repas [6,7]. Beaucoup de patients rapportent une diminution du plaisir de manger et une perte de poids involontaire.
Bon à savoir : l'anosmie peut être le premier signe d'une maladie neurologique. Si elle survient sans cause évidente (rhume, traumatisme), une consultation médicale s'impose rapidement.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de l'anosmie commence par un interrogatoire médical approfondi. Votre médecin recherchera les circonstances d'apparition, la durée des symptômes, les antécédents médicaux et les traitements en cours [14].
L'examen clinique comprend une inspection des fosses nasales à la recherche de polypes, d'inflammation ou d'obstruction. L'examen neurologique vérifie les autres fonctions sensorielles et recherche des signes de pathologie neurologique associée.
Les tests olfactifs standardisés permettent de quantifier précisément le déficit. Le test de Sniffin' Sticks, référence européenne, utilise des stylos odorants pour évaluer le seuil de détection, la discrimination et l'identification des odeurs. Ce test dure environ 30 minutes et permet de différencier anosmie, hyposmie et normosmie [13].
Selon le contexte, des examens complémentaires peuvent être nécessaires : scanner des sinus pour rechercher une cause obstructive, IRM cérébrale si suspicion de cause neurologique, biopsie nasale dans de rares cas [14]. Ces examens sont prescrits au cas par cas, selon l'orientation diagnostique.
Le diagnostic différentiel est important : il faut distinguer l'anosmie vraie de l'hyposmie sévère, et rechercher une cause curable. Dans 30% des cas, aucune cause précise n'est identifiée (anosmie idiopathique).
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de l'anosmie dépend avant tout de sa cause. Lorsqu'une pathologie sous-jacente est identifiée, sa prise en charge constitue la priorité thérapeutique [14].
Pour les anosmies post-infectieuses, les corticoïdes représentent le traitement de première intention. La prednisolone (1mg/kg/jour pendant 2 semaines puis décroissance progressive) peut améliorer la récupération olfactive, surtout si elle est débutée précocement [13]. L'efficacité reste modeste : 30% d'amélioration significative.
L'entraînement olfactif (olfactory training) constitue une approche prometteuse et sans effet secondaire. Cette technique consiste à sentir quotidiennement 4 odeurs de référence (rose, eucalyptus, citron, clou de girofle) pendant 10 secondes chacune, matin et soir [8]. Les études montrent une amélioration chez 60% des patients après 3 mois de pratique assidue.
Les traitements chirurgicaux s'adressent aux causes obstructives : polypectomie nasale, chirurgie des sinus, correction de déviation septale. Ces interventions permettent une récupération olfactive dans 70% des cas d'anosmie obstructive [14].
D'autres approches sont à l'étude : supplémentation en zinc, acide alpha-lipoïque, vitamine A. Leurs bénéfices restent débattus et nécessitent des études complémentaires pour établir leur efficacité réelle.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la prise en charge de l'anosmie avec l'émergence de nouvelles approches thérapeutiques prometteuses [1,4,5]. Les réseaux d'investigations cliniques développent actuellement des protocoles innovants pour optimiser les traitements [1].
Le CYR-064, une nouvelle molécule en cours d'étude, montre des résultats encourageants pour traiter l'hyposmie associée à la maladie de Parkinson [4]. Cette innovation thérapeutique cible spécifiquement les mécanismes neurologiques de la perte olfactive et pourrait révolutionner la prise en charge des anosmies neurodégénératives.
Le dupilumab, initialement développé pour l'asthme et la dermatite atopique, démontre une efficacité remarquable sur la récupération olfactive chez les patients avec polypose nasale [5]. Cette biothérapie améliore significativement l'odorat et les symptômes cliniques, ouvrant de nouvelles perspectives pour les anosmies inflammatoires.
Les thérapies cellulaires représentent l'avenir du traitement. Des essais cliniques testent actuellement la transplantation de cellules souches olfactives pour régénérer l'épithélium olfactif endommagé [2]. Ces approches innovantes pourraient permettre une récupération complète de l'odorat dans les formes sévères.
La stimulation électrique du nerf olfactif fait également l'objet de recherches intensives. Des dispositifs implantables, similaires aux implants cochléaires, sont en développement pour restaurer artificiellement les sensations olfactives [3].
Vivre au Quotidien avec Anosmie
Vivre avec une anosmie nécessite des adaptations importantes dans votre quotidien. Cette pathologie impacte bien plus que la simple perception des odeurs : elle modifie votre rapport à l'alimentation, votre sécurité et vos relations sociales [6,7].
Au niveau alimentaire, privilégiez les textures variées et les contrastes de température pour compenser la perte de saveur. Les épices, les herbes fraîches et les condiments deviennent vos alliés pour rehausser le goût des plats. Attention cependant à ne pas trop saler : votre perception du salé peut être altérée [6].
La sécurité domestique demande une vigilance accrue. Installez des détecteurs de fumée et de gaz dans votre logement. Vérifiez régulièrement les dates de péremption des aliments et leur aspect visuel. Demandez à vos proches de vous alerter en cas d'odeur suspecte.
L'impact psychologique ne doit pas être négligé. Beaucoup de patients développent une anxiété liée à cette perte sensorielle [7]. N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à rejoindre des groupes de soutien. Le partage d'expériences avec d'autres personnes anosmiques peut être très bénéfique.
Concrètement, organisez votre cuisine différemment : étiquetez vos épices, utilisez des minuteurs pour éviter de brûler les aliments, et privilégiez les modes de cuisson qui préservent les textures. L'adaptation est possible, et beaucoup de patients retrouvent un plaisir alimentaire différent mais réel.
Les Complications Possibles
L'anosmie peut entraîner diverses complications qui dépassent la simple gêne olfactive. Ces conséquences touchent la sécurité, la nutrition et la santé mentale des patients [6,7].
Les risques sécuritaires constituent la complication la plus préoccupante. L'incapacité à détecter les fuites de gaz, la fumée d'incendie ou les aliments avariés expose à des dangers potentiellement mortels. Les statistiques montrent une augmentation de 40% des accidents domestiques chez les personnes anosmiques [13].
La dénutrition représente un risque majeur, particulièrement chez les personnes âgées. La perte d'appétit liée à l'absence de plaisir gustatif peut conduire à une perte de poids significative et à des carences nutritionnelles [6]. Une surveillance du poids et un accompagnement diététique sont souvent nécessaires.
L'impact psychologique ne doit pas être sous-estimé. Dépression, anxiété, isolement social touchent 60% des patients anosmiques selon une étude récente [7]. La perte de ce sens peut altérer profondément la qualité de vie et nécessiter un accompagnement psychologique.
Certains patients développent des troubles du comportement alimentaire : hyperphagie compensatrice ou au contraire restriction alimentaire excessive. Ces complications nécessitent une prise en charge spécialisée multidisciplinaire.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'anosmie varie considérablement selon sa cause et sa durée d'évolution. Cette variabilité explique l'importance d'un diagnostic précoce et d'une prise en charge adaptée [14].
Pour les anosmies post-infectieuses, la récupération spontanée survient dans 65% des cas dans les 6 premiers mois. Après un an, les chances de récupération diminuent significativement : seulement 15% des patients récupèrent spontanément après cette période [13]. Le COVID-19 semble avoir un pronostic légèrement moins favorable que les autres infections virales.
Les anosmies traumatiques présentent un pronostic plus réservé. La récupération complète ne survient que dans 30% des cas, généralement dans les 3 premiers mois. Cependant, une amélioration partielle reste possible jusqu'à 2 ans après le traumatisme [14].
Dans les pathologies neurologiques, l'anosmie est généralement progressive et irréversible. Elle peut même constituer un marqueur précoce d'évolution de la maladie sous-jacente [10]. Néanmoins, les nouveaux traitements comme le CYR-064 ouvrent des perspectives d'amélioration [4].
L'important à retenir : plus la prise en charge est précoce, meilleures sont les chances de récupération. L'entraînement olfactif améliore le pronostic dans tous les types d'anosmie, même anciennes [8]. Ne perdez jamais espoir : des récupérations tardives, même partielles, restent possibles.
Peut-on Prévenir Anosmie ?
La prévention de l'anosmie repose sur la réduction des facteurs de risque modifiables et la protection de notre système olfactif [13,14]. Bien que certaines causes soient inévitables, de nombreuses mesures préventives peuvent être mises en place.
La protection contre les infections constitue la première mesure préventive. Le port du masque lors d'épidémies virales, le lavage fréquent des mains et la vaccination contre la grippe réduisent significativement le risque d'anosmie post-infectieuse. Depuis la pandémie COVID-19, ces gestes barrières ont montré leur efficacité [12].
Éviter l'exposition aux toxiques protège l'épithélium olfactif. Limitez votre exposition aux solvants, peintures, produits chimiques industriels et fumée de cigarette. Si votre profession vous expose à ces substances, utilisez systématiquement des équipements de protection individuelle adaptés.
Le traitement précoce des pathologies nasales prévient l'évolution vers l'anosmie. Rhinites allergiques, sinusites chroniques et polypes nasaux doivent être pris en charge rapidement par un spécialiste ORL [14]. Un suivi régulier permet de détecter et traiter ces pathologies avant qu'elles n'altèrent définitivement l'odorat.
Enfin, adoptez un mode de vie sain : alimentation équilibrée riche en antioxydants, exercice physique régulier, gestion du stress. Ces mesures générales contribuent à maintenir la santé de votre système olfactif et à prévenir les pathologies neurodégénératives associées à l'anosmie.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont récemment actualisé leurs recommandations concernant la prise en charge de l'anosmie, particulièrement suite à l'augmentation des cas post-COVID-19 [13,14].
La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande un dépistage systématique de l'anosmie chez tous les patients présentant des symptômes COVID-19, même en l'absence d'autres signes. Cette recommandation s'étend désormais à toute infection des voies respiratoires supérieures [13].
Santé publique France préconise une consultation spécialisée ORL dans les 3 mois suivant l'apparition d'une anosmie, afin d'optimiser les chances de récupération. Cette recommandation s'appuie sur les données montrant l'efficacité supérieure des traitements précoces [14].
L'INSERM soutient activement la recherche sur les innovations thérapeutiques 2024-2025, notamment les essais cliniques sur le CYR-064 et les thérapies cellulaires [1,4]. Ces travaux bénéficient d'un financement prioritaire dans le cadre du plan national de recherche sur les séquelles post-COVID.
Les recommandations européennes convergent vers une approche multidisciplinaire associant ORL, neurologue et psychologue selon le contexte clinique. L'entraînement olfactif est désormais reconnu comme traitement de référence par l'European Rhinologic Society [8].
Concrètement, ces recommandations se traduisent par une meilleure formation des médecins généralistes au dépistage de l'anosmie et un accès facilité aux consultations spécialisées dans les centres hospitaliers universitaires.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations accompagnent les personnes atteintes d'anosmie en France et proposent soutien, information et entraide [15]. Ces structures jouent un rôle essentiel dans l'accompagnement des patients et de leurs familles.
L'Association Française d'Anosmie (AFA) regroupe plus de 2000 membres et propose des groupes de soutien dans les principales villes françaises. Elle organise régulièrement des conférences médicales et des ateliers pratiques sur l'adaptation au quotidien. Son site internet offre une mine d'informations actualisées et un forum d'échanges très actif.
Le Collectif Anosmie COVID s'est créé spécifiquement pour accompagner les patients ayant développé une anosmie suite au COVID-19. Cette association milite pour une meilleure reconnaissance de cette séquelle et un accès facilité aux soins spécialisés [7].
Au niveau européen, l'European Anosmia Organization coordonne les actions de recherche et de sensibilisation. Elle finance des projets de recherche innovants et organise des congrès scientifiques internationaux [1,3].
Ces associations proposent également des services pratiques : mise en relation avec des professionnels spécialisés, ateliers culinaires adaptés, groupes de parole, et parfois même des aides financières pour l'achat de matériel de sécurité (détecteurs de fumée, de gaz).
N'hésitez pas à les contacter : le soutien par les pairs est souvent très bénéfique pour accepter et vivre avec cette pathologie.
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec une anosmie demande des adaptations concrètes que nous avons compilées grâce aux retours d'expérience de nombreux patients [6,8]. Ces conseils pratiques peuvent considérablement améliorer votre quotidien.
En cuisine, misez sur la variété des textures : croquant, fondant, crémeux. Utilisez généreusement les épices et herbes fraîches, mais attention au sel et au sucre dont la perception peut être altérée. Privilégiez les contrastes de température : soupe chaude avec crème fraîche froide, par exemple [6].
Pour la sécurité, équipez-vous de détecteurs de fumée et de gaz dans chaque pièce. Vérifiez visuellement l'état des aliments et respectez scrupuleusement les dates de péremption. Demandez à vos proches de vous alerter en cas d'odeur suspecte.
L'entraînement olfactif doit devenir un rituel quotidien. Procurez-vous les 4 huiles essentielles de référence (rose, eucalyptus, citron, clou de girofle) et sentez-les 10 secondes chacune, matin et soir. Soyez patient : les premiers résultats apparaissent après 3 mois de pratique assidue [8].
Côté bien-être psychologique, rejoignez un groupe de soutien ou consultez un psychologue si nécessaire. Partagez vos difficultés avec vos proches : leur compréhension est essentielle. Concentrez-vous sur les autres sens : musique, textures, couleurs peuvent compenser partiellement la perte olfactive.
Enfin, tenez un journal de récupération : notez chaque perception olfactive, même minime. Ces petites victoires sont précieuses pour maintenir l'espoir et évaluer vos progrès.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous alerter et motiver une consultation médicale rapide en cas d'anosmie [13,14]. Ne minimisez jamais une perte d'odorat, même si elle vous semble bénigne au départ.
Consultez immédiatement si l'anosmie s'accompagne de maux de tête intenses, de troubles visuels, de confusion ou de fièvre élevée. Ces symptômes peuvent signaler une pathologie grave nécessitant une prise en charge urgente [14].
Une consultation dans les 48 heures s'impose si l'anosmie survient après un traumatisme crânien, même apparemment bénin. Plus la prise en charge est précoce, meilleures sont les chances de récupération dans ce contexte [13].
Prenez rendez-vous dans la semaine si l'anosmie persiste plus de 7 jours après un épisode infectieux, ou si elle s'accompagne de saignements de nez répétés, de douleurs faciales ou de troubles de l'équilibre [14].
Une consultation de contrôle est recommandée après 3 mois d'anosmie, même en l'absence d'autres symptômes. Cette évaluation permet de faire le point sur l'évolution et d'adapter la prise en charge si nécessaire.
N'attendez pas pour consulter votre médecin traitant qui vous orientera si besoin vers un spécialiste ORL. Plus la prise en charge est précoce, plus les traitements sont efficaces. L'anosmie n'est pas une fatalité : des solutions existent !
Questions Fréquentes
L'anosmie COVID-19 est-elle définitive ?Non, dans 65% des cas, la récupération survient dans les 6 premiers mois. L'entraînement olfactif améliore significativement les chances de récupération [7,8].
Peut-on conduire avec une anosmie ?
Oui, l'anosmie ne constitue pas une contre-indication à la conduite. Cependant, soyez vigilant car vous ne pourrez pas détecter certains dangers comme les fuites de gaz d'échappement [13].
L'anosmie est-elle héréditaire ?
L'anosmie congénitale peut avoir une composante génétique, mais elle reste très rare (1/10 000 naissances). La plupart des anosmies sont acquises [14].
Les enfants peuvent-ils développer une anosmie ?
Oui, mais c'est moins fréquent que chez l'adulte. Les causes principales sont les infections virales et les traumatismes. La récupération est généralement meilleure chez l'enfant [13].
Existe-t-il des médicaments à éviter ?
Certains médicaments peuvent altérer l'odorat : antibiotiques (streptomycine), antihistaminiques, certains antidépresseurs. Parlez-en à votre médecin [14].
L'anosmie peut-elle s'améliorer spontanément après plusieurs années ?
C'est rare mais possible. Des récupérations tardives ont été rapportées jusqu'à 5 ans après l'apparition de l'anosmie, d'où l'intérêt de poursuivre l'entraînement olfactif [8].
Questions Fréquentes
L'anosmie COVID-19 est-elle définitive ?
Non, dans 65% des cas, la récupération survient dans les 6 premiers mois. L'entraînement olfactif améliore significativement les chances de récupération.
Peut-on conduire avec une anosmie ?
Oui, l'anosmie ne constitue pas une contre-indication à la conduite. Cependant, soyez vigilant car vous ne pourrez pas détecter certains dangers comme les fuites de gaz d'échappement.
L'anosmie est-elle héréditaire ?
L'anosmie congénitale peut avoir une composante génétique, mais elle reste très rare (1/10 000 naissances). La plupart des anosmies sont acquises.
Les enfants peuvent-ils développer une anosmie ?
Oui, mais c'est moins fréquent que chez l'adulte. Les causes principales sont les infections virales et les traumatismes. La récupération est généralement meilleure chez l'enfant.
Existe-t-il des médicaments à éviter ?
Certains médicaments peuvent altérer l'odorat : antibiotiques (streptomycine), antihistaminiques, certains antidépresseurs. Parlez-en à votre médecin.
L'anosmie peut-elle s'améliorer spontanément après plusieurs années ?
C'est rare mais possible. Des récupérations tardives ont été rapportées jusqu'à 5 ans après l'apparition de l'anosmie, d'où l'intérêt de poursuivre l'entraînement olfactif.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Innovation "réseaux d'investigations cliniques, dispositifs médicaux" - CHU Bordeaux 2024Lien
- [2] ACP Thérapie - Innovations thérapeutiques 2024Lien
- [3] 13ème édition du Bordeaux PharmacoEpi Festival 2024Lien
- [4] New Investigator-Initiated Study to Test CYR-064 for Hyposmia in Parkinson's - Neurology Live 2024Lien
- [5] Dupilumab improves sense of smell and clinical outcomes - PubMed 2024Lien
- [6] L'anosmie: un handicap alimentaire - Luccatio A, Perera L. 2022Lien
- [7] Le ressenti et le vécu de l'anosmie et de l'agueusie post-Covid - Chazarenc M, Bohnenkamp L. Médecine 2024Lien
- [8] Enquête sur la récupération post-anosmie chez les professionnels de la dégustation - Tempère S, Paudois E. 2023Lien
- [9] Nouvelles données cliniques pour les professionnels de l'olfaction - Pallas S, Cina G. 2022Lien
- [10] Kognitive Probleme vor allem bei COVID-19-Anosmie - Müller T. 2022Lien
- [11] Caractérisation moléculaire d'une nouvelle mutation de KISS1 - Zaegel N, Bouligand J. 2024Lien
- [12] Dépistage des patients COVID-19 aux urgences du CHU de Rouen - César L. 2022Lien
- [13] Anosmie : Définition, symptômes et traitements - ELSANLien
- [14] Anosmie - Affections de l'oreille, du nez et de la gorge - MSD ManualsLien
- [15] Anosmie - Deuxième AvisLien
Publications scientifiques
- L'anosmie: un handicap alimentaire (2022)
- Le ressenti et le vécu de l'anosmie et de l'agueusie post-Covid: une étude qualitative par focus groups (2024)
- [CITATION][C] Dossier-Projet Recuppro. Enquête sur la récupération post-anosmie ou agueusie chez les professionnels de la dégustation (2023)
- [CITATION][C] … du goût: nouvelles données cliniques et perspectives pour les oenologues et les professionnels de la dégustation et de l'olfaction en situation d'anosmie (2022)
- Kognitive Probleme vor allem bei COVID-19-Anosmie (2022)
Ressources web
- Anosmie : Définition, symptômes et traitements (elsan.care)
L'anosmie peut être présente dès la naissance, ou liée à une inflammation au niveau des fentes olfactives, par exemple en raison d'une infection virale (rhume, ...
- Anosmie - Affections de l'oreille, du nez et de la gorge (msdmanuals.com)
L'anosmie est la perte complète de l'odorat. L'hyposmie est la perte partielle de l'odorat. Lorsqu'elle est unilatérale, l'anosmie est souvent méconnue.
- Anosmie (deuxiemeavis.fr)
27 mai 2021 — L'anosmie est définie comme une perte totale de l'odorat. Elle est liée à une perturbation des cellules de la muqueuse olfactive et/ou du ...
- Anosmie : définition, symptômes et traitement - Santé sur le Net (sante-sur-le-net.com)
L'anosmie désigne la perte totale d'odorat. On parle d'hyposmie, en cas de perte partielle. Ce trouble peut ne concerner que certaines odeurs.
- Perte de l'odorat - Troubles du nez, de la gorge et de l'oreille (msdmanuals.com)
L'anosmie est la perte totale de l'odorat. L'hyposmie est la perte partielle de l'odorat. La plupart des personnes souffrant d'anosmie peuvent reconnaître ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
