Anémie Réfractaire avec Excès de Blastes : Guide Complet 2025 | Symptômes, Traitements
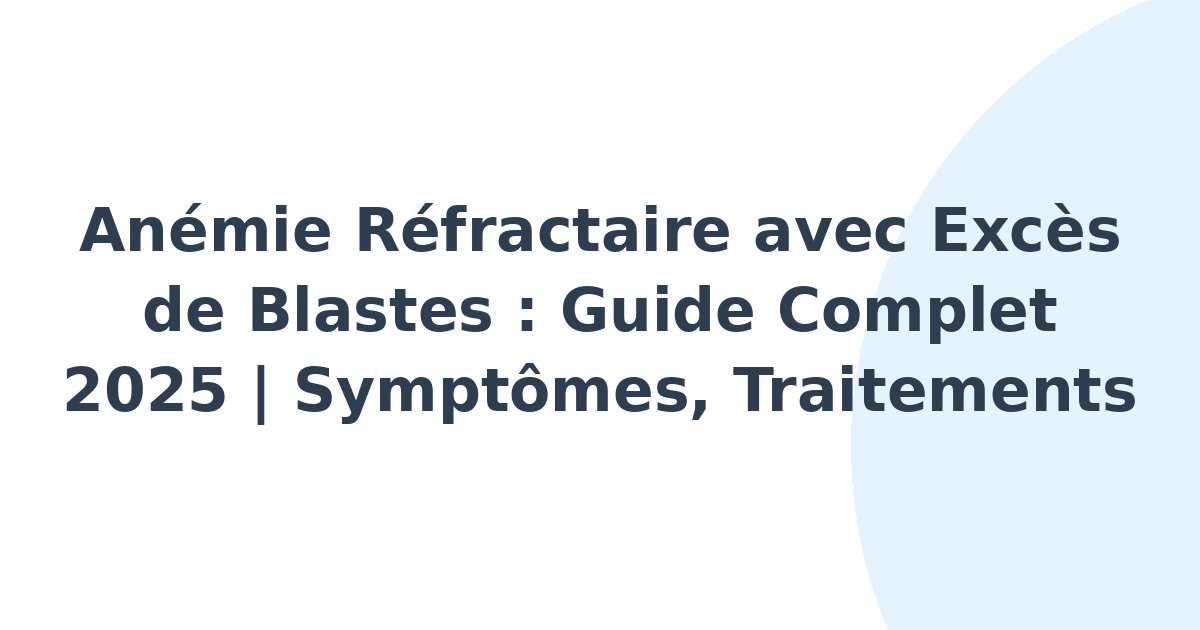
L'anémie réfractaire avec excès de blastes représente une forme particulière de syndrome myélodysplasique qui touche environ 2 000 nouveaux patients chaque année en France [6,7]. Cette pathologie hématologique complexe se caractérise par une production défaillante de cellules sanguines dans la moelle osseuse. Bien que le diagnostic puisse sembler inquiétant, les avancées thérapeutiques récentes offrent de nouveaux espoirs aux patients.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Anémie réfractaire avec excès de blastes : Définition et Vue d'Ensemble
L'anémie réfractaire avec excès de blastes (AREB) appartient à la famille des syndromes myélodysplasiques, des maladies de la moelle osseuse qui perturbent la production normale des cellules sanguines [6,14]. Concrètement, votre moelle osseuse fabrique des cellules immatures appelées blastes en trop grande quantité, au détriment des cellules sanguines fonctionnelles.
Cette pathologie se distingue par la présence de 5 à 19% de blastes dans la moelle osseuse, un pourcentage qui définit précisément cette forme de syndrome myélodysplasique [7,11]. Mais attention, ces chiffres peuvent paraître abstraits : l'important à retenir, c'est que votre organisme peine à produire suffisamment de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes en bon état de fonctionnement.
D'ailleurs, le terme "réfractaire" ne signifie pas que la maladie résiste à tous les traitements. Il indique plutôt que l'anémie ne répond pas aux traitements classiques comme les suppléments de fer ou les vitamines [9]. En fait, cette pathologie nécessite une approche thérapeutique spécialisée que nous détaillerons plus loin.
Les spécialistes classent cette maladie en deux sous-types selon le pourcentage de blastes : l'AREB-1 (5-9% de blastes) et l'AREB-2 (10-19% de blastes) [6,7]. Cette distinction influence directement le pronostic et les options de traitement disponibles.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, les syndromes myélodysplasiques touchent environ 4 000 à 5 000 nouvelles personnes chaque année, dont 40% présentent une anémie réfractaire avec excès de blastes [13,6]. Cette incidence place notre pays dans la moyenne européenne, avec des variations régionales notables selon les données de Santé publique France.
L'âge médian au diagnostic se situe autour de 70 ans, mais la pathologie peut survenir dès 50 ans [7,13]. Fait intéressant : les hommes sont légèrement plus touchés que les femmes, avec un ratio de 1,3 pour 1. Cette différence s'explique en partie par l'exposition professionnelle à certains toxiques, plus fréquente chez les hommes.
Comparativement aux autres pays européens, la France présente une incidence similaire à l'Allemagne et au Royaume-Uni [13]. Cependant, les États-Unis rapportent des chiffres légèrement supérieurs, probablement liés à de meilleures capacités de diagnostic et à des facteurs environnementaux spécifiques.
Les projections épidémiologiques pour 2025-2030 suggèrent une augmentation de 15% des cas, principalement due au vieillissement de la population [7,13]. Cette évolution souligne l'importance cruciale du développement de nouvelles approches thérapeutiques comme celles étudiées dans les programmes Breizh CoCoA 2024 [1].
Les Causes et Facteurs de Risque
Dans la majorité des cas, l'anémie réfractaire avec excès de blastes survient sans cause identifiable : on parle alors de forme primaire ou idiopathique [6,7]. Mais rassurez-vous, cela ne signifie pas que vous avez fait quelque chose de mal. Cette pathologie résulte d'anomalies génétiques acquises au cours de la vie, non héréditaires.
Certains facteurs augmentent néanmoins le risque de développer cette maladie. L'exposition à des agents chimiothérapeutiques comme les alkylants ou les inhibiteurs de topoisomérase II peut favoriser l'apparition de syndromes myélodysplasiques secondaires [7,12]. Ces formes représentent environ 10 à 15% des cas et surviennent généralement 5 à 10 ans après le traitement initial.
L'exposition professionnelle ou environnementale à certaines substances toxiques constitue également un facteur de risque reconnu [13]. Le benzène, les pesticides organochlorés et les radiations ionisantes figurent parmi les principaux coupables identifiés. D'ailleurs, les études épidémiologiques montrent une incidence plus élevée chez les travailleurs de l'industrie chimique et pétrolière.
Enfin, certaines pathologies hématologiques préexistantes comme l'anémie aplasique ou la myélofibrose peuvent évoluer vers un syndrome myélodysplasique [8,12]. Le tabagisme chronique et l'âge avancé restent les facteurs de risque les plus fréquemment retrouvés dans les études de cohorte récentes.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les premiers signes de l'anémie réfractaire avec excès de blastes apparaissent souvent de manière insidieuse. Vous pourriez d'abord remarquer une fatigue inhabituelle qui ne s'améliore pas avec le repos [14,15]. Cette asthénie, comme l'appellent les médecins, résulte de la diminution du nombre de globules rouges fonctionnels dans votre sang.
La pâleur constitue un autre signe précoce, particulièrement visible au niveau des conjonctives, des ongles et de la paume des mains [14]. Certains patients rapportent également des essoufflements lors d'efforts qui ne les gênaient pas auparavant. Ces symptômes traduisent la difficulté de votre organisme à transporter suffisamment d'oxygène vers les tissus.
Mais attention, d'autres manifestations peuvent survenir selon les lignées cellulaires affectées. Une diminution des plaquettes peut provoquer des saignements spontanés : saignements de nez fréquents, ecchymoses apparaissant sans traumatisme, ou règles plus abondantes chez les femmes [15,16]. Ces signes hémorragiques nécessitent une consultation rapide.
La baisse des globules blancs expose quant à elle à un risque infectieux accru [14,15]. Vous pourriez ainsi présenter des infections récidivantes, des fièvres inexpliquées ou une cicatrisation plus lente. L'important à retenir : ces symptômes évoluent généralement de façon progressive sur plusieurs semaines ou mois.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de l'anémie réfractaire avec excès de blastes repose sur une démarche méthodique qui commence par un simple bilan sanguin [6,11]. Votre médecin prescrira d'abord une numération formule sanguine (NFS) qui révélera typiquement une anémie, souvent associée à une diminution des autres lignées cellulaires.
L'étape cruciale consiste en la réalisation d'un myélogramme, un examen de la moelle osseuse obtenu par ponction sternale ou iliaque [11,16]. Bien que cette procédure puisse sembler impressionnante, elle se déroule sous anesthésie locale et ne dure que quelques minutes. L'analyse microscopique permettra de compter précisément le pourcentage de blastes et d'identifier les anomalies morphologiques caractéristiques.
La cytométrie en flux complète aujourd'hui systématiquement le diagnostic, permettant une caractérisation fine des cellules anormales [11]. Cette technique moderne améliore considérablement la précision diagnostique et aide à distinguer les différents sous-types de syndromes myélodysplasiques. D'ailleurs, les recommandations 2024 insistent sur l'importance de cet examen [6].
Enfin, l'analyse cytogénétique recherche les anomalies chromosomiques qui influencent directement le pronostic [7,11]. Certaines anomalies comme la délétion 5q ou la monosomie 7 orientent vers des stratégies thérapeutiques spécifiques. Ces examens génétiques prennent généralement 2 à 3 semaines, mais ils sont essentiels pour adapter votre prise en charge.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de l'anémie réfractaire avec excès de blastes dépend étroitement de votre âge, de votre état général et du sous-type de la maladie [9,7]. Pour les patients de moins de 65 ans en bon état général, l'allogreffe de moelle osseuse reste le seul traitement potentiellement curatif. Cette procédure complexe nécessite un donneur compatible et s'accompagne de risques significatifs qu'il faut bien peser.
Les agents hypométhylants comme l'azacitidine représentent le traitement de référence pour les patients non éligibles à la greffe [9]. Ces médicaments agissent en réactivant des gènes suppresseurs de tumeur silencés par des mécanismes épigénétiques. Concrètement, vous recevrez des injections sous-cutanées pendant 7 jours consécutifs, avec des cycles répétés toutes les 4 semaines.
La chimiothérapie intensive peut être proposée aux patients jeunes avec un AREB-2, particulièrement en cas d'évolution vers une leucémie aiguë [7,9]. Les protocoles utilisent généralement une association de cytarabine et d'anthracyclines, similaire aux traitements des leucémies aiguës myéloïdes. Cependant, les taux de rémission restent inférieurs à ceux observés dans les leucémies de novo.
Les soins de support occupent une place centrale dans la prise en charge [9]. Les transfusions de globules rouges permettent de corriger l'anémie symptomatique, tandis que les transfusions plaquettaires préviennent les complications hémorragiques. L'utilisation de chélateurs du fer devient nécessaire après 15 à 20 transfusions pour éviter la surcharge martiale.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans le traitement des syndromes myélodysplasiques avec l'arrivée de nouvelles molécules prometteuses. Le programme Breizh CoCoA 2024 évalue actuellement plusieurs approches innovantes, notamment les inhibiteurs de splicing et les thérapies cellulaires [1]. Ces recherches ouvrent des perspectives inédites pour les patients en échec des traitements conventionnels.
Le RZALEX® représente l'une des innovations les plus attendues de 2024-2025 [2]. Cette nouvelle molécule cible spécifiquement les mécanismes de résistance aux agents hypométhylants, offrant une option thérapeutique aux patients réfractaires à l'azacitidine. Les premiers résultats des essais cliniques montrent des taux de réponse encourageants, particulièrement chez les patients avec certaines anomalies cytogénétiques.
Les thérapies CAR-T adaptées aux syndromes myélodysplasiques font également l'objet d'investigations poussées [1,5]. Contrairement aux CAR-T utilisées dans les lymphomes, ces nouvelles approches ciblent des antigènes spécifiques des cellules myélodysplasiques. L'APL-4098, actuellement en phase II, montre des résultats préliminaires prometteurs avec un profil de toxicité acceptable [5].
D'ailleurs, les combinaisons thérapeutiques représentent une voie d'avenir particulièrement intéressante [1,2]. L'association d'agents hypométhylants avec des inhibiteurs de checkpoints immunitaires ou des modulateurs du microenvironnement médullaire pourrait améliorer significativement les taux de réponse. Ces approches multimodales font l'objet d'essais cliniques multicentriques dont les résultats sont attendus fin 2025.
Vivre au Quotidien avec Anémie réfractaire avec excès de blastes
Adapter votre mode de vie à l'anémie réfractaire avec excès de blastes nécessite quelques ajustements, mais ne signifie pas renoncer à vos activités [15]. L'important consiste à écouter votre corps et à respecter vos limites énergétiques. Planifiez vos activités aux moments où vous vous sentez le plus en forme, généralement le matin après une bonne nuit de sommeil.
La gestion de la fatigue représente souvent le défi principal au quotidien [14,15]. Fractionnez vos tâches en petites étapes et n'hésitez pas à faire des pauses régulières. Certains patients trouvent bénéfique de pratiquer une activité physique adaptée comme la marche ou le yoga doux, toujours en accord avec leur équipe médicale.
Côté alimentation, privilégiez une alimentation équilibrée riche en fer, en vitamines B9 et B12 [15]. Cependant, évitez les suppléments de fer sans avis médical, car ils peuvent être contre-productifs en cas de surcharge transfusionnelle. Votre diététicien pourra vous conseiller des menus adaptés à votre situation spécifique.
La prévention des infections mérite une attention particulière, surtout si votre taux de globules blancs est bas [14]. Lavez-vous fréquemment les mains, évitez les foules pendant les épidémies et signalez rapidement tout signe infectieux à votre médecin. Ces précautions simples peuvent considérablement réduire le risque de complications.
Les Complications Possibles
L'évolution de l'anémie réfractaire avec excès de blastes peut s'accompagner de plusieurs complications qu'il est important de connaître [7,8]. La plus redoutée reste la transformation en leucémie aiguë myéloïde, qui survient chez 20 à 30% des patients dans les 2 ans suivant le diagnostic. Cette évolution nécessite une prise en charge urgente et modifie radicalement le pronostic.
Les complications liées aux transfusions répétées représentent un enjeu majeur à long terme [9]. La surcharge en fer peut affecter le cœur, le foie et les glandes endocrines si elle n'est pas prévenue par un traitement chélateur approprié. D'ailleurs, un suivi cardiologique régulier devient nécessaire après 50 transfusions de globules rouges.
Les infections sévères constituent une complication fréquente, particulièrement chez les patients présentant une neutropénie profonde [14,15]. Les infections fongiques invasives et les septicémies bactériennes peuvent mettre en jeu le pronostic vital. C'est pourquoi votre équipe médicale vous prescrira parfois des antibiotiques ou antifongiques préventifs.
Enfin, les complications hémorragiques liées à la thrombopénie peuvent survenir de façon imprévisible [8,15]. Les hémorragies digestives, cérébrales ou pulmonaires nécessitent une prise en charge en urgence. Heureusement, un suivi régulier de votre numération plaquettaire permet d'anticiper ces risques et d'adapter les transfusions préventives.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'anémie réfractaire avec excès de blastes varie considérablement selon plusieurs facteurs pronostiques bien identifiés [7]. L'âge au diagnostic constitue l'élément le plus déterminant : les patients de moins de 60 ans présentent généralement une survie médiane supérieure à 5 ans, contre 2 à 3 ans pour les patients plus âgés.
Le score IPSS-R (International Prognostic Scoring System-Revised) permet d'évaluer précisément le pronostic individuel [7]. Ce système intègre le pourcentage de blastes, les anomalies cytogénétiques, le nombre de lignées touchées et l'importance des cytopénies. Concrètement, votre hématologue utilisera ce score pour adapter votre stratégie thérapeutique.
Les anomalies cytogénétiques influencent fortement l'évolution de la maladie [7,11]. Certaines anomalies comme la délétion 5q isolée confèrent un pronostic favorable, tandis que les anomalies complexes ou la monosomie 7 sont associées à un pronostic plus réservé. Ces données génétiques orientent directement les choix thérapeutiques.
Mais rassurez-vous, les progrès thérapeutiques récents améliorent progressivement ces statistiques [1,2]. Les nouveaux traitements comme le RZALEX® ou les thérapies combinées permettent d'espérer une amélioration significative de la survie dans les années à venir. L'important reste de maintenir un suivi régulier et de bénéficier des innovations thérapeutiques dès qu'elles deviennent disponibles.
Peut-on Prévenir Anémie réfractaire avec excès de blastes ?
La prévention primaire de l'anémie réfractaire avec excès de blastes reste limitée car la majorité des cas surviennent de façon spontanée [6,13]. Cependant, certaines mesures peuvent réduire le risque de développer cette pathologie, particulièrement chez les personnes exposées à des facteurs de risque identifiés.
L'évitement des expositions professionnelles aux substances cancérogènes constitue la mesure préventive la plus efficace [13]. Si votre travail vous expose au benzène, aux solvants organiques ou aux pesticides, respectez scrupuleusement les équipements de protection individuelle. Les entreprises doivent également mettre en place des mesures de surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés.
Pour les patients ayant reçu une chimiothérapie antérieure, un suivi hématologique régulier permet de détecter précocement l'apparition d'un syndrome myélodysplasique secondaire [7,12]. Cette surveillance s'avère particulièrement importante chez les patients traités par alkylants ou inhibiteurs de topoisomérase II, avec des bilans sanguins annuels pendant au moins 10 ans.
Le sevrage tabagique représente une mesure préventive accessible à tous [13]. Bien que le lien ne soit pas aussi direct que pour les cancers pulmonaires, plusieurs études épidémiologiques montrent une association entre tabagisme chronique et risque de syndromes myélodysplasiques. D'ailleurs, l'arrêt du tabac améliore également la tolérance aux traitements en cas de maladie déclarée.
Recommandations des Autorités de Santé
Les recommandations françaises pour la prise en charge de l'anémie réfractaire avec excès de blastes s'appuient sur les guidelines européennes actualisées en 2024 [6,3]. La Haute Autorité de Santé (HAS) insiste sur l'importance d'un diagnostic précoce et d'une prise en charge dans des centres spécialisés en hématologie disposant de plateaux techniques complets.
L'arrêté du 19 février 2015 définit les forfaits alloués aux établissements pour la prise en charge des syndromes myélodysplasiques [3]. Ces dispositions garantissent un accès équitable aux soins sur l'ensemble du territoire français, avec une prise en charge à 100% au titre de l'ALD 30 (Affection de Longue Durée).
Les autorités sanitaires recommandent une approche multidisciplinaire associant hématologues, oncologues, spécialistes de la transfusion et psycho-oncologues [6]. Cette coordination permet d'optimiser la prise en charge globale du patient, depuis le diagnostic jusqu'au suivi à long terme. D'ailleurs, l'accès aux essais cliniques doit être systématiquement évalué pour chaque patient.
La surveillance post-thérapeutique fait l'objet de recommandations précises, avec des bilans biologiques mensuels pendant les 6 premiers mois de traitement [6,9]. Les centres de référence doivent également assurer une permanence téléphonique 24h/24 pour la gestion des urgences hématologiques. Ces mesures visent à améliorer la sécurité et l'efficacité des prises en charge.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations françaises accompagnent les patients atteints d'anémie réfractaire avec excès de blastes et leurs familles. L'Association France Lymphome Espoir propose des groupes de parole spécialisés dans les hémopathies malignes, avec des rencontres régionales organisées dans toute la France.
La Société Française d'Hématologie met à disposition des patients des fiches d'information actualisées et des webinaires éducatifs [6]. Ces ressources permettent de mieux comprendre votre pathologie et les évolutions thérapeutiques récentes. Le site internet propose également un annuaire des centres spécialisés par région.
L'Institut National du Cancer (INCa) développe des programmes d'éducation thérapeutique spécifiquement adaptés aux syndromes myélodysplasiques. Ces programmes, dispensés dans les centres de référence, vous aident à mieux gérer votre maladie au quotidien et à identifier les signes d'alerte nécessitant une consultation urgente.
Les réseaux sociaux offrent également des espaces d'échange entre patients, mais attention à la qualité des informations partagées. Privilégiez les groupes modérés par des professionnels de santé et n'hésitez pas à vérifier toute information avec votre équipe médicale. L'entraide entre patients peut s'avérer précieuse, à maladie de rester vigilant sur les conseils thérapeutiques.
Nos Conseils Pratiques
Gérer une anémie réfractaire avec excès de blastes au quotidien nécessite quelques adaptations pratiques que nous avons compilées grâce à l'expérience de nombreux patients. Tenez un carnet de suivi de vos symptômes, particulièrement utile lors des consultations pour évaluer l'efficacité des traitements.
Organisez votre environnement domestique pour économiser votre énergie : placez les objets fréquemment utilisés à portée de main, installez des barres d'appui dans la salle de bain si nécessaire, et n'hésitez pas à utiliser des aides techniques comme un chariot pour transporter vos courses.
Côté voyages et déplacements, quelques précautions s'imposent. Emportez toujours une ordonnance récente et vos derniers résultats biologiques. Évitez les destinations tropicales pendant les périodes de neutropénie et souscrivez une assurance voyage adaptée à votre pathologie. Informez votre compagnie aérienne si vous transportez des médicaments injectables.
Pour les relations sociales, expliquez simplement votre maladie à vos proches sans entrer dans les détails techniques. Beaucoup de personnes confondent les syndromes myélodysplasiques avec les leucémies aiguës, ce qui peut générer des inquiétudes disproportionnées. Une communication claire évite les malentendus et maintient des relations sereines.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous amener à consulter rapidement votre hématologue ou à vous rendre aux urgences. Une fièvre supérieure à 38°C nécessite une prise en charge immédiate, particulièrement si votre taux de globules blancs est bas [14,15]. N'attendez pas que la fièvre persiste : contactez votre équipe médicale dès les premiers signes.
Les saignements anormaux constituent également des signaux d'alarme : saignements de nez prolongés, vomissements sanglants, selles noires ou présence de sang dans les urines [15]. Ces manifestations peuvent traduire une chute importante du taux de plaquettes nécessitant des transfusions urgentes.
Une aggravation brutale de la fatigue ou l'apparition d'un essoufflement au repos doivent vous alerter [14]. Ces symptômes peuvent signaler une chute rapide du taux d'hémoglobine ou l'évolution vers une leucémie aiguë. Dans ce cas, un bilan sanguin urgent s'impose pour adapter rapidement votre prise en charge.
Enfin, tout changement inhabituel dans votre état général mérite une évaluation médicale : perte de poids inexpliquée, douleurs osseuses persistantes, ou apparition de ganglions palpables [15,16]. Votre équipe médicale préfère toujours être consultée pour rien plutôt que de passer à côté d'une complication. N'hésitez jamais à les contacter en cas de doute.
Questions Fréquentes
L'anémie réfractaire avec excès de blastes est-elle héréditaire ?Non, cette pathologie n'est pas héréditaire dans l'immense majorité des cas [6]. Les anomalies génétiques responsables de la maladie sont acquises au cours de la vie et ne se transmettent pas à la descendance. Seules de très rares formes familiales ont été décrites dans la littérature médicale.
Puis-je continuer à travailler avec cette maladie ?
Cela dépend de votre état général, de votre profession et de la réponse au traitement [15]. Beaucoup de patients continuent leurs activités professionnelles en adaptant leur rythme. Votre médecin du travail pourra évaluer les aménagements nécessaires : télétravail, horaires adaptés, ou changement de poste si nécessaire.
Les transfusions sont-elles dangereuses ?
Les transfusions modernes sont très sûres grâce aux contrôles rigoureux des produits sanguins [9]. Le principal risque à long terme reste la surcharge en fer, prévenue par les traitements chélateurs. Les réactions transfusionnelles immédiates sont rares et généralement bénignes.
Existe-t-il des traitements naturels efficaces ?
Aucun traitement naturel n'a prouvé son efficacité contre les syndromes myélodysplasiques [14]. Méfiez-vous des promesses miraculeuses sur internet. Une alimentation équilibrée et une activité physique adaptée peuvent améliorer votre qualité de vie, mais ne remplacent jamais les traitements médicaux spécialisés.
Questions Fréquentes
L'anémie réfractaire avec excès de blastes est-elle héréditaire ?
Non, cette pathologie n'est pas héréditaire dans l'immense majorité des cas. Les anomalies génétiques responsables sont acquises au cours de la vie.
Puis-je continuer à travailler avec cette maladie ?
Cela dépend de votre état général et de votre profession. Beaucoup de patients continuent leurs activités en adaptant leur rythme de travail.
Les transfusions sont-elles dangereuses ?
Les transfusions modernes sont très sûres. Le principal risque à long terme est la surcharge en fer, prévenue par les traitements chélateurs.
Existe-t-il des traitements naturels efficaces ?
Aucun traitement naturel n'a prouvé son efficacité. Une alimentation équilibrée peut améliorer la qualité de vie mais ne remplace pas les traitements spécialisés.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Programme Breizh CoCoA 2024 : nouvelles approches thérapeutiques dans les syndromes myélodysplasiquesLien
- [2] RZALEX® : innovation thérapeutique 2024-2025 pour les syndromes myélodysplasiques réfractairesLien
- [3] Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santéLien
- [6] Wagner-Ballon O, Kosmider O. SMD & LMMC: diagnostic et classification. Bulletin du Cancer 2023Lien
- [7] Gyan E, Thépot S. Facteurs pronostiques des syndromes myélodysplasiques. Bulletin du Cancer 2023Lien
- [9] Park S. Traitement des syndromes myélodysplasiques de bas risque. Bulletin du Cancer 2023Lien
- [11] Ludovic MF. Apports de la cytométrie en flux dans le diagnostic et le pronostic des syndromes myélodysplasiquesLien
- [14] Syndrome myélodysplasique - Hématologie et oncologie. MSD ManualsLien
Publications scientifiques
- SMD & LMMC: diagnostic et classification (2023)
- Facteurs pronostiques des syndromes myélodysplasiques (2023)
- Une splénomégalie qui dépasse les frontières (2023)
- Traitement des syndromes myélodysplasiques de bas risque (2023)
- [PDF][PDF] Prévalence de l'anémie chez les sujets atteints de MICI Expérience du service d'hépato-gastro-entérologie de l'hôpital Militaire Moulay Ismail de Meknès (à … (2022)[PDF]
Ressources web
- Syndrome myélodysplasique - Hématologie et oncologie (msdmanuals.com)
Les symptômes du syndrome myélodysplasique reflètent la lignée cellulaire la plus atteinte et peuvent comprendre une pâleur, une asthénie et une fatigue (en ...
- Syndromes myélodysplasiques (cancer.ca)
L'anémie réfractaire avec excès de blastes (AREB) est caractérisée par un nombre peu élevé de globules rouges dans le sang et parfois un nombre peu élevé de ...
- Syndrome myélodysplasique : diagnostic - Santé sur le Net (sante-sur-le-net.com)
17 juin 2021 — Le syndrome myélodysplasique est une maladie du sang et de la moelle osseuse qui se traduit par une insuffisance de globules rouges, blancs.
- Anémie réfractaire – symptômes, causes et traitement (medicoverhospitals.in)
L'anémie réfractaire avec excès de blastes (AREB) est un sous-type d'anémie réfractaire dans lequel il y a un nombre accru de cellules sanguines immatures ( ...
- Syndromes myélodysplasiques (SMD) - InfoCancer (arcagy.org)
7 févr. 2025 — Elle se caractérise par l'existence d'une anémie et la présence de plus de 5 % et de moins de 20 % de blastes dans la moelle osseuse. Au bout de ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
