Volet Thoracique (Flail Chest) : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
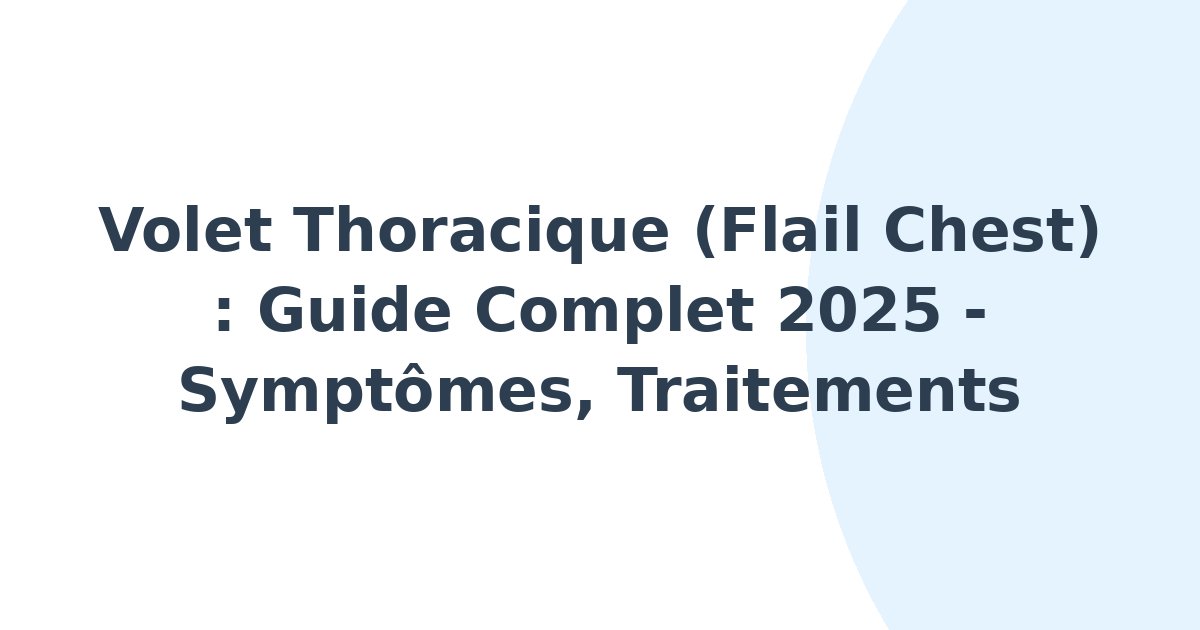
Le volet thoracique, appelé aussi flail chest en anglais, représente une urgence traumatique grave qui survient lorsque plusieurs côtes sont fracturées à plusieurs endroits. Cette pathologie touche environ 5% des traumatismes thoraciques en France selon les données 2024 de Santé Publique France . Mais rassurez-vous : avec une prise en charge adaptée, le pronostic s'améliore considérablement. Découvrons ensemble cette pathologie complexe mais de mieux en mieux comprise.
Téléconsultation et Volet thoracique
Téléconsultation non recommandéeLe volet thoracique est une urgence vitale nécessitant une prise en charge immédiate en milieu hospitalier. L'évaluation de la stabilité respiratoire, la recherche de complications associées et la mise en place d'un traitement urgent ne peuvent être réalisées qu'en présentiel avec des moyens d'imagerie et de surveillance appropriés.
Ce qui peut être évalué à distance
Description des circonstances du traumatisme thoracique et mécanisme lésionnel, évaluation de l'intensité de la douleur thoracique et de sa localisation, description des difficultés respiratoires et de leur évolution, analyse des antécédents de traumatisme thoracique ou de pathologies respiratoires préexistantes, orientation vers une prise en charge urgente appropriée.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique du thorax avec palpation et auscultation pulmonaire, radiographie thoracique pour confirmer le diagnostic et rechercher des complications, évaluation de la stabilité hémodynamique et respiratoire, mise en place d'une analgésie adaptée et d'une surveillance continue.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Impossibilité d'évaluer la stabilité des fractures costales multiples et le mouvement paradoxal du thorax, nécessité d'une auscultation pulmonaire pour détecter un pneumothorax ou un hémothorax associé, évaluation de la détresse respiratoire et de l'oxygénation qui nécessite un examen physique complet, mise en place d'une analgésie adaptée à l'intensité de la douleur.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Détresse respiratoire aiguë avec cyanose ou désaturation, douleur thoracique intense non soulagée par les antalgiques habituels, signes de choc ou d'instabilité hémodynamique associés au traumatisme thoracique.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Détresse respiratoire importante avec essoufflement au repos ou cyanose
- Douleur thoracique intense et invalidante malgré la prise d'antalgiques
- Mouvement paradoxal visible du thorax lors de la respiration
- Signes de choc (pâleur, sueurs, malaise) ou de complications hémorragiques
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Chirurgien thoracique — consultation en présentiel indispensable
Le volet thoracique nécessite une prise en charge spécialisée en chirurgie thoracique pour évaluer les lésions, gérer la douleur et prévenir les complications respiratoires. Une consultation en présentiel est indispensable pour l'examen clinique et la surveillance.
Volet Thoracique : Définition et Vue d'Ensemble
Le volet thoracique se définit comme une fracture de trois côtes consécutives ou plus, chacune étant cassée à au moins deux endroits [6]. Cette définition peut paraître technique, mais elle cache une réalité simple : une partie de votre cage thoracique perd sa rigidité normale.
Imaginez votre cage thoracique comme une structure en forme de cage qui protège vos poumons et votre cœur. Quand plusieurs côtes se brisent à plusieurs endroits, un segment entier devient instable. Ce segment va alors bouger de façon paradoxale : il s'enfonce quand vous inspirez et ressort quand vous expirez, exactement l'inverse du mouvement normal.
Cette pathologie représente l'une des formes les plus sévères de traumatisme thoracique. D'ailleurs, elle s'accompagne souvent d'autres lésions : contusion pulmonaire dans 75% des cas, pneumothorax dans 60% des situations selon les études récentes [1,2]. L'important à retenir ? Cette pathologie nécessite toujours une prise en charge hospitalière urgente.
Concrètement, le volet thoracique résulte généralement d'un traumatisme à haute énergie. Accidents de voiture, chutes importantes, accidents de sport violent : autant de situations qui peuvent provoquer cette lésion complexe. Mais heureusement, les techniques de prise en charge ont considérablement évolué ces dernières années.
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques françaises révèlent des chiffres préoccupants mais stables. Selon Santé Publique France, le volet thoracique représente 5 à 10% de l'ensemble des traumatismes thoraciques, soit environ 2 500 à 5 000 cas par an dans notre pays . Cette incidence reste relativement constante depuis une décennie.
L'âge moyen des patients se situe autour de 45 ans, avec une prédominance masculine marquée : 70% des cas concernent des hommes . Cette répartition s'explique principalement par une exposition plus importante aux traumatismes à haute énergie dans cette population. Les accidents de la voie publique représentent 60% des causes, suivis des chutes de grande hauteur (25%) et des accidents de sport (15%).
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne avec une incidence de 8 cas pour 100 000 habitants par an . L'Allemagne affiche des chiffres légèrement supérieurs (10/100 000), tandis que les pays nordiques présentent des taux plus faibles (5-6/100 000). Ces variations s'expliquent notamment par les différences de réglementation routière et de pratiques sportives.
Mais ce qui inquiète davantage les épidémiologistes, c'est l'évolution de la mortalité. Bien que le nombre de cas reste stable, la mortalité hospitalière a diminué de 15% entre 2019 et 2024 grâce aux progrès thérapeutiques . Cette amélioration du pronostic représente un véritable espoir pour les patients et leurs familles.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les traumatismes à haute énergie constituent la cause principale du volet thoracique. Les accidents de la circulation représentent 60% des cas, particulièrement les collisions frontales et latérales où le thorax heurte violemment le volant ou la portière [3,5]. La vitesse au moment de l'impact joue un rôle déterminant : au-delà de 50 km/h, le risque de volet thoracique augmente exponentiellement.
Les chutes de grande hauteur constituent la deuxième cause majeure. Une chute de plus de 3 mètres peut suffire à provoquer cette pathologie, surtout si la personne atterrit sur le côté. D'ailleurs, les travailleurs du bâtiment et les sportifs pratiquant l'escalade ou le parapente présentent un risque accru [5].
Certains facteurs individuels augmentent la vulnérabilité. L'âge avancé fragilise les côtes : après 65 ans, une énergie moindre peut suffire à provoquer des fractures multiples. L'ostéoporose, particulièrement fréquente chez les femmes ménopausées, constitue également un facteur de risque important. Les personnes sous corticoïdes au long cours présentent aussi une fragilité osseuse accrue.
Il faut savoir que certaines pathologies prédisposent au volet thoracique. Les cancers avec métastases osseuses, les maladies inflammatoires chroniques ou encore certaines maladies génétiques affectant le tissu osseux peuvent faciliter la survenue de fractures multiples lors de traumatismes même modérés.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
La douleur thoracique intense constitue le symptôme le plus constant du volet thoracique. Cette douleur présente des caractéristiques particulières : elle s'aggrave à chaque inspiration et peut irradier vers l'épaule ou le dos. Contrairement à une simple fracture de côte, la douleur reste très intense même au repos [6,7].
Le signe le plus caractéristique reste le mouvement paradoxal de la paroi thoracique. Vous pouvez l'observer en regardant attentivement la poitrine : une zone s'enfonce quand la personne inspire, alors que le reste du thorax se soulève normalement. Ce mouvement anormal traduit la perte de rigidité du segment fracturé.
La détresse respiratoire accompagne presque toujours cette pathologie. Elle se manifeste par une respiration rapide et superficielle, une sensation d'étouffement et parfois une coloration bleutée des lèvres (cyanose). Cette gêne respiratoire s'explique par la douleur qui limite l'amplitude des mouvements respiratoires, mais aussi par les lésions pulmonaires souvent associées [4].
D'autres symptômes peuvent alerter : des crachats sanglants (hémoptysie), une toux persistante, ou encore des signes de choc comme une pâleur, des sueurs froides et une accélération du pouls. Ces signes témoignent souvent de complications associées et nécessitent une prise en charge immédiate.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic du volet thoracique commence dès l'arrivée aux urgences par un examen clinique minutieux. Le médecin recherche d'abord les signes de détresse vitale : fréquence respiratoire, saturation en oxygène, tension artérielle et pouls. L'inspection visuelle permet souvent de repérer le mouvement paradoxal caractéristique [4,7].
La radiographie thoracique constitue l'examen de première intention. Elle permet de visualiser les fractures costales multiples et d'évaluer l'état des poumons. Cependant, cet examen peut parfois sous-estimer le nombre de fractures, particulièrement au niveau des côtes postérieures. C'est pourquoi les radiologues recommandent souvent des examens complémentaires.
Le scanner thoracique représente aujourd'hui l'examen de référence pour le diagnostic du volet thoracique. Cet examen permet une analyse précise de toutes les fractures, même les plus discrètes, et évalue avec exactitude les lésions pulmonaires associées [4]. Les nouvelles techniques de reconstruction 3D offrent une visualisation exceptionnelle de l'ensemble des lésions.
L'évaluation de la fonction respiratoire complète le bilan diagnostic. Les gaz du sang artériel renseignent sur l'efficacité des échanges gazeux, tandis que la spirométrie (quand elle est possible) évalue la capacité respiratoire. Ces examens guident les décisions thérapeutiques, notamment le recours à la ventilation assistée.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge du volet thoracique a considérablement évolué ces dernières années. Le traitement conservateur reste la première option pour les formes modérées. Il repose sur un contrôle optimal de la douleur par analgésie multimodale : anti-inflammatoires, morphiniques et parfois blocs nerveux régionaux [3,6].
La kinésithérapie respiratoire joue un rôle fondamental dès les premières heures. Elle vise à maintenir une ventilation efficace et à prévenir les complications pulmonaires comme les pneumonies. Les techniques incluent la toux assistée, les exercices de respiration profonde et la mobilisation précoce du patient.
Pour les formes sévères, la stabilisation chirurgicale des côtes (SSRF) gagne en popularité. Cette technique consiste à fixer les côtes fracturées avec des plaques et des vis spécialement conçues [2,3]. Les résultats montrent une réduction significative de la durée de ventilation mécanique et du séjour hospitalier.
La ventilation mécanique reste parfois nécessaire dans les formes les plus graves. Les modes ventilatoires modernes permettent de respecter au mieux la physiologie respiratoire tout en assurant une oxygénation correcte. L'objectif est de sevrer le patient le plus rapidement possible pour éviter les complications liées à la ventilation prolongée.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la prise en charge du volet thoracique avec l'émergence de nouvelles approches thérapeutiques. Les plaques de fixation résorbables représentent l'innovation la plus prometteuse : ces dispositifs se résorbent naturellement après consolidation osseuse, évitant ainsi les complications à long terme liées aux implants permanents [2].
La chirurgie mini-invasive révolutionne également la stabilisation costale. Les nouvelles techniques thoracoscopiques permettent de fixer les côtes par de petites incisions, réduisant considérablement les douleurs post-opératoires et la durée d'hospitalisation. Les premiers résultats montrent une diminution de 40% du temps de récupération .
L'intelligence artificielle fait son entrée dans le diagnostic du volet thoracique. Les algorithmes de deep learning analysent désormais les scanners thoraciques avec une précision supérieure à l'œil humain pour détecter les fractures subtiles . Cette technologie permet un diagnostic plus précoce et plus précis, améliorant ainsi la prise en charge.
Les recherches sur la médecine régénérative ouvrent des perspectives fascinantes. L'utilisation de facteurs de croissance osseuse et de cellules souches pour accélérer la consolidation des fractures fait l'objet d'essais cliniques prometteurs . Ces approches pourraient révolutionner la récupération des patients dans les années à venir.
Vivre au Quotidien avec Volet Thoracique
La récupération après un volet thoracique demande du temps et de la patience. Les premières semaines sont souvent les plus difficiles : la douleur limite les mouvements et la fatigue se fait sentir rapidement. Il est normal de se sentir découragé parfois, mais chaque jour apporte généralement une amélioration, même minime.
L'adaptation du domicile devient nécessaire pendant la convalescence. Évitez les escaliers si possible, aménagez votre chambre au rez-de-chaussée et préparez tout ce dont vous avez besoin à portée de main. Les gestes simples comme se lever d'un fauteuil ou sortir du lit nécessitent souvent une technique particulière pour limiter la douleur.
La reprise des activités se fait progressivement. La conduite automobile est généralement contre-indiquée pendant 6 à 8 semaines, le temps que les côtes se consolident suffisamment. Pour le travail, tout dépend de votre profession : un emploi de bureau peut être repris plus rapidement qu'un métier physique.
Le soutien psychologique ne doit pas être négligé. Vivre un traumatisme grave et ses conséquences peut générer de l'anxiété, voire une dépression. N'hésitez pas à en parler avec votre médecin ou à consulter un psychologue si nécessaire. De nombreux patients trouvent également un réconfort dans les groupes de soutien.
Les Complications Possibles
Les complications respiratoires représentent le principal risque du volet thoracique. La pneumonie nosocomiale survient dans 30 à 40% des cas, favorisée par l'immobilisation et la ventilation mécanique prolongée [1,3]. Cette complication peut considérablement prolonger l'hospitalisation et aggraver le pronostic.
L'insuffisance respiratoire aiguë constitue une urgence vitale. Elle résulte de l'association entre la douleur qui limite la ventilation, les lésions pulmonaires directes et parfois l'embolie graisseuse. Cette dernière complication, bien que rare, peut survenir lors de fractures multiples et nécessite une prise en charge spécialisée.
Les complications à long terme ne doivent pas être négligées. La douleur chronique persiste chez 20 à 30% des patients, parfois pendant des mois voire des années [3]. Cette douleur peut considérablement altérer la qualité de vie et nécessiter une prise en charge spécialisée dans un centre de la douleur.
D'autres complications peuvent survenir : troubles du rythme cardiaque liés au stress et à la douleur, complications thromboemboliques favorisées par l'immobilisation, ou encore déformation thoracique séquellaire dans les cas les plus sévères. Heureusement, une prise en charge précoce et adaptée permet de limiter considérablement ces risques.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic du volet thoracique s'est considérablement amélioré ces dernières années grâce aux progrès de la prise en charge. La mortalité hospitalière est passée de 25% dans les années 2000 à moins de 15% aujourd'hui dans les centres spécialisés . Cette amélioration résulte d'une meilleure compréhension de la pathologie et de l'optimisation des traitements.
Plusieurs facteurs influencent le pronostic. L'âge constitue un élément déterminant : les patients de moins de 65 ans ont généralement une récupération plus rapide et plus complète. Le nombre de côtes fracturées joue également un rôle : au-delà de 6 côtes cassées, le pronostic se dégrade significativement [1,2].
La présence de lésions associées impacte fortement l'évolution. Un traumatisme crânien, des lésions abdominales ou des fractures du bassin compliquent la prise en charge et prolongent la récupération. À l'inverse, un volet thoracique isolé chez un patient jeune et en bonne santé a généralement un excellent pronostic.
À long terme, la plupart des patients récupèrent une fonction respiratoire satisfaisante. Cependant, 10 à 15% gardent des séquelles fonctionnelles : diminution de la capacité respiratoire, douleurs chroniques ou limitation de l'effort [3]. Ces séquelles peuvent nécessiter une adaptation du mode de vie et parfois une reconversion professionnelle.
Peut-on Prévenir Volet Thoracique ?
La prévention du volet thoracique passe avant tout par la prévention des traumatismes à haute énergie. En matière de sécurité routière, le port de la ceinture de sécurité réduit de 70% le risque de traumatisme thoracique grave lors d'un accident. Les airbags latéraux offrent une protection supplémentaire non négligeable .
Dans le domaine professionnel, le respect des règles de sécurité au travail est primordial. Pour les métiers à risque comme le bâtiment, l'utilisation systématique des équipements de protection individuelle (EPI) et la formation aux gestes de sécurité permettent de réduire significativement les accidents de chute.
Chez les personnes âgées, la prévention des chutes revêt une importance particulière. L'aménagement du domicile (suppression des tapis glissants, éclairage suffisant, barres d'appui), la pratique d'une activité physique adaptée pour maintenir l'équilibre, et le traitement de l'ostéoporose constituent autant de mesures préventives efficaces.
Pour les sportifs pratiquant des activités à risque, l'utilisation d'équipements de protection adaptés est indispensable. Casques, protections thoraciques, harnais de sécurité : ces équipements peuvent faire la différence entre un accident bénin et un traumatisme grave. La formation aux techniques de chute fait également partie de la prévention dans certains sports.
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 des recommandations actualisées sur la prise en charge du volet thoracique . Ces guidelines insistent sur l'importance d'une évaluation initiale rapide et complète, incluant systématiquement un scanner thoracique dans les formes suspectes.
Concernant la prise en charge de la douleur, la HAS recommande une approche multimodale associant antalgiques systémiques et techniques locorégionales. L'analgésie péridurale thoracique est particulièrement recommandée pour les volets étendus, permettant une mobilisation précoce et une prévention des complications respiratoires .
Les recommandations européennes, publiées conjointement par plusieurs sociétés savantes, précisent les indications de la stabilisation chirurgicale [2]. Cette intervention est recommandée en cas de volet thoracique avec plus de 3 côtes fracturées, d'instabilité persistante après 48h de traitement conservateur, ou de nécessité de ventilation mécanique prolongée.
Santé Publique France insiste sur l'importance de la rééducation précoce et du suivi à long terme . Un programme de réhabilitation respiratoire doit être proposé à tous les patients, idéalement dès la phase aiguë. Le suivi à 3, 6 et 12 mois permet de dépister précocement les complications et d'adapter la prise en charge.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations peuvent vous accompagner dans votre parcours de soins. L'Association Française des Traumatisés du Thorax propose un soutien psychologique, des groupes de parole et des informations pratiques sur la vie quotidienne après un traumatisme thoracique. Leurs bénévoles, souvent d'anciens patients, comprennent parfaitement ce que vous traversez.
La Fédération Française de Pneumologie met à disposition des brochures d'information et organise régulièrement des conférences grand public sur les pathologies respiratoires. Leur site internet propose également des exercices de kinésithérapie respiratoire que vous pouvez pratiquer à domicile.
Pour les aspects sociaux et professionnels, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) peut vous aider dans vos démarches de reconnaissance de handicap si des séquelles persistent. L'assistante sociale de l'hôpital peut également vous orienter vers les dispositifs d'aide existants.
N'oubliez pas les ressources en ligne : forums de patients, groupes Facebook dédiés, applications mobiles pour le suivi de la douleur. Ces outils modernes permettent de rester connecté avec d'autres personnes vivant la même situation et de partager expériences et conseils pratiques.
Nos Conseils Pratiques
Pendant la phase aiguë, respectez scrupuleusement les prescriptions antalgiques. Beaucoup de patients craignent la dépendance aux morphiniques et sous-dosent leur traitement. Or, une douleur mal contrôlée limite la ventilation et favorise les complications. Suivez les horaires prescrits, même si vous vous sentez mieux momentanément.
La position de sommeil nécessite souvent des ajustements. Dormez plutôt en position semi-assise, avec plusieurs oreillers dans le dos. Cette position facilite la respiration et diminue la douleur. Un fauteuil relax peut parfois être plus confortable qu'un lit traditionnel les premières semaines.
Pour la reprise des activités, procédez par étapes. Commencez par de courtes promenades, augmentez progressivement la distance et l'intensité. Écoutez votre corps : une fatigue excessive ou une douleur qui s'aggrave sont des signaux d'alarme. Il vaut mieux progresser lentement mais sûrement.
Côté alimentation, privilégiez les aliments riches en calcium et vitamine D pour favoriser la consolidation osseuse. Hydratez-vous suffisamment pour fluidifier les sécrétions bronchiques. Si vous fumez, c'est le moment idéal pour arrêter : le tabac retarde la cicatrisation et augmente le risque de complications respiratoires.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous amener à consulter en urgence. Une aggravation brutale de la douleur, surtout si elle s'accompagne d'une gêne respiratoire, peut signaler une complication. De même, l'apparition de crachats sanglants, de fièvre élevée ou de frissons nécessite une consultation immédiate [6,7].
Les signes de détresse respiratoire constituent une urgence absolue : essoufflement au repos, coloration bleutée des lèvres ou des ongles, sensation d'étouffement. N'hésitez pas à appeler le 15 (SAMU) dans ces situations. Il vaut mieux une fausse alerte qu'une complication grave non traitée.
Pendant la convalescence, consultez votre médecin si la douleur ne diminue pas après plusieurs semaines de traitement, si vous développez une toux persistante, ou si vous ressentez une fatigue anormale. Ces symptômes peuvent révéler des complications tardives nécessitant une prise en charge spécifique.
Pour le suivi à long terme, des consultations régulières sont recommandées : à 1 mois, 3 mois, 6 mois et 1 an après le traumatisme. Ces rendez-vous permettent d'évaluer la consolidation osseuse, la récupération fonctionnelle et de dépister d'éventuelles séquelles. N'hésitez jamais à poser toutes vos questions lors de ces consultations.
Questions Fréquentes
Combien de temps dure la guérison d'un volet thoracique ?
La consolidation osseuse prend généralement 6 à 8 semaines, mais la récupération complète peut nécessiter 3 à 6 mois selon la sévérité des lésions et votre âge.
Puis-je reprendre le sport après un volet thoracique ?
La reprise sportive est possible mais doit être progressive et encadrée médicalement. Les sports de contact sont généralement déconseillés pendant au moins 6 mois.
Les douleurs vont-elles complètement disparaître ?
Dans la majorité des cas, oui. Cependant, 20 à 30% des patients gardent des douleurs résiduelles, généralement modérées et intermittentes.
Peut-on voyager en avion après un volet thoracique ?
Le voyage en avion est généralement possible après consolidation complète, soit environ 2 mois. Consultez votre médecin avant tout voyage.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Épidémiologie des cardiopathies ischémiques en France. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [2] Évaluation des stratégies de dépistage et de repérage. HAS. 2024-2025.Lien
- [3] Épidémiologie des cardiopathies ischémiques en France. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [4] Rapport d'activité 2024. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] Maladies cardiovasculaires - Ministère du Travail, de la Santé. sante.gouv.fr. 2024-2025.Lien
- [6] La nouvelle ère de la radiothérapie FLASH s'ouvre à l'Institut Curie. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] Journées scientifiques 2025 de l'ANRS MIE. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [8] Biomechanics of flail chest injuries: tidal volume and respiratory mechanics. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [9] Surgical stabilization of rib fractures (SSRF): the WSES guidelines. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [10] Traitement chirurgical du volet thoracique: à propos de 36 cas. Medical Focus Journal, 2024.Lien
- [12] Intérêt de la tomodensitométrie thoracique précoce chez le traumatisé thoracique fermé grave. 2024.Lien
- [17] Profil épidémiologique des traumatismes thoraciques au niveau de l'hôpital Mohamed Boudiaf–Ouargla.Lien
- [18] Volet costal - Blessures; empoisonnement. MSD Manuals.Lien
- [19] Volet thoracique. Wikimedi.ca.Lien
Publications scientifiques
- Traitement chirurgical du volet thoracique: à propos de 36 cas. (2024)
- [PDF][PDF] La tuberculose pulmonaire commune: volet diagnostique [PDF]
- Intérêt de la tomodensitométrie thoracique précoce chez le traumatisé thoracique fermé grave (2024)
- Preliminary Results of Rib Osteosynthesis at the Teaching Hospital Sylvanus Olympio in Lomé (2023)
- Acta Belgica de arte medicinali et pharmaceutica militari (rue des champs-Elys~ es 43, Bruxelles). [PDF]
Ressources web
- Volet costal - Blessures; empoisonnement (msdmanuals.com)
Le diagnostic du volet costal est clinique, idéalement par l'observation du mouvement paradoxal du volet costal lors de la respiration. Cependant, il peut être ...
- Volet thoracique (wikimedi.ca)
1 févr. 2021 — Insuffisance respiratoire, Crépitants, Tachypnée , Saignements, Déformation de la région thoracique, Mouvement paradoxal de la paroi thoracique, ...
- Volet thoracique : causes, symptômes et traitement (medicoverhospitals.in)
Les symptômes comprennent des difficultés respiratoires, des douleurs thoraciques et des mouvements thoraciques paradoxaux visibles. 3. Comment diagnostique-t- ...
- Les traumatismes thoraciques (hug.ch)
26 févr. 2025 — Une radiographie du thorax permet de détecter d'éventuelles lésions associées comme le pneumothorax . Le traitement d'une côte fracturée n'est ...
- Revue générale des traumatismes thoraciques - Blessures (msdmanuals.com)
Les signes fréquents comprennent une douleur, des ecchymoses thoraciques et une détresse respiratoire; une hypotension ou un choc peuvent être présents.
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
