Blessures du Thorax : Symptômes, Traitements et Pronostic 2025
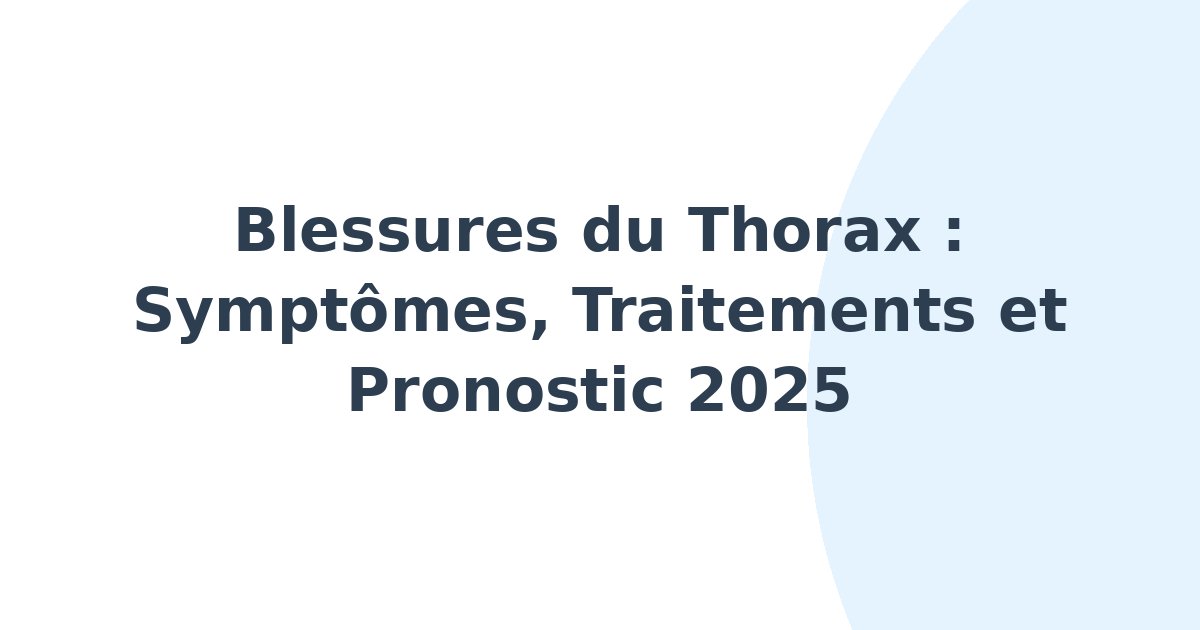
Les blessures du thorax représentent un enjeu majeur de santé publique, touchant chaque année des milliers de personnes en France. Qu'elles résultent d'accidents de la route, de chutes ou de traumatismes sportifs, ces pathologies nécessitent une prise en charge rapide et adaptée. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur ces traumatismes thoraciques, leurs symptômes et les dernières avancées thérapeutiques.
Téléconsultation et Blessures du thorax
Téléconsultation non recommandéeLes blessures du thorax nécessitent un examen physique approfondi pour évaluer l'atteinte des structures internes (poumons, cœur, vaisseaux). L'évaluation de la gravité, la détection de complications comme un pneumothorax ou un hémothorax, et la nécessité d'examens d'imagerie urgents rendent la téléconsultation inadéquate pour le diagnostic initial.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil de l'histoire du traumatisme et des circonstances de survenue. Description des symptômes ressentis par le patient (douleur, essoufflement, gêne respiratoire). Évaluation visuelle des lésions cutanées superficielles si présentes. Orientation initiale vers une structure de soins adaptée. Suivi post-hospitalisation après prise en charge initiale en présentiel.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen physique complet avec auscultation pulmonaire et cardiaque obligatoire. Évaluation de la mécanique ventilatoire et de la stabilité hémodynamique. Réalisation d'examens d'imagerie (radiographie thoracique, scanner selon gravité). Recherche de complications comme pneumothorax, hémothorax ou contusion pulmonaire.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Impossibilité d'évaluer à distance la stabilité respiratoire et hémodynamique. Nécessité d'un examen physique pour rechercher des signes de pneumothorax (diminution du murmure vésiculaire, tympanisme). Évaluation de la douleur nécessitant une palpation thoracique. Besoin d'examens d'imagerie urgents non réalisables à domicile.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Tout traumatisme thoracique récent nécessite une évaluation immédiate en structure hospitalière. Suspicion de lésions internes graves nécessitant une prise en charge chirurgicale urgente. Signes de détresse respiratoire ou hémodynamique imposant une hospitalisation immédiate.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Difficultés respiratoires importantes ou essoufflement au repos
- Douleur thoracique intense et persistante malgré les antalgiques
- Crachats sanglants ou vomissements de sang
- Pâleur, sueurs froides, malaise général ou perte de connaissance
- Déformation visible de la cage thoracique ou enfoncement
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Urgentiste ou chirurgien thoracique — consultation en présentiel indispensable
Les blessures du thorax nécessitent une évaluation urgente par un médecin urgentiste pour le bilan initial, avec recours possible à un chirurgien thoracique selon la gravité. L'examen clinique et l'imagerie sont indispensables pour exclure des complications potentiellement mortelles.
Blessures du thorax : Définition et Vue d'Ensemble
Les blessures du thorax regroupent l'ensemble des traumatismes affectant la cage thoracique et les organes qu'elle protège. Cette région anatomique complexe abrite des structures vitales : le cœur, les poumons, les gros vaisseaux et l'œsophage [8,9].
On distingue deux grandes catégories de traumatismes thoraciques. D'une part, les traumatismes fermés où la peau reste intacte malgré l'impact. D'autre part, les traumatismes ouverts ou pénétrants qui créent une communication entre l'extérieur et la cavité thoracique [2,3].
Mais pourquoi ces blessures sont-elles si préoccupantes ? En fait, le thorax contient des organes dont le fonctionnement est indispensable à la vie. Une atteinte cardiaque ou pulmonaire peut rapidement engager le pronostic vital. C'est pourquoi toute suspicion de traumatisme thoracique nécessite une évaluation médicale urgente [7].
L'important à retenir : même un traumatisme apparemment bénin peut masquer des lésions internes graves. Les signes peuvent parfois apparaître plusieurs heures après l'accident initial.
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques françaises révèlent une réalité préoccupante concernant les traumatismes thoraciques. Selon les dernières analyses de Santé Publique France, les accidents de trottinettes électriques représentent désormais une cause émergente de blessures thoraciques, avec une augmentation de 23% des cas graves entre 2023 et 2024 [1].
En France, on estime qu'environ 15 000 personnes sont hospitalisées chaque année pour des traumatismes thoraciques. Les hommes sont deux fois plus touchés que les femmes, principalement dans la tranche d'âge 25-45 ans. Cette différence s'explique par une exposition plus importante aux activités à risque et aux accidents du travail [1].
D'ailleurs, les accidents de la route demeurent la première cause de traumatismes thoraciques graves, représentant 45% des cas. Viennent ensuite les chutes de hauteur (25%), les accidents sportifs (15%) et les agressions (10%). Les 5% restants concernent des causes diverses, incluant les accidents domestiques [1,5].
Comparativement aux pays européens, la France présente un taux d'incidence légèrement supérieur à la moyenne, avec 23 cas pour 100 000 habitants contre 19 en moyenne européenne. Cette différence pourrait s'expliquer par des habitudes de conduite et des pratiques sportives spécifiques à notre pays.
Les Causes et Facteurs de Risque
Comprendre les mécanismes à l'origine des blessures thoraciques permet de mieux les prévenir. Les traumatismes à haute énergie constituent la principale catégorie de risque. Ils résultent d'impacts violents capables de transmettre une force considérable à travers la cage thoracique [4,6].
Les accidents de la circulation représentent le scénario le plus fréquent. L'impact frontal projette le conducteur contre le volant ou déclenche le déploiement de l'airbag avec une force parfois traumatisante. Les motocyclistes sont particulièrement vulnérables, malgré les équipements de protection [5].
Mais les causes ne se limitent pas aux accidents de transport. Les chutes de hauteur concernent souvent les professionnels du bâtiment, mais aussi les personnes âgées lors de chutes domestiques. L'impact au sol peut provoquer des fractures costales multiples ou des contusions pulmonaires [6].
Certains facteurs individuels augmentent la vulnérabilité. L'âge avancé fragilise les structures osseuses, rendant les côtes plus susceptibles de se fracturer. L'ostéoporose constitue un facteur de risque majeur chez les femmes ménopausées. De même, certaines pathologies comme l'emphysème pulmonaire peuvent aggraver les conséquences d'un traumatisme thoracique.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Reconnaître les signes d'une blessure thoracique peut littéralement sauver une vie. La douleur thoracique constitue le symptôme le plus fréquent, mais son intensité ne reflète pas toujours la gravité des lésions. Cette douleur s'aggrave typiquement lors de la respiration profonde ou des mouvements [8,9].
La dyspnée ou difficulté respiratoire doit alerter immédiatement. Elle peut se manifester par un essoufflement au repos, une sensation d'oppression ou l'impossibilité de prendre une inspiration profonde. Parfois, la respiration devient superficielle et rapide [3,8].
D'autres signes peuvent accompagner ces symptômes principaux. Une toux persistante, parfois accompagnée de crachats sanglants, suggère une atteinte pulmonaire. Des douleurs irradiant vers l'épaule ou le bras peuvent évoquer une irritation du diaphragme [9].
Attention aux signes de gravité qui nécessitent un appel d'urgence immédiat : coloration bleutée des lèvres ou des ongles, sueurs froides, pouls rapide et faible, confusion ou perte de connaissance. Ces symptômes peuvent indiquer un choc traumatique mettant en jeu le pronostic vital.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic d'une blessure thoracique suit un protocole rigoureux, adapté à l'urgence de la situation. L'examen clinique initial permet d'évaluer rapidement la gravité et d'orienter les investigations complémentaires [7,8].
La radiographie thoracique constitue l'examen de première intention. Elle révèle les fractures costales, un éventuel pneumothorax ou des signes d'épanchement pleural. Cependant, certaines lésions peuvent échapper à cet examen initial, d'où l'importance d'une surveillance clinique attentive [8,9].
Lorsque les lésions semblent complexes, le scanner thoracique apporte des informations précieuses. Cet examen permet de visualiser finement les structures internes et de détecter des lésions passées inaperçues sur la radiographie simple. Il guide également la stratégie thérapeutique [4,7].
Dans certains cas spécifiques, d'autres examens peuvent s'avérer nécessaires. L'échocardiographie recherche une atteinte cardiaque, particulièrement en cas de suspicion de contusion myocardique. L'endoscopie bronchique peut être indiquée si l'on suspecte une lésion des voies aériennes [3].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge des blessures thoraciques a considérablement évolué ces dernières années. Le traitement varie selon la nature et la gravité des lésions, allant de la simple surveillance à la chirurgie d'urgence [7,8].
Pour les traumatismes mineurs, le traitement reste souvent conservateur. Il repose sur le contrôle de la douleur, la kinésithérapie respiratoire et la surveillance de l'évolution. Les antalgiques permettent de maintenir une ventilation efficace, élément crucial de la guérison [8,9].
Les fractures costales multiples nécessitent parfois une approche plus agressive. La fixation chirurgicale des côtes, technique en plein développement, permet de restaurer la mécanique respiratoire et de réduire les complications. Cette intervention s'avère particulièrement bénéfique chez les patients âgés [7].
En cas de pneumothorax important, le drainage pleural s'impose. Cette procédure consiste à évacuer l'air accumulé dans la cavité pleurale grâce à un drain thoracique. L'intervention peut être réalisée en urgence et permet souvent une amélioration spectaculaire des symptômes [8].
Concrètement, la chirurgie thoracique d'urgence concerne les cas les plus graves : plaies pénétrantes, hémorragies massives ou lésions des gros vaisseaux. Ces interventions requièrent une équipe spécialisée et un plateau technique adapté [2,7].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2025 marque un tournant dans la prise en charge des traumatismes thoraciques. Les thérapies ciblées et l'immunothérapie ouvrent de nouvelles perspectives, particulièrement pour la gestion des complications inflammatoires post-traumatiques .
Une innovation majeure concerne le développement de substituts physiques de thorax pour la recherche. Ces modèles permettent de mieux comprendre les mécanismes lésionnels et d'optimiser les équipements de protection individuelle [4]. Cette approche révolutionnaire aide à prédire le risque de blessures lors d'impacts balistiques ou d'accidents.
D'ailleurs, les avancées en cicatrisation transforment la récupération post-traumatique. Les nouvelles techniques de régénération tissulaire accélèrent la guérison des plaies thoraciques et réduisent les séquelles . Ces innovations s'appuient sur une meilleure compréhension des mécanismes de réparation cellulaire.
Parallèlement, la recherche explore les applications des cellules souches dans le traitement des lésions pulmonaires post-traumatiques. Bien que ces thérapies soient encore expérimentales, les premiers résultats suggèrent un potentiel considérable pour la régénération du tissu pulmonaire endommagé .
L'intelligence artificielle révolutionne également le diagnostic. Les algorithmes d'analyse d'images permettent une détection plus précoce et plus précise des lésions thoraciques, améliorant ainsi le pronostic des patients .
Vivre au Quotidien avec Blessures du thorax
La récupération après une blessure thoracique demande du temps et de la patience. Les premiers mois sont souvent marqués par une fatigue importante et une diminution de la capacité d'effort. Il est normal de se sentir essoufflé plus rapidement qu'avant l'accident [8,9].
La kinésithérapie respiratoire joue un rôle central dans la rééducation. Ces exercices spécifiques permettent de retrouver progressivement une ventilation efficace et de prévenir les complications pulmonaires. Votre kinésithérapeute vous enseignera des techniques de respiration adaptées à votre situation .
Certaines activités quotidiennes peuvent nécessiter des adaptations temporaires. Porter des charges lourdes, jardiner ou faire le ménage peuvent s'avérer difficiles les premières semaines. N'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage pendant cette période de convalescence.
L'aspect psychologique ne doit pas être négligé. Vivre un traumatisme thoracique peut générer de l'anxiété, particulièrement concernant la respiration. Certaines personnes développent une appréhension lors d'efforts physiques. Un accompagnement psychologique peut s'avérer bénéfique dans ces situations.
Les Complications Possibles
Bien que la plupart des blessures thoraciques guérissent sans séquelles, certaines complications peuvent survenir. La pneumonie post-traumatique représente l'une des complications les plus fréquentes, particulièrement chez les patients âgés ou alités [7,8].
Les séquelles respiratoires concernent environ 15% des patients ayant subi un traumatisme thoracique grave. Elles se manifestent par une diminution de la capacité pulmonaire, un essoufflement à l'effort ou des douleurs chroniques. Ces symptômes peuvent persister plusieurs mois après l'accident initial [8,9].
Plus rarement, des complications cardiovasculaires peuvent apparaître. La contusion myocardique peut provoquer des troubles du rythme cardiaque ou une insuffisance cardiaque temporaire. Cette complication nécessite une surveillance cardiologique spécialisée [3].
D'ailleurs, certaines complications peuvent survenir à distance du traumatisme initial. L'apparition d'adhérences pleurales peut limiter l'expansion pulmonaire et provoquer des douleurs chroniques. Dans de rares cas, une intervention chirurgicale peut s'avérer nécessaire pour libérer ces adhérences.
L'important à retenir : un suivi médical régulier permet de dépister précocement ces complications et d'adapter le traitement en conséquence. N'hésitez jamais à signaler l'apparition de nouveaux symptômes à votre médecin.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des blessures thoraciques dépend largement de la rapidité de la prise en charge et de la gravité initiale des lésions. Dans la majorité des cas, l'évolution est favorable avec une récupération complète en quelques mois [8,9].
Les traumatismes mineurs, comme les fractures costales simples, guérissent généralement en 6 à 8 semaines. La douleur diminue progressivement et la fonction respiratoire se normalise. Cependant, certaines personnes peuvent ressentir des douleurs résiduelles pendant plusieurs mois [8].
Pour les traumatismes graves, le pronostic reste globalement bon grâce aux progrès de la réanimation et de la chirurgie thoracique. Le taux de mortalité a considérablement diminué ces dernières décennies, passant de 15% dans les années 1990 à moins de 5% aujourd'hui [7].
Plusieurs facteurs influencent le pronostic. L'âge du patient joue un rôle déterminant : les personnes âgées récupèrent plus lentement et présentent plus de complications. L'existence de pathologies associées, comme une maladie cardiaque ou pulmonaire, peut également compliquer l'évolution [7,8].
Rassurez-vous : avec un traitement adapté et un suivi médical régulier, la grande majorité des patients retrouvent une qualité de vie satisfaisante. La clé du succès réside dans le respect des consignes médicales et la patience durant la phase de récupération.
Peut-on Prévenir Blessures du thorax ?
La prévention des blessures thoraciques repose sur l'adoption de comportements sécuritaires dans nos activités quotidiennes. Le port de la ceinture de sécurité en voiture reste la mesure de prévention la plus efficace, réduisant de 70% le risque de traumatisme thoracique grave [1,5].
Pour les motocyclistes, l'équipement de protection individuelle fait la différence. Un gilet de protection thoracique peut absorber une partie de l'énergie d'impact et limiter les lésions. Les recherches récentes montrent l'efficacité de ces dispositifs dans la réduction des fractures costales [5].
Dans le domaine professionnel, le respect des règles de sécurité s'avère crucial. Les travailleurs du bâtiment doivent utiliser systématiquement leurs équipements de protection individuelle et respecter les procédures de sécurité lors des travaux en hauteur [6].
Concernant les sports à risque, un échauffement approprié et l'utilisation d'équipements adaptés réduisent significativement les risques. Les sports de contact nécessitent des protections thoraciques spécifiques, particulièrement chez les jeunes sportifs.
À la maison, quelques précautions simples peuvent éviter bien des accidents. Sécuriser les escaliers, éviter l'encombrement des passages et maintenir un bon éclairage réduisent les risques de chutes, particulièrement chez les personnes âgées.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont émis des recommandations spécifiques concernant la prise en charge des traumatismes thoraciques. La Haute Autorité de Santé insiste sur l'importance du dépistage précoce des complications, particulièrement chez les patients à risque .
Santé Publique France recommande une surveillance particulière des nouveaux modes de transport comme les trottinettes électriques. L'augmentation des accidents liés à ces véhicules nécessite une adaptation des stratégies de prévention et de prise en charge [1].
Les recommandations pour les voyageurs incluent des conseils spécifiques selon les destinations. Certaines activités touristiques présentent des risques particuliers de traumatismes thoraciques, notamment les sports d'aventure ou les activités en altitude .
D'ailleurs, les autorités insistent sur l'importance de la formation des premiers secours. Savoir reconnaître les signes d'un traumatisme thoracique grave et alerter les secours appropriés peut sauver des vies. Cette formation devrait être généralisée dans les entreprises à risque.
Les recommandations évoluent régulièrement en fonction des nouvelles données scientifiques. Il est donc important de se tenir informé des dernières guidelines, particulièrement pour les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge de ces traumatismes.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations accompagnent les personnes victimes de traumatismes thoraciques. L'Association Française de Chirurgie Thoracique propose des ressources éducatives et met en relation patients et professionnels spécialisés.
La Fédération Française de Pneumologie offre un soutien spécifique aux patients présentant des séquelles respiratoires. Elle organise régulièrement des groupes de parole et des séances d'information sur les nouvelles thérapies .
Pour les victimes d'accidents de la route, l'association Prévention Routière propose un accompagnement psychologique et juridique. Elle aide également à la réinsertion professionnelle des personnes handicapées suite à leur accident.
Les centres de rééducation spécialisés constituent une ressource précieuse pour la récupération fonctionnelle. Ils proposent des programmes personnalisés combinant kinésithérapie, ergothérapie et soutien psychologique.
N'oubliez pas les ressources en ligne : forums de patients, sites d'information médicale validés et applications mobiles d'aide à la rééducation. Ces outils complètent utilement l'accompagnement médical traditionnel.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos recommandations pour optimiser votre récupération après une blessure thoracique. Tout d'abord, respectez scrupuleusement les consignes de votre médecin concernant les activités autorisées et interdites. Chaque cas est unique et nécessite une approche personnalisée.
La gestion de la douleur ne doit pas être négligée. Une douleur mal contrôlée peut entraver la récupération en limitant les mouvements respiratoires. N'hésitez pas à signaler toute douleur persistante à votre équipe soignante.
Maintenez une activité physique adaptée dès que possible. La marche quotidienne, même courte, favorise la récupération et prévient les complications liées à l'immobilisation. Augmentez progressivement l'intensité selon vos capacités.
L'alimentation joue également un rôle important. Privilégiez les aliments riches en protéines pour favoriser la cicatrisation et en vitamines pour soutenir votre système immunitaire. Une hydratation suffisante aide à fluidifier les sécrétions bronchiques.
Enfin, n'isolez pas votre entourage de votre parcours de soins. Leur soutien moral et pratique constitue un atout précieux pour votre rétablissement. Communiquez sur vos difficultés et acceptez l'aide proposée.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous amener à consulter en urgence, même si votre traumatisme thoracique semblait initialement bénin. Une aggravation de la douleur ou l'apparition d'une gêne respiratoire nécessitent une évaluation médicale immédiate [8,9].
La survenue de fièvre dans les jours suivant un traumatisme thoracique peut signaler une complication infectieuse. De même, l'apparition de crachats purulents ou sanglants doit vous alerter et motiver une consultation rapide [8].
D'autres symptômes justifient un avis médical urgent : palpitations cardiaques, malaise général, confusion ou altération de l'état de conscience. Ces signes peuvent révéler une complication grave nécessitant une prise en charge spécialisée [7,9].
Pour le suivi à long terme, consultez votre médecin si vous ressentez une limitation persistante de vos activités plusieurs mois après l'accident. Une réévaluation peut permettre d'optimiser votre prise en charge et d'améliorer votre qualité de vie.
N'hésitez jamais à contacter votre médecin en cas de doute. Il vaut mieux une consultation de précaution qu'une complication négligée. Votre équipe soignante est là pour vous accompagner tout au long de votre récupération.
Questions Fréquentes
Combien de temps dure la guérison d'une fracture costale ?
La consolidation osseuse prend généralement 6 à 8 semaines. Cependant, la douleur peut persister plus longtemps, particulièrement chez les personnes âgées.
Peut-on faire du sport après un traumatisme thoracique ?
La reprise sportive dépend de la gravité initiale et de l'évolution de la guérison. Les sports de contact sont généralement déconseillés pendant plusieurs mois.
Les séquelles sont-elles fréquentes ?
La majorité des patients récupèrent complètement. Les séquelles concernent principalement les traumatismes graves ou les patients présentant des facteurs de risque particuliers.
Faut-il éviter l'avion après un pneumothorax ?
Les voyages en avion sont généralement déconseillés pendant 2 à 4 semaines après un pneumothorax. La variation de pression en cabine peut favoriser une récidive.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Évaluation des stratégies de dépistage et de repérage - HAS 2024-2025Lien
- [2] Caractéristiques des accidentés à trottinettes électriques - Santé Publique France 2024-2025Lien
- [3] Recommandations sanitaires aux voyageurs - sante.gouv.fr 2024-2025Lien
- [4] Thérapies ciblées et immunothérapie : positionnement - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [5] Libérer tout le potentiel du système - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [6] Livre des résumés - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [7] Next-gen spinal cord injury clinical trials - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [8] Stem cell therapies for spinal cord injury in humans - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [10] Traumatisme thoracique pénétrant auto-infligé par une flèche d'arbalète (2022)Lien
- [11] La contusion myocardique, une entité à ne pas négliger lors de tout traumatisme thoracique (2025)Lien
- [12] Développement d'un substitut physique de thorax humain et de son jumeau numérique (2023)Lien
- [13] Modélisation et évaluation des dispositifs de retenue pour motards (2022)Lien
- [14] Compréhension des mécanismes de dégradation pulmonaires face au blast (2022)Lien
- [15] La réanimation du patient polytraumatiséLien
- [17] Revue générale des traumatismes thoraciques - MSD ManualsLien
- [18] Présentation des lésions thoraciques - MSD ManualsLien
Publications scientifiques
- Douleur et mort du lion assyrien: cas d'études (VIIe saC) (2024)
- Traumatisme thoracique pénétrant auto-infligé par une flèche d'arbalète (2022)
- La contusion myocardique, une entité à ne pas négliger lors de tout traumatisme thoracique. À propos d'un cas (2025)
- Développement d'un substitut physique de thorax humain et de son jumeau numérique dédiés à la prédiction du risque lésionnel lors d'impacts balistiques non … (2023)
- Modélisation et évaluation des dispositifs de retenue pour motards (2022)1 citations
Ressources web
- Revue générale des traumatismes thoraciques - Blessures (msdmanuals.com)
Les signes fréquents comprennent une douleur, des ecchymoses thoraciques et une détresse respiratoire; une hypotension ou un choc peuvent être présents.
- Présentation des lésions thoraciques (msdmanuals.com)
Symptômes des lésions thoraciques ... La zone lésée est généralement sensible ou douloureuse. La douleur est accrue à l'inspiration. Le thorax peut présenter un ...
- Clínica especializada explica las lesiones de caja torácica (elgeaditraumatologia.com)
Les blessures à la paroi thoracique sont extrêmement fréquentes et sont généralement causées par un traumatisme direct, comme des chutes ou des coups violents. ...
- Pneumothorax : définition, causes, traitements (elsan.care)
Les symptômes d'un pneumothorax peuvent inclure une respiration rapide et sifflante, une douleur thoracique aiguë, une toux, une faiblesse et une sensation de ...
- Douleur thoracique : causes, symptômes, diagnostic et ... (medecindirect.fr)
sensation d'oppression ou de pression : ressentie dans la poitrine, pouvant s'étendre aux bras, à la mâchoire et au cou ;. essoufflement : survenant surtout ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
