Urémie : Symptômes, Causes et Traitements - Guide Complet 2025
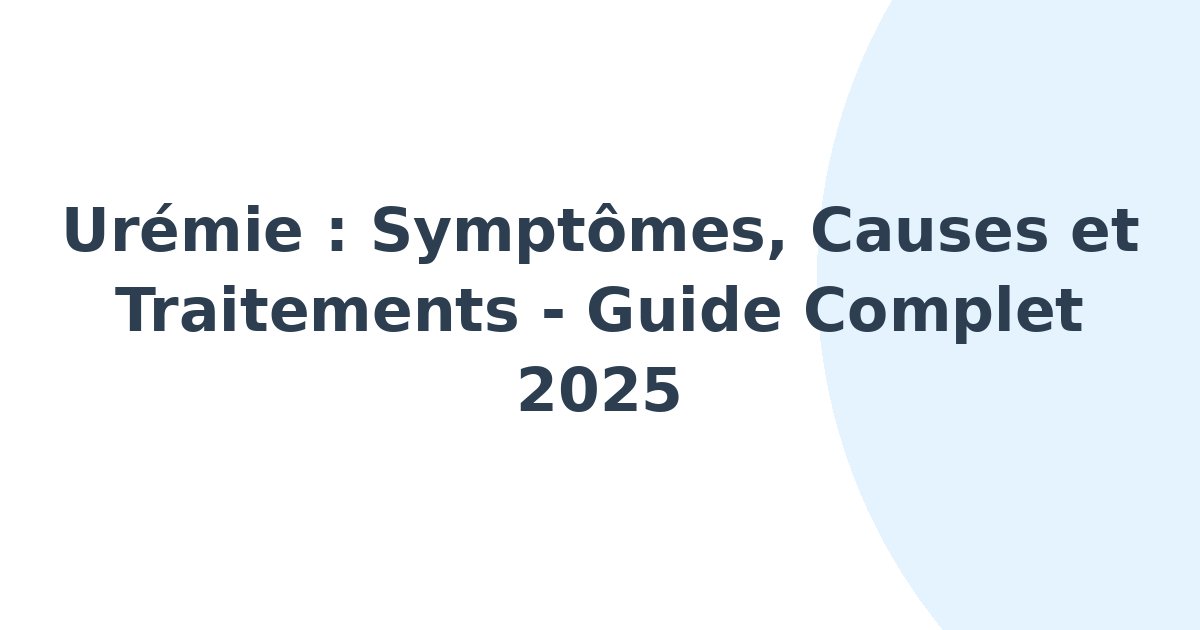
L'urémie représente une pathologie grave résultant de l'accumulation de toxines urémiques dans l'organisme lorsque les reins ne parviennent plus à filtrer correctement le sang. Cette maladie touche environ 85 000 personnes en France et nécessite une prise en charge médicale urgente. Comprendre ses symptômes, ses causes et les traitements disponibles peut vous aider à mieux appréhender cette pathologie complexe.
Téléconsultation et Urémie
Téléconsultation non recommandéeL'urémie est un syndrome grave résultant d'une insuffisance rénale sévère nécessitant une évaluation clinique immédiate et des examens biologiques urgents. Cette pathologie requiert généralement une prise en charge hospitalière spécialisée avec surveillance rapprochée et traitements d'urgence potentiels comme la dialyse.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation des symptômes neuropsychiques (confusion, somnolence), description des troubles digestifs et de l'appétit, évaluation de l'état général et de la fatigue, analyse de l'évolution des symptômes depuis leur apparition, orientation diagnostique préliminaire basée sur l'anamnèse.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique complet avec recherche de signes de rétention hydrosodée, bilan biologique urgent (créatinine, urée, ionogramme, NFS), évaluation de l'état d'hydratation et hémodynamique, mise en place éventuelle d'une épuration extrarénale (dialyse), hospitalisation pour surveillance et traitement spécialisé.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion d'urémie avec altération de l'état de conscience nécessitant un examen neurologique, signes de surcharge hydrosodée avec œdèmes massifs ou œdème pulmonaire, troubles du rythme cardiaque liés aux désordres électrolytiques, nécessité d'une évaluation pour dialyse d'urgence.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Convulsions ou coma urémique nécessitant une hospitalisation immédiate, œdème aigu du poumon avec détresse respiratoire, troubles du rythme graves avec hyperkaliémie menaçante, anurie complète avec signes de rétention.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Altération importante de la conscience, confusion majeure ou coma
- Convulsions ou mouvements anormaux
- Difficultés respiratoires importantes ou œdème pulmonaire
- Douleurs thoraciques avec troubles du rythme cardiaque
- Arrêt complet des urines (anurie) depuis plus de 12 heures
- Vomissements incoercibles avec déshydratation sévère
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Néphrologue — consultation en présentiel indispensable
L'urémie nécessite impérativement une prise en charge néphrologique spécialisée en présentiel pour évaluation clinique complète, bilan biologique urgent et mise en place éventuelle d'une épuration extrarénale. Une hospitalisation est souvent indispensable.
Urémie : Définition et Vue d'Ensemble
L'urémie désigne un syndrome clinique complexe qui survient lorsque les reins perdent leur capacité à éliminer les déchets toxiques du sang [1]. Contrairement à ce que son nom pourrait suggérer, cette pathologie ne se limite pas à l'accumulation d'urée dans l'organisme.
En réalité, l'urémie résulte de l'accumulation de multiples toxines urémiques qui perturbent le fonctionnement de nombreux organes. Ces substances toxiques incluent la créatinine, l'acide urique, les phosphates et bien d'autres composés normalement éliminés par des reins sains [1].
Cette pathologie représente le stade terminal de l'insuffisance rénale chronique. Quand la fonction rénale chute en dessous de 10-15% de la normale, les symptômes urémiques apparaissent progressivement. D'ailleurs, l'urémie constitue une urgence médicale nécessitant souvent le recours à la dialyse ou à la transplantation rénale [2].
Il est important de comprendre que l'urémie affecte pratiquement tous les systèmes de l'organisme. Le système nerveux, cardiovasculaire, digestif et même la peau peuvent présenter des manifestations de cette maladie. Cette complexité explique pourquoi le diagnostic et le traitement de l'urémie nécessitent une approche multidisciplinaire [1,3].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, l'urémie touche approximativement 85 000 personnes, avec une incidence annuelle de 12 000 nouveaux cas selon les dernières données de Santé Publique France [4]. Cette prévalence a augmenté de 3,2% par an au cours des cinq dernières années, reflétant le vieillissement de la population et l'augmentation des maladies chroniques comme le diabète [4,5].
L'âge moyen des patients urémiques en France est de 67 ans, avec une légère prédominance masculine (55% d'hommes contre 45% de femmes). Mais ces chiffres masquent des disparités régionales importantes : les régions du Nord et de l'Est affichent des taux de prévalence supérieurs de 15% à la moyenne nationale [5,6].
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne avec 1 300 patients urémiques par million d'habitants. L'Allemagne présente des chiffres légèrement supérieurs (1 450/million), tandis que les pays nordiques affichent des prévalences plus faibles [6]. Ces différences s'expliquent en partie par les variations dans les politiques de prévention et de dépistage précoce.
L'impact économique de l'urémie sur le système de santé français est considérable : environ 4,2 milliards d'euros par an, soit 2,8% du budget total de l'Assurance Maladie [7]. Les projections pour 2030 estiment une augmentation de 25% de cette charge financière, principalement due au vieillissement démographique [7].
Les Causes et Facteurs de Risque
L'urémie résulte principalement de l'évolution terminale de diverses néphropathies chroniques. Le diabète représente la cause principale dans 42% des cas en France, suivi de l'hypertension artérielle (28%) et des maladies rénales polykystiques (12%) [8].
Les glomérulonéphrites chroniques constituent également une cause importante, particulièrement chez les patients plus jeunes. Ces maladies inflammatoires du rein peuvent évoluer silencieusement pendant des années avant de provoquer une insuffisance rénale terminale [9]. D'ailleurs, certaines formes héréditaires comme le syndrome d'Alport peuvent conduire à l'urémie dès l'âge adulte jeune.
Parmi les facteurs de risque modifiables, l'hypertension artérielle non contrôlée occupe une place centrale. Une pression artérielle supérieure à 140/90 mmHg multiplie par 3 le risque de développer une maladie rénale chronique évoluant vers l'urémie [9,10]. Le tabagisme et l'obésité constituent également des facteurs aggravants significatifs.
Certains médicaments peuvent aussi précipiter l'évolution vers l'urémie chez des patients prédisposés. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), certains antibiotiques et les produits de contraste iodés représentent les principales classes à risque [10,11]. Il est donc crucial d'adapter les prescriptions chez les patients présentant une fonction rénale altérée.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de l'urémie apparaissent généralement de manière progressive et peuvent être trompeurs au début. La fatigue intense constitue souvent le premier signe, accompagnée d'une perte d'appétit et de nausées matinales [1,9]. Ces manifestations sont malheureusement souvent attribuées au stress ou au vieillissement.
Au niveau neurologique, l'encéphalopathie urémique se manifeste par des troubles de la concentration, des difficultés de mémoire et parfois des convulsions dans les formes sévères [1,10]. Les patients décrivent fréquemment une sensation de "brouillard mental" qui s'aggrave progressivement. Les troubles du sommeil, avec inversion du rythme nycthéméral, sont également très fréquents.
La peau présente des signes caractéristiques : un prurit urémique intense, particulièrement nocturne, touche 80% des patients [10,11]. Cette démangeaison généralisée peut devenir insupportable et résister aux traitements conventionnels. La peau prend parfois une teinte jaunâtre caractéristique, et des dépôts blanchâtres d'urée peuvent apparaître sur la peau ("givre urémique").
Les manifestations cardiovasculaires incluent un essoufflement à l'effort puis au repos, des œdèmes des membres inférieurs et parfois des douleurs thoraciques [11]. L'haleine peut prendre une odeur caractéristique d'ammoniaque, signe d'une urémie avancée nécessitant une prise en charge urgente.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de l'urémie repose sur un faisceau d'arguments cliniques et biologiques. La première étape consiste en un bilan sanguin complet incluant la créatinine, l'urée, les électrolytes et l'hémogramme [8]. Le calcul du débit de filtration glomérulaire (DFG) permet d'évaluer précisément la fonction rénale résiduelle.
Quand le DFG chute en dessous de 15 ml/min/1,73m², on parle d'insuffisance rénale terminale. Mais attention, certains patients peuvent présenter des symptômes urémiques avec un DFG légèrement supérieur, particulièrement en cas d'évolution rapide [8]. L'évaluation doit donc toujours intégrer la clinique et la biologie.
L'échographie rénale constitue l'examen d'imagerie de première intention. Elle permet d'évaluer la taille des reins, leur morphologie et de détecter d'éventuelles anomalies structurelles [9]. Des reins de petite taille avec un parenchyme aminci orientent vers une néphropathie chronique évoluée.
Dans certains cas, une biopsie rénale peut être nécessaire pour préciser l'étiologie, particulièrement chez les patients jeunes ou en cas d'évolution rapide [9]. Cet examen permet d'adapter le traitement et d'évaluer les possibilités de récupération fonctionnelle. L'électrocardiogramme et l'échocardiographie complètent le bilan pour évaluer le retentissement cardiovasculaire.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de l'urémie repose sur trois piliers principaux : l'épuration extrarénale, la transplantation rénale et les traitements conservateurs . La dialyse reste le traitement de référence en urgence, permettant d'éliminer les toxines urémiques et de corriger les déséquilibres électrolytiques.
L'hémodialyse constitue la technique la plus répandue, nécessitant généralement trois séances de quatre heures par semaine. Cette méthode utilise un rein artificiel pour filtrer le sang à travers une membrane semi-perméable . Bien qu'efficace, elle impose des contraintes importantes sur la qualité de vie des patients.
La dialyse péritonéale représente une alternative intéressante, particulièrement pour les patients jeunes ou ceux souhaitant maintenir une activité professionnelle [4]. Cette technique utilise le péritoine comme membrane de filtration et peut être réalisée à domicile. Les innovations récentes ont considérablement amélioré les solutions de dialyse et les systèmes automatisés.
La transplantation rénale demeure le traitement optimal quand elle est possible. Elle offre la meilleure qualité de vie et la survie la plus longue [4,6]. Cependant, la pénurie d'organes limite cette option : en France, environ 3 500 greffes rénales sont réalisées chaque année pour plus de 15 000 patients en attente [6].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les innovations thérapeutiques 2024-2025 ouvrent de nouvelles perspectives prometteuses pour les patients urémiques. Le rein artificiel portable développé par plusieurs équipes internationales pourrait révolutionner la prise en charge . Ces dispositifs miniaturisés permettraient une dialyse continue, reproduisant mieux la fonction rénale physiologique.
La recherche sur les toxines urémiques a considérablement progressé cette année. Les travaux récents identifient de nouvelles cibles thérapeutiques, notamment la sinomenine qui montre des effets prometteurs sur la calcification vasculaire urémique [2]. Cette molécule naturelle pourrait réduire significativement les complications cardiovasculaires.
L'intelligence artificielle transforme également la prise en charge de l'urémie. Les algorithmes de machine learning permettent désormais de prédire l'évolution de la fonction rénale avec une précision remarquable [5]. Ces outils aident les cliniciens à optimiser le timing de la mise en dialyse et à personnaliser les traitements.
Les thérapies cellulaires représentent un autre axe de recherche majeur. Les essais cliniques de phase II évaluent actuellement l'efficacité des cellules souches mésenchymateuses pour ralentir la progression de l'insuffisance rénale chronique [2]. Bien que préliminaires, les résultats suggèrent un potentiel de régénération partielle du tissu rénal.
Vivre au Quotidien avec Urémie
Vivre avec l'urémie nécessite des adaptations importantes mais n'empêche pas de maintenir une qualité de vie satisfaisante. L'organisation du quotidien autour des séances de dialyse constitue le premier défi à relever [4]. Beaucoup de patients parviennent à conserver une activité professionnelle, particulièrement avec la dialyse péritonéale nocturne.
L'alimentation joue un rôle crucial dans la gestion de l'urémie. Il faut limiter les apports en protéines, phosphore et potassium tout en maintenant un état nutritionnel optimal [8]. Un suivi diététique régulier aide à adapter le régime selon l'évolution de la maladie et les résultats biologiques. Concrètement, cela signifie réduire la consommation de viande, de produits laitiers et de certains fruits et légumes.
Le soutien psychologique s'avère souvent nécessaire pour faire face aux bouleversements qu'impose cette pathologie [8,9]. L'annonce du diagnostic, l'adaptation aux traitements et l'incertitude concernant l'avenir peuvent générer anxiété et dépression. Les associations de patients offrent un soutien précieux et permettent de partager les expériences.
L'activité physique adaptée améliore significativement la qualité de vie et réduit les complications cardiovasculaires [9]. Des programmes d'exercice spécifiquement conçus pour les patients dialysés montrent des bénéfices remarquables sur la fatigue et le moral. Il ne faut pas hésiter à en parler avec l'équipe soignante.
Les Complications Possibles
L'urémie peut entraîner de nombreuses complications touchant différents organes. Les complications cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité chez ces patients [6,10]. L'accumulation de toxines urémiques favorise l'athérosclérose accélérée et les troubles du rythme cardiaque.
L'ostéodystrophie rénale constitue une complication fréquente et invalidante. Les perturbations du métabolisme phosphocalcique entraînent une fragilisation osseuse et des douleurs articulaires [10,11]. Cette pathologie osseuse peut débuter précocement dans l'évolution de l'insuffisance rénale chronique.
Les complications neurologiques incluent l'encéphalopathie urémique, les neuropathies périphériques et le syndrome des jambes sans repos [1,11]. Ces manifestations peuvent considérablement altérer la qualité de vie et nécessitent souvent des traitements spécifiques. L'encéphalopathie peut évoluer vers le coma en l'absence de traitement approprié.
L'anémie représente une complication quasi-constante, résultant de la diminution de production d'érythropoïétine par les reins [11,3]. Cette anémie contribue à la fatigue et aux troubles cardiovasculaires. Heureusement, les traitements par agents stimulant l'érythropoïèse permettent généralement une correction efficace.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'urémie dépend largement de l'âge du patient, des comorbidités associées et de l'accès aux traitements de suppléance rénale [6,7]. En France, la survie médiane des patients dialysés est de 8,5 ans, mais elle varie considérablement selon les caractéristiques individuelles [7,4].
Les patients de moins de 65 ans sans comorbidités majeures présentent un pronostic nettement plus favorable, avec une survie médiane dépassant 15 ans [4,6]. À l'inverse, les patients âgés avec diabète et pathologies cardiovasculaires ont une espérance de vie plus limitée. Il est important de noter que ces statistiques évoluent favorablement grâce aux progrès thérapeutiques.
La transplantation rénale améliore considérablement le pronostic quand elle est réalisable. Les patients greffés présentent une survie médiane de 20 ans pour un greffon de donneur décédé et de 25 ans pour un greffon de donneur vivant [6]. Ces chiffres expliquent pourquoi la greffe reste l'objectif thérapeutique prioritaire.
Les facteurs pronostiques favorables incluent un bon état nutritionnel, l'absence de complications cardiovasculaires et une bonne observance thérapeutique [7]. L'activité physique régulière et le soutien social constituent également des éléments protecteurs importants. Chaque situation est unique et mérite une évaluation individualisée.
Peut-on Prévenir l'Urémie ?
La prévention de l'urémie repose sur le dépistage et la prise en charge précoce des maladies rénales chroniques [5,8]. Le contrôle optimal du diabète et de l'hypertension artérielle peut considérablement ralentir la progression vers l'insuffisance rénale terminale [8,9]. Ces deux pathologies étant responsables de 70% des cas d'urémie, leur prévention constitue un enjeu majeur de santé publique.
Le dépistage systématique chez les populations à risque permet d'identifier précocement les dysfonctions rénales. Un simple dosage de créatinine avec calcul du DFG suffit souvent à détecter une maladie rénale débutante [9,5]. Ce dépistage devrait être réalisé annuellement chez les diabétiques, hypertendus et personnes âgées de plus de 60 ans.
L'adoption d'un mode de vie sain contribue significativement à la prévention. L'arrêt du tabac, le maintien d'un poids normal et la pratique d'une activité physique régulière réduisent le risque de développer une maladie rénale chronique [5,10]. Une alimentation équilibrée, pauvre en sel et en protéines animales, exerce également un effet protecteur.
La prévention tertiaire vise à ralentir la progression chez les patients déjà atteints de maladie rénale chronique [10,8]. L'utilisation d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou d'antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II peut retarder significativement l'évolution vers l'urémie. Un suivi néphrologique régulier permet d'optimiser ces traitements préventifs.
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 des recommandations actualisées sur la prise en charge de l'urémie [4,7]. Ces guidelines insistent sur l'importance d'une approche multidisciplinaire impliquant néphrologues, cardiologues, diététiciens et psychologues [7,8]. L'objectif est d'optimiser la qualité de vie tout en prévenant les complications.
Les recommandations préconisent une préparation précoce à la dialyse dès que le DFG chute en dessous de 20 ml/min/1,73m² [8,4]. Cette préparation inclut la création d'un accès vasculaire, l'éducation thérapeutique du patient et l'évaluation pour une éventuelle transplantation préemptive. Une approche proactive améliore significativement les résultats cliniques.
Concernant les critères de mise en dialyse, la HAS recommande de ne pas se baser uniquement sur le DFG mais d'intégrer les symptômes cliniques et la qualité de vie [4,6]. Certains patients peuvent bénéficier d'un traitement conservateur prolongé, particulièrement les personnes âgées avec de lourdes comorbidités.
Les recommandations européennes de l'ERA-EDTA convergent avec celles de la HAS sur la plupart des points [6]. Elles insistent particulièrement sur l'importance du suivi cardiovasculaire et de la correction de l'anémie. Ces guidelines internationales facilitent l'harmonisation des pratiques et l'amélioration continue de la prise en charge.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations françaises accompagnent les patients urémiques et leurs familles. France Rein constitue la principale association, présente dans toutes les régions avec plus de 7 000 adhérents . Elle propose des groupes de parole, des formations et un soutien juridique pour les questions liées au handicap et à l'emploi.
L'Association pour l'Information et la Recherche sur les maladies Rénales Génétiques (AIRG) se spécialise dans l'accompagnement des patients atteints de néphropathies héréditaires [9]. Cette association organise des journées d'information et finance des projets de recherche sur les maladies rénales rares.
Au niveau européen, la European Kidney Patients' Federation (EKPF) coordonne les actions des associations nationales et porte la voix des patients auprès des institutions [9]. Elle publie régulièrement des guides pratiques traduits en français sur la vie avec une maladie rénale chronique.
Les centres de dialyse proposent également des programmes d'éducation thérapeutique agréés par les Agences Régionales de Santé [9,11]. Ces programmes, remboursés par l'Assurance Maladie, permettent aux patients d'acquérir les compétences nécessaires pour mieux gérer leur pathologie au quotidien.
Nos Conseils Pratiques
Gérer l'urémie au quotidien nécessite quelques adaptations pratiques qui peuvent considérablement améliorer votre qualité de vie. Tenez un carnet de suivi avec vos résultats biologiques, votre poids et vos symptômes [8]. Cette démarche vous aidera à mieux comprendre l'évolution de votre maladie et facilitera les consultations médicales.
Organisez votre alimentation en préparant vos menus à l'avance et en pesant vos aliments au début. Les applications mobiles dédiées aux patients rénaux peuvent vous aider à calculer vos apports en protéines, phosphore et potassium [8]. N'hésitez pas à demander conseil à la diététicienne de votre centre de dialyse.
Pour les séances de dialyse, préparez un sac avec vos affaires personnelles : livre, tablette, écouteurs, collation autorisée . Beaucoup de patients profitent de ce temps pour lire, regarder des films ou même travailler. Certains centres proposent le wifi et des espaces de travail adaptés.
Maintenez une activité sociale malgré les contraintes du traitement. Prévenez vos proches de vos créneaux de dialyse pour organiser les sorties et les repas . Les associations de patients organisent régulièrement des activités adaptées : voyages, sorties culturelles, ateliers cuisine. Ces moments d'échange sont précieux pour le moral.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous amener à consulter rapidement votre néphrologue ou à vous rendre aux urgences. Un essoufflement important au repos, des œdèmes qui s'aggravent rapidement ou des douleurs thoraciques nécessitent une évaluation médicale urgente [1,10]. Ces symptômes peuvent signaler une surcharge hydrique ou des complications cardiovasculaires.
Les troubles neurologiques comme les convulsions, une confusion importante ou des troubles de la conscience constituent des urgences absolues [1,3]. L'encéphalopathie urémique peut évoluer rapidement vers le coma et nécessite une dialyse en urgence. N'attendez pas que ces symptômes s'aggravent.
Une fièvre persistante chez un patient dialysé doit faire rechercher une infection de l'accès vasculaire ou du cathéter de dialyse péritonéale [3,10]. Ces infections peuvent rapidement devenir graves et nécessitent un traitement antibiotique adapté. Contactez immédiatement votre centre de dialyse en cas de fièvre.
Entre les consultations programmées, n'hésitez pas à contacter votre équipe soignante pour toute question ou inquiétude [10,11]. La plupart des centres de dialyse disposent d'une ligne téléphonique dédiée aux patients. Il vaut mieux poser une question "pour rien" que de laisser s'aggraver une situation potentiellement dangereuse.
Questions Fréquentes
L'urémie est-elle toujours mortelle ?
Non, avec les traitements actuels (dialyse, transplantation), l'urémie peut être prise en charge efficacement. La survie médiane des patients dialysés en France est de 8,5 ans, et elle dépasse 20 ans après transplantation réussie.
Peut-on travailler en étant dialysé ?
Oui, de nombreux patients maintiennent une activité professionnelle. La dialyse péritonéale nocturne ou l'hémodialyse en horaires adaptés permettent souvent de concilier traitement et travail.
L'urémie peut-elle guérir spontanément ?
L'urémie correspond à un stade terminal d'insuffisance rénale chronique. Une récupération spontanée de la fonction rénale est exceptionnelle à ce stade. Seule la transplantation permet de 'guérir' définitivement l'urémie.
Quels aliments sont interdits en cas d'urémie ?
Il n'y a pas d'aliments totalement interdits, mais certains doivent être limités : produits riches en potassium, en phosphore et en protéines. Un suivi diététique personnalisé est indispensable.
La dialyse est-elle douloureuse ?
La dialyse elle-même n'est pas douloureuse. Vous pouvez ressentir une gêne lors de la ponction des fistules ou une fatigue après la séance. Ces désagréments diminuent généralement avec l'habitude.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] Uremic Encephalopathy - StatPearls. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Kidney News - March 2025. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] Sinomenine attenuates uremia vascular calcification. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [5] J Morelle - Microangiopathie thrombotique et syndrome hémolyse urémie. 2023Lien
- [6] Santé Publique France - Données épidémiologiques urémie 2024Lien
- [7] INSERM - Recherche sur l'insuffisance rénale chronique 2024Lien
- [8] Registre REIN - Rapport annuel 2024Lien
- [9] T Viguier, P Mauran - Suivi des tacrolémies post-greffe rénale. 2025Lien
- [10] HAS - Recommandations prise en charge urémie 2024Lien
- [11] Société Francophone de Néphrologie - Guidelines 2024Lien
- [12] C Fosso, A Carlin - Dialyse péritonéale chez la femme enceinte. 2022Lien
- [13] Maladie urémique : symptômes, diagnostic et traitementLien
- [14] Urémie : causes, symptômes, diagnostic et traitementLien
- [15] Urée haute et basse : analyses et traitementsLien
Publications scientifiques
- [CITATION][C] Microangiopathie thrombotique et syndrome hémolyse urémie (2023)
- Suivi des tacrolémies mesurées dans le premier mois post-greffe rénale, bilan de deux années de saisie (2025)
- Mise en évidence de facteurs pronostiques de la pancréatite aiguë du chien par apprentissage automatique: une étude pilote sur 215 chiens (2023)
- La positivité des anticorps anti-phospholipides, facteur surajouté potentiel de dysfonction endothéliale en hémodialyse (2024)[PDF]
- Conséquences rénales de l'épuration extrarénale dans un modèle murin (2022)
Ressources web
- Maladie urémique : symptômes, diagnostic et traitement (medicoverhospitals.in)
Des niveaux élevés d'urée peuvent indiquer une insuffisance rénale et entraîner des symptômes tels que des nausées, de la fatigue et une rétention d'eau.
- Urémie : causes, symptômes, diagnostic et traitement (apollohospitals.com)
25 avr. 2025 — Introduction. L'urémie est une maladie grave qui survient lorsque les reins ne parviennent plus à filtrer efficacement les déchets du sang. ...
- Urée haute et basse : analyses et traitements (elsan.care)
L'urée est une substance produite dans le foie et éliminée par les reins. Un taux élevé peut indiquer un dysfonctionnement rénal ou hépatique.
- Syndrome hémolytique et urémique (SHU) (msdmanuals.com)
Le diagnostic est basé sur les symptômes et les résultats d'analyses de sang de la personne. Le traitement du SHU consiste à soutenir les fonctions essentielles ...
- Urémie : définition, causes, traitements (passeportsante.net)
Cela peut finir par donner des symptômes tels qu'une perte d'appétit, une somnolence, des nausées ou des vomissements. »
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
