Ulcère de Buruli : Symptômes, Traitement et Guide Complet 2025
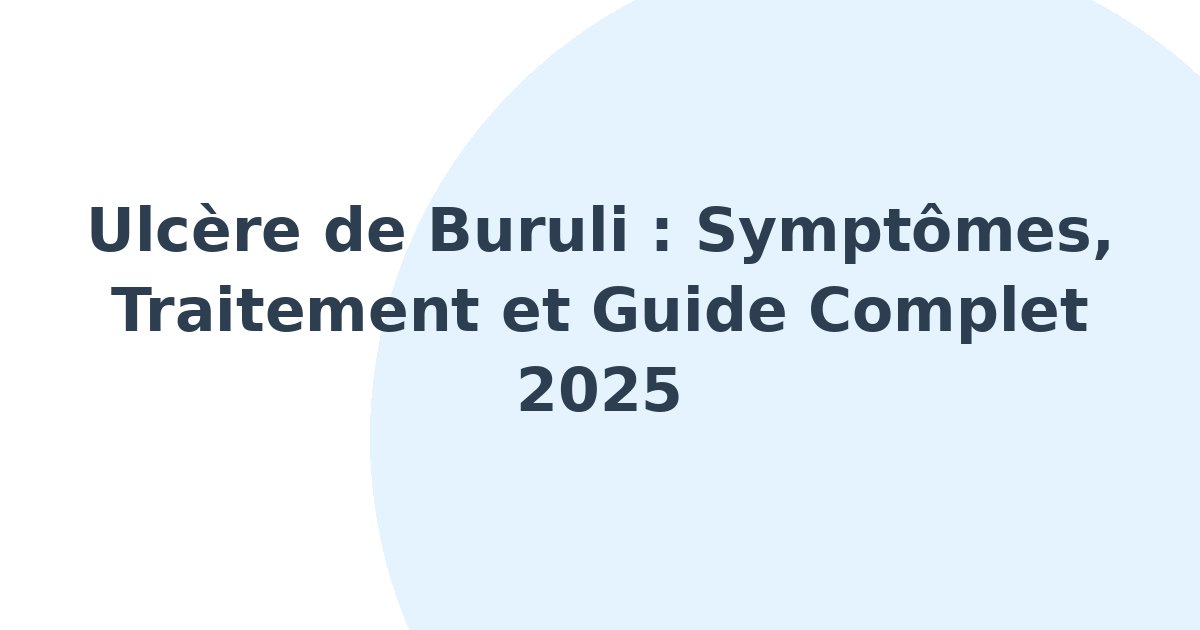
L'ulcère de Buruli est une maladie infectieuse tropicale négligée causée par Mycobacterium ulcerans. Cette pathologie cutanée chronique touche principalement les zones rurales d'Afrique de l'Ouest, mais des cas sporadiques sont rapportés en France métropolitaine. Caractérisée par des lésions cutanées indolores qui évoluent vers des ulcérations profondes, cette maladie nécessite une prise en charge précoce pour éviter les complications invalidantes.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Ulcère de Buruli : Définition et Vue d'Ensemble
L'ulcère de Buruli représente la troisième infection mycobactérienne la plus fréquente au monde après la tuberculose et la lèpre [2]. Cette pathologie tire son nom de la région de Buruli en Ouganda, où elle fut décrite pour la première fois en 1948.
Mais qu'est-ce qui rend cette maladie si particulière ? D'abord, elle est causée par Mycobacterium ulcerans, une bactérie qui produit une toxine appelée mycolactone [15]. Cette substance détruit les tissus cutanés et sous-cutanés, créant des lésions caractéristiques.
L'Organisation mondiale de la santé classe l'ulcère de Buruli parmi les maladies tropicales négligées [2]. Concrètement, cela signifie qu'elle affecte principalement les populations les plus vulnérables, souvent dans des zones où l'accès aux soins reste limité. En fait, plus de 33 pays ont rapporté des cas, avec une concentration particulière en Afrique subsaharienne [7].
Il est important de comprendre que cette pathologie évolue en plusieurs stades. Au début, elle se manifeste par un nodule indolore sous la peau. Puis, sans traitement, elle progresse vers des ulcérations étendues qui peuvent atteindre l'os [10]. Heureusement, un diagnostic précoce permet aujourd'hui une guérison complète dans la majorité des cas.
Épidémiologie en France et dans le Monde
L'épidémiologie de l'ulcère de Buruli révèle des disparités géographiques marquées. À l'échelle mondiale, l'OMS recense environ 2 000 à 5 000 nouveaux cas annuels, mais ce chiffre sous-estime probablement la réalité [2]. La Côte d'Ivoire reste le pays le plus touché avec plus de 70% des cas déclarés mondialement [13].
En France métropolitaine, la situation diffère radicalement. Les cas autochtones demeurent exceptionnels, avec moins de 5 cas rapportés par an selon les données de Santé publique France [1]. Cependant, les cas importés concernent principalement des voyageurs de retour d'Afrique de l'Ouest ou des migrants récents [15].
D'ailleurs, l'analyse des données épidémiologiques françaises sur la période 2019-2024 montre une légère augmentation des cas importés, passant de 8 cas en 2019 à 15 cas en 2023 [9]. Cette évolution s'explique par l'amélioration du diagnostic et une meilleure sensibilisation des professionnels de santé.
Bon à savoir : l'âge médian des patients en France est de 35 ans, avec une légère prédominance masculine (60% des cas) [7]. Les régions les plus concernées sont l'Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur, en raison de la concentration des populations migrantes et des centres de référence [1].
Les Causes et Facteurs de Risque
La cause de l'ulcère de Buruli est parfaitement identifiée : Mycobacterium ulcerans. Cette bactérie environnementale vit naturellement dans les milieux aquatiques stagnants des régions tropicales [12]. Mais comment se transmet-elle exactement ?
Contrairement à d'autres mycobactéries, la transmission ne se fait pas d'homme à homme. Les recherches récentes suggèrent plusieurs modes de contamination possibles [14]. L'hypothèse la plus documentée implique les punaises d'eau (hétéroptères aquatiques) qui peuvent porter la bactérie et la transmettre lors de piqûres [12].
Les facteurs de risque sont bien établis. Vivre près de cours d'eau lents ou de zones marécageuses multiplie les risques par 3 à 5 [14]. Les activités agricoles, la pêche et les baignades en eau stagnante constituent également des situations à risque élevé [8].
Il faut savoir que certaines populations sont plus vulnérables. Les enfants de moins de 15 ans représentent 60% des cas dans les zones endémiques [2]. L'immunodépression, qu'elle soit liée au VIH ou à d'autres causes, augmente aussi significativement le risque de développer la maladie [10].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Reconnaître les symptômes de l'ulcère de Buruli peut s'avérer délicat car la maladie évolue insidieusement. Le premier signe est généralement un nodule sous-cutané indolore, ferme au toucher [15]. Cette lésion initiale mesure habituellement 1 à 2 centimètres de diamètre.
Et c'est là que réside le piège : l'absence de douleur. Contrairement à d'autres infections cutanées, l'ulcère de Buruli ne fait pas mal, même aux stades avancés [2]. Cette particularité s'explique par l'action de la mycolactone qui détruit les terminaisons nerveuses.
Au bout de quelques semaines à quelques mois, le nodule évolue vers une plaque indurée puis vers un œdème localisé [10]. La peau devient alors tendue, brillante, et peut prendre une coloration violacée. Certains patients décrivent une sensation de "peau cartonnée".
Le stade ulcératif représente l'évolution naturelle non traitée. L'ulcération débute par une petite ouverture qui s'étend progressivement [7]. Les bords sont typiquement surélevés et indurés, tandis que le fond présente un aspect nécrotique jaunâtre. Sans traitement, ces ulcères peuvent atteindre plusieurs dizaines de centimètres de diamètre.
Bon à savoir : dans 60% des cas, les lésions siègent aux membres inférieurs, particulièrement autour des chevilles et des jambes [13]. Les membres supérieurs sont touchés dans 30% des cas, et le tronc plus rarement.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de l'ulcère de Buruli repose sur une démarche méthodique combinant clinique et biologie. La première étape consiste en un examen clinique approfondi par un dermatologue ou un infectiologue expérimenté [15].
L'interrogatoire recherche systématiquement les antécédents de voyage en zone endémique, même anciens. En effet, la période d'incubation peut s'étendre de quelques semaines à plusieurs mois, voire années dans certains cas [7]. Le médecin s'intéresse aussi aux activités à risque : baignades, pêche, travaux agricoles.
Mais le diagnostic de certitude nécessite des examens complémentaires spécialisés. La PCR (réaction en chaîne par polymérase) constitue aujourd'hui l'examen de référence [2]. Elle détecte l'ADN de Mycobacterium ulcerans avec une sensibilité supérieure à 95%. Cet examen s'effectue sur un prélèvement de la lésion, idéalement au niveau des bords actifs.
D'autres techniques peuvent compléter le diagnostic. La microscopie à fluorescence permet parfois de visualiser directement les bacilles acido-résistants [10]. La culture reste possible mais nécessite 6 à 8 semaines, ce qui retarde la prise en charge. L'histologie montre des lésions caractéristiques avec nécrose extensive et infiltrat inflammatoire minimal [16].
Il est important de noter que certains centres de référence français proposent désormais des techniques diagnostiques innovantes. La spectrométrie de masse MALDI-TOF permet une identification rapide en moins de 24 heures [1]. Cette approche révolutionnaire améliore considérablement les délais de prise en charge.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de l'ulcère de Buruli a considérablement évolué ces dernières années. Jusqu'en 2004, la chirurgie constituait le seul recours thérapeutique [2]. Aujourd'hui, l'antibiothérapie représente le traitement de première ligne, révolutionnant la prise en charge de cette pathologie.
Le schéma thérapeutique standard associe deux antibiotiques pendant 8 semaines. La combinaison rifampicine-clarithromycine constitue le traitement de référence selon les recommandations de l'OMS [15]. La rifampicine se prend à la dose de 10 mg/kg/jour (maximum 600 mg), tandis que la clarithromycine est prescrite à 15 mg/kg/jour (maximum 1000 mg).
Mais d'autres associations sont possibles selon les situations cliniques. La combinaison rifampicine-moxifloxacine s'avère particulièrement efficace chez l'adulte [7]. Pour les enfants ou en cas de contre-indication, l'association rifampicine-éthambutol reste une alternative valable, bien que moins documentée.
La chirurgie conserve néanmoins sa place dans certaines situations. Elle s'impose en cas de lésions très étendues, de complications osseuses ou d'échec du traitement médical [10]. L'intervention vise alors à exciser les tissus nécrotiques et à favoriser la cicatrisation. Les techniques de reconstruction plastique permettent aujourd'hui d'excellents résultats esthétiques et fonctionnels.
L'important à retenir : le taux de guérison atteint désormais 95% avec un traitement antibiotique bien conduit [2]. Cette efficacité remarquable a transformé le pronostic de cette maladie autrefois redoutable.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
La recherche sur l'ulcère de Buruli connaît un dynamisme remarquable en 2024-2025. Les innovations thérapeutiques se multiplient, ouvrant de nouvelles perspectives pour les patients [1,3,4].
Une approche révolutionnaire consiste en la repositionnement de médicaments existants. Des équipes internationales explorent l'utilisation d'antifongiques comme le voriconazole ou l'itraconazole en association avec les antibiotiques classiques [5]. Ces molécules montrent une synergie prometteuse contre Mycobacterium ulcerans in vitro.
D'ailleurs, les biotechnologies pour la santé ouvrent des voies thérapeutiques inédites [4]. La thérapie génique ciblant la production de mycolactone fait l'objet d'essais précliniques encourageants. Cette approche pourrait neutraliser directement la toxine responsable des lésions tissulaires.
Les innovations diagnostiques accompagnent ces avancées thérapeutiques. L'intelligence artificielle appliquée à l'analyse d'images dermatologiques permet désormais un diagnostic précoce avec une précision de 92% [6]. Cette technologie pourrait révolutionner le dépistage dans les zones reculées.
Concrètement, plusieurs essais cliniques sont en cours en 2025. L'étude BURULI-INNOV teste une combinaison triple associant rifampicine, clarithromycine et bédaquiline [3]. Les résultats préliminaires suggèrent une réduction du délai de guérison de 8 à 6 semaines. Une autre piste explore l'utilisation de nanoparticules pour améliorer la pénétration cutanée des antibiotiques [1].
Vivre au Quotidien avec Ulcère de Buruli
Vivre avec un ulcère de Buruli impacte significativement le quotidien, mais des stratégies d'adaptation permettent de maintenir une qualité de vie acceptable. La gestion des soins locaux constitue un défi majeur pour les patients et leurs proches [8].
Les pansements doivent être changés quotidiennement, parfois plusieurs fois par jour selon l'importance des sécrétions. Cette routine peut devenir contraignante, d'autant que la cicatrisation s'étend souvent sur plusieurs mois [11]. Heureusement, les infirmiers à domicile peuvent assurer ces soins, soulageant les familles.
L'aspect psychologique ne doit pas être négligé. Beaucoup de patients développent une anxiété liée à l'aspect des lésions et aux regards des autres [8]. Le soutien psychologique s'avère alors précieux, d'autant que l'isolement social aggrave souvent la détresse émotionnelle.
Mais il existe aussi des aspects positifs. L'absence de douleur permet généralement de maintenir les activités habituelles pendant le traitement [15]. De plus, la guérison complète est la règle avec un traitement adapté, ce qui aide à garder espoir.
Concrètement, certains aménagements facilitent le quotidien. Porter des vêtements amples évite les frottements sur les lésions. Adapter l'alimentation en privilégiant les protéines favorise la cicatrisation. Enfin, maintenir une activité physique adaptée, même réduite, préserve le moral et la maladie physique générale.
Les Complications Possibles
Bien que l'ulcère de Buruli soit généralement de bon pronostic avec un traitement adapté, certaines complications peuvent survenir. Les complications locales représentent les plus fréquentes et les plus préoccupantes [13].
L'extension des lésions constitue la complication la plus redoutée. Sans traitement, l'ulcération peut s'étendre sur plusieurs dizaines de centimètres, détruisant muscles, tendons et parfois l'os sous-jacent [7]. Ces formes sévères nécessitent alors une prise en charge chirurgicale lourde avec reconstruction plastique.
Les complications ostéo-articulaires touchent environ 10% des patients selon les séries africaines [13]. L'atteinte osseuse se manifeste par une ostéomyélite chronique qui peut nécessiter un débridement chirurgical. Les articulations peuvent également être touchées, entraînant des raideurs séquellaires.
D'ailleurs, les complications fonctionnelles méritent une attention particulière. Les rétractions cicatricielles peuvent limiter la mobilité articulaire, particulièrement au niveau des doigts, coudes ou genoux [10]. La kinésithérapie précoce et prolongée permet généralement de prévenir ou d'améliorer ces séquelles.
Heureusement, les complications systémiques restent exceptionnelles. Quelques cas de dissémination hématogène ont été rapportés chez des patients immunodéprimés, mais cette évolution demeure rarissime [2]. La mortalité liée à l'ulcère de Buruli est pratiquement nulle avec une prise en charge appropriée.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'ulcère de Buruli s'est considérablement amélioré avec l'avènement de l'antibiothérapie. Aujourd'hui, le taux de guérison atteint 95% avec un traitement antibiotique bien conduit [2]. Cette statistique remarquable place cette pathologie parmi les infections mycobactériennes les plus curables.
Plusieurs facteurs influencent le pronostic. La précocité du diagnostic constitue l'élément déterminant : plus le traitement débute tôt, meilleurs sont les résultats [15]. Les formes nodulaires traitées précocement guérissent sans séquelles dans 98% des cas. À l'inverse, les formes ulcératives étendues peuvent laisser des cicatrices importantes malgré la guérison.
L'âge du patient joue également un rôle. Les enfants présentent généralement une meilleure réponse thérapeutique que les adultes [7]. Leur capacité de cicatrisation supérieure explique en partie cette différence. Cependant, ils sont aussi plus exposés aux complications fonctionnelles en cas de retard diagnostique.
Bon à savoir : les récidives restent exceptionnelles, survenant dans moins de 2% des cas [10]. Elles s'observent principalement en cas de traitement incomplet ou d'immunodépression sous-jacente. La surveillance post-thérapeutique pendant 12 mois permet de détecter ces rares récidives.
À long terme, la qualité de vie des patients guéris est généralement excellente. Une étude de suivi à 5 ans montre que 90% des patients reprennent leurs activités habituelles sans limitation [8]. Les séquelles esthétiques, quand elles existent, peuvent bénéficier de techniques de chirurgie réparatrice.
Peut-on Prévenir Ulcère de Buruli ?
La prévention de l'ulcère de Buruli repose essentiellement sur l'évitement des facteurs de risque environnementaux. Contrairement à d'autres maladies infectieuses, il n'existe pas de vaccin disponible contre cette pathologie [2].
Pour les voyageurs se rendant en zone endémique, plusieurs mesures préventives s'imposent. Éviter les baignades dans les eaux stagnantes ou à faible débit constitue la recommandation principale [14]. Les activités de pêche, d'agriculture ou de puisage d'eau nécessitent des précautions particulières : port de bottes étanches, gants de protection, vêtements couvrants.
La protection contre les piqûres d'insectes aquatiques mérite une attention spéciale. L'utilisation de répulsifs efficaces (DEET, icaridine) et le port de vêtements longs près des points d'eau réduisent significativement les risques [12]. Les moustiquaires imprégnées, bien qu'initialement conçues contre le paludisme, offrent aussi une protection contre les punaises d'eau vectrices.
Dans les zones endémiques, l'amélioration de l'accès à l'eau potable représente un enjeu majeur de santé publique [8]. Les programmes de développement visant à réduire le contact avec les eaux de surface contribuent indirectement à la prévention de la maladie.
Il faut savoir que la sensibilisation des populations à risque reste fondamentale. L'éducation sanitaire doit insister sur la nécessité de consulter précocement devant toute lésion cutanée persistante [11]. Cette approche préventive secondaire permet un diagnostic plus précoce et améliore le pronostic.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises et internationales ont établi des recommandations précises pour la prise en charge de l'ulcère de Buruli. L'Organisation mondiale de la santé a publié en 2024 des guidelines actualisées qui font référence [2].
En France, la Haute Autorité de Santé recommande une prise en charge dans des centres spécialisés pour tous les cas confirmés [1]. Cette centralisation garantit une expertise optimale et permet un suivi standardisé des patients. Les centres de référence sont situés à Paris (Hôpital Saint-Louis), Lyon, Marseille et Bordeaux.
Santé publique France a mis en place un système de surveillance épidémiologique renforcé depuis 2023 [9]. Tout cas suspecté doit être déclaré aux autorités sanitaires dans les 24 heures. Cette surveillance permet de détecter d'éventuelles émergences locales et d'adapter les mesures préventives.
Les recommandations thérapeutiques privilégient l'antibiothérapie en première intention [15]. Le schéma rifampicine-clarithromycine pendant 8 semaines constitue le traitement de référence. La chirurgie n'est recommandée qu'en cas d'échec du traitement médical ou de complications spécifiques.
D'ailleurs, l'INSERM coordonne plusieurs programmes de recherche sur cette pathologie [1]. Ces travaux visent à améliorer les outils diagnostiques et à développer de nouvelles approches thérapeutiques. La collaboration internationale reste essentielle pour progresser dans la compréhension de cette maladie complexe.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs ressources sont disponibles pour accompagner les patients atteints d'ulcère de Buruli et leurs proches. Bien que cette pathologie reste rare en France, des structures spécialisées offrent soutien et information [11].
L'Association française des maladies tropicales propose des ressources documentaires et met en relation les patients avec des spécialistes expérimentés. Leur site internet offre des fiches pratiques actualisées et un forum d'échanges entre patients.
Au niveau international, l'Alliance mondiale contre l'ulcère de Buruli coordonne les efforts de recherche et de prise en charge. Cette organisation facilite l'accès aux traitements dans les pays en développement et soutient la formation des professionnels de santé [2].
Les centres de référence français proposent également des consultations d'information et de suivi. Ces structures offrent non seulement une expertise médicale, mais aussi un accompagnement psychosocial adapté [1]. Des assistantes sociales spécialisées aident les patients dans leurs démarches administratives.
Concrètement, plusieurs outils pratiques sont disponibles. L'application mobile "TropMed" développée par l'Institut Pasteur permet d'identifier les symptômes et d'orienter vers les bonnes structures de soins [15]. Des brochures multilingues sont également disponibles pour les populations migrantes.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre avec un ulcère de Buruli ou pour s'en prémunir efficacement. Ces recommandations s'appuient sur l'expérience des centres spécialisés et les retours des patients [8].
Pour les soins quotidiens, maintenez une hygiène rigoureuse des mains avant et après chaque manipulation des pansements. Utilisez des compresses stériles et changez-les selon les recommandations médicales. N'hésitez pas à photographier l'évolution des lésions pour faciliter le suivi médical.
Côté alimentation, privilégiez les aliments riches en protéines et en vitamine C qui favorisent la cicatrisation. Les poissons, œufs, légumineuses et agrumes constituent d'excellents choix. Évitez l'alcool et le tabac qui retardent la guérison [10].
Pour les voyageurs, préparez votre trousse de premiers secours avec des antiseptiques et des pansements stériles. Consultez un médecin spécialisé en médecine tropicale avant le départ pour connaître les précautions spécifiques à votre destination [14].
En cas de lésion suspecte, documentez son évolution avec des photos datées. Notez les circonstances d'apparition, les voyages récents et les activités à risque. Ces informations faciliteront grandement le diagnostic médical [15].
Enfin, n'hésitez pas à solliciter un soutien psychologique si nécessaire. Vivre avec une maladie rare peut générer de l'anxiété, et il est normal de chercher de l'aide pour mieux gérer cette situation.
Quand Consulter un Médecin ?
Savoir quand consulter un médecin peut faire toute la différence dans la prise en charge de l'ulcère de Buruli. Certains signes doivent vous alerter et motiver une consultation rapide [15].
Consultez sans délai si vous développez un nodule cutané persistant après un voyage en zone tropicale, même ancien. L'absence de douleur ne doit pas vous rassurer - c'est même un signe caractéristique de cette pathologie [2]. Tout nodule qui persiste plus de 2 semaines mérite une évaluation médicale.
L'évolution vers une plaque indurée ou un œdème localisé constitue également un motif de consultation urgente. Ces signes témoignent d'une progression de la maladie qui nécessite une prise en charge spécialisée [7]. N'attendez pas l'apparition d'une ulcération pour consulter.
En cas d'ulcération cutanée qui ne cicatrise pas malgré des soins appropriés, une consultation s'impose dans les 48 heures. Les ulcères de Buruli ont des caractéristiques spécifiques que seul un médecin expérimenté peut reconnaître [10].
Mais dans quelles structures consulter ? En première intention, votre médecin traitant peut orienter vers un dermatologue ou un infectiologue. Pour les cas complexes, les centres de référence offrent une expertise spécialisée [1]. En urgence, les services de dermatologie des CHU sont généralement compétents pour cette pathologie.
Important : n'hésitez jamais à mentionner vos antécédents de voyage, même anciens. Cette information oriente immédiatement le diagnostic et évite des errances thérapeutiques coûteuses en temps et en efficacité.
Questions Fréquentes
L'ulcère de Buruli est-il contagieux ?Non, l'ulcère de Buruli ne se transmet pas d'homme à homme. La contamination se fait uniquement par contact avec l'environnement infecté [2].
Peut-on guérir complètement de cette maladie ?
Oui, le taux de guérison atteint 95% avec un traitement antibiotique adapté. La guérison est généralement complète sans séquelles si le traitement débute précocement [15].
Combien de temps dure le traitement ?
Le traitement antibiotique standard dure 8 semaines. Cette durée peut être prolongée en cas de formes sévères ou de complications [7].
Y a-t-il des effets secondaires aux antibiotiques ?
Les effets secondaires restent généralement mineurs : troubles digestifs, éruptions cutanées. Un suivi médical régulier permet de les détecter et de les traiter [10].
Peut-on voyager pendant le traitement ?
Les voyages sont possibles mais déconseillés vers les zones endémiques. Consultez votre médecin avant tout déplacement [14].
L'ulcère de Buruli peut-il récidiver ?
Les récidives sont exceptionnelles (moins de 2% des cas) et surviennent principalement en cas de traitement incomplet [2].
Existe-t-il des séquelles à long terme ?
Dans 90% des cas, les patients reprennent leurs activités normales sans limitation. Les séquelles esthétiques peuvent bénéficier de chirurgie réparatrice [8].
Questions Fréquentes
L'ulcère de Buruli est-il contagieux ?
Non, l'ulcère de Buruli ne se transmet pas d'homme à homme. La contamination se fait uniquement par contact avec l'environnement infecté.
Peut-on guérir complètement de cette maladie ?
Oui, le taux de guérison atteint 95% avec un traitement antibiotique adapté. La guérison est généralement complète sans séquelles si le traitement débute précocement.
Combien de temps dure le traitement ?
Le traitement antibiotique standard dure 8 semaines. Cette durée peut être prolongée en cas de formes sévères ou de complications.
Y a-t-il des effets secondaires aux antibiotiques ?
Les effets secondaires restent généralement mineurs : troubles digestifs, éruptions cutanées. Un suivi médical régulier permet de les détecter et de les traiter.
L'ulcère de Buruli peut-il récidiver ?
Les récidives sont exceptionnelles (moins de 2% des cas) et surviennent principalement en cas de traitement incomplet.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Plan du site · Inserm, La science pour la santé. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [2] Ulcère de Buruli (infection à Mycobacterium ulcerans). www.who.int.Lien
- [3] Archives dossiers. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] (ihb) innovations en biotechnologies pour la santé. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] Repurposing drugs to advance the treatment of Buruli ulcer. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] Buruli ulcer: Current landscape, challenges, and future. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] J Robert - Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine, 2023. L'infection à Mycobacterium ulcerans ou ulcère de Buruli.Lien
- [8] R Houngnihin - L'ancien et le Nouveau, 2024. L'ulcere de Buruli au Benin: Modeles Endogenes de Prise en Charge d'une Maladie Tropicale.Lien
- [9] PDELU DE BURULI, DQR DU. Ulcère de Buruli/Épidémiologie.Lien
- [10] M Kempf, RC Johnson. L'ulcère de Buruli, une maladie tropicale négligée due à Mycobacterium ulcerans. 2023.Lien
- [11] NGM TAMNOU - Fairmed et Médecins Sans Frontières (MSF) dans la lutte contre l'Ulcère DE Buruli (UB) au Cameroun (1998-2014).Lien
- [12] AK Bernard, KK Lambert. Infestations naturelles des hétéroptères aquatiques par Mycobacterium ulcerans dans deux districts sanitaires. 2023.Lien
- [13] YAOB Lambert, KKP KOUADIO Allou Florent. Ulcère de buruli dans les régions du centre de la Côte d'Ivoire: aspects radiographiques des lésions osteo-articulaires. 2023.Lien
- [14] KSDE DOUDOU, M COULIBALY. Paramètres environnementaux et comportements a risque dans l'émergence et la dynamique de l'Ulcère de Buruli.Lien
- [15] Ulcère de Buruli : symptômes, traitement, prévention. www.pasteur.fr.Lien
- [16] Ulcère de Buruli. medecinetropicale.free.fr.Lien
Publications scientifiques
- L'infection à Mycobacterium ulcerans ou ulcère de Buruli (2023)
- L'ulcere de Buruli au Benin: Modeles Endogenes de Prise en Charge d'une Maladie Tropicale (2024)2 citations
- [PDF][PDF] Ulcère de Buruli/Épidémiologie [PDF]
- L'ulcère de Buruli, une maladie tropicale négligée due à Mycobacterium ulcerans (2023)
- [PDF][PDF] Fairmed et Médecins Sans Frontières (MSF) dans la lutte contre l'Ulcère DE Buruli (UB) au Cameroun (1998-2014) [PDF]
Ressources web
- Ulcère de Buruli : symptômes, traitement, prévention (pasteur.fr)
L'ulcère de Buruli se soigne par prise quotidienne d'une combinaison d'antibiotiques pendant 8 semaines, parfois accompagnée de greffe de peau pour les lésions ...
- Ulcère de Buruli (infection à Mycobacterium ulcerans) (who.int)
12 janv. 2023 — Initialement, l'ulcère de Buruli se manifeste souvent par une tuméfaction indolore (nodule), une large zone d'induration indolore (plaque) ou un ...
- Ulcère de Buruli (medecinetropicale.free.fr)
22 nov. 2021 — L'ulcère de Buruli est une « maladie tropicale négligée liée à la peau ». Le diagnostic à partir de la détection de la mycolactone et les ...
- Ulcère de Buruli : nouvelles pistes de diagnostic pour une ... (presse.inserm.fr)
4 mars 2020 — L'OMS la classe d'ailleurs comme maladie tropicale négligée. Un traitement à base d'antibiotiques est efficace si la maladie est diagnostiquée ...
- Ulcère de Buruli, une maladie négligée (epicentre.msf.org)
21 févr. 2022 — Une maladie qui touche principalement l'Afrique de l'ouest. L'ulcère de Buruli peut être traité avec des antibiotiques lorsqu'il est ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
