Tumeurs de la Vessie Urinaire : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
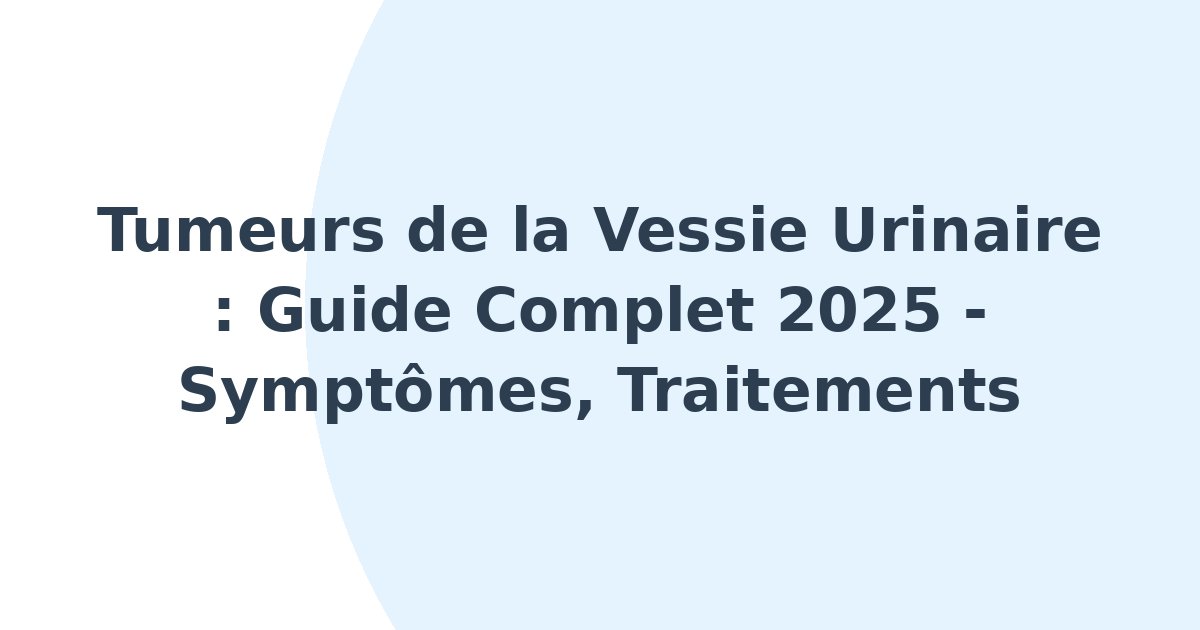
Les tumeurs de la vessie urinaire représentent une pathologie complexe qui touche chaque année des milliers de personnes en France. Cette maladie, souvent méconnue du grand public, nécessite une prise en charge spécialisée et précoce. Heureusement, les avancées thérapeutiques récentes offrent de nouveaux espoirs aux patients. Découvrons ensemble cette pathologie, ses manifestations et les solutions disponibles aujourd'hui.
Téléconsultation et Tumeurs de la vessie urinaire
Téléconsultation non recommandéeLes tumeurs de la vessie nécessitent impérativement des examens spécialisés (cystoscopie, imagerie, analyses cytologiques) pour le diagnostic et la stadification. La complexité de cette pathologie oncologique requiert une prise en charge présentielle multidisciplinaire coordonnée entre urologue, oncologue et autres spécialistes selon les cas.
Ce qui peut être évalué à distance
Analyse de l'historique des symptômes urinaires et de leur évolution temporelle. Évaluation des antécédents familiaux de cancers uro-génitaux et des facteurs de risque (tabagisme, exposition professionnelle). Discussion des résultats d'examens déjà réalisés. Coordination du parcours de soins entre les différents spécialistes. Suivi de l'observance thérapeutique et des effets secondaires des traitements en cours.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique urologique complet et palpation abdominale. Réalisation de la cystoscopie pour visualisation directe des lésions vésicales. Prescription et interprétation des examens d'imagerie (scanner, IRM) et des analyses cytologiques urinaires. Biopsies tissulaires pour confirmation histologique et stadification tumorale.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion de nouvelle lésion vésicale nécessitant une cystoscopie diagnostique. Évaluation de l'extension tumorale locale ou métastatique nécessitant un examen clinique complet. Prescription de chimiothérapie nécessitant une évaluation de l'état général et des fonctions organiques. Complications post-opératoires après résection trans-urétrale ou cystectomie nécessitant un examen physique.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Hématurie massive avec retentissement hémodynamique ou formation de caillots obstructifs. Rétention aiguë d'urine par obstruction tumorale. Signes d'infection urinaire fébrile sur vessie tumorale ou après instillations endovésicales.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Hématurie massive avec caillots et signes de choc hémorragique (pâleur, tachycardie, hypotension)
- Rétention aiguë d'urine avec globe vésical et douleurs pelviennes intenses
- Fièvre élevée avec frissons associée à des troubles urinaires (pyélonéphrite sur obstacle tumoral)
- Douleurs lombaires intenses bilatérales évoquant une insuffisance rénale obstructive
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Urologue — consultation en présentiel indispensable
L'urologue est le spécialiste référent pour le diagnostic, le traitement et le suivi des tumeurs vésicales. Une consultation présentielle est indispensable pour l'examen clinique spécialisé, la réalisation de la cystoscopie et la coordination avec l'équipe d'oncologie selon la stadification tumorale.
Tumeurs de la vessie urinaire : Définition et Vue d'Ensemble
Les tumeurs de la vessie urinaire désignent un ensemble de pathologies malignes qui se développent dans la paroi vésicale. Cette maladie touche principalement l'urothélium, le tissu qui tapisse l'intérieur de la vessie [2,16].
Mais qu'est-ce qui caractérise exactement cette pathologie ? En fait, il existe plusieurs types de tumeurs vésicales. Le carcinome urothélial représente environ 90% des cas, tandis que d'autres formes plus rares incluent les carcinomes épidermoïdes et les adénocarcinomes [16,17].
L'important à retenir, c'est que ces tumeurs peuvent être classées selon leur degré d'invasion. Les tumeurs non infiltrantes restent superficielles, tandis que les formes infiltrantes pénètrent plus profondément dans la paroi vésicale [8,9]. Cette distinction est cruciale car elle détermine entièrement l'approche thérapeutique.
Concrètement, la vessie fonctionne comme un réservoir souple qui stocke l'urine. Quand une tumeur se développe, elle peut perturber ce mécanisme délicat et provoquer divers symptômes.
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques récentes révèlent une réalité préoccupante. En France, les tumeurs de la vessie touchent environ 13 000 nouvelles personnes chaque année, avec une nette prédominance masculine [1]. Cette pathologie représente le 7ème cancer le plus fréquent chez l'homme et le 17ème chez la femme.
D'ailleurs, l'évolution temporelle montre des tendances contrastées. Chez les adolescents et jeunes adultes de 15 à 39 ans, l'incidence reste heureusement faible mais stable selon les dernières données de Santé Publique France [1]. Cependant, l'âge médian au diagnostic se situe autour de 70 ans, avec un pic d'incidence entre 65 et 75 ans [12].
Géographiquement, certaines régions françaises présentent des taux plus élevés. Les zones industrielles du Nord et de l'Est affichent une incidence supérieure à la moyenne nationale, probablement liée aux expositions professionnelles [12]. Cette répartition géographique souligne l'importance des facteurs environnementaux.
Au niveau international, la France se situe dans la moyenne européenne. Mais les pays nordiques comme la Norvège et le Danemark présentent des taux d'incidence plus élevés, tandis que les pays méditerranéens affichent des chiffres plus bas [12].
L'impact économique sur notre système de santé est considérable. Le coût annuel de prise en charge dépasse les 200 millions d'euros, incluant les traitements, le suivi et les arrêts de travail [12]. Ces chiffres justifient pleinement les investissements dans la recherche et la prévention.
Les Causes et Facteurs de Risque
Le tabagisme constitue de loin le principal facteur de risque, responsable d'environ 50% des cas chez l'homme et 30% chez la femme [16,17]. Chaque cigarette fumée augmente progressivement le risque, et cette augmentation persiste même plusieurs années après l'arrêt.
Les expositions professionnelles représentent le deuxième facteur majeur. Les travailleurs de l'industrie chimique, du textile, du caoutchouc et de la métallurgie présentent un risque accru [12]. Concrètement, les amines aromatiques et les hydrocarbures polycycliques sont particulièrement incriminés.
Mais d'autres facteurs entrent en jeu. Les infections urinaires chroniques, notamment à Schistosoma haematobium dans certaines régions du monde, peuvent favoriser le développement tumoral [16]. De même, certains traitements médicamenteux comme la cyclophosphamide augmentent le risque à long terme.
L'âge reste un facteur incontournable. Après 60 ans, l'incidence augmente exponentiellement, reflétant l'accumulation des dommages cellulaires au fil du temps [12,17]. Les antécédents familiaux jouent également un rôle, suggérant une composante génétique dans certains cas.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
L'hématurie, c'est-à-dire la présence de sang dans les urines, constitue le symptôme d'alarme principal [2,16]. Cette manifestation peut être visible à l'œil nu (hématurie macroscopique) ou détectable uniquement par analyse (hématurie microscopique). Il est crucial de ne jamais ignorer ce signe, même s'il disparaît spontanément.
D'autres symptômes urinaires peuvent accompagner l'hématurie. Les troubles mictionnels incluent une augmentation de la fréquence urinaire, des brûlures lors de la miction, ou une sensation de vidange incomplète [2,17]. Ces signes ressemblent parfois à ceux d'une infection urinaire banale, d'où l'importance d'un diagnostic différentiel rigoureux.
Certains patients rapportent également des douleurs pelviennes ou lombaires, particulièrement dans les formes avancées [16,17]. Ces douleurs peuvent irradier vers les organes génitaux ou les cuisses, reflétant l'extension locale de la tumeur.
Bon à savoir : les symptômes peuvent être intermittents au début. Beaucoup de patients décrivent des épisodes d'hématurie séparés par des périodes asymptomatiques, ce qui peut retarder le diagnostic [2]. C'est pourquoi toute hématurie, même isolée, justifie une consultation urologique rapide.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic débute toujours par un examen clinique approfondi et un interrogatoire détaillé [2,16]. Votre médecin recherchera les facteurs de risque, évaluera vos symptômes et procédera à un examen physique complet, incluant un toucher rectal chez l'homme.
L'analyse d'urine constitue l'examen de première intention. Elle confirme la présence d'hématurie et élimine une infection urinaire [2]. Parallèlement, la cytologie urinaire recherche des cellules anormales, bien que sa sensibilité reste limitée pour les tumeurs de bas grade [10,11].
L'imagerie joue un rôle central dans le bilan. L'uroscanner (ou uro-TDM) permet de visualiser l'ensemble de l'appareil urinaire et de détecter les tumeurs vésicales [13]. Cet examen non invasif offre une excellente résolution et guide la suite de la prise en charge.
Mais l'examen de référence reste la cystoscopie. Cette endoscopie de la vessie permet de visualiser directement les lésions et de réaliser des biopsies [2,16]. Bien que légèrement inconfortable, cet examen est indispensable pour confirmer le diagnostic et évaluer l'extension locale.
Les innovations récentes incluent l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer les performances diagnostiques. Des études prometteuses montrent que l'IA peut aider à interpréter la cytologie urinaire avec une précision accrue [11]. De même, le test Xpert® bladder cancer monitor offre de nouvelles perspectives pour le suivi des patients [10].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement des tumeurs vésicales non infiltrantes repose principalement sur la résection transurétrale (RTUV) [8,9]. Cette intervention, réalisée par voie endoscopique, permet de retirer la tumeur tout en préservant la vessie. La plupart des patients rentrent chez eux le lendemain de l'intervention.
Après la résection, l'immunothérapie par BCG (Bacille de Calmette-Guérin) constitue le traitement de référence pour prévenir les récidives [8,9]. Ces instillations vésicales stimulent le système immunitaire local et réduisent significativement le risque de progression tumorale. Le protocole standard comprend 6 instillations hebdomadaires suivies d'un traitement d'entretien.
Pour les tumeurs infiltrantes, la cystectomie radicale reste souvent nécessaire [9]. Cette intervention majeure consiste à retirer entièrement la vessie et les organes adjacents. Heureusement, les techniques de reconstruction urinaire permettent aujourd'hui de maintenir une qualité de vie acceptable.
La chimiothérapie trouve sa place dans plusieurs situations. En néoadjuvant, elle peut réduire la taille tumorale avant la chirurgie. En adjuvant, elle diminue le risque de récidive métastatique [14]. Les protocoles modernes associent généralement plusieurs molécules pour optimiser l'efficacité.
L'immunothérapie systémique révolutionne la prise en charge des formes métastatiques. Les inhibiteurs de checkpoints immunitaires comme le pembrolizumab ou l'atézolizumab offrent de nouveaux espoirs aux patients en situation avancée [14].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la prise en charge des tumeurs vésicales avec l'émergence de thérapies révolutionnaires [3]. Les innovations actuelles ouvrent des perspectives inédites pour les patients, particulièrement dans les formes résistantes aux traitements conventionnels.
Le TAR-200 de Johnson & Johnson représente une avancée majeure [5]. Ce système de libération prolongée permet d'administrer la gemcitabine directement dans la vessie sur plusieurs semaines. Les résultats de l'étude ENVISION montrent un taux de survie sans maladie supérieur à 80% chez les patients atteints de tumeurs non infiltrantes à haut risque [5,6].
Parallèlement, les vaccins thérapeutiques entrent en phase d'évaluation clinique. L'étude du V940 en association avec le BCG explore une nouvelle approche immunologique prometteuse [7]. Cette stratégie vise à renforcer la réponse immunitaire spécifique contre les cellules tumorales.
Les journées d'innovations techniques de 2024 ont également mis en lumière les progrès en chirurgie robotique et en imagerie peropératoire [4]. Ces avancées permettent des interventions plus précises avec moins de complications post-opératoires.
Concrètement, ces innovations transforment le pronostic de nombreux patients. Elles offrent des alternatives thérapeutiques là où les traitements classiques atteignent leurs limites [3]. L'objectif est de personnaliser davantage les traitements selon le profil moléculaire de chaque tumeur.
Vivre au Quotidien avec les Tumeurs de la Vessie
Recevoir un diagnostic de tumeur vésicale bouleverse inévitablement le quotidien. Mais rassurez-vous, de nombreux patients mènent une vie normale après le traitement [17]. L'adaptation nécessite du temps et un accompagnement approprié.
Les troubles urinaires post-traitement constituent souvent la principale préoccupation. Après une résection ou une BCG-thérapie, vous pourriez ressentir des irritations vésicales temporaires [8]. Ces symptômes s'améliorent généralement en quelques semaines avec un traitement symptomatique adapté.
Pour les patients ayant bénéficié d'une cystectomie, l'apprentissage de la nouvelle fonction urinaire demande patience et persévérance [9]. Les équipes spécialisées proposent un accompagnement personnalisé pour maîtriser les techniques de sondage ou de vidange selon le type de dérivation réalisée.
L'important à retenir, c'est que chaque personne réagit différemment. Certains reprennent rapidement leurs activités habituelles, tandis que d'autres nécessitent un temps d'adaptation plus long [17]. Il n'existe pas de "bonne" façon de vivre avec cette pathologie.
Le soutien psychologique joue un rôle crucial dans cette adaptation. N'hésitez pas à exprimer vos inquiétudes et à solliciter l'aide des professionnels de santé. De nombreuses associations proposent également un accompagnement par des patients ayant vécu la même expérience.
Les Complications Possibles
Les récidives tumorales constituent la complication la plus fréquente des tumeurs vésicales non infiltrantes [8,15]. Environ 70% des patients présentent une récidive dans les 5 ans suivant le traitement initial, d'où l'importance d'un suivi régulier par cystoscopie.
La progression vers une forme infiltrante représente l'évolution la plus redoutée [15]. Cette transformation survient chez 10 à 20% des patients selon le grade initial de la tumeur. C'est pourquoi les tumeurs de haut grade nécessitent une surveillance particulièrement étroite.
Les complications liées aux traitements méritent également d'être mentionnées. La BCG-thérapie peut provoquer des effets secondaires locaux (cystite, hématurie) ou plus rarement systémiques (fièvre, arthrites) [8]. Ces réactions, bien que désagréables, témoignent généralement de l'efficacité du traitement.
Après cystectomie radicale, les complications peuvent inclure des troubles de la fonction sexuelle, des problèmes de dérivation urinaire ou des infections [9]. Heureusement, les techniques chirurgicales modernes ont considérablement réduit la fréquence de ces complications.
Certaines formes particulières présentent d'emblée des métastases, même en l'absence d'infiltration musculaire apparente [15]. Cette situation paradoxale souligne la complexité de cette pathologie et l'importance d'un bilan d'extension complet.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des tumeurs vésicales varie considérablement selon le stade et le grade au diagnostic [15,17]. Pour les tumeurs non infiltrantes de bas grade, le pronostic est excellent avec une survie à 5 ans supérieure à 95%. Ces formes évoluent lentement et répondent généralement bien aux traitements conservateurs.
Les tumeurs non infiltrantes de haut grade présentent un pronostic plus réservé en raison du risque de progression [15]. Malgré un traitement optimal, 15 à 25% d'entre elles évoluent vers une forme infiltrante dans les 5 ans. C'est pourquoi ces patients bénéficient d'une surveillance renforcée.
Pour les tumeurs infiltrantes localisées, la survie à 5 ans avoisine 70% après cystectomie radicale [17]. Ce pronostic s'améliore constamment grâce aux progrès chirurgicaux et aux traitements adjuvants. L'âge du patient et son état général influencent également les résultats.
Les formes métastatiques restent de pronostic plus sombre, avec une survie médiane de 12 à 15 mois [14]. Cependant, l'arrivée de l'immunothérapie transforme cette donne. Certains patients répondeurs peuvent désormais espérer des rémissions prolongées, voire des guérisons.
L'important à retenir, c'est que ces statistiques évoluent rapidement. Les innovations thérapeutiques de 2024-2025 laissent entrevoir des améliorations significatives du pronostic dans toutes les formes de la maladie [3,5].
Peut-on Prévenir les Tumeurs de la Vessie ?
La prévention primaire repose essentiellement sur l'éviction des facteurs de risque modifiables [16,17]. L'arrêt du tabac constitue la mesure la plus efficace, réduisant le risque de 30 à 50% après 10 ans de sevrage. Il n'est jamais trop tard pour arrêter, même après 60 ans.
En milieu professionnel, le respect des mesures de protection s'avère crucial [12]. Les travailleurs exposés aux substances chimiques cancérigènes doivent porter des équipements de protection individuelle et bénéficier d'une surveillance médicale renforcée. La déclaration en maladie professionnelle est possible dans certains cas.
L'hydratation abondante pourrait exercer un effet protecteur en diluant les substances toxiques et en réduisant leur temps de contact avec l'urothélium [17]. Boire au moins 1,5 litre d'eau par jour représente une mesure simple et accessible à tous.
Certaines études suggèrent un rôle protecteur de l'alimentation riche en fruits et légumes [17]. Les antioxydants qu'ils contiennent pourraient neutraliser les radicaux libres responsables des dommages cellulaires. Cependant, ces données restent à confirmer par des études plus larges.
Pour les patients déjà traités, la prévention secondaire vise à détecter précocement les récidives [10]. Le respect du calendrier de surveillance par cystoscopie est essentiel, même en l'absence de symptômes. Les nouveaux tests urinaires pourraient à l'avenir compléter cette surveillance.
Recommandations des Autorités de Santé
Les recommandations françaises s'alignent sur les guidelines européennes pour la prise en charge des tumeurs vésicales [2]. L'Assurance Maladie préconise une consultation urologique dans les 15 jours suivant la découverte d'une hématurie chez un patient à risque.
Le parcours de soins doit être coordonné entre le médecin traitant, l'urologue et l'oncologue selon la complexité du cas [2]. Cette approche multidisciplinaire attendut une prise en charge optimale et évite les retards diagnostiques ou thérapeutiques.
Concernant le suivi post-traitement, les autorités recommandent des cystoscopies régulières selon un calendrier précis [2]. Pour les tumeurs non infiltrantes, le rythme initial est trimestriel la première année, puis s'espace progressivement selon l'évolution.
Les innovations diagnostiques font l'objet d'évaluations continues par la Haute Autorité de Santé [10,11]. L'objectif est d'intégrer rapidement les outils les plus performants dans la pratique courante, tout en maîtrisant les coûts pour la collectivité.
En matière de prévention, Santé Publique France insiste sur la lutte antitabac et la surveillance des expositions professionnelles [1]. Des campagnes d'information ciblent particulièrement les secteurs à risque pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs.
Ressources et Associations de Patients
L'Association Française d'Urologie (AFU) propose des ressources documentaires actualisées pour les patients et leurs proches [17]. Leur site internet offre des fiches d'information détaillées sur les différents aspects de la pathologie et des traitements.
La Ligue contre le Cancer dispose d'un réseau national de comités départementaux qui proposent un accompagnement personnalisé [17]. Leurs services incluent le soutien psychologique, l'aide sociale et l'information sur les droits des patients.
Les groupes de parole permettent aux patients de partager leur expérience avec d'autres personnes confrontées à la même pathologie. Ces rencontres, souvent organisées dans les hôpitaux, créent des liens précieux et rompent l'isolement.
Sur internet, plusieurs forums spécialisés offrent un espace d'échange 24h/24 [17]. Attention cependant à vérifier la fiabilité des informations partagées et à toujours confirmer avec votre équipe médicale.
Les applications mobiles dédiées au suivi des patients cancéreux se multiplient. Elles permettent de noter les symptômes, de programmer les rendez-vous et de communiquer avec l'équipe soignante entre les consultations.
Nos Conseils Pratiques
Face à une hématurie, ne temporisez jamais. Même si elle disparaît spontanément, consultez rapidement votre médecin traitant qui vous orientera vers un urologue [2,16]. Cette démarche peut littéralement sauver des vies en permettant un diagnostic précoce.
Pendant les traitements, maintenez une hydratation abondante sauf contre-indication médicale [8]. Cela aide à éliminer les toxines et réduit les irritations vésicales. Évitez les boissons alcoolisées et les épices qui peuvent aggraver les symptômes.
Préparez vos consultations en notant vos questions à l'avance. N'hésitez pas à demander des explications si quelque chose vous échappe. Votre médecin est là pour vous informer et vous rassurer [17].
Organisez votre suivi médical en programmant les rendez-vous à l'avance [10]. Respectez scrupuleusement le calendrier de surveillance, même si vous vous sentez bien. La détection précoce des récidives améliore considérablement le pronostic.
Enfin, n'oubliez pas de prendre soin de votre bien-être psychologique. Cette pathologie génère naturellement de l'anxiété. Parlez-en à vos proches, consultez un psychologue si nécessaire, et n'hésitez pas à rejoindre des groupes de soutien [17].
Quand Consulter un Médecin ?
Toute hématurie, même minime ou transitoire, justifie une consultation médicale rapide [2,16]. Ce symptôme peut révéler une tumeur vésicale débutante, d'où l'importance de ne pas attendre qu'il s'aggrave ou se répète.
Les troubles urinaires persistants doivent également alerter, surtout chez les personnes à risque [17]. Une augmentation de la fréquence mictionnelle, des brûlures récidivantes ou une sensation de vidange incomplète méritent un avis spécialisé.
Chez les fumeurs de longue date ou les travailleurs exposés aux substances chimiques, un bilan urologique préventif peut être discuté avec le médecin traitant [12,16]. Cette démarche proactive permet parfois de détecter des lésions avant l'apparition des symptômes.
Pour les patients déjà traités, respectez impérativement le calendrier de surveillance [10]. Toute modification de vos habitudes urinaires entre deux contrôles doit motiver une consultation anticipée.
En cas de douleurs pelviennes inexpliquées, de fatigue inhabituelle ou d'amaigrissement, n'hésitez pas à consulter [17]. Ces signes peuvent témoigner d'une évolution de la maladie nécessitant une réévaluation thérapeutique.
Actes médicaux associés
Les actes CCAM suivants peuvent être pratiqués dans le cadre de Tumeurs de la vessie urinaire :
Questions Fréquentes
Les tumeurs de la vessie sont-elles toujours cancéreuses ?
La grande majorité des tumeurs vésicales sont effectivement malignes. Cependant, il existe de rares formes bénignes comme les papillomes. Seule l'analyse histologique après biopsie permet de déterminer avec certitude la nature de la lésion.
Peut-on guérir complètement d'une tumeur de la vessie ?
Oui, particulièrement pour les formes non infiltrantes diagnostiquées précocement. Le taux de guérison dépasse 95% pour les tumeurs de bas grade. Même les formes plus avancées peuvent obtenir une rémissiones grâce aux traitements modernes.
La BCG-thérapie est-elle douloureuse ?
Les instillations de BCG provoquent généralement des irritations vésicales temporaires. Ces effets secondaires, bien que désagréables, sont le signe que le traitement agit. Des médicaments peuvent soulager ces symptômes.
Faut-il arrêter de travailler pendant le traitement ?
Cela dépend de votre profession et du type de traitement. Beaucoup de patients continuent à travailler avec des aménagements d'horaires. Discutez-en avec votre médecin et votre médecin du travail.
Les innovations 2024-2025 sont-elles accessibles en France ?
Certaines innovations comme le TAR-200 sont en cours d'évaluation pour une autorisation européenne. D'autres sont disponibles dans le cadre d'essais cliniques. Votre oncologue peut vous informer sur les options disponibles.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Incidence des cancers chez les adolescents et jeunes adultes âgés de 15 à 39 ansLien
- [2] Évolutions épidémiologiques 2000-2020 des cancers urologiquesLien
- [3] Symptômes et diagnostic du cancer de la vessieLien
- [4] Cancer de la vessie : l'ère des grandes espérancesLien
- [5] Journées des innovations techniques en urologie 2024Lien
- [6] TAR-200 : taux élevé de survie sans maladie > 80%Lien
- [7] Étude ENVISION : essai clinique phase 3Lien
- [8] Étude clinique V940 et BCGLien
- [9] Réponse lymphocytaire BCG-spécifique dans la BCG-thérapieLien
- [10] Traitement chirurgical et immunothérapie BCGLien
- [11] Test Xpert® bladder cancer monitorLien
- [12] Intelligence artificielle en cytologie vésicaleLien
- [13] Aspects épidémiologiques des tumeurs de vessieLien
- [14] Apport de l'uroscanner en pathologie urinaireLien
- [15] Immunothérapie dans les tumeurs vésicalesLien
- [16] Tumeurs vésicales métastatiques d'embléeLien
- [17] Symptômes et diagnostic - Fondation ARCLien
- [18] Cancer de la vessie : symptômes et traitementsLien
Publications scientifiques
- … la réponse lymphocytaire BCG-spécifique sérique et urinaire au cours d'un traitement par BCG-thérapie dans la prise en charge des tumeurs de vessie n'infiltrant pas … (2024)
- Traitement chirurgical des tumeurs de la vessie urinaire et immunothérapeute du BCG. propres résultats (2023)
- Performances diagnostiques du test urinaire Xpert® bladder cancer monitor dans la surveillance des patients atteints de tumeurs de vessie n'infiltrant pas le muscle (2022)
- L'intelligence artificielle pour améliorer les performances de la cytologie dans le diagnostic du carcinome urothélial de la vessie résultats de l'étude prospective … (2023)2 citations
- Aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques des tumeurs de vessie au service d'urologie du CHU Kati. (2023)[PDF]
Ressources web
- Les symptômes et le diagnostic du cancer de la vessie (ameli.fr)
Le symptôme le plus évocateur du cancer de la vessie est la présence de sang dans les urines ou hématurie, qui peut toutefois être présente dans d'autres ...
- Cancers de la vessie : les symptômes et le diagnostic (fondation-arc.org)
10 févr. 2025 — Le principal symptôme lié au cancer de la vessie est l'hématurie, c'est-à-dire la présence de sang dans les urines. On le retrouve chez 90 % des ...
- Cancer de la vessie : Symptômes, traitements et espérance ... (elsan.care)
Quels sont les symptômes d'un cancer de la vessie plus avancé ? · Hématurie : présence de sang dans les urines, · Dysurie : douleur, sensation de brûlure ou de ...
- Diagnostic du cancer de la vessie (cancer.ca)
La présence de sang dans l'urine (hématurie) peut signifier qu'il y a un saignement dans les voies urinaires, qui pourrait être causé par un cancer.
- Cancer de la vessie - Troubles génito-urinaires (msdmanuals.com)
Le diagnostic repose sur une cystoscopie avec biopsies. Le traitement repose sur l'électrocoagulation, la résection transurétrale les instillations ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
