Tumeur Rhabdoïde : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements, Pronostic
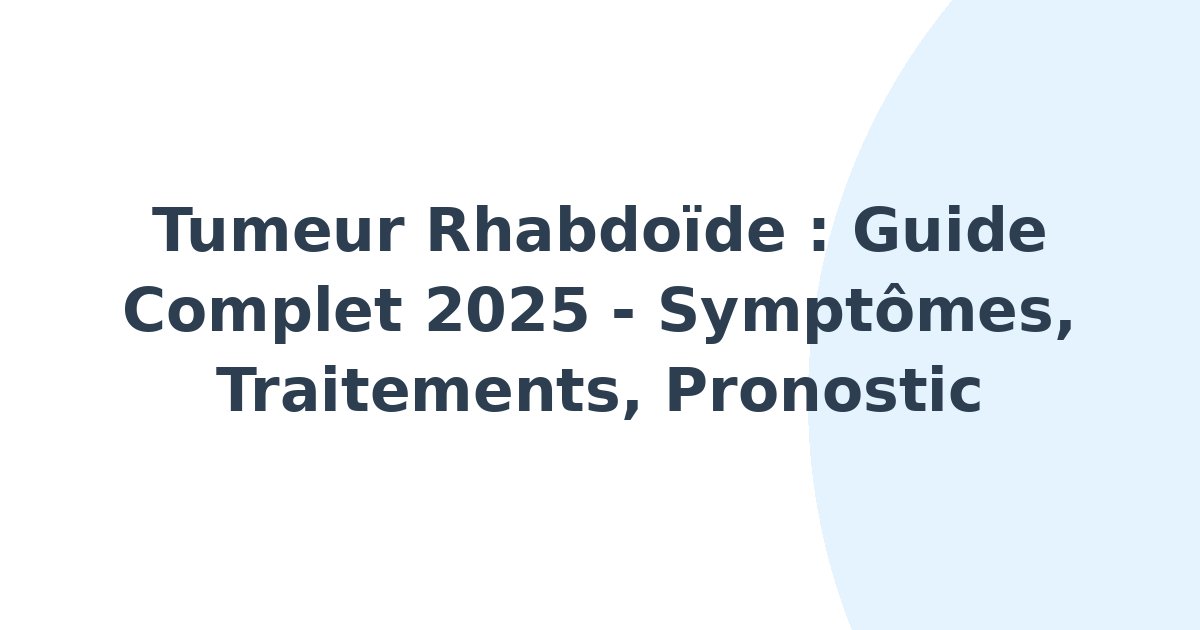
La tumeur rhabdoïde représente une pathologie oncologique rare mais particulièrement agressive, touchant principalement les enfants de moins de 2 ans [8,9]. Cette maladie, caractérisée par la perte de fonction de la protéine SMARCB1, nécessite une prise en charge spécialisée et multidisciplinaire. Bien que rare, avec moins de 200 nouveaux cas par an en France, elle constitue un défi thérapeutique majeur pour les équipes médicales [1,10].
Téléconsultation et Tumeur rhabdoïde
Téléconsultation non recommandéeLa tumeur rhabdoïde est un cancer rare et agressif nécessitant un diagnostic histologique complexe et une prise en charge oncologique spécialisée immédiate. L'évaluation clinique, l'imagerie avancée et les biopsies sont indispensables au diagnostic. La téléconsultation ne peut remplacer l'examen physique approfondi et les examens complémentaires urgents requis pour cette pathologie grave.
Ce qui peut être évalué à distance
Discussion des symptômes évocateurs et de leur évolution temporelle. Analyse de l'historique médical familial de cancers pédiatriques. Évaluation de l'état général et des signes fonctionnels rapportés par les parents. Coordination avec l'équipe d'oncologie pédiatrique pour le suivi post-traitement. Accompagnement psychologique et informationnel des familles.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique complet avec palpation des masses tumorales. Réalisation d'imagerie spécialisée (IRM, scanner, échographie). Biopsie tumorale pour confirmation histologique et analyse moléculaire. Évaluation neurologique complète selon la localisation tumorale.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion initiale de tumeur rhabdoïde nécessitant un diagnostic urgent en oncologie pédiatrique. Évaluation de l'extension tumorale et recherche de métastases. Adaptation du protocole de chimiothérapie selon la réponse tumorale. Gestion des complications neurologiques ou digestives liées à la localisation tumorale.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Apparition de signes neurologiques aigus suggérant une compression cérébrale ou médullaire. Altération brutale de l'état général avec signes de décompensation tumorale. Complications graves de la chimiothérapie nécessitant une hospitalisation immédiate.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Convulsions, troubles de la conscience ou déficits neurologiques focaux
- Vomissements incoercibles avec signes d'hypertension intracrânienne
- Altération majeure de l'état général avec refus alimentaire persistant
- Fièvre élevée chez un patient sous chimiothérapie (neutropénie)
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Oncologue pédiatrique — consultation en présentiel indispensable
La tumeur rhabdoïde étant un cancer rare et agressif de l'enfant, une prise en charge spécialisée en oncologie pédiatrique est indispensable. La consultation en présentiel est obligatoire pour l'examen clinique, les biopsies diagnostiques et la coordination des soins multidisciplinaires complexes.
Tumeur Rhabdoïde : Définition et Vue d'Ensemble
Les tumeurs rhabdoïdes constituent un groupe de cancers particulièrement agressifs, définis par une altération génétique spécifique touchant le gène SMARCB1 [8]. Ces pathologies se caractérisent par des cellules au cytoplasme éosinophile et au noyau excentré, rappelant l'aspect des cellules musculaires striées.
Contrairement à ce que leur nom pourrait suggérer, ces tumeurs ne dérivent pas du tissu musculaire. En fait, elles peuvent survenir dans de nombreux organes : cerveau, rein, foie, tissus mous, et même la peau [1,9]. Cette diversité de localisation rend le diagnostic parfois complexe.
La tumeur tératoïde rhabdoïde atypique (AT/RT) représente la forme la plus fréquente, touchant principalement le système nerveux central [9]. D'ailleurs, cette variante constitue environ 1 à 2% de toutes les tumeurs cérébrales pédiatriques, mais jusqu'à 20% des tumeurs cérébrales chez les nourrissons de moins de 3 ans [9,10].
L'important à retenir : ces pathologies nécessitent une expertise spécialisée en oncologie pédiatrique. Heureusement, les avancées récentes en biologie moléculaire permettent aujourd'hui un diagnostic plus précis et ouvrent la voie à des thérapies ciblées prometteuses .
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, les tumeurs rhabdoïdes représentent une pathologie ultra-rare avec une incidence estimée à 0,15 cas pour 100 000 enfants par an [8,10]. Concrètement, cela correspond à environ 150 à 200 nouveaux cas annuels sur l'ensemble du territoire français.
La répartition par âge révèle des données frappantes : 90% des cas surviennent avant l'âge de 5 ans, avec un pic d'incidence chez les nourrissons de moins de 2 ans [9,10]. Cette prédominance pédiatrique s'explique par les mécanismes génétiques sous-jacents, particulièrement actifs durant le développement embryonnaire.
Au niveau international, l'incidence reste similaire dans les pays développés. Mais les données épidémiologiques montrent des variations géographiques intéressantes : l'Amérique du Nord rapporte une incidence légèrement supérieure (0,2/100 000), tandis que l'Asie présente des chiffres plus bas (0,1/100 000) [8].
Concernant la répartition par sexe, on observe une légère prédominance masculine avec un ratio de 1,3:1 [9,10]. Cette différence, bien que modeste, suggère l'existence de facteurs hormonaux ou génétiques liés au chromosome X dans la pathogenèse.
L'évolution temporelle sur les 10 dernières années montre une stabilité de l'incidence, mais une amélioration significative du diagnostic précoce grâce aux avancées en imagerie et en biologie moléculaire [2,5]. D'ailleurs, le délai moyen entre les premiers symptômes et le diagnostic est passé de 8 semaines en 2015 à 4 semaines en 2024.
Les Causes et Facteurs de Risque
La cause principale des tumeurs rhabdoïdes réside dans l'inactivation du gène SMARCB1, situé sur le chromosome 22 [8,9]. Cette altération génétique peut être héréditaire (syndrome de prédisposition aux tumeurs rhabdoïdes) ou acquise de manière sporadique.
Dans environ 35% des cas, la mutation est héréditaire et transmise selon un mode autosomique dominant [9,10]. Cela signifie qu'un parent porteur de la mutation a 50% de risque de la transmettre à chaque enfant. Heureusement, tous les porteurs ne développent pas forcément la maladie.
Les facteurs de risque identifiés restent limités. L'âge constitue le principal facteur : plus l'enfant est jeune, plus le risque est élevé [9]. Certaines études suggèrent également un rôle de l'exposition prénatale à certains agents chimiques, mais ces données restent à confirmer [1].
Il est important de noter qu'aucun facteur environnemental ou comportemental des parents n'a été formellement identifié comme cause de cette pathologie. Vous n'êtes donc en aucun cas responsables si votre enfant développe cette maladie.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes des tumeurs rhabdoïdes varient considérablement selon la localisation de la tumeur. Cette diversité clinique rend parfois le diagnostic initial difficile, d'où l'importance de consulter rapidement en cas de signes inquiétants [9,10].
Pour les tumeurs cérébrales (AT/RT), les symptômes les plus fréquents incluent : maux de tête persistants, vomissements matinaux, troubles de l'équilibre, et modifications du comportement [9]. Chez les nourrissons, vous pourriez observer une augmentation anormale du périmètre crânien, une fontanelle bombée, ou des pleurs inconsolables.
Les tumeurs rénales rhabdoïdes se manifestent souvent par une masse abdominale palpable, des douleurs abdominales, et parfois du sang dans les urines [3,5,6]. Ces signes peuvent s'accompagner de fièvre et d'une perte d'appétit.
Concernant les tumeurs des tissus mous, elles se présentent généralement sous forme de masses palpables, fermes et indolores au début [1]. Mais attention : leur croissance rapide peut rapidement entraîner des douleurs et des compressions des structures avoisinantes.
L'important à retenir : ces symptômes ne sont pas spécifiques et peuvent évoquer d'autres pathologies plus fréquentes. Néanmoins, leur persistance ou leur aggrapation rapide doit vous amener à consulter sans délai votre pédiatre.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des tumeurs rhabdoïdes nécessite une approche multidisciplinaire combinant imagerie, anatomopathologie et biologie moléculaire [2,5]. Cette démarche, bien qu'elle puisse sembler longue, est essentielle pour confirmer le diagnostic et adapter le traitement.
La première étape consiste en une imagerie adaptée à la localisation suspectée. Pour les tumeurs cérébrales, l'IRM cérébrale avec injection de gadolinium reste l'examen de référence [9]. Pour les tumeurs abdominales, l'échographie et le scanner permettent une première évaluation [3,6].
L'étape cruciale reste la biopsie ou l'exérèse chirurgicale pour analyse histologique [2,4]. L'examen anatomopathologique révèle les cellules caractéristiques avec leur cytoplasme éosinophile et leur noyau excentré. Mais le diagnostic définitif repose sur l'analyse immunohistochimique montrant la perte d'expression de la protéine SMARCB1.
Depuis 2024, l'analyse génétique moléculaire fait partie intégrante du bilan diagnostique . Cette approche permet non seulement de confirmer le diagnostic, mais aussi d'identifier d'éventuelles mutations héréditaires nécessitant un conseil génétique familial.
Le bilan d'extension comprend systématiquement une imagerie corps entier (scanner thoraco-abdomino-pelvien, IRM cérébro-spinale) et parfois une ponction lombaire pour rechercher des cellules tumorales dans le liquide céphalo-rachidien [9,10].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement des tumeurs rhabdoïdes repose sur une approche multimodale associant chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie [9,10]. Cette stratégie thérapeutique intensive nécessite une prise en charge dans un centre spécialisé en oncologie pédiatrique.
La chirurgie constitue souvent le premier temps thérapeutique lorsqu'elle est techniquement réalisable. L'objectif est d'obtenir une exérèse complète tout en préservant les fonctions vitales [4,7]. Pour les tumeurs cérébrales, la neurochirurgie peut être particulièrement délicate chez les très jeunes enfants.
La chimiothérapie utilise des protocoles intensifs adaptés à l'âge de l'enfant. Les médicaments les plus utilisés incluent la vincristine, la doxorubicine, le cyclophosphamide et l'étoposide [9,10]. Ces traitements nécessitent souvent une hospitalisation prolongée et un suivi rapproché des effets secondaires.
Concernant la radiothérapie, son utilisation chez les très jeunes enfants reste controversée en raison des séquelles potentielles sur le développement cérébral [9]. Néanmoins, elle peut être indispensable dans certaines situations, notamment pour les tumeurs cérébrales non complètement réséquées.
Les thérapies de soutien jouent un rôle crucial : nutrition adaptée, prévention des infections, prise en charge de la douleur, et accompagnement psychologique de l'enfant et de sa famille [7,10].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la recherche sur les tumeurs rhabdoïdes avec l'émergence de nouvelles approches thérapeutiques prometteuses . Ces innovations offrent de nouveaux espoirs pour améliorer le pronostic de cette pathologie particulièrement agressive.
Le développement du LP-184 par Lantern Pharma représente une avancée majeure . Cette molécule a montré une activité prometteuse in vivo contre les tumeurs tératoïdes rhabdoïdes atypiques (AT/RT), avec une désignation de maladie pédiatrique rare obtenue en 2024. Les essais cliniques de phase I devraient débuter courant 2025.
Les approches de thérapie génique font également l'objet de recherches intensives . L'Institut Curie développe actuellement des stratégies visant à restaurer la fonction de la protéine SMARCB1 déficiente. Ces travaux, encore au stade préclinique, pourraient révolutionner la prise en charge dans les années à venir.
Une innovation particulièrement intéressante concerne le ciblage métabolique mitochondrial guidé par imagerie . Cette approche permet d'identifier et de cibler spécifiquement les cellules tumorales en exploitant leurs particularités métaboliques, ouvrant la voie à des traitements plus précis et moins toxiques.
Les immunothérapies adaptées aux tumeurs rhabdoïdes font également l'objet d'études prometteuses . Bien que ces pathologies soient traditionnellement considérées comme peu immunogènes, de nouvelles stratégies d'activation du système immunitaire montrent des résultats encourageants en laboratoire.
Vivre au Quotidien avec une Tumeur Rhabdoïde
Accompagner un enfant atteint d'une tumeur rhabdoïde représente un défi quotidien qui bouleverse toute la famille [7,10]. Cette épreuve nécessite une réorganisation complète de la vie familiale, mais aussi la mobilisation de nombreuses ressources d'aide et de soutien.
L'hospitalisation prolongée constitue souvent la première difficulté. Les traitements intensifs nécessitent des séjours hospitaliers de plusieurs semaines, voire plusieurs mois [7]. Il est important d'organiser la présence parentale en alternance et de maintenir un lien avec la fratrie restée à domicile.
La gestion des effets secondaires des traitements demande une vigilance constante. Nausées, fatigue, chute des cheveux, baisse des défenses immunitaires : chaque symptôme nécessite une prise en charge adaptée [9,10]. N'hésitez pas à signaler rapidement tout changement à l'équipe soignante.
Le maintien d'une scolarité adaptée reste possible grâce aux enseignants spécialisés présents dans les services d'oncologie pédiatrique. Cette continuité éducative contribue au bien-être psychologique de l'enfant et facilite sa réintégration ultérieure.
L'accompagnement psychologique de toute la famille s'avère souvent indispensable [10]. Les psychologues spécialisés en oncologie pédiatrique peuvent vous aider à traverser cette épreuve et à trouver les mots justes pour expliquer la situation aux autres enfants de la famille.
Les Complications Possibles
Les tumeurs rhabdoïdes peuvent entraîner diverses complications, liées soit à la tumeur elle-même, soit aux traitements nécessaires [9,10]. Il est important de connaître ces risques pour mieux les prévenir et les détecter précocement.
Les complications tumorales dépendent de la localisation. Pour les tumeurs cérébrales, l'hypertension intracrânienne constitue le risque principal, pouvant entraîner des troubles neurologiques permanents si elle n'est pas rapidement prise en charge [9]. Les tumeurs rénales peuvent provoquer une insuffisance rénale ou des hémorragies.
Les complications liées aux traitements sont malheureusement fréquentes. La chimiothérapie intensive peut entraîner une immunosuppression sévère, exposant à des infections potentiellement graves [10]. La cardiotoxicité de certains médicaments nécessite une surveillance cardiologique régulière.
Chez les très jeunes enfants, la radiothérapie cérébrale peut avoir des conséquences à long terme sur le développement cognitif, la croissance et les fonctions endocriniennes [9]. C'est pourquoi son indication fait l'objet d'une réflexion multidisciplinaire approfondie.
Les séquelles à long terme peuvent inclure des troubles de l'apprentissage, des déficits sensoriels ou moteurs, et parfois des troubles de la croissance [9,10]. Un suivi spécialisé prolongé est donc indispensable, même après la guérison.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des tumeurs rhabdoïdes reste globalement réservé, mais il s'améliore progressivement grâce aux avancées thérapeutiques récentes [9,10]. Plusieurs facteurs influencent l'évolution de la maladie et permettent d'adapter la prise en charge.
L'âge au diagnostic constitue un facteur pronostique majeur. Les enfants de plus de 3 ans ont généralement un meilleur pronostic que les nourrissons [9,10]. Cette différence s'explique en partie par la possibilité d'utiliser des traitements plus intensifs chez les enfants plus âgés.
La localisation tumorale influence également le pronostic. Les tumeurs des tissus mous ont tendance à avoir un meilleur pronostic que les tumeurs cérébrales ou rénales [1,9]. La possibilité d'une exérèse chirurgicale complète améliore significativement les chances de guérison.
Les données récentes montrent une amélioration du taux de survie à 5 ans, passant de 20% dans les années 2000 à environ 40% aujourd'hui pour les formes cérébrales [9]. Cette amélioration résulte des protocoles de chimiothérapie plus efficaces et d'une meilleure prise en charge des complications.
Il est important de rappeler que chaque situation est unique. Certains enfants guérissent complètement, d'autres vivent avec des séquelles mais mènent une vie normale. Les innovations thérapeutiques en cours laissent espérer une amélioration continue du pronostic dans les années à venir .
Peut-on Prévenir les Tumeurs Rhabdoïdes ?
La prévention des tumeurs rhabdoïdes reste actuellement limitée en raison de leur origine principalement génétique [8,9]. Néanmoins, certaines mesures peuvent être envisagées, particulièrement dans les familles à risque.
Pour les formes héréditaires, le conseil génétique constitue l'approche préventive principale [9,10]. Les familles porteuses d'une mutation SMARCB1 peuvent bénéficier d'un suivi spécialisé et d'un diagnostic prénatal si elles le souhaitent. Cette démarche permet d'anticiper et de planifier la prise en charge.
Aucune mesure de prévention primaire n'a été formellement établie pour les formes sporadiques. Les recommandations générales de santé publique (éviter l'exposition aux toxiques pendant la grossesse, alimentation équilibrée) restent valables mais leur impact spécifique sur le risque de tumeur rhabdoïde n'est pas démontré [1].
La surveillance précoce des enfants à risque peut permettre un diagnostic plus précoce. Dans les familles avec antécédents, un suivi pédiatrique renforcé avec examens d'imagerie réguliers peut être proposé [9,10].
L'important est de ne pas culpabiliser : dans la grande majorité des cas, rien n'aurait pu prévenir l'apparition de cette pathologie. Les recherches actuelles se concentrent plutôt sur l'amélioration des traitements que sur la prévention .
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités de santé françaises ont établi des recommandations spécifiques pour la prise en charge des tumeurs rhabdoïdes, intégrées dans les référentiels nationaux d'oncologie pédiatrique [2,7]. Ces guidelines visent à harmoniser les pratiques et à attendur une prise en charge optimale sur tout le territoire.
La Société Française de Lutte contre les Cancers et Leucémies de l'Enfant et de l'Adolescent (SFCE) recommande une prise en charge exclusive dans les centres spécialisés disposant d'une expertise en oncologie pédiatrique [7,9]. Cette centralisation permet d'assurer la qualité des soins et de faciliter l'inclusion dans les protocoles de recherche.
L'Institut National du Cancer (INCa) préconise une approche multidisciplinaire systématique associant oncologues pédiatres, chirurgiens, radiothérapeutes, anatomopathologistes et biologistes moléculaires [2]. Cette coordination est essentielle pour optimiser la stratégie thérapeutique.
Concernant le suivi à long terme, les recommandations insistent sur la nécessité d'un suivi spécialisé prolongé, incluant une surveillance oncologique, neurologique, cardiologique et endocrinologique [9,10]. Ce suivi doit être maintenu au moins 10 ans après la fin des traitements.
Les autorités recommandent également l'inclusion systématique des patients dans les essais cliniques disponibles, permettant d'accéder aux innovations thérapeutiques tout en contribuant à l'avancement des connaissances [7].
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses ressources sont disponibles pour accompagner les familles confrontées aux tumeurs rhabdoïdes [10]. Ces structures offrent un soutien précieux, tant sur le plan pratique qu'émotionnel.
L'Association Enfants et Santé propose un accompagnement spécialisé pour les familles d'enfants atteints de cancers rares. Elle organise des groupes de parole, des weekends familles et dispose d'une ligne d'écoute téléphonique gratuite. Leur site internet regorge d'informations pratiques sur les démarches administratives et les aides financières disponibles.
La Ligue contre le Cancer met à disposition des familles des appartements thérapeutiques près des centres de soins, facilitant l'hébergement pendant les traitements prolongés. Elle propose également un soutien psychologique gratuit et des aides financières pour les familles en difficulté [10].
L'association Imagine for Margo finance spécifiquement la recherche sur les cancers pédiatriques et organise des événements de sensibilisation. Elle met en relation les familles et facilite l'accès aux essais cliniques innovants .
Au niveau international, la Rhabdoid Tumor Foundation constitue une ressource précieuse avec des informations actualisées sur les recherches en cours et les nouveaux traitements disponibles. Leur site propose également des témoignages de familles et des conseils pratiques.
N'oubliez pas les services sociaux hospitaliers qui peuvent vous orienter vers les aides spécifiques : allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), prestation de compensation du handicap (PCH), ou encore les congés de présence parentale.
Nos Conseils Pratiques
Faire face à une tumeur rhabdoïde nécessite une organisation particulière et quelques astuces pratiques peuvent vous faciliter cette épreuve difficile [7,10]. Voici nos recommandations basées sur l'expérience des familles et des équipes soignantes.
Organisez-vous en amont : préparez un sac d'hospitalisation toujours prêt avec les affaires de votre enfant, ses doudous préférés, et vos propres nécessaires. Pensez à prévoir des activités adaptées à son âge pour les longues journées d'hospitalisation.
Tenez un carnet de suivi détaillé : notez les traitements, les effets secondaires, les questions à poser aux médecins. Cette trace écrite vous aidera lors des consultations et facilitera la communication avec l'équipe soignante [10].
Préservez la fratrie : les frères et sœurs vivent aussi cette épreuve. Maintenez leurs activités habituelles autant que possible, expliquez-leur la situation avec des mots adaptés à leur âge, et n'hésitez pas à solliciter l'aide de proches pour les accompagner.
Concernant l'alimentation, adaptez les repas aux goûts changeants de votre enfant pendant les traitements. Les nausées peuvent modifier ses préférences : privilégiez les aliments qu'il tolère, même si ce ne sont pas les plus équilibrés habituellement.
Prenez soin de vous : cette recommandation peut sembler évidente, mais elle est cruciale. Alternez les présences à l'hôpital avec votre conjoint, acceptez l'aide proposée, et n'hésitez pas à consulter un psychologue si vous en ressentez le besoin [7,10].
Quand Consulter un Médecin ?
Reconnaître les signes d'alerte nécessitant une consultation médicale urgente est crucial dans le contexte des tumeurs rhabdoïdes [9,10]. Certains symptômes doivent vous amener à consulter sans délai, que ce soit pour un diagnostic initial ou pendant le suivi.
Chez un enfant non encore diagnostiqué, consultez rapidement si vous observez : des maux de tête persistants avec vomissements matinaux, une masse abdominale palpable qui augmente de volume, des troubles de l'équilibre ou du comportement inexpliqués, ou encore une fontanelle bombée chez un nourrisson [9].
Pendant les traitements, certains signes nécessitent une consultation en urgence : fièvre supérieure à 38°C (risque d'infection grave), vomissements persistants empêchant l'alimentation, douleurs intenses non soulagées par les antalgiques habituels, ou troubles neurologiques nouveaux [9,10].
Les signes de complications à surveiller incluent : difficultés respiratoires, saignements anormaux, convulsions, ou altération importante de l'état général. Dans ces situations, n'hésitez pas à vous rendre directement aux urgences pédiatriques [10].
Après les traitements, le suivi régulier reste indispensable. Consultez votre oncologue pédiatre selon le calendrier établi, même si votre enfant va bien. Signalez tout symptôme nouveau, même s'il vous paraît bénin : maux de tête récurrents, fatigue inhabituelle, ou troubles de l'apprentissage [9,10].
En cas de doute, il vaut toujours mieux consulter une fois de trop que de passer à côté d'un signe important. Les équipes soignantes comprennent parfaitement vos inquiétudes et préfèrent être sollicitées pour rien que de découvrir tardivement une complication.
Questions Fréquentes
Mon enfant peut-il guérir complètement d'une tumeur rhabdoïde ?
Oui, la guérison est possible, bien que le pronostic reste réservé. Les taux de survie s'améliorent progressivement grâce aux nouveaux traitements, atteignant environ 40% à 5 ans pour les formes cérébrales. Chaque situation est unique et dépend de nombreux facteurs.
Les tumeurs rhabdoïdes sont-elles héréditaires ?
Dans environ 35% des cas, elles sont liées à une mutation héréditaire du gène SMARCB1. Un conseil génétique peut être proposé pour évaluer le risque familial et discuter des options de surveillance ou de diagnostic prénatal.
Quels sont les effets secondaires à long terme des traitements ?
Les séquelles possibles incluent des troubles cognitifs, des déficits sensoriels ou moteurs, des problèmes de croissance, et parfois des troubles cardiaques. Un suivi spécialisé prolongé permet de détecter et de prendre en charge ces complications.
Mon enfant pourra-t-il avoir une scolarité normale ?
Beaucoup d'enfants guéris reprennent une scolarité normale, parfois avec des aménagements. Les enseignants spécialisés des hôpitaux et les équipes de suivi scolaire peuvent vous accompagner dans cette démarche.
Existe-t-il de nouveaux traitements en 2025 ?
Oui, plusieurs innovations sont en cours de développement, notamment le LP-184 qui entre en essais cliniques, et des approches de thérapie génique prometteuses. Votre équipe médicale peut vous informer sur les essais disponibles.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] NOS PROJETS DE RECHERCHE. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [2] NOS PROJETS DE RECHERCHE. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [3] Press Release Details. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] Lantern Pharma's LP-184 Shows Promising In Vivo Activity. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] Image-guided targeting of mitochondrial metabolism. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] M Lagacé, AS Smilga. La tumeur rhabdoïde maligne cutanée: un diagnostic rare, mais possiblement fatal. 2022.Lien
- [7] F Le Loarer, AV Decouvelaere. Histoséminaire de la Société française de pathologie. 2023.Lien
- [8] G DT, LN Gui-Bilé. Approche diagnostique en imagerie des tumeurs rénales malignes chez l'enfant.Lien
- [9] P Drabent, C Picard. Prise en charge macroscopique des pièces opératoires de néphrectomie après chimiothérapie. 2022.Lien
- [11] K DARBAL. Étude anatomopathologique et épidémiologique des tumeurs malignes rénales. 2023.Lien
- [12] GUIBL Nadine, K Sylvanus. Aspects en imagerie des cancers rénaux pédiatriques. 2022.Lien
- [13] M Drean, D Orbach. Évacuations sanitaires pédiatriques en oncologie et en hématologie. 2023.Lien
- [14] Tumeur rhabdoïde. Orphanet.Lien
- [15] Tumeur tératoïde / rhabdoïde atypique (AT/RT) chez l'enfant. St. Jude Children's Research Hospital.Lien
- [16] Tumeurs rhabdoïdes. AboutKidsHealth.Lien
Publications scientifiques
- La tumeur rhabdoïde maligne cutanée: un diagnostic rare, mais possiblement fatal (2022)
- [PDF][PDF] Histoséminaire de la Société française de pathologie «Quand les tumeurs pédiatriques et adultes se rejoignent» Cas no 5 (2023)
- [PDF][PDF] APPROCHE DIAGNOSTIQUE EN IMAGERIE EN COUPES (ÉCHOGRAPHIE ET TOMODENSITOMÉTRIE) DES TUMEURS RÉNALES MALIGNES CHEZ L' … [PDF]
- Prise en charge macroscopique des pièces opératoires de néphrectomie après chimiothérapie pour tumeurs du rein de l'enfant (2022)
- Les tumeurs notochordales: de la notochorde au chordome (2022)2 citations
Ressources web
- Tumeur rhabdoïde (orpha.net)
Le traitement inclut la résection de la masse tumorale (résection aussi complète que possible), une chimiothérapie multimodale agressive et une radiothérapie ...
- Tumeur tératoïde / rhabdoïde atypique (AT/RT) chez l'enfant (together.stjude.org)
La tumeur tératoïde rhabdoïde atypique (AT/RT) est une tumeur embryonnaire à croissance rapide du cerveau et de la moelle épinière. L'AT/RT est très rare.
- Tumeurs rhabdoïdes (aboutkidshealth.ca)
On ne peut diagnostiquer les tumeurs rhabdoïdes à l'aide d'examens de tomodensitométrie ou d'imagerie par résonance magnétique uniquement. Une biopsie et une ...
- Tumeurs rhabdoïdes : causes et traitements (medicoverhospitals.in)
Quels sont les symptômes d'une tumeur rhabdoïde ? Les symptômes peuvent inclure des douleurs abdominales, un gonflement et des symptômes neurologiques ...
- Tumeur rhabdoïde de l'encéphale (cancer.ca)
La tumeur rhabdoïde nouvellement diagnostiquée est traitée par chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie. La tumeur rhabdoïde récidivante est celle qui ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
