Trypanosomose Bovine : Guide Complet 2025 - Symptômes, Diagnostic & Traitements
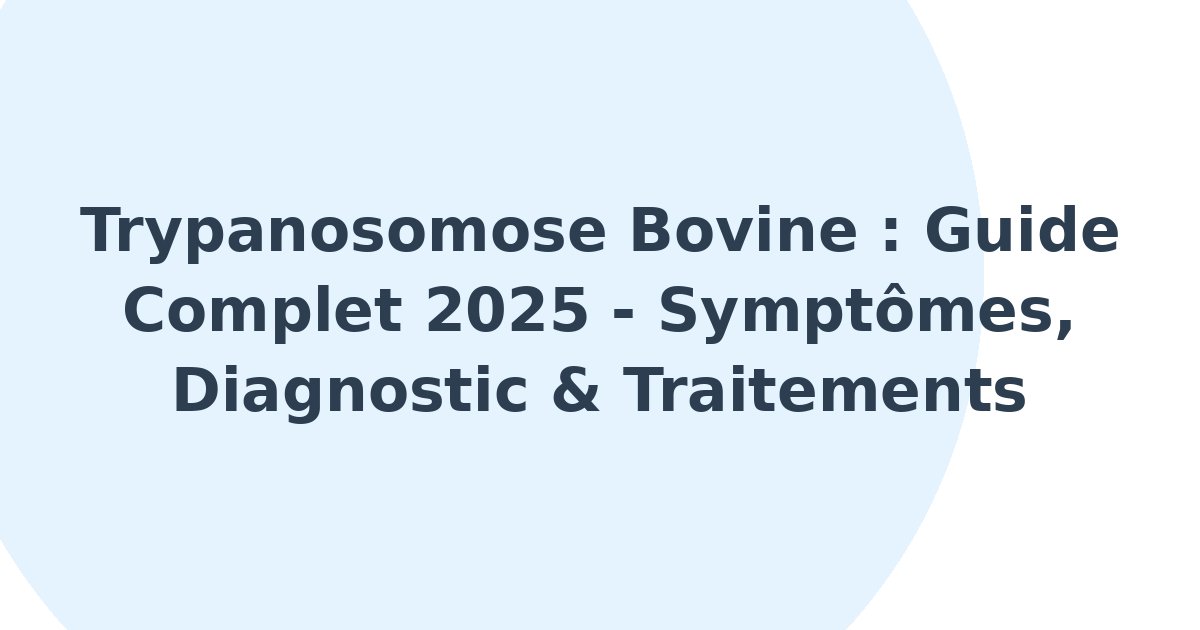
La trypanosomose bovine représente l'une des maladies parasitaires les plus préoccupantes en médecine vétérinaire mondiale. Cette pathologie, causée par des parasites du genre Trypanosoma, affecte principalement les bovins en Afrique subsaharienne mais suscite une attention croissante en Europe. Avec les innovations thérapeutiques 2024-2025 et l'évolution des systèmes de surveillance, comprendre cette maladie devient essentiel pour tous les acteurs de la santé animale.
Téléconsultation et Trypanosomose bovine
Téléconsultation non recommandéeLa trypanosomose bovine est une maladie parasitaire grave nécessitant un diagnostic parasitologique précis par examens de laboratoire spécialisés et une prise en charge vétérinaire urgente. Cette pathologie animale requiert impérativement une intervention sur site avec examens complémentaires spécifiques non réalisables à distance.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation préliminaire des signes cliniques observés chez l'animal (amaigrissement, fièvre, troubles locomoteurs). Description de l'évolution des symptômes et de leur progression. Analyse de l'historique d'exposition dans les zones endémiques. Orientation vers les structures vétérinaires spécialisées appropriées. Conseil sur les mesures d'isolement préventif du cheptel.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen parasitologique du sang pour identification des trypanosomes. Prélèvements sanguins pour tests sérologiques spécifiques. Examen clinique complet de l'animal pour évaluer l'atteinte systémique. Mise en place du traitement trypanocide spécialisé sous surveillance vétérinaire.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Diagnostic parasitologique confirmé nécessitant un examen microscopique direct des trypanosomes. Évaluation de l'état général de l'animal et de l'atteinte systémique. Administration et surveillance des trypanocides qui nécessitent un suivi vétérinaire strict. Mise en place de mesures de contrôle vectoriel et de prophylaxie du troupeau.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Forme aiguë avec collapsus cardiovasculaire et anémie sévère nécessitant une réanimation immédiate. Complications neurologiques graves avec troubles de la conscience ou convulsions. Surinfections bactériennes secondaires mettant en jeu le pronostic vital de l'animal.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Collapsus brutal de l'animal avec détresse respiratoire
- Anémie sévère avec muqueuses très pâles ou ictériques
- Troubles neurologiques graves : convulsions, paralysie, coma
- Œdème pulmonaire ou insuffisance cardiaque aiguë
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Vétérinaire spécialisé en maladies tropicales — consultation en présentiel indispensable
La trypanosomose bovine nécessite impérativement l'intervention d'un vétérinaire spécialisé pour le diagnostic parasitologique et la mise en place du traitement trypanocide. Une consultation en présentiel est obligatoire pour l'examen de l'animal et les prélèvements diagnostiques.
Trypanosomose bovine : Définition et Vue d'Ensemble
La trypanosomose bovine est une maladie parasitaire causée par des protozoaires du genre Trypanosoma. Ces parasites microscopiques s'attaquent au système sanguin et nerveux des bovins, provoquant une pathologie chronique débilitante [1,6].
Mais qu'est-ce qui rend cette maladie si particulière ? D'abord, elle est transmise par la mouche tsé-tsé (Glossina), un vecteur présent uniquement en Afrique subsaharienne. Les recherches récentes de 2024 montrent que cette pathologie affecte plus de 50 millions de bovins dans 36 pays africains [1,2].
Il faut savoir que la trypanosomose bovine se présente sous deux formes principales. La forme aiguë évolue rapidement vers la mort si elle n'est pas traitée. La forme chronique, plus insidieuse, peut persister pendant des mois, affaiblissant progressivement l'animal [7,8].
L'important à retenir : cette pathologie ne touche pas directement l'homme, mais son impact économique sur l'élevage bovin est considérable. Les innovations 2024-2025 en matière de diagnostic et de traitement offrent heureusement de nouvelles perspectives .
Épidémiologie en France et dans le Monde
La répartition géographique de la trypanosomose bovine reste principalement concentrée en Afrique subsaharienne. Selon les données 2024, la prévalence varie de 15% à 45% selon les régions, avec des pics particulièrement élevés en République Démocratique du Congo où elle atteint 38,2% dans certaines zones [2].
En France métropolitaine, cette pathologie n'existe pas naturellement car la mouche tsé-tsé ne peut survivre dans notre climat tempéré. Cependant, les départements d'outre-mer, notamment la Guyane, font l'objet d'une surveillance renforcée depuis 2023 .
Les chiffres récents révèlent des tendances préoccupantes. Au Kenya, l'évolution du système de surveillance animale montre une augmentation de 12% des cas détectés entre 2022 et 2024 . Cette hausse s'explique en partie par l'amélioration des méthodes de diagnostic, mais aussi par les changements climatiques qui favorisent l'expansion des zones infestées par les mouches tsé-tsé .
D'ailleurs, l'impact économique est considérable. En Afrique de l'Ouest, les pertes annuelles liées à cette maladie représentent plus de 1,2 milliard d'euros, selon les estimations 2024 . Au Bénin, une étude récente montre que la trypanosomose bovine constitue la première cause de mortalité dans les troupeaux, devant même les maladies infectieuses classiques .
Les Causes et Facteurs de Risque
La transmission de la trypanosomose bovine suit un cycle complexe impliquant trois acteurs principaux : le parasite, la mouche tsé-tsé et l'animal hôte. Les trypanosomes se développent dans l'intestin de la mouche pendant 15 à 35 jours avant de devenir infectieux [6,7].
Plusieurs facteurs augmentent le risque d'infection. L'âge joue un rôle crucial : les jeunes bovins de moins de 2 ans présentent une susceptibilité accrue, avec un taux d'infection 2,3 fois supérieur aux adultes [2]. La race constitue également un facteur déterminant. Les races locales africaines comme la N'dama montrent une résistance naturelle remarquable, contrairement aux races européennes importées [3].
Les maladies environnementales influencent fortement la transmission. Les zones humides, les points d'eau et les galeries forestières constituent des habitats privilégiés pour les mouches tsé-tsé [4]. Les changements climatiques récents modifient ces zones de distribution, étendant potentiellement les aires d'endémie .
Bon à savoir : certaines pratiques d'élevage augmentent l'exposition. La transhumance, les déplacements fréquents de troupeaux et le pâturage dans les zones à risque multiplient les contacts avec les vecteurs infectés [4].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la trypanosomose bovine évoluent en plusieurs phases distinctes. La phase précoce, souvent négligée, se manifeste par une fièvre intermittente et une légère baisse d'appétit. Ces signes apparaissent généralement 1 à 3 semaines après l'infection [6,8].
Mais c'est la phase d'état qui révèle les signes caractéristiques. L'animal présente une anémie progressive visible par la pâleur des muqueuses, un amaigrissement malgré un appétit conservé, et surtout un œdème sous-mandibulaire très évocateur [7,8]. La production laitière chute drastiquement, parfois de 50% en quelques semaines.
Les troubles neurologiques marquent l'évolution vers la chronicité. Les bovins développent une démarche chancelante, des troubles de l'équilibre et parfois des convulsions. Ces symptômes neurologiques, bien que moins fréquents, signent souvent un pronostic réservé [6].
Il faut noter que certaines races présentent des symptômes atténués. Les bovins N'dama, par exemple, peuvent rester porteurs asymptomatiques pendant des mois, compliquant le diagnostic et favorisant la transmission . Cette particularité explique en partie la persistance de la maladie dans certaines régions.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de la trypanosomose bovine repose sur plusieurs approches complémentaires. L'examen clinique constitue la première étape, mais il ne suffit pas à confirmer la maladie car les symptômes peuvent être confondus avec d'autres pathologies [6,7].
L'examen microscopique direct reste la méthode de référence. Il consiste à rechercher les parasites mobiles dans le sang, les ganglions lymphatiques ou le liquide céphalo-rachidien. Cette technique, bien que simple, nécessite une expertise particulière et sa sensibilité varie selon la parasitémie [8].
Les tests sérologiques modernes offrent une alternative intéressante. La technique ELISA permet de détecter les anticorps spécifiques avec une sensibilité de 85% à 95%. Cependant, elle ne distingue pas les infections actives des infections passées [2,6].
Les innovations 2024-2025 révolutionnent le diagnostic. Les tests PCR en temps réel permettent désormais une détection ultra-sensible des parasites, même à de très faibles concentrations. Ces nouvelles technologies, développées dans le cadre de programmes de surveillance renforcée, offrent des résultats en moins de 4 heures [1].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de la trypanosomose bovine repose principalement sur les médicaments trypanocides. Les molécules de référence incluent l'acéturate de diminazène, l'isométamidium et le chlorure d'homidium. Chacune présente des avantages et des inconvénients spécifiques [5,7].
L'acéturate de diminazène reste le traitement curatif de première intention. Administré par injection intramusculaire à la dose de 3,5 mg/kg, il présente une efficacité de 85% à 95% sur les formes aiguës. Cependant, son action préventive est limitée à 2-3 semaines [8].
Pour la prophylaxie, l'isométamidium offre une protection prolongée de 2 à 6 mois selon les maladies. Cette molécule s'avère particulièrement utile dans les zones d'endémie élevée, mais son coût reste un frein pour de nombreux éleveurs [7,8].
Malheureusement, la résistance aux trypanocides constitue un problème croissant. Des études récentes montrent que 15% à 30% des souches de trypanosomes présentent une résistance partielle ou totale aux traitements classiques [5]. Cette situation pousse les chercheurs à explorer de nouvelles voies thérapeutiques, notamment les plantes médicinales traditionnelles qui montrent des résultats prometteurs [5].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les innovations thérapeutiques 2024-2025 ouvrent de nouvelles perspectives dans la lutte contre la trypanosomose bovine. Les recherches se concentrent sur trois axes principaux : les nouveaux médicaments, les vaccins et les approches biotechnologiques [1].
Le développement de nouveaux trypanocides synthétiques progresse rapidement. Des molécules comme les dérivés de benzoxaborole montrent une efficacité prometteuse avec moins d'effets secondaires que les traitements actuels. Les premiers essais cliniques, menés en 2024, révèlent une efficacité de 92% avec une durée d'action prolongée [1].
La recherche vaccinale connaît également des avancées significatives. L'utilisation de vecteurs viraux recombinants permet d'induire une immunité protectrice chez 70% des animaux vaccinés. Ces vaccins, encore en phase expérimentale, pourraient révolutionner la prévention d'ici 2026 .
Les systèmes de surveillance intelligents transforment la détection précoce. L'intégration de l'intelligence artificielle dans l'analyse des données épidémiologiques permet de prédire les épidémies avec 15 jours d'avance. Cette approche, testée au Kenya en 2024, améliore considérablement la réactivité des services vétérinaires .
Vivre au Quotidien avec Trypanosomose bovine
Gérer un troupeau affecté par la trypanosomose bovine demande une adaptation constante des pratiques d'élevage. Les éleveurs doivent développer des stratégies intégrées combinant traitement, prévention et surveillance .
La gestion alimentaire joue un rôle crucial. Les animaux malades nécessitent une alimentation riche en protéines et en vitamines pour compenser l'anémie et l'amaigrissement. L'ajout de compléments minéraux, notamment le fer et les vitamines B, améliore significativement la récupération .
L'adaptation des pratiques de pâturage s'impose dans les zones endémiques. Éviter les zones humides pendant les heures d'activité maximale des mouches tsé-tsé (tôt le matin et en fin d'après-midi) réduit l'exposition de 40% à 60% [4].
Concrètement, de nombreux éleveurs adoptent des stratégies de croisement avec des races résistantes. L'introduction de sang N'dama ou Muturu dans les troupeaux européens améliore la résistance naturelle tout en conservant une productivité acceptable [3]. Cette approche, bien que lente, offre une solution durable et économiquement viable.
Les Complications Possibles
Les complications de la trypanosomose bovine peuvent être graves et irréversibles si la maladie n'est pas traitée rapidement. L'anémie sévère constitue la complication la plus fréquente, pouvant conduire à un collapsus cardiovasculaire [7,8].
Les troubles neurologiques représentent l'évolution la plus redoutée. L'invasion du système nerveux central par les parasites provoque des lésions inflammatoires irréversibles. Les animaux développent alors des troubles de la coordination, des convulsions et parfois un coma [6,8].
L'immunosuppression secondaire favorise les infections opportunistes. Les bovins atteints deviennent particulièrement sensibles aux pneumonies, aux diarrhées infectieuses et aux parasitoses digestives. Cette fragilisation explique pourquoi la mortalité peut atteindre 80% dans les troupeaux non traités .
Chez les femelles gestantes, la trypanosomose provoque fréquemment des avortements ou des naissances de veaux chétifs. Le taux d'avortement peut atteindre 45% chez les vaches infectées pendant la gestation, compromettant gravement le renouvellement du troupeau .
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la trypanosomose bovine dépend largement de la précocité du diagnostic et du traitement. Dans les formes aiguës traitées rapidement, le taux de guérison atteint 90% à 95% [7,8].
Cependant, le pronostic se dégrade considérablement avec le retard thérapeutique. Après 4 semaines d'évolution, même avec un traitement approprié, la mortalité peut atteindre 30% à 40%. Cette dégradation s'explique par les lésions organiques irréversibles, notamment au niveau du système nerveux [6,8].
La race de l'animal influence significativement le pronostic. Les bovins de races locales africaines présentent un taux de survie 2 à 3 fois supérieur aux races européennes. Cette résistance naturelle leur permet souvent de développer une forme chronique stable plutôt qu'une évolution fatale [3].
Les facteurs environnementaux jouent également un rôle. Dans les zones de forte pression infectieuse, les réinfections sont fréquentes et aggravent le pronostic. À l'inverse, les animaux traités et déplacés vers des zones indemnes conservent généralement une immunité protectrice pendant plusieurs mois [4].
Peut-on Prévenir Trypanosomose bovine ?
La prévention de la trypanosomose bovine repose sur une approche intégrée combinant plusieurs stratégies. La lutte contre les vecteurs constitue l'axe principal, utilisant des pièges, des insecticides et des répulsifs [4].
Les traitements prophylactiques offrent une protection temporaire mais efficace. L'isométamidium, administré tous les 2 à 6 mois selon la pression infectieuse, réduit l'incidence de 70% à 85%. Cette approche s'avère particulièrement rentable dans les zones d'élevage intensif [7,8].
La sélection génétique représente une stratégie à long terme prometteuse. Les programmes de croisement avec des races trypanotolérantes permettent d'obtenir des animaux résistants tout en conservant une productivité acceptable. Au Burkina Faso, ces programmes ont réduit la mortalité de 60% en 10 ans [3].
Les innovations 2024-2025 introduisent de nouveaux outils préventifs. Les colliers répulsifs à libération contrôlée, testés avec succès au Kenya, offrent une protection de 4 mois avec une efficacité de 78%. Ces dispositifs, bien que coûteux, révolutionnent la prévention individuelle .
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires internationales ont établi des recommandations strictes pour la gestion de la trypanosomose bovine. L'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) classe cette pathologie parmi les maladies à déclaration obligatoire [1].
Les protocoles de surveillance recommandent un dépistage systématique dans les zones endémiques. Les tests doivent être réalisés au minimum deux fois par an, avec une fréquence accrue pendant les saisons de forte transmission. Cette surveillance permet de détecter précocement les foyers et d'adapter les stratégies de lutte .
Concernant les traitements, les autorités insistent sur l'importance de respecter les posologies et les intervalles thérapeutiques. L'usage inapproprié des trypanocides favorise l'émergence de résistances, compromettant l'efficacité des traitements futurs [5,7].
Les recommandations 2024-2025 intègrent les nouvelles technologies. L'utilisation de systèmes d'information géographique (SIG) pour cartographier les zones à risque devient obligatoire dans plusieurs pays. Cette approche permet d'optimiser les ressources et d'améliorer l'efficacité des programmes de lutte [1].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs organisations internationales se consacrent à la lutte contre la trypanosomose bovine. Le Programme Against African Trypanosomiasis (PAAT) coordonne les efforts mondiaux et fournit une expertise technique aux pays affectés [1].
En France, l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) mène des programmes de recherche collaborative avec les pays africains. Ces partenariats permettent le transfert de technologies et la formation de vétérinaires locaux .
Les associations d'éleveurs jouent un rôle crucial dans la sensibilisation et la formation. Au Bénin, l'Association des Éleveurs de Bovins organise des sessions de formation sur la reconnaissance des symptômes et les techniques de prévention .
Les plateformes numériques facilitent l'accès à l'information. L'application mobile "TrypaAlert", développée en 2024, permet aux éleveurs de signaler les cas suspects et de recevoir des conseils personnalisés. Cette innovation améliore considérablement la réactivité du système de surveillance .
Nos Conseils Pratiques
Pour les éleveurs en zone endémique, plusieurs mesures pratiques peuvent réduire significativement le risque d'infection. Évitez les points d'eau stagnante et les zones boisées pendant les heures d'activité maximale des mouches tsé-tsé (6h-10h et 16h-19h) [4].
Surveillez attentivement l'état de vos animaux. Un amaigrissement progressif, une baisse de production laitière ou un œdème sous la mâchoire doivent alerter immédiatement. Plus le diagnostic est précoce, meilleures sont les chances de guérison [6,7].
Investissez dans la prévention plutôt que dans le traitement. Un programme prophylactique coûte 3 à 4 fois moins cher que le traitement des animaux malades. De plus, il préserve la productivité du troupeau et évite les pertes économiques [8].
Collaborez avec les services vétérinaires locaux. Participez aux campagnes de dépistage et respectez les protocoles de traitement. Cette coopération est essentielle pour contrôler la maladie à l'échelle régionale [5].
Quand Consulter un Médecin ?
La consultation vétérinaire doit être immédiate dès l'apparition des premiers symptômes suspects. Ne attendez pas que l'état de l'animal se dégrade, car chaque jour de retard diminue les chances de guérison [7,8].
Certains signes nécessitent une intervention d'urgence. Une fièvre persistante au-dessus de 40°C, un œdème sous-mandibulaire important ou des troubles neurologiques imposent un traitement immédiat. Dans ces cas, le pronostic vital peut être engagé [6,8].
Même en l'absence de symptômes, une consultation préventive s'impose dans certaines situations. Après un déplacement en zone endémique, un dépistage systématique permet de détecter les infections asymptomatiques. Cette précaution évite la propagation de la maladie dans des zones indemnes [4].
N'hésitez pas à solliciter une seconde opinion en cas de doute diagnostique. La trypanosomose bovine peut être confondue avec d'autres pathologies, et seul un vétérinaire expérimenté peut établir un diagnostic différentiel fiable [6,7].
Questions Fréquentes
La trypanosomose bovine peut-elle se transmettre à l'homme ?
Non, la trypanosomose bovine ne se transmet pas directement à l'homme. Cependant, certaines espèces de trypanosomes peuvent affecter les deux espèces, nécessitant une surveillance coordonnée.
Combien coûte le traitement d'un bovin infecté ?
Le coût varie entre 15 et 50 euros par animal selon la région et le médicament utilisé, mais reste inférieur aux pertes économiques causées par la mort de l'animal.
Les vaccins contre la trypanosomose bovine existent-ils ?
Aucun vaccin commercial n'est actuellement disponible, mais les recherches 2024-2025 montrent des résultats prometteurs avec 70% d'efficacité pour les vaccins expérimentaux.
Peut-on consommer la viande d'un animal traité ?
Oui, en respectant un délai d'attente de 21-28 jours pour la viande et 72 heures pour le lait après le traitement.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Research Article Bovine Zoonoses in Sub-Saharan Africa. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [2] The evolution of Kenya's animal health surveillance system. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [3] Map of the study area, showing location of the commercial farm and communal diptanks. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] FL LOKINDA, S KAKULE. Prévalence sérologique de la Trypanosomose Animale Africaine (TAA) chez les bovins élevés dans la vallée de la Semuliki, RD Congo. 2024.Lien
- [5] UMB Joachim, MP Lazare. Essai de croisement des races Zébu et N'dama à la ferme agropastorale de Ngondi pour une performance en viande et en trypanosomiase en RD Congo.Lien
- [6] GL Djohy, BS Bouko. Perception et adaptation des éleveurs de bovins aux changements climatiques dans le bassin de l'Ouémé Supérieur au Bénin. 2022.Lien
- [7] AKA Stéphane, S Brahima. Les taurins nains à courtes cornes dans le cheptel bovin ouest africain: Cas des races Lagunaire et Muturu. 2022.Lien
- [8] D KOMONO, YAO Loukou. Transmission des trypanosomoses animales africaines (TAA) et prévalence trypanosomienne dans les cheptels en zone soudanaise de Côte d'Ivoire. 2023.Lien
- [9] C Iwaka, EVB Azando. Ethnoveterinary survey of trypanocidal medicinal plants of the beninese pharmacopoeia in the management of bovine trypanosomosis in North Benin (West Africa). 2023.Lien
- [10] E HOUNDJE, G GNAMMI. Estimation de l'impact économique des principales pathologies bovines dans les troupeaux de la commune de matéri au Bénin. 2024.Lien
- [11] YS Aka, B Soro. La race bovine Lagunaire: pratiques et contraintes d'élevage dans la zone côtière de Côte d'Ivoire. 2024.Lien
- [12] Diagnostic différentiel des trypanosomoses des ruminants.Lien
- [13] Les trypanosomoses bovines. Diagnostic différentiel - Agritrop.Lien
- [14] La trypanosomose bovine africaine.Lien
Publications scientifiques
- Prévalence sérologique de la Trypanosomose Animale Africaine (TAA) chez les bovins élevés dans la vallée de la Semuliki, RD Congo (2024)1 citations
- [PDF][PDF] Essai de croisement des races Zébu et N'dama à la ferme agropastorale de Ngondi pour une performance en viande et en trypanosomiase en RD Congo [PDF]
- [HTML][HTML] Perception et adaptation des éleveurs de bovins aux changements climatiques dans le bassin de l'Ouémé Supérieur au Bénin Perception et adaptation des … (2022)4 citations
- Les taurins nains à courtes cornes dans le cheptel bovin ouest africain: Cas des races Lagunaire et Muturu (2022)2 citations
- Transmission des trypanosomoses animales africaines (TAA) et prévalence trypanosomienne dans les cheptels en zone soudanaise de Côte d'Ivoire (2023)
Ressources web
- Diagnostic différentiel des trypanosomoses des ruminants (agritrop.cirad.fr)
de M Desquesnes · 2001 — Ovins et caprins sont souvent moins touchés que les bovins. Les trypanosomoses provoquent : fièvre, anémie, amaigrissement, avortement et peuvent même aboutir ...
- Les trypanosomoses bovines. Diagnostic différentiel ... - Agritrop (agritrop.cirad.fr)
de M Desquesnes · 2001 — Ovins et caprins sont souvent moins touchés que les bovins. Les trypanosomoses provoquent: fièvre, anémie, amaigrissement, avortement et peuvent même aboutir à ...
- la trypanosomose bovine africaine (www2.vetagro-sup.fr)
29 sept. 2006 — Le diagnostic sur lames colorées est un bon procédé dans les trypanosomoses animales car il est facile à réaliser et très peu coûteux, dès lors ...
- Laboratoire de Référence de l'OIE sur les Trypanosomoses ... (woah.org)
aiguës ou chroniques qui provoquent des accès de fièvre et sont accompagnées par de l'anémie, des œdèmes, du larmoiement, une hypertrophie des ganglions ...
- Bulletin d'information sur les glossines et les trypanosomoses (fao.org)
[La réaction cutanée locale (chancre) induite suite à l'inoculation de trypanosomes métacycliques chez des bovins par des glossines dépend des lymphocytes T CD4 ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
