Trypanosomiase (Maladie du Sommeil) : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
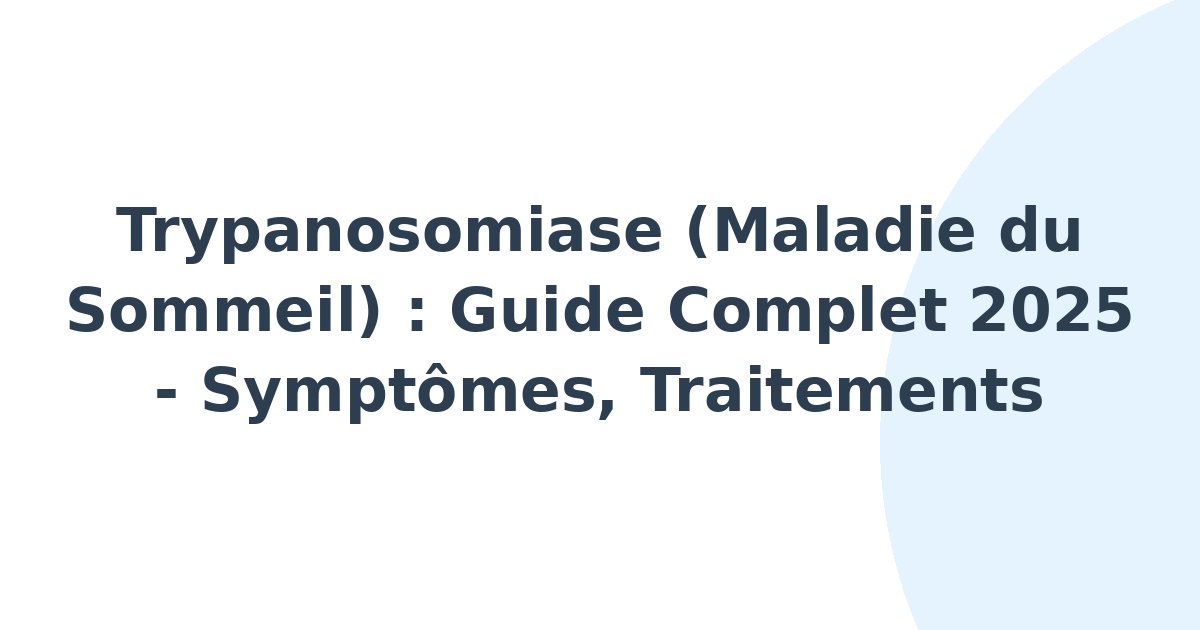
La trypanosomiase humaine africaine, plus connue sous le nom de maladie du sommeil, reste une pathologie tropicale négligée qui touche principalement l'Afrique subsaharienne. Bien que rare en France métropolitaine, cette maladie parasitaire transmise par la mouche tsé-tsé mérite votre attention, notamment si vous voyagez dans les zones endémiques. Heureusement, les avancées thérapeutiques récentes offrent de nouveaux espoirs de traitement.
Téléconsultation et Trypanosomiase
Téléconsultation non recommandéeLa trypanosomiase est une maladie parasitaire tropicale grave nécessitant un diagnostic spécialisé par identification microscopique du parasite et une prise en charge hospitalière urgente. Les examens complémentaires indispensables (ponction lombaire, examens sanguins spécialisés) et la surveillance étroite requise ne peuvent être réalisés à distance.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil de l'historique de voyage en zone d'endémie (Afrique subsaharienne), description des symptômes neurologiques et généraux, évaluation de l'évolution clinique, orientation vers une prise en charge spécialisée urgente, coordination avec les services de maladies infectieuses.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Identification microscopique du trypanosome dans le sang, la lymphe ou le liquide céphalorachidien, ponction lombaire pour déterminer le stade de la maladie, examens neurologiques spécialisés, surveillance cardiaque et rénale pendant le traitement spécifique.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion de trypanosomiase nécessitant une confirmation parasitologique urgente, troubles neurologiques progressifs nécessitant une ponction lombaire, signes de méningo-encéphalite parasitaire, besoin d'initier un traitement spécialisé (mélarsoprol, NECT, fexinidazole).
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Coma ou troubles de conscience sévères évoquant une méningo-encéphalite à trypanosomes, convulsions répétées, signes de défaillance cardiaque ou rénale liés au parasite ou au traitement.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Troubles de conscience, confusion sévère ou coma
- Convulsions ou crises épileptiques
- Troubles respiratoires ou cardiaques sévères
- Fièvre élevée persistante avec signes neurologiques
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Infectiologue — consultation en présentiel indispensable
La trypanosomiase nécessite une prise en charge spécialisée en maladies infectieuses et médecine tropicale pour le diagnostic parasitologique et l'administration de traitements spécifiques potentiellement toxiques nécessitant une surveillance hospitalière.
Trypanosomiase : Définition et Vue d'Ensemble
La trypanosomiase humaine africaine est une maladie parasitaire causée par des protozoaires du genre Trypanosoma. Ces parasites microscopiques sont transmis à l'homme par la piqûre de mouches tsé-tsé infectées [1].
Il existe deux formes principales de cette pathologie. D'abord, la forme gambiense, causée par Trypanosoma brucei gambiense, représente plus de 95% des cas rapportés [1]. Cette forme évolue lentement et peut passer inaperçue pendant des mois, voire des années. Ensuite, la forme rhodesiense, due à Trypanosoma brucei rhodesiense, progresse plus rapidement mais reste heureusement moins fréquente [12].
Concrètement, le parasite envahit progressivement votre système lymphatique, puis votre circulation sanguine. Sans traitement, il finit par franchir la barrière hémato-encéphalique et atteindre votre système nerveux central. C'est à ce stade que surviennent les troubles du sommeil caractéristiques qui donnent son nom à la maladie [13].
Bon à savoir : cette pathologie porte plusieurs noms selon les régions. En Afrique de l'Ouest, on l'appelle souvent "maladie du sommeil", tandis qu'en Afrique de l'Est, elle est parfois désignée sous le terme de "fièvre de la mouche tsé-tsé".
Épidémiologie en France et dans le Monde
L'épidémiologie de la trypanosomiase présente un contraste saisissant entre la France et les zones endémiques africaines. En France métropolitaine, cette pathologie reste exceptionnelle avec moins de 5 cas diagnostiqués annuellement, principalement chez des voyageurs de retour d'Afrique subsaharienne [1].
À l'échelle mondiale, l'Organisation mondiale de la santé rapporte une diminution spectaculaire des cas. De plus de 37 000 cas en 1998, nous sommes passés à moins de 1 000 cas déclarés en 2023 [1,9]. Cette baisse remarquable s'explique par l'intensification des programmes de lutte et l'amélioration des stratégies de dépistage [10].
Les pays les plus touchés restent la République démocratique du Congo, qui concentre environ 70% des cas mondiaux, suivie par l'Angola, le Soudan du Sud et la République centrafricaine [1]. D'ailleurs, le Tchad a récemment été déclaré exempt de trypanosomiase en tant que problème de santé publique en 2024 [9].
En termes de répartition par âge, la maladie touche principalement les adultes de 20 à 50 ans, avec une légère prédominance masculine dans certaines régions [6]. Les enfants représentent environ 15% des cas, mais leur diagnostic reste souvent plus difficile en raison de symptômes moins spécifiques.
Les Causes et Facteurs de Risque
La cause unique de la trypanosomiase humaine africaine est la transmission du parasite Trypanosoma brucei par la piqûre d'une mouche tsé-tsé infectée. Ces mouches, du genre Glossina, vivent exclusivement en Afrique subsaharienne dans une zone délimitée par les isothermes de 10°C [1,12].
Plusieurs facteurs augmentent votre risque d'exposition. Les activités professionnelles en zone rurale, comme l'agriculture, l'élevage ou la pêche, constituent le principal facteur de risque [8]. Les voyageurs qui pratiquent le tourisme d'aventure, la chasse ou les safaris dans les parcs nationaux africains présentent également un risque accru [12].
Il faut savoir que toutes les mouches tsé-tsé ne sont pas infectées. En réalité, moins de 1% d'entre elles portent le parasite dans la plupart des régions endémiques [1]. Cependant, une seule piqûre d'une mouche infectée suffit pour transmettre la maladie.
Contrairement à d'autres maladies tropicales, la trypanosomiase ne se transmet pas d'homme à homme par contact direct. La transmission mère-enfant reste exceptionnelle, bien que quelques cas aient été rapportés dans la littérature médicale [13].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la trypanosomiase évoluent en deux phases distinctes, et leur reconnaissance précoce peut faire toute la différence pour votre pronostic. La première phase, dite lymphatico-sanguine, débute généralement 1 à 3 semaines après la piqûre infectante [12].
Vous pourriez d'abord remarquer l'apparition d'un chancre trypanosomien au site de piqûre. Cette lésion cutanée, rouge et douloureuse, mesure généralement 2 à 5 centimètres de diamètre [6]. Mais attention, ce chancre n'apparaît que chez 50% des patients et peut facilement passer inaperçu.
Les symptômes généraux de cette première phase ressemblent à ceux d'une grippe : fièvre intermittente, maux de tête, douleurs articulaires et musculaires [12,13]. Vous pouvez également développer des adénopathies, particulièrement au niveau du cou. Ces ganglions enflés constituent d'ailleurs un signe caractéristique de la maladie [1].
La seconde phase, neurologique, survient après plusieurs mois ou années d'évolution. C'est à ce stade que se manifestent les troubles du sommeil qui donnent son nom à la pathologie [13]. Vous pourriez ressentir une somnolence diurne excessive, des troubles de l'humeur, des difficultés de concentration, voire des convulsions dans les cas avancés [7].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de la trypanosomiase repose sur plusieurs examens complémentaires, car aucun test unique ne permet de confirmer la maladie avec certitude. Votre médecin commencera par un interrogatoire détaillé sur vos antécédents de voyage en zone endémique [12].
L'examen clinique recherche les signes caractéristiques : adénopathies cervicales, chancre cutané, fièvre intermittente. Le signe de Winterbottom, correspondant à des ganglions enflés dans le triangle cervical postérieur, reste pathognomonique de la maladie [13].
Les examens biologiques incluent d'abord la recherche directe du parasite. L'examen microscopique du sang, de la lymphe ganglionnaire ou du liquide céphalorachidien peut révéler la présence de trypanosomes mobiles [1]. Cependant, cette méthode manque souvent de sensibilité, particulièrement en phase chronique.
Les tests sérologiques, comme le CATT (Card Agglutination Test for Trypanosomiasis), constituent des outils de dépistage précieux [12]. Plus récemment, les techniques de biologie moléculaire par PCR offrent une sensibilité et une spécificité supérieures [4]. D'ailleurs, l'imagerie cérébrale par IRM peut révéler des anomalies caractéristiques en phase neurologique [7].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de la trypanosomiase a considérablement évolué ces dernières années, avec l'abandon progressif des thérapies toxiques au profit de molécules mieux tolérées. Le choix thérapeutique dépend principalement de la forme de la maladie et du stade d'évolution [1].
Pour la forme gambiense en première phase, la pentamidine reste le traitement de référence. Cette molécule, administrée par voie intramusculaire pendant 7 jours, présente une efficacité de plus de 95% [12]. Cependant, elle peut provoquer des effets secondaires comme des douleurs au site d'injection et des troubles glycémiques.
La révolution thérapeutique récente concerne le fexinidazole, premier traitement oral de la trypanosomiase approuvé en 2018 [4]. Cette molécule présente l'avantage majeur d'être active sur les deux phases de la maladie gambiense. Le traitement consiste en une prise quotidienne pendant 10 jours, ce qui simplifie considérablement la prise en charge [5].
Pour la forme rhodesiense, plus agressive, le traitement repose encore sur la suramine en première phase et l'association mélarsoprol-prednisolone en phase neurologique [13]. Ces traitements restent plus lourds et nécessitent une hospitalisation prolongée.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque une période d'innovation majeure dans la prise en charge de la trypanosomiase. Les recherches actuelles se concentrent sur l'optimisation des protocoles thérapeutiques et le développement de nouvelles approches diagnostiques [2,3].
Une étude récente menée en Guinée évalue la faisabilité du traitement oral par fexinidazole dans les communautés rurales [5]. Cette recherche révèle que l'administration communautaire du médicament pourrait révolutionner la prise en charge, particulièrement dans les zones reculées où l'accès aux soins reste limité.
Les innovations diagnostiques progressent également. L'UMR Intertryp développe actuellement de nouveaux outils de diagnostic rapide basés sur la détection d'antigènes spécifiques [3]. Ces tests pourraient permettre un diagnostic en moins de 30 minutes, contre plusieurs heures actuellement.
En parallèle, les stratégies de lutte vectorielle évoluent. Une expérimentation récente dans la province du Sankuru en République démocratique du Congo teste de nouveaux pièges à glossines plus efficaces [8]. Ces dispositifs innovants pourraient réduire significativement la transmission de la maladie.
L'imagerie médicale apporte aussi sa contribution. Des cas récents documentent des aspects inhabituels à l'IRM cérébrale, permettant d'affiner les critères diagnostiques de la phase neurologique [7]. Ces avancées facilitent la détection précoce des atteintes du système nerveux central.
Vivre au Quotidien avec Trypanosomiase
Vivre avec une trypanosomiase diagnostiquée nécessite une adaptation de votre mode de vie, mais rassurez-vous, un traitement précoce offre d'excellentes perspectives de guérison. La prise en charge moderne permet à la plupart des patients de retrouver une vie normale [4].
Pendant le traitement, vous devrez probablement adapter votre rythme de vie. Les effets secondaires des médicaments, comme la fatigue ou les troubles digestifs, peuvent temporairement limiter vos activités. Il est important de maintenir une alimentation équilibrée et de vous reposer suffisamment [5].
Le suivi médical régulier constitue un élément essentiel de votre prise en charge. Votre médecin programmera des consultations de contrôle pour évaluer l'efficacité du traitement et dépister d'éventuelles complications. Ces rendez-vous incluent généralement des examens sanguins et parfois une ponction lombaire [12].
Sur le plan psychologique, il est normal de ressentir de l'anxiété face à cette maladie méconnue. N'hésitez pas à exprimer vos inquiétudes à votre équipe soignante. Le soutien de vos proches joue également un rôle crucial dans votre rétablissement.
Les Complications Possibles
Les complications de la trypanosomiase surviennent principalement en l'absence de traitement ou en cas de diagnostic tardif. La progression vers la phase neurologique constitue la complication la plus redoutable de cette pathologie [13].
Au niveau du système nerveux central, l'invasion parasitaire peut provoquer des troubles cognitifs progressifs, des changements de personnalité et des troubles psychiatriques [7]. Les patients peuvent développer une apathie marquée, des troubles de la mémoire, voire des épisodes psychotiques dans les cas les plus sévères.
Les complications cardiaques, bien que moins fréquentes, méritent votre attention. Le parasite peut provoquer une myocardite avec troubles du rythme cardiaque [12]. Ces atteintes cardiaques expliquent en partie la mortalité associée à la maladie non traitée.
D'autres complications peuvent survenir : troubles endocriniens avec dysfonctionnement thyroïdien, atteintes hépatiques, troubles de la coagulation [13]. Heureusement, un traitement précoce et adapté prévient efficacement la survenue de ces complications graves.
Il faut également mentionner les complications liées aux anciens traitements, particulièrement l'encéphalopathie arsenicale due au mélarsoprol. Cette complication, potentiellement mortelle, justifie l'abandon progressif de cette molécule au profit du fexinidazole [4].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la trypanosomiase dépend essentiellement de la précocité du diagnostic et de la mise en route du traitement. Avec les thérapeutiques modernes, le taux de guérison dépasse 95% pour les formes diagnostiquées en phase précoce [4,5].
Pour la forme gambiense traitée en première phase, la guérison est obtenue dans plus de 98% des cas avec la pentamidine ou le fexinidazole [1]. Le pronostic reste excellent même en phase neurologique, avec des taux de guérison supérieurs à 90% grâce aux nouveaux protocoles thérapeutiques.
La forme rhodesiense présente un pronostic plus réservé en raison de son évolution plus rapide. Cependant, un traitement précoce permet d'obtenir la guérison dans 85 à 90% des cas [13]. Le délai entre l'apparition des symptômes et le début du traitement constitue le facteur pronostique le plus important.
Après guérison, le risque de rechute reste faible, inférieur à 2% avec les traitements actuels [4]. La surveillance post-thérapeutique, recommandée pendant 24 mois, permet de détecter précocement d'éventuelles récidives.
L'important à retenir : un diagnostic précoce et un traitement adapté offrent d'excellentes perspectives de guérison complète. Les séquelles neurologiques permanentes sont devenues exceptionnelles avec les protocoles thérapeutiques modernes.
Peut-on Prévenir Trypanosomiase ?
La prévention de la trypanosomiase repose principalement sur la protection contre les piqûres de mouches tsé-tsé lors de séjours en zone endémique. Contrairement au paludisme, il n'existe pas de chimioprophylaxie efficace contre cette pathologie [12].
Les mesures de protection individuelle constituent votre première ligne de défense. Portez des vêtements longs de couleur claire, car les mouches tsé-tsé sont attirées par les couleurs sombres et brillantes [1]. Les répulsifs cutanés contenant du DEET à concentration élevée (30-50%) offrent une protection efficace pendant plusieurs heures.
Évitez les zones à risque élevé, particulièrement les abords des points d'eau et les zones boisées où prolifèrent les mouches tsé-tsé [12]. Si votre activité vous oblige à fréquenter ces zones, planifiez vos déplacements aux heures les moins favorables à l'activité des mouches, généralement tôt le matin ou en fin de journée.
À l'échelle collective, les programmes de lutte vectorielle montrent leur efficacité. L'utilisation de pièges à mouches, l'épandage d'insecticides ciblés et les techniques de lâchers d'insectes stériles contribuent à réduire les populations de glossines [8].
Pour les voyageurs, une consultation en médecine des voyages avant le départ permet d'évaluer les risques spécifiques à votre destination et d'adapter les mesures préventives. N'oubliez pas de signaler tout symptôme suspect à votre retour de voyage [13].
Recommandations des Autorités de Santé
L'Organisation mondiale de la santé a établi des recommandations précises pour la prise en charge de la trypanosomiase, régulièrement mises à jour en fonction des avancées thérapeutiques [1]. Ces guidelines constituent la référence internationale pour les professionnels de santé.
L'OMS recommande désormais le fexinidazole comme traitement de première intention pour la trypanosomiase gambiense, toutes phases confondues [4]. Cette recommandation, émise en 2019 et confirmée en 2024, simplifie considérablement les protocoles thérapeutiques.
Concernant le diagnostic, les autorités sanitaires préconisent une approche en deux étapes : dépistage sérologique suivi de confirmation parasitologique [1]. Cette stratégie permet d'optimiser le rapport coût-efficacité des programmes de lutte tout en maintenant une sensibilité diagnostique élevée.
En France, la Haute Autorité de Santé recommande une vigilance particulière pour les voyageurs de retour de zone endémique présentant des symptômes évocateurs [12]. Le diagnostic doit être évoqué devant toute fièvre inexpliquée chez un patient ayant séjourné en Afrique subsaharienne.
Les recommandations insistent également sur l'importance de la déclaration obligatoire des cas diagnostiqués. Cette surveillance épidémiologique permet de suivre l'évolution de la maladie et d'adapter les stratégies de lutte [10]. D'ailleurs, l'objectif d'élimination de la trypanosomiase comme problème de santé publique d'ici 2030 reste maintenu par l'OMS [11].
Ressources et Associations de Patients
Bien que la trypanosomiase reste une maladie rare en France, plusieurs ressources peuvent vous accompagner dans votre parcours de soins. Les centres de référence en médecine tropicale constituent votre premier recours pour une prise en charge spécialisée [12].
L'Institut Pasteur dispose d'un centre de consultations spécialisé en pathologies tropicales qui peut vous orienter et vous conseiller [12]. Ces experts possèdent une expérience unique dans le diagnostic et le traitement des maladies tropicales négligées.
Au niveau international, l'organisation Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) mène des recherches actives sur la trypanosomiase [2]. Leur site internet propose des informations actualisées sur les avancées thérapeutiques et les essais cliniques en cours.
Pour les professionnels de santé, la Société de pathologie exotique offre des formations continues et des recommandations pratiques. Cette société savante publie régulièrement des mises au point sur les maladies tropicales, incluant la trypanosomiase.
Les voyageurs peuvent consulter les recommandations du ministère des Affaires étrangères et du Centre de conseil médical aux voyageurs. Ces organismes fournissent des informations actualisées sur les risques sanitaires par pays et les mesures préventives recommandées.
Nos Conseils Pratiques
Face à la trypanosomiase, quelques conseils pratiques peuvent faire la différence entre un diagnostic précoce et une évolution compliquée. Votre vigilance constitue le premier maillon de la chaîne de soins [12].
Avant tout voyage en zone endémique, documentez-vous sur les risques spécifiques de votre destination. Consultez les cartes de répartition de la maladie et adaptez votre itinéraire si possible. Emportez systématiquement un répulsif efficace et des vêtements de protection adaptés [1].
Pendant votre séjour, restez vigilant face aux symptômes évocateurs. Toute fièvre, fatigue inhabituelle ou gonflement ganglionnaire doit vous alerter. Photographiez toute lésion cutanée suspecte, cela pourra aider votre médecin au diagnostic [6].
Au retour de voyage, consultez rapidement en cas de symptômes, même plusieurs mois après votre retour. Mentionnez systématiquement vos antécédents de voyage à tout professionnel de santé que vous consultez. Cette information peut orienter le diagnostic vers des pathologies rares comme la trypanosomiase [13].
Si le diagnostic est confirmé, suivez scrupuleusement votre traitement et respectez les rendez-vous de suivi. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à votre équipe soignante. Une bonne compréhension de votre maladie favorise l'adhésion thérapeutique et améliore le pronostic.
Quand Consulter un Médecin ?
Savoir quand consulter peut littéralement vous sauver la vie en cas de trypanosomiase. Cette pathologie nécessite une prise en charge médicale urgente dès l'apparition des premiers symptômes [12].
Consultez immédiatement si vous développez une fièvre dans les semaines suivant un retour de zone endémique. Cette fièvre peut être intermittente et s'accompagner de frissons, maux de tête et douleurs musculaires [13]. N'attendez pas que les symptômes s'aggravent.
L'apparition d'une lésion cutanée au site d'une piqûre d'insecte constitue également un motif de consultation urgent. Ce chancre trypanosomien, bien que non systématique, peut orienter précocement le diagnostic [6]. Même si la lésion semble bénigne, elle mérite une évaluation médicale.
Les troubles du sommeil, la somnolence diurne excessive ou les changements de comportement chez un patient ayant voyagé en Afrique subsaharienne imposent une consultation spécialisée [7]. Ces symptômes peuvent témoigner d'une atteinte neurologique nécessitant un traitement urgent.
En cas de doute, privilégiez toujours la consultation. Les services d'urgence des hôpitaux disposent généralement de protocoles pour la prise en charge des pathologies tropicales. Mentionnez systématiquement vos antécédents de voyage dès l'accueil [1].
Questions Fréquentes
La trypanosomiase est-elle contagieuse ?
Non, la trypanosomiase ne se transmet pas d'homme à homme par contact direct. La transmission nécessite obligatoirement la piqûre d'une mouche tsé-tsé infectée.
Peut-on attraper la maladie du sommeil en France ?
Il est impossible de contracter la trypanosomiase en France métropolitaine car les mouches tsé-tsé n'y vivent pas. Tous les cas diagnostiqués en France concernent des voyageurs de retour d'Afrique.
Combien de temps dure le traitement ?
Le traitement par fexinidazole dure 10 jours pour la forme gambiense. Les anciens traitements nécessitaient parfois plusieurs semaines d'hospitalisation.
Y a-t-il des séquelles après guérison ?
Avec les traitements modernes et un diagnostic précoce, les séquelles sont exceptionnelles. Plus de 95% des patients guérissent complètement sans séquelles.
Faut-il éviter certaines destinations ?
Les zones rurales d'Afrique centrale et occidentale présentent le risque le plus élevé. Consultez les recommandations actualisées avant tout voyage en Afrique subsaharienne.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil). Organisation mondiale de la santé.Lien
- [2] Plateforme THA Bulletin d'information N°23. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [3] UMR Intertryp. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] Effectiveness and safety of fexinidazole for gambiense human African trypanosomiasis. PMC, 2024.Lien
- [7] Camara ML, Kagbadouno M. Traitement oral de la trypanosomiase humaine africaine: faisabilité dans les communautés du littoral Guinéen. Santé Publique, 2025.Lien
- [8] Kourouma A, Camara M. Manifestations cutanées de la trypanosomiase humaine africaine gambiense. Santé Publique, 2025.Lien
- [9] Moussavou C, Imoumby FN. Aspect inhabituel de l'IRM dans la Trypanosomiase humaine africaine: à propos d'un cas. Science Direct, 2025.Lien
- [10] Tshijik K, Atila DW. Expérimentation d'un Nouveau Piège à Glossines dans les Zones Endémiques à la Trypanosomiase Humaine Africaine. Core, 2024.Lien
- [11] Organisation mondiale de la Santé. Human African trypanosomiasis eliminated as a public health problem in Chad. WHO, 2024.Lien
- [13] Soro DM, Elodie CMA. Active Dépistage actif vers dépistage passif de la Trypanosomiase Humaine Africaine en Côte d'Ivoire. RASP, 2022.Lien
- [14] Organisation mondiale de la Santé. Elimination of human African trypanosomiasis as public health problem. Weekly Epidemiological Record, 2022.Lien
- [15] Maladie du sommeil : symptômes, traitement, prévention. Institut Pasteur.Lien
- [16] Trypanosomiase africaine - Maladies infectieuses. MSD Manuals.Lien
Publications scientifiques
- Traitement oral de la trypanosomiase humaine africaine: faisabilité dans les communautés du littoral Guinéen (2025)
- Manifestations cutanées de la trypanosomiase humaine africaine gambiense (THA) (2025)
- Aspect inhabituel de l'IRM dans la Trypanosomiase humaine africaine: à propos d'un cas (2025)
- [PDF][PDF] Expérimentation d'un Nouveau Piège à Glossines dans les Zones Endémiques à la Trypanosomiase Humaine Africaine de la Province du Sankuru en … (2024)[PDF]
- Human African trypanosomiasis eliminated as a public health problem in Chad= La trypanosomiase humaine africaine éliminée en tant que problème de santé … (2024)
Ressources web
- Maladie du sommeil : symptômes, traitement, prévention (pasteur.fr)
La maladie du sommeil, aussi appelée trypanosomose humaine africaine, est due à la présence d'un parasite flagellé (Trypanosoma brucei), injecté dans ...
- Trypanosomiase africaine - Maladies infectieuses (msdmanuals.com)
Les symptômes comprennent des lésions cutanées caractéristiques, une fièvre intermittente, des céphalées, des frissons, un œdème transitoire, une ...
- Trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil) (who.int)
2 mai 2023 — En général, il correspond à l'apparition des signes et symptômes plus manifestes de la maladie : modification du comportement, état confusionnel ...
- Trypanosomiase africaine (maladie du sommeil) (canada.ca)
3 avr. 2019 — Quels sont les symptômes? · fièvre · maux de tête et douleurs musculaires · démangeaisons · gonflement du visage · ganglions lymphatiques enflés ...
- Apports et limites du diagnostic de la trypanosomiase ... (medecinesciences.org)
de V Jamonneau · 2004 · Cité 9 fois — Le diagnostic de phase de la maladie repose sur l'analyse du liquide céphalorachidien (LCR), après double centrifugation (DC), à la recherche de trypanosomes et ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
