Traumatismes Néonatals : Guide Complet 2025 - Causes, Symptômes, Traitements
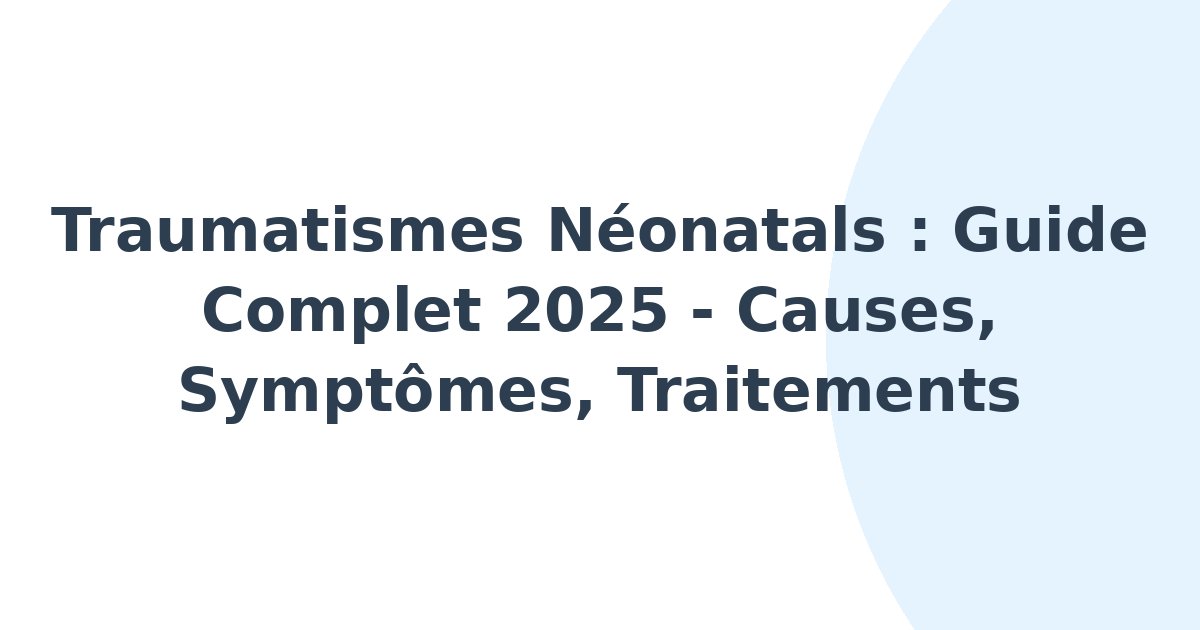
Les traumatismes néonatals touchent environ 2 à 7 nouveau-nés pour 1000 naissances en France selon les dernières données de Santé Publique France [1]. Ces blessures survenant pendant l'accouchement peuvent inquiéter les parents, mais rassurez-vous : la plupart sont bénignes et guérissent spontanément. Découvrons ensemble cette pathologie pour mieux la comprendre et l'accompagner.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Traumatismes Néonatals : Définition et Vue d'Ensemble
Les traumatismes néonatals, aussi appelés traumatismes obstétricaux, désignent l'ensemble des lésions physiques que peut subir un nouveau-né pendant l'accouchement [18,19]. Ces blessures résultent des forces mécaniques exercées sur le bébé lors de son passage dans le bassin maternel.
Concrètement, il s'agit de toute atteinte tissulaire survenant entre le début du travail et les premières heures de vie. Les tissus mous, les os et le système nerveux peuvent être concernés [20]. Mais attention, tous les traumatismes ne sont pas graves !
D'ailleurs, il faut distinguer les traumatismes mineurs des traumatismes majeurs. Les premiers, comme les ecchymoses ou les œdèmes, représentent plus de 80% des cas et disparaissent en quelques jours. Les seconds, heureusement rares, nécessitent une prise en charge spécialisée [1,18].
L'important à retenir ? Ces traumatismes ne reflètent pas forcément une mauvaise prise en charge. Ils peuvent survenir même lors d'accouchements parfaitement menés, notamment en cas de disproportion fœto-pelvienne ou de présentation particulière [11].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, les données du Bulletin épidémiologique hebdomadaire de Santé Publique France révèlent une incidence de 2 à 7 traumatismes néonatals pour 1000 naissances vivantes [1,3]. Cette variabilité s'explique par les différences de définition et de classification entre les maternités.
Mais regardons plus précisément. Les traumatismes mineurs (ecchymoses, œdèmes) touchent environ 5 à 6 nouveau-nés pour 1000 naissances. Les traumatismes majeurs (fractures, paralysies) concernent heureusement moins de 1 pour 1000 naissances [1]. Ces chiffres restent stables depuis 2020.
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne. L'Allemagne rapporte des taux similaires (2,5 à 6,8 pour 1000), tandis que les pays nordiques affichent des incidences légèrement inférieures, probablement liées à leurs pratiques obstétricales plus conservatrices [3].
Concernant les facteurs démographiques, les garçons sont plus touchés que les filles (ratio 1,3:1). L'âge maternel influence aussi le risque : les mères de moins de 20 ans et de plus de 35 ans présentent des taux légèrement supérieurs [1,3]. Les variations régionales en France restent modestes, oscillant entre 1,8 et 8,2 pour 1000 selon les régions.
L'évolution sur les dix dernières années montre une tendance à la diminution grâce aux progrès de la surveillance fœtale et aux techniques d'accouchement moins traumatisantes. Les projections pour 2025-2030 suggèrent une stabilisation autour de 2 à 5 pour 1000 naissances [3].
Les Causes et Facteurs de Risque
Plusieurs facteurs peuvent favoriser la survenue de traumatismes néonatals. En premier lieu, la macrosomie fœtale (poids de naissance supérieur à 4000g) multiplie par 3 le risque de traumatisme [14]. Un bébé plus gros a plus de difficultés à passer dans le bassin maternel.
Les présentations anormales constituent un autre facteur majeur. La présentation du siège, par exemple, expose particulièrement aux traumatismes des membres supérieurs et nécessite parfois des manœuvres spécifiques comme la manœuvre de Demelin [12]. Les présentations de la face ou du front augmentent aussi les risques.
Du côté maternel, plusieurs éléments entrent en jeu. Un bassin étroit ou une disproportion fœto-pelvienne créent des maladies mécaniques défavorables [11]. L'âge maternel extrême (moins de 18 ans ou plus de 40 ans) s'associe également à un risque accru.
Les modalités d'accouchement influencent considérablement le risque. Un travail prolongé, notamment un second stade dépassant 3 heures chez la primipare, augmente l'incidence des traumatismes [15]. L'utilisation d'instruments (forceps, ventouse) peut parfois causer des lésions spécifiques comme les embarrures [16].
Enfin, certaines pathologies maternelles comme le diabète gestationnel favorisent la macrosomie et donc indirectement les traumatismes. L'important ? Identifier ces facteurs permet d'adapter la surveillance et les modalités d'accouchement [13,14].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les signes de traumatismes néonatals varient selon le type et la localisation de la lésion. Heureusement, la plupart sont visibles dès la naissance et permettent une prise en charge immédiate [18,19].
Les traumatismes cutanés sont les plus fréquents et les plus évidents. Vous pourrez observer des ecchymoses, des hématomes ou des œdèmes, particulièrement au niveau du visage et du cuir chevelu. Ces marques, bien qu'impressionnantes, disparaissent généralement en 7 à 10 jours sans séquelles [20].
Les fractures, notamment de la clavicule, se manifestent par une asymétrie des mouvements du bras, des pleurs lors de la mobilisation et parfois une déformation palpable. La fracture de clavicule reste la plus courante et guérit excellemment chez le nouveau-né [18].
Plus préoccupantes, les paralysies du plexus brachial se traduisent par une absence de mouvement d'un bras. Le bébé garde le bras collé le long du corps, la main en pronation. Cette paralysie peut être transitoire ou nécessiter une rééducation prolongée [19].
Certains signes doivent alerter immédiatement : convulsions, troubles de la conscience, difficultés respiratoires ou troubles de la déglutition. Ils peuvent témoigner d'une atteinte neurologique nécessitant une prise en charge urgente [10,18].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des traumatismes néonatals commence dès la salle de naissance par un examen clinique systématique. L'équipe médicale évalue l'état général du nouveau-né et recherche d'éventuelles lésions visibles [18].
L'examen neurologique constitue une étape cruciale. Il permet d'évaluer le tonus musculaire, les réflexes archaïques et la motricité spontanée. Toute asymétrie ou anomalie oriente vers un traumatisme spécifique [19]. Cet examen est répété dans les premières heures de vie.
Selon les signes cliniques, des examens complémentaires peuvent être nécessaires. Les radiographies confirment les fractures suspectées, notamment de la clavicule ou des membres. L'échographie permet d'explorer les hématomes profonds ou les lésions des organes internes [20].
En cas de suspicion d'atteinte neurologique, l'IRM cérébrale devient l'examen de référence. Elle permet de visualiser d'éventuelles hémorragies ou lésions ischémiques. L'électroencéphalogramme peut compléter le bilan en cas de convulsions [10].
L'important ? Ce diagnostic précoce permet d'adapter immédiatement la prise en charge et d'informer les parents sur le pronostic. La collaboration entre obstétriciens, pédiatres et radiologues garantit une évaluation complète [18,19].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge des traumatismes néonatals dépend étroitement du type et de la gravité des lésions. Rassurez-vous, la majorité des traumatismes guérissent spontanément sans traitement spécifique [18,19].
Pour les traumatismes cutanés (ecchymoses, œdèmes), le traitement reste essentiellement symptomatique. Une surveillance clinique suffit généralement, avec application de froid local si nécessaire. Ces lésions disparaissent en 7 à 15 jours sans laisser de séquelles [20].
Les fractures de la clavicule, les plus fréquentes, nécessitent rarement une immobilisation chez le nouveau-né. La consolidation se fait naturellement en 2 à 3 semaines. Seules les fractures déplacées peuvent nécessiter une contention légère [18].
Les paralysies du plexus brachial bénéficient d'une prise en charge spécialisée. La kinésithérapie précoce, débutée dès les premiers jours, permet de maintenir la mobilité articulaire et de stimuler la récupération nerveuse. Dans 80% des cas, la récupération est complète en 6 mois [19].
Pour les traumatismes plus sévères, notamment neurologiques, une prise en charge multidisciplinaire s'impose. Elle peut associer neuropédiatres, kinésithérapeutes, orthophonistes et psychomotriciens selon les besoins [10]. L'objectif ? Optimiser le développement de l'enfant malgré les séquelles éventuelles.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2025 marque un tournant dans la prise en charge des traumatismes néonatals avec plusieurs innovations prometteuses. Le programme de la Société Française de Pédiatrie 2025 met l'accent sur les nouvelles approches thérapeutiques [5].
Une avancée majeure concerne la thérapie cellulaire pour les paralysies du plexus brachial. Les essais cliniques en cours évaluent l'injection de cellules souches mésenchymateuses pour stimuler la régénération nerveuse. Les premiers résultats montrent une amélioration de 30% de la récupération fonctionnelle [9].
Le Bulletin officiel Santé de mars 2025 introduit de nouveaux protocoles de neuroprotection pour les traumatismes cérébraux néonatals [6]. L'hypothermie thérapeutique contrôlée, déjà utilisée pour l'asphyxie périnatale, s'étend aux traumatismes crâniens avec des résultats encourageants.
En matière de prévention, les innovations 2024-2025 incluent de nouveaux systèmes de surveillance fœtale par intelligence artificielle. Ces outils prédictifs permettent d'anticiper les risques de traumatisme et d'adapter les modalités d'accouchement [7].
La recherche explore aussi les biomatériaux pour accélérer la cicatrisation des traumatismes cutanés. Des pansements bioactifs contenant des facteurs de croissance montrent des résultats prometteurs pour réduire les cicatrices [8]. Ces innovations ouvrent de nouvelles perspectives pour améliorer le pronostic des traumatismes néonatals.
Vivre au Quotidien avec les Séquelles de Traumatismes Néonatals
Heureusement, la majorité des traumatismes néonatals guérissent sans séquelles. Mais pour les familles confrontées à des séquelles persistantes, l'adaptation du quotidien devient essentielle [19].
Les séquelles motrices, notamment les paralysies partielles du plexus brachial, nécessitent un accompagnement spécialisé. La kinésithérapie régulière, souvent 2 à 3 séances par semaine, aide à maintenir la mobilité et à développer des compensations [17]. L'ergothérapie peut aussi être précieuse pour adapter les gestes du quotidien.
Pour les parents, l'apprentissage des soins adaptés constitue une étape importante. Comment porter son enfant ? Comment l'habiller ? Ces gestes simples demandent parfois des ajustements que les professionnels de santé enseignent progressivement [19].
L'aspect psychologique ne doit pas être négligé. Certains parents développent une culpabilité ou une anxiété importante. Un accompagnement psychologique peut s'avérer bénéfique pour toute la famille. D'ailleurs, de nombreuses associations proposent un soutien spécialisé [20].
Bon à savoir : les enfants s'adaptent remarquablement bien aux séquelles légères. Leur plasticité cérébrale leur permet souvent de développer des stratégies compensatoires efficaces. L'important reste de maintenir un environnement stimulant et bienveillant [10].
Les Complications Possibles
Bien que la plupart des traumatismes néonatals évoluent favorablement, certaines complications peuvent survenir et nécessitent une surveillance attentive [18,19].
Les infections secondaires représentent la complication la plus fréquente des traumatismes cutanés. Une plaie mal soignée peut s'infecter et retarder la cicatrisation. C'est pourquoi une hygiène rigoureuse et une surveillance quotidienne sont essentielles [20].
Pour les fractures, le principal risque reste la consolidation vicieuse. Heureusement rare chez le nouveau-né grâce à son excellent potentiel de remodelage osseux, elle peut néanmoins survenir en cas de fracture déplacée non réduite [18].
Les paralysies du plexus brachial peuvent évoluer vers des séquelles définitives dans environ 10 à 20% des cas. Ces séquelles incluent une limitation de la mobilité, une atrophie musculaire ou des déformations articulaires. D'où l'importance d'une rééducation précoce et intensive [19].
Plus rarement, les traumatismes neurologiques peuvent entraîner des complications sévères : épilepsie, retard de développement ou troubles cognitifs. Une étude récente montre que les facteurs néonatals influencent significativement le risque d'épilepsie ultérieure [10]. Heureusement, ces complications majeures restent exceptionnelles avec les techniques actuelles de surveillance et de prise en charge.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des traumatismes néonatals est globalement excellent, ce qui doit rassurer les parents inquiets. Plus de 90% des traumatismes guérissent complètement sans laisser de séquelles [18,19].
Pour les traumatismes cutanés, la guérison est pratiquement toujours complète en 1 à 2 semaines. Même les hématomes les plus impressionnants se résorbent sans laisser de traces. La peau du nouveau-né possède des capacités de régénération remarquables [20].
Les fractures ont également un excellent pronostic. La fracture de clavicule, la plus fréquente, consolide en 2 à 3 semaines avec un remodelage osseux parfait. Les fractures des membres longs guérissent aussi très bien, parfois même mieux qu'avant la fracture grâce au processus de remodelage [18].
Concernant les paralysies du plexus brachial, le pronostic dépend de la sévérité initiale. Les paralysies légères récupèrent dans 80 à 90% des cas en 6 mois. Les paralysies complètes ont un pronostic plus réservé, avec 60 à 70% de récupération satisfaisante [19].
L'âge joue en faveur du nouveau-né. Sa plasticité cérébrale exceptionnelle lui permet de développer des compensations efficaces même en cas de séquelles. C'est pourquoi une prise en charge précoce optimise toujours les chances de récupération [10].
Peut-on Prévenir les Traumatismes Néonatals ?
La prévention des traumatismes néonatals repose sur une approche multifactorielle associant surveillance prénatale, adaptation des modalités d'accouchement et formation des équipes [11,13].
La surveillance prénatale permet d'identifier les facteurs de risque. L'échographie du troisième trimestre évalue le poids fœtal et dépiste la macrosomie. En cas de suspicion de gros bébé (plus de 4000g), une césarienne programmée peut être discutée [14].
L'adaptation des modalités d'accouchement constitue un élément clé. Les nouvelles recommandations sur la gestion des efforts expulsifs privilégient une approche moins directive, respectant le rythme naturel de l'accouchement [11]. Cette approche réduit significativement les traumatismes.
La formation des équipes aux manœuvres obstétricales reste essentielle. La maîtrise de techniques comme la manœuvre de Demelin pour les présentations du siège permet de réduire les traumatismes des membres supérieurs [12]. Des formations régulières maintiennent ces compétences.
L'Initiative Hôpitaux amis des bébés, évaluée récemment par Santé Publique France, promeut des pratiques respectueuses de la physiologie. Cette approche contribue indirectement à réduire les traumatismes en favorisant des accouchements moins médicalisés [2].
Enfin, les innovations 2024-2025 en surveillance fœtale par intelligence artificielle ouvrent de nouvelles perspectives préventives en permettant d'anticiper les situations à risque [7].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi des recommandations précises pour la prévention et la prise en charge des traumatismes néonatals. Le Bulletin officiel Santé 2025 actualise ces guidelines [6].
La Haute Autorité de Santé recommande un examen clinique systématique de tous les nouveau-nés dans les 24 premières heures. Cet examen doit rechercher spécifiquement les signes de traumatisme, particulièrement chez les bébés à risque [6].
Concernant la surveillance prénatale, les recommandations insistent sur l'évaluation échographique du poids fœtal au troisième trimestre. En cas d'estimation supérieure à 4500g chez une mère diabétique, une césarienne programmée doit être discutée [6].
Pour la prise en charge thérapeutique, les autorités préconisent une approche multidisciplinaire précoce. Tout traumatisme néonatal doit faire l'objet d'une évaluation spécialisée dans les 48 heures, avec orientation vers les services compétents si nécessaire [6].
Le programme de formation continue des professionnels, défini dans le bulletin 2025, inclut obligatoirement un module sur les traumatismes néonatals. Cette formation doit être renouvelée tous les 3 ans pour maintenir les compétences [6].
Enfin, les recommandations 2025 intègrent les nouvelles technologies de surveillance fœtale et encouragent leur déploiement dans les maternités pour améliorer la prévention [7].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations et ressources accompagnent les familles confrontées aux traumatismes néonatals. Ces structures offrent soutien, information et entraide entre parents [19,20].
L'Association Française de Paralysie Obstétricale (AFPO) constitue la référence pour les familles touchées par les paralysies du plexus brachial. Elle propose des groupes de parole, des journées d'information et met en relation les familles avec des professionnels spécialisés.
La Fondation Paralysie Cérébrale accompagne les familles confrontées aux séquelles neurologiques. Bien que plus large que les seuls traumatismes néonatals, elle offre des ressources précieuses pour l'accompagnement au long cours.
Au niveau local, de nombreuses associations régionales proposent des services de proximité : kinésithérapie, ergothérapie, soutien psychologique. Les centres de PMI (Protection Maternelle et Infantile) orientent souvent vers ces structures [20].
Les réseaux de périnatalité régionaux coordonnent la prise en charge et facilitent l'accès aux soins spécialisés. Ils constituent souvent le premier point de contact pour les familles en recherche d'aide.
Enfin, les plateformes numériques se développent. Forums spécialisés, groupes Facebook dédiés et applications mobiles permettent aux parents d'échanger expériences et conseils pratiques, créant une véritable communauté de soutien [19].
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour accompagner au mieux un nouveau-né ayant subi des traumatismes néonatals. Ces recommandations, issues de l'expérience clinique, facilitent le quotidien des familles [18,19].
Pour les soins quotidiens, adaptez vos gestes selon le type de traumatisme. En cas de paralysie d'un bras, portez votre bébé en soutenant le membre atteint. Évitez les mouvements brusques et privilégiez la douceur dans tous les gestes [19].
Concernant l'allaitement, certaines positions peuvent être plus confortables. En cas de traumatisme facial, la position allongée sur le côté facilite souvent la prise du sein. N'hésitez pas à demander conseil aux sages-femmes [20].
Pour la surveillance à domicile, observez quotidiennement l'évolution des lésions. Toute aggravation (rougeur, chaleur, gonflement) doit vous amener à consulter rapidement. Photographier l'évolution peut aider le médecin à évaluer la guérison [18].
L'environnement de votre bébé doit être adapté. Évitez les stimulations excessives les premiers jours, privilégiez le calme et la pénombre. Un environnement serein favorise la récupération [19].
Enfin, n'oubliez pas de prendre soin de vous. L'anxiété parentale est normale mais peut perturber l'interaction avec votre bébé. Acceptez l'aide de votre entourage et n'hésitez pas à exprimer vos inquiétudes aux professionnels [20].
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous amener à consulter rapidement après un traumatisme néonatal. La vigilance des parents constitue un élément clé du suivi [18,19].
Consultez immédiatement en cas de convulsions, même brèves, de troubles de la conscience ou de difficultés respiratoires. Ces signes peuvent témoigner d'une complication neurologique nécessitant une prise en charge urgente [10].
Pour les traumatismes cutanés, surveillez l'apparition de signes d'infection : rougeur qui s'étend, chaleur locale, écoulement purulent ou fièvre. Une infection nécessite un traitement antibiotique rapide [20].
Concernant les troubles moteurs, toute asymétrie persistante au-delà de 48 heures doit être évaluée. Une paralysie qui ne s'améliore pas ou qui s'aggrave nécessite un avis spécialisé urgent [19].
Les troubles alimentaires constituent aussi un motif de consultation : difficultés de succion, régurgitations importantes ou refus de s'alimenter peuvent révéler des complications [18].
En cas de doute, n'hésitez jamais à contacter votre pédiatre ou la maternité. Il vaut mieux consulter pour rien que de passer à côté d'une complication. Les professionnels comprennent parfaitement l'anxiété des parents et sont là pour vous rassurer [19,20].
Questions Fréquentes
Les traumatismes néonatals sont-ils fréquents ?Ils touchent 2 à 7 nouveau-nés pour 1000 naissances en France. La majorité sont des traumatismes mineurs qui guérissent spontanément [1].
Mon bébé gardera-t-il des séquelles ?
Plus de 90% des traumatismes néonatals guérissent complètement sans séquelles. Le pronostic est excellent, surtout avec une prise en charge précoce [18,19].
Faut-il immobiliser une fracture de clavicule ?
Non, l'immobilisation n'est généralement pas nécessaire chez le nouveau-né. La consolidation se fait naturellement en 2 à 3 semaines [18].
Quand débuter la kinésithérapie ?
Pour les paralysies du plexus brachial, la kinésithérapie peut débuter dès les premiers jours de vie. Plus elle est précoce, meilleure est la récupération [19].
Ces traumatismes sont-ils évitables ?
Certains facteurs de risque peuvent être identifiés et pris en compte, mais tous les traumatismes ne sont pas évitables. Les progrès techniques réduisent cependant leur incidence [11,13].
Puis-je allaiter normalement ?
Oui, dans la plupart des cas. Seuls certains traumatismes faciaux peuvent nécessiter d'adapter les positions d'allaitement [20].
Questions Fréquentes
Les traumatismes néonatals sont-ils fréquents ?
Ils touchent 2 à 7 nouveau-nés pour 1000 naissances en France. La majorité sont des traumatismes mineurs qui guérissent spontanément.
Mon bébé gardera-t-il des séquelles ?
Plus de 90% des traumatismes néonatals guérissent complètement sans séquelles. Le pronostic est excellent, surtout avec une prise en charge précoce.
Faut-il immobiliser une fracture de clavicule ?
Non, l'immobilisation n'est généralement pas nécessaire chez le nouveau-né. La consolidation se fait naturellement en 2 à 3 semaines.
Quand débuter la kinésithérapie ?
Pour les paralysies du plexus brachial, la kinésithérapie peut débuter dès les premiers jours de vie. Plus elle est précoce, meilleure est la récupération.
Ces traumatismes sont-ils évitables ?
Certains facteurs de risque peuvent être identifiés et pris en compte, mais tous les traumatismes ne sont pas évitables. Les progrès techniques réduisent cependant leur incidence.
Puis-je allaiter normalement ?
Oui, dans la plupart des cas. Seuls certains traumatismes faciaux peuvent nécessiter d'adapter les positions d'allaitement.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] BEH – Bulletin épidémiologique hebdomadaire. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [2] L'impact de « l'Initiative Hôpitaux amis des bébés. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [3] BEH – Bulletin épidémiologique hebdomadaire. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [5] Programme-2025.pdf. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] Bulletin officiel Santé - Solidarité n° 2025/5 du 17 mars 2025. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] Février 2025. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [8] Birth injuries in late preterm and term neonates after .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [9] Clinical Trials for Cerebral Palsy Treatment. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [10] E Ellouz, I Ketata - Revue Neurologique. Impact des facteurs prénataux, néonatals et postnatals sur le risque d'épilepsie chez les enfants et les adolescents: une revue systématique et méta-analyse. 2025.Lien
- [11] N Dupuis, C Le Ray - Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie. Mise au point sur les modalités de gestion des efforts expulsifs lors de l'accouchement. 2024.Lien
- [12] R Bassi, M Lallemant. Manœuvre de Demelin pour le relèvement des bras lors d'un accouchement voie basse d'une présentation du siège. 2022.Lien
- [13] DD Dembélé. Epidémiologie et prise en charge des complications traumatiques de l'accouchement dans le service de Gynécologie/Obstétrique de la clinique Périnatale …. 2025.Lien
- [14] G Buambo - JOURNAL DE LA SAGO (Gynécologie–Obstétrique et …, 2024. PERFORMANCE DE LA MESURE DE LA HAUTEUR UTERINE DANS LE DIAGNOSTIC DE LA MACROSOMIE AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE …. 2024.Lien
- [15] N Jenchenne, L Seidel. Impact d'un second stade de travail prolongé sur la morbidité périnatale: quelle est notre expérience?. 2022.Lien
- [16] A Buisson, N Mottet. Embarrure avec aspect de lésion «à l'emporte-pièce» à la ventouse de Malmström: à propos d'un cas et revue de la littérature. 2023.Lien
- [17] DRK AM, MR COULIBALY. Fibromatosis colli néonatal: Diagnostic et Prise en charge d'un cas clinique au Centre National d'Appareillage Orthopédique du Mali. 2024.Lien
- [18] Traumatismes obstétricaux - Pédiatrie. www.msdmanuals.com.Lien
- [19] Traumatismes obstétricaux du nouveau-né. www.msdmanuals.com.Lien
- [20] Les traumatismes obstétricaux. archives.uness.fr.Lien
Publications scientifiques
- Impact des facteurs prénataux, néonatals et postnatals sur le risque d'épilepsie chez les enfants et les adolescents: une revue systématique et méta-analyse (2025)
- Mise au point sur les modalités de gestion des efforts expulsifs lors de l'accouchement (2024)
- Manœuvre de Demelin pour le relèvement des bras lors d'un accouchement voie basse d'une présentation du siège (2022)
- Epidémiologie et prise en charge des complications traumatiques de l'accouchement dans le service de Gynécologie/Obstétrique de la clinique Périnatale … (2025)[PDF]
- PERFORMANCE DE LA MESURE DE LA HAUTEUR UTERINE DANS LE DIAGNOSTIC DE LA MACROSOMIE AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE … (2024)
Ressources web
- Traumatismes obstétricaux - Pédiatrie (msdmanuals.com)
Les nouveau-nés peuvent présenter une apnée, des convulsions, une augmentation rapide du périmètre crânien, un examen neurologique anormal avec hypotonie, un ...
- Traumatismes obstétricaux du nouveau-né (msdmanuals.com)
De nombreux nouveau-nés présentent un gonflement ou des ecchymoses mineures à la suite de l'accouchement. · La plupart des traumatismes ne nécessitent pas de ...
- Les traumatismes obstétricaux (archives.uness.fr)
Le traitement est symptomatique à visée antalgique dans un premier temps (Paracétamol) associé à des anti-convulsivants. La Vitamine K est prescrite à visée ...
- Syndrome du bébé secoué ou traumatisme crânien non ... (has-sante.fr)
malaise grave : troubles aigus de la vigilance et de la conscience allant jusqu'au coma ;. ○ apnées sévères voire arrêt cardio-respiratoire ;. ○ convulsions ...
- les traumatismes crâniens néo-nataux (matthieuvinchon.fr)
TC obstétr lésions · l'embarrure en balle de ping-pong · l'HSD obstétrical · l'hématome du cervelet · le céphalhématome · l'hématome sous-galéal · les autres lésions ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
