Traumatismes du Système Nerveux : Guide Complet 2025 | Symptômes, Traitements
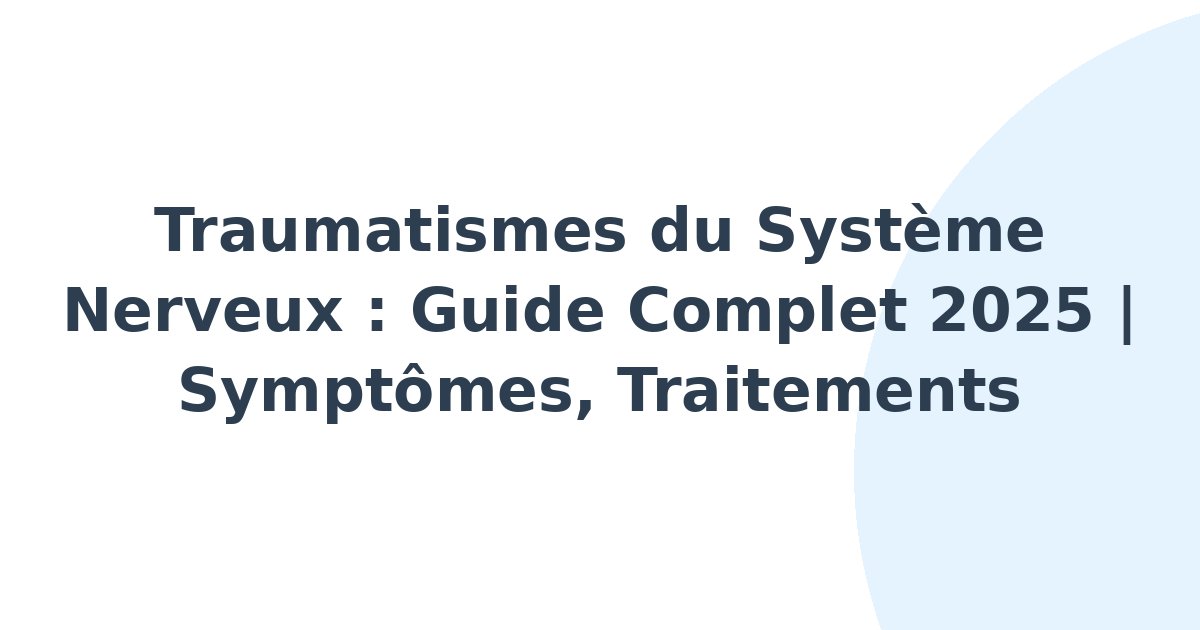
Les traumatismes du système nerveux représentent une urgence médicale majeure qui peut bouleverser une vie en quelques secondes. Qu'il s'agisse d'un accident de la route, d'une chute ou d'un traumatisme crânien, ces lésions touchent chaque année des milliers de personnes en France. Mais rassurez-vous : les avancées médicales de 2024-2025 offrent aujourd'hui des perspectives thérapeutiques inédites et des espoirs de récupération considérablement améliorés.
Téléconsultation et Traumatismes du système nerveux
Téléconsultation non recommandéeLes traumatismes du système nerveux nécessitent généralement une évaluation neurologique complète avec examen physique approfondi et souvent des examens d'imagerie urgents. L'évaluation des fonctions neurologiques, des réflexes et de l'état de conscience ne peut être réalisée de manière fiable à distance. Ces pathologies présentent souvent un caractère d'urgence nécessitant une prise en charge spécialisée immédiate.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil des circonstances du traumatisme et de l'historique de l'accident. Évaluation initiale de l'état de conscience et de la capacité de communication du patient. Description des symptômes neurologiques rapportés par le patient ou l'entourage. Orientation vers une prise en charge appropriée et conseils d'attente. Suivi post-hospitalisation pour l'évolution des symptômes résiduels.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen neurologique complet avec évaluation des fonctions cognitives, motrices et sensitives. Réalisation d'examens d'imagerie cérébrale ou médullaire (scanner, IRM). Évaluation de la pression intracrânienne et des signes de complications. Prise en charge chirurgicale éventuelle et surveillance en milieu spécialisé.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Tout traumatisme récent du système nerveux avec perte de conscience ou confusion nécessite un examen en présentiel. Les troubles neurologiques nouveaux ou qui s'aggravent après un traumatisme doivent être évalués physiquement. L'évaluation des réflexes, de la force musculaire et de la sensibilité ne peut se faire qu'en consultation directe. Les céphalées post-traumatiques persistantes ou inhabituelles nécessitent un examen clinique complet.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Tout traumatisme crânien récent avec altération de la conscience, confusion ou désorientation. Céphalées violentes et soudaines post-traumatiques avec nausées et vomissements. Déficits neurologiques nouveaux ou qui s'aggravent rapidement après un traumatisme.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Perte de conscience, même brève, après un traumatisme crânien
- Confusion, désorientation ou troubles du comportement après un choc
- Céphalées intenses et persistantes avec nausées et vomissements post-traumatiques
- Déficit moteur, troubles de la parole ou de la vision apparus après le traumatisme
- Convulsions ou mouvements anormaux après un traumatisme neurologique
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Neurologue — consultation en présentiel indispensable
Les traumatismes du système nerveux nécessitent impérativement l'expertise d'un neurologue ou d'un neurochirurgien pour un examen neurologique complet et une évaluation des complications potentielles. Une consultation en présentiel est indispensable pour l'examen physique et la réalisation d'examens complémentaires urgents.
Traumatismes du système nerveux : Définition et Vue d'Ensemble
Un traumatisme du système nerveux désigne toute lésion affectant le cerveau, la moelle épinière ou les nerfs périphériques suite à un choc physique. Cette pathologie englobe un spectre très large de blessures, depuis la simple commotion cérébrale jusqu'aux lésions médullaires complètes [4].
Le système nerveux central, composé du cerveau et de la moelle épinière, contrôle toutes nos fonctions vitales. Quand il subit un traumatisme, les conséquences peuvent être dramatiques. D'ailleurs, on distingue deux types principaux de lésions : les traumatismes fermés (sans pénétration du crâne) et les traumatismes ouverts (avec fracture ou pénétration) [4].
L'important à retenir, c'est que chaque traumatisme est unique. Deux personnes ayant subi un choc similaire peuvent présenter des symptômes complètement différents. Cette variabilité s'explique par la complexité extraordinaire de notre système nerveux et par les mécanismes de compensation que notre cerveau peut développer .
Concrètement, ces traumatismes peuvent affecter la motricité, la sensibilité, les fonctions cognitives ou encore l'équilibre émotionnel. Mais heureusement, notre cerveau possède une capacité remarquable de neuroplasticité qui permet, dans certains cas, une récupération partielle ou complète des fonctions perdues.
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les chiffres des traumatismes du système nerveux en France révèlent l'ampleur de ce problème de santé publique. Selon Santé Publique France, on dénombre environ 155 000 nouveaux cas de traumatismes crâniens chaque année dans notre pays . Cette incidence place la France dans la moyenne européenne, mais avec des disparités régionales importantes.
L'analyse épidémiologique montre que les accidents de la route représentent 50% des cas, suivis par les chutes (30%) et les accidents de sport (15%) . Les hommes sont deux fois plus touchés que les femmes, avec un pic d'incidence entre 15 et 25 ans. Mais attention : les personnes âgées de plus de 65 ans constituent un groupe à risque croissant, notamment à cause des chutes domestiques .
D'un point de vue économique, le coût annuel des traumatismes du système nerveux pour l'Assurance Maladie dépasse les 2,5 milliards d'euros . Ce montant inclut les soins aigus, la rééducation et la prise en charge des séquelles à long terme. Il faut savoir que 40% des patients gardent des séquelles permanentes nécessitant un suivi médical prolongé.
Comparativement aux autres pays européens, la France présente un taux de mortalité par traumatisme crânien de 8,2 pour 100 000 habitants, légèrement inférieur à la moyenne européenne de 9,1 . Cette performance s'explique par l'efficacité de notre système de soins d'urgence et par les progrès de la neurochirurgie.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes des traumatismes du système nerveux sont multiples et souvent imprévisibles. Les accidents de la circulation arrivent en tête, responsables de la moitié des cas graves. Mais il ne faut pas oublier que les chutes, particulièrement chez les personnes âgées, constituent une cause majeure et souvent sous-estimée .
Certains facteurs augmentent considérablement le risque. L'âge joue un rôle crucial : les jeunes adultes (15-25 ans) sont surexposés aux accidents de la route et aux traumatismes sportifs, tandis que les seniors font face aux risques de chutes. D'ailleurs, après 75 ans, le risque de traumatisme crânien par chute est multiplié par quatre .
Les activités à risque incluent évidemment les sports de contact (rugby, boxe, football américain), mais aussi des activités apparemment anodines comme le cyclisme sans casque ou les sports d'hiver. L'alcool et les substances psychoactives multiplient par trois le risque d'accident grave .
Il existe aussi des facteurs de risque médicaux. Les troubles de l'équilibre, certains médicaments (sédatifs, antihypertenseurs), l'épilepsie ou encore les troubles visuels prédisposent aux chutes et aux traumatismes. Bon à savoir : les femmes ménopausées présentent un risque accru de fractures crâniennes en cas de chute, à cause de l'ostéoporose.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Reconnaître les signes d'un traumatisme du système nerveux peut littéralement sauver une vie. Les symptômes varient énormément selon la localisation et la gravité de la lésion, mais certains signaux d'alarme ne trompent pas [4].
Les symptômes immédiats incluent la perte de connaissance, même brève, les vomissements répétés, les maux de tête intenses et la confusion. Attention : une personne peut sembler aller bien juste après l'accident, puis se dégrader rapidement. C'est ce qu'on appelle l'intervalle libre, particulièrement dangereux [4].
Les troubles de la motricité se manifestent par une faiblesse d'un côté du corps, des difficultés à coordonner les mouvements ou une paralysie partielle. Les troubles sensitifs incluent des engourdissements, des fourmillements ou une perte de sensation dans certaines zones du corps [5].
Mais il y a aussi des symptômes plus subtils qu'il ne faut pas négliger. Les troubles cognitifs (difficultés de concentration, perte de mémoire), les changements de personnalité ou les troubles du sommeil peuvent apparaître plusieurs jours après le traumatisme. Ces signes tardifs nécessitent une consultation médicale urgente .
Chez l'enfant, les symptômes peuvent être différents : irritabilité inhabituelle, refus de s'alimenter, pleurs inconsolables ou somnolence excessive doivent alerter les parents.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic d'un traumatisme du système nerveux suit un protocole précis et urgent. Dès l'arrivée aux urgences, l'équipe médicale évalue la gravité neurologique grâce à l'échelle de Glasgow, qui mesure l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice [1].
L'examen clinique recherche les signes de fracture du crâne : écoulement de sang ou de liquide par le nez ou les oreilles, ecchymoses autour des yeux (signe du raton laveur) ou derrière les oreilles. Le neurologue teste également les réflexes, la force musculaire et la sensibilité [4].
L'imagerie médicale constitue l'étape cruciale du diagnostic. Le scanner cérébral sans injection, réalisé en urgence, détecte les hémorragies, les œdèmes et les fractures. L'IRM, plus sensible, peut être nécessaire pour visualiser les lésions de la substance blanche ou du tronc cérébral [1].
Des examens complémentaires peuvent s'avérer nécessaires. L'électroencéphalogramme (EEG) détecte d'éventuelles crises d'épilepsie post-traumatiques. Les potentiels évoqués évaluent le fonctionnement des voies nerveuses. Enfin, des tests neuropsychologiques précisent l'impact sur les fonctions cognitives [3].
Le dosage de certains biomarqueurs sanguins comme la protéine S100β permet d'évaluer la gravité des lésions cérébrales et de suivre l'évolution [3]. Cette approche innovante aide les médecins à adapter le traitement et le pronostic.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement des traumatismes du système nerveux a considérablement évolué ces dernières années. En phase aiguë, la priorité absolue est de contrôler la pression intracrânienne pour éviter les lésions secondaires. Cette prise en charge se fait en unité de soins intensifs avec surveillance neurologique continue [1].
La neurochirurgie d'urgence peut être nécessaire pour évacuer un hématome, retirer des fragments osseux ou poser une valve de dérivation. Les techniques mini-invasives se développent rapidement, réduisant les risques opératoires et accélérant la récupération .
Les traitements médicamenteux incluent les anti-œdémateux (mannitol, sérum salé hypertonique) pour réduire l'œdème cérébral, les anticonvulsivants pour prévenir l'épilepsie post-traumatique, et les neuroprotecteurs pour limiter les dégâts cellulaires [1]. Certains médicaments innovants, comme les antagonistes des récepteurs NMDA, montrent des résultats prometteurs.
La rééducation commence dès que l'état du patient le permet. Elle associe kinésithérapie, orthophonie, ergothérapie et neuropsychologie. L'objectif est de stimuler la neuroplasticité et de compenser les déficits. Les nouvelles technologies, comme la réalité virtuelle ou les interfaces cerveau-machine, révolutionnent cette prise en charge .
Il faut savoir que la récupération peut se poursuivre pendant des mois, voire des années. Chaque patient évolue à son rythme, et il est important de ne jamais perdre espoir.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans le traitement des traumatismes du système nerveux. Les thérapies cellulaires utilisant des cellules souches montrent des résultats encourageants pour réparer les lésions cérébrales. Plusieurs essais cliniques sont en cours en France et aux États-Unis .
L'équipe du Dr Kevin Sheth à Yale développe des biomarqueurs prédictifs révolutionnaires qui permettent d'identifier précocement les patients à risque de complications. Cette approche personnalisée pourrait transformer la prise en charge des traumatismes crâniens .
Les interfaces cerveau-machine représentent l'une des avancées les plus spectaculaires. Ces dispositifs permettent aux patients paralysés de contrôler des prothèses ou des ordinateurs par la pensée. Les premiers implants commerciaux devraient être disponibles d'ici 2026 .
La recherche sur la neuroplasticité a également progressé. Des techniques de stimulation magnétique transcrânienne couplées à la rééducation accélèrent la récupération fonctionnelle. Ces protocoles innovants sont testés dans plusieurs centres français [2].
Enfin, l'intelligence artificielle révolutionne le diagnostic. Des algorithmes d'analyse d'images peuvent détecter des lésions invisibles à l'œil nu et prédire l'évolution des patients avec une précision inégalée. Cette technologie sera bientôt déployée dans tous les services d'urgences français .
Vivre au Quotidien avec Traumatismes du système nerveux
Vivre avec les séquelles d'un traumatisme du système nerveux demande une adaptation constante, mais de nombreuses solutions existent pour améliorer la qualité de vie. L'important est de ne pas rester isolé et de s'entourer d'une équipe de professionnels compétents .
L'aménagement du domicile constitue souvent la première étape. Barres d'appui, rampes d'accès, éclairage renforcé : ces modifications simples peuvent considérablement faciliter les déplacements. Les ergothérapeutes sont des alliés précieux pour conseiller ces adaptations .
La reprise du travail nécessite parfois des aménagements spécifiques. Le temps partiel thérapeutique, l'adaptation du poste de travail ou la reconversion professionnelle sont des options à explorer avec la médecine du travail. Bon à savoir : de nombreuses aides financières existent pour accompagner ces transitions.
Les troubles cognitifs (mémoire, attention, concentration) peuvent être compensés par des stratégies d'adaptation. Agendas électroniques, applications de rappel, techniques de mémorisation : ces outils deviennent rapidement indispensables .
Il ne faut pas négliger l'aspect psychologique. Les traumatismes du système nerveux s'accompagnent souvent de dépression, d'anxiété ou de troubles du comportement. Un suivi psychologique régulier aide à traverser ces difficultés et à retrouver confiance en soi .
Les Complications Possibles
Les complications des traumatismes du système nerveux peuvent survenir à court ou long terme. Il est important de les connaître pour mieux les prévenir et les traiter rapidement [4].
Les complications précoces incluent l'œdème cérébral, les hémorragies secondaires et l'hypertension intracrânienne. Ces urgences neurochirurgicales nécessitent une prise en charge immédiate en réanimation. L'épilepsie post-traumatique touche 15% des patients dans les premières semaines [1].
À moyen terme, les infections représentent un risque majeur, particulièrement en cas de fracture ouverte du crâne. La méningite post-traumatique, bien que rare, peut avoir des conséquences dramatiques. C'est pourquoi une antibiothérapie préventive est souvent prescrite [4].
Les complications tardives sont plus insidieuses. L'hydrocéphalie post-traumatique peut se développer des mois après l'accident, causant des troubles de la marche et des fonctions cognitives. Les troubles endocriniens, liés à une atteinte de l'hypophyse, affectent 20% des patients [1].
Il faut aussi mentionner les complications psychologiques. Le syndrome post-commotionnel associe maux de tête persistants, troubles du sommeil, irritabilité et difficultés de concentration. Ce syndrome peut durer plusieurs mois et nécessite une prise en charge spécialisée .
Enfin, les troubles de la déglutition et les pneumopathies d'inhalation constituent des complications fréquentes chez les patients comateux ou présentant des troubles de conscience.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des traumatismes du système nerveux dépend de nombreux facteurs, mais les avancées médicales récentes ont considérablement amélioré les perspectives de récupération [1].
La gravité initiale, évaluée par l'échelle de Glasgow, reste le facteur pronostique principal. Un score inférieur à 8 indique un traumatisme sévère avec risque de séquelles importantes. Cependant, des récupérations spectaculaires sont possibles même dans les cas les plus graves [4].
L'âge joue un rôle crucial : les enfants et les jeunes adultes ont une capacité de récupération supérieure grâce à la plasticité cérébrale. Après 65 ans, le pronostic est plus réservé, mais des améliorations significatives restent possibles avec une rééducation adaptée .
Les facteurs favorables incluent une prise en charge précoce, l'absence de complications secondaires et un bon état de santé antérieur. Le soutien familial et social influence également l'évolution. D'ailleurs, les patients bénéficiant d'un entourage solide récupèrent généralement mieux .
Concrètement, 60% des patients retrouvent une autonomie complète, 25% gardent des séquelles légères à modérées, et 15% présentent un handicap sévère . Ces chiffres s'améliorent chaque année grâce aux progrès thérapeutiques.
Il faut retenir que la récupération peut se poursuivre pendant des années. Certains patients continuent à progresser 5 à 10 ans après leur accident, notamment grâce aux nouvelles techniques de rééducation .
Peut-on Prévenir Traumatismes du système nerveux ?
La prévention des traumatismes du système nerveux repose sur des mesures simples mais efficaces. Selon Santé Publique France, 70% de ces accidents pourraient être évités par des gestes de prévention appropriés .
En sécurité routière, le port de la ceinture de sécurité réduit de 45% le risque de traumatisme crânien grave. Le casque à vélo diminue ce risque de 85%. Malheureusement, seulement 22% des cyclistes français portent systématiquement un casque .
Pour les personnes âgées, la prévention des chutes est cruciale. L'aménagement du domicile (éclairage, suppression des tapis, barres d'appui), l'activité physique régulière pour maintenir l'équilibre, et la révision des traitements médicamenteux peuvent diviser par deux le risque de chute .
Dans le sport, le respect des règles de sécurité et l'utilisation d'équipements de protection adaptés sont essentiels. Les sports de contact doivent être encadrés par des professionnels formés à la détection des commotions cérébrales [2].
La sensibilisation du public reste un enjeu majeur. Les campagnes de prévention routière et les programmes d'éducation dans les écoles contribuent à réduire l'incidence des traumatismes. Chacun peut agir à son niveau pour protéger sa famille et ses proches.
Il faut aussi mentionner l'importance de la prévention secondaire : éviter l'alcool au volant, adapter sa conduite aux maladies météorologiques, maintenir son véhicule en bon état. Ces gestes simples sauvent des vies.
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 des recommandations actualisées pour la prise en charge des traumatismes du système nerveux. Ces protocoles nationaux standardisent les pratiques et améliorent la qualité des soins [1].
Le parcours de soins recommandé débute par une évaluation neurologique systématique aux urgences, suivie d'une imagerie cérébrale dans les 2 heures. La HAS insiste sur l'importance d'une surveillance neurologique rapprochée pendant les 48 premières heures [1].
Pour la rééducation, les recommandations préconisent une approche multidisciplinaire précoce associant kinésithérapie, orthophonie, ergothérapie et neuropsychologie. L'objectif est de débuter la rééducation dès la phase aiguë, même chez les patients comateux [1].
Santé Publique France recommande un suivi à long terme de tous les patients ayant présenté un traumatisme crânien modéré à sévère. Ce suivi inclut une évaluation neuropsychologique annuelle et un dépistage des complications tardives .
Les autorités insistent également sur l'importance de la formation des professionnels. Des programmes de formation continue sont déployés dans tous les services d'urgences pour améliorer la reconnaissance et la prise en charge précoce des traumatismes [1].
Enfin, la HAS recommande l'utilisation des nouvelles technologies (télémédecine, intelligence artificielle) pour optimiser le diagnostic et le suivi des patients, particulièrement dans les zones sous-médicalisées.
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses associations accompagnent les patients et leurs familles dans leur parcours de soins et de réadaptation. Ces structures offrent un soutien précieux et des informations pratiques .
L'UNAFTC (Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés Crâniens) fédère 26 associations régionales. Elle propose des groupes de parole, des formations pour les aidants et un accompagnement juridique pour les démarches administratives.
La Fondation Paralysie Cérébrale finance la recherche et soutient les familles. Elle organise des colloques scientifiques et diffuse des informations actualisées sur les avancées thérapeutiques. Son site internet constitue une mine d'informations fiables.
Au niveau local, les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) orientent vers les dispositifs d'aide appropriés : allocation adulte handicapé, prestation de compensation du handicap, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé .
Les centres de rééducation spécialisés proposent des programmes adaptés aux traumatisés crâniens. Ces établissements disposent d'équipes pluridisciplinaires expérimentées et d'équipements de pointe pour optimiser la récupération.
N'oublions pas les ressources numériques : applications mobiles d'aide cognitive, forums de patients, webinaires d'information. Ces outils modernes complètent efficacement l'accompagnement traditionnel.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre avec un traumatisme du système nerveux ou accompagner un proche dans cette épreuve .
Pour les patients : Acceptez votre nouveau rythme. La fatigue cognitive est normale après un traumatisme crânien. Planifiez vos activités, faites des pauses régulières et n'hésitez pas à utiliser des aide-mémoires. Votre cerveau a besoin de temps pour récupérer.
Pour les familles : Informez-vous sur la pathologie pour mieux comprendre les difficultés de votre proche. Soyez patients face aux changements de comportement et aux troubles cognitifs. Votre soutien est essentiel, mais n'oubliez pas de prendre soin de vous aussi .
Côté pratique, organisez le domicile pour faciliter les déplacements : éclairage suffisant, suppression des obstacles, installation de barres d'appui si nécessaire. Un ergothérapeute peut vous conseiller gratuitement sur ces aménagements.
Maintenez une activité physique adaptée. La marche, la natation ou la gymnastique douce favorisent la récupération neurologique et améliorent l'humeur. Demandez conseil à votre kinésithérapeute pour choisir les exercices appropriés .
Enfin, restez connecté socialement. L'isolement aggrave les troubles cognitifs et la dépression. Participez aux activités des associations de patients, maintenez le contact avec vos amis, et n'hésitez pas à demander de l'aide quand vous en avez besoin.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous amener à consulter en urgence, même si le traumatisme initial semblait bénin. La règle d'or : en cas de doute, n'hésitez jamais [4].
Consultez immédiatement si vous observez : perte de connaissance même brève, vomissements répétés, maux de tête intenses et persistants, confusion ou désorientation, troubles de l'équilibre, convulsions, ou écoulement de sang ou de liquide par le nez ou les oreilles [4].
Chez l'enfant, soyez particulièrement vigilant aux signes suivants : somnolence inhabituelle, irritabilité, refus de s'alimenter, pleurs inconsolables, ou changement de comportement. Les enfants peuvent présenter des symptômes différents des adultes [4].
Pour un suivi à long terme, consultez votre médecin si vous ressentez : troubles persistants de la mémoire ou de la concentration, changements d'humeur ou de personnalité, maux de tête chroniques, troubles du sommeil, ou difficultés dans les activités quotidiennes .
N'attendez pas que les symptômes s'aggravent. Un traumatisme crânien peut avoir des conséquences retardées, parfois plusieurs semaines après l'accident. Votre médecin traitant saura vous orienter vers les spécialistes appropriés si nécessaire.
Bon à savoir : en cas d'urgence neurologique, appelez le 15 (SAMU) plutôt que de vous rendre directement aux urgences. Les équipes médicalisées peuvent commencer le traitement dès votre domicile et vous orienter vers l'hôpital le mieux équipé.
Questions Fréquentes
Peut-on guérir complètement d'un traumatisme crânien ?
La récupération dépend de la gravité initiale et de la précocité de la prise en charge. 60% des patients retrouvent une autonomie complète, et des améliorations sont possibles pendant des années grâce à la neuroplasticité.
Combien de temps dure la rééducation ?
Il n'y a pas de durée standard. Certains patients récupèrent en quelques mois, d'autres continuent à progresser pendant des années. L'important est de maintenir les efforts de rééducation même si les progrès semblent lents.
Les traumatismes légers sont-ils vraiment sans conséquence ?
Non, même une commotion apparemment bénigne peut avoir des répercussions durables. Le syndrome post-commotionnel peut persister plusieurs mois et nécessite un suivi médical.
Peut-on reprendre le sport après un traumatisme crânien ?
Cela dépend de la gravité des séquelles et du type de sport. Une évaluation médicale spécialisée est indispensable avant toute reprise d'activité sportive, surtout pour les sports de contact.
Les enfants récupèrent-ils mieux que les adultes ?
Généralement oui, grâce à la plasticité cérébrale plus importante chez l'enfant. Cependant, certaines lésions peuvent avoir des conséquences sur le développement cognitif à long terme.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Épidémiologie des accidents vasculaires cérébraux en France - Santé Publique France 2024-2025Lien
- [2] Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS) - HAS 2024-2025Lien
- [3] Épidémiologie des accidents vasculaires cérébraux en France - Santé Publique France 2024-2025Lien
- [4] Les maladies cardiovasculaires en France - Santé Publique France 2024-2025Lien
- [5] Suicides et tentatives de suicide - Santé Publique France 2024-2025Lien
- [6] Startups - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [7] Kevin Sheth, MD - Yale School of Medicine - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [8] Clinical Faculty by Section - Radiology & Biomedical Imaging - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [9] Neuropsychological impact of Sanda training on athlete - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [10] La dissociation: symptôme central des traumatismes complexes - Le grand livre du trauma complexe 2023Lien
- [11] Le stress et les soins tenant compte des traumatismes 2023Lien
- [12] Le Lifespan Integration ou ICV dans le traitement des traumatismes complexes 2023Lien
- [14] Traumatisme crânien: Intérêt du dosage de la protéine SIOOß dans la prise en charge 2022Lien
- [15] Le traumatisme psychique - Que sais-je? 2024Lien
- [18] Présentation des traumatismes crâniens - MSD ManualsLien
- [19] Douleur neuropathique - Troubles neurologiques - MSD ManualsLien
Publications scientifiques
- Chapitre 5. La dissociation: symptôme central des traumatismes complexes? (2023)
- [LIVRE][B] Le stress et les soins tenant compte des traumatismes (2023)[PDF]
- Chapitre 20. Le Lifespan Integration ou ICV dans le traitement des traumatismes complexes (2023)
- [HTML][HTML] Traumatismes relationnels précoces, capacité de mentalisation et caractéristiques du jeu chez les enfants ayant vécu de la maltraitance et issus de la … (2025)
- Traumatisme crânien: Intérêt du dosage de la protéine SIOOß dans la prise en charge. (2022)
Ressources web
- Présentation des traumatismes crâniens - Lésions et ... (msdmanuals.com)
Les symptômes fréquents de traumatismes crâniens mineurs peuvent comprendre des maux de tête et une sensation de vertige ou d'étourdissement. Certaines ...
- Douleur neuropathique - Troubles neurologiques (msdmanuals.com)
Le diagnostic est établi devant une douleur disproportionnée en regard de l'atteinte tissulaire, une dysesthésie (p. ex., des brûlures, des picotements) et des ...
- Troubles neurologiques fonctionnels (chuv.ch)
19 mars 2025 — Le Trouble Neurologique Fonctionnel (TNF) est une affection neurologique qui se manifeste par des symptômes comme la faiblesse musculaire, des ...
- Maladies neurologiques : comment se passe le diagnostic (deuxiemeavis.fr)
12 juil. 2021 — Consultez votre médecin dès les premiers symptômes. Faiblesse musculaire, maux de tête, troubles du sommeil, dérèglement des sens, tremblements, ...
- TRAUMATISMES ET MALADIES NEUROLOGIQUES (neurosciences.asso.fr)
Les médicaments antiépileptiques et antidépresseurs sont utiles principalement pour traiter les douleurs neuro- pathiques qui résultent d'une lésion ou blessure ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
